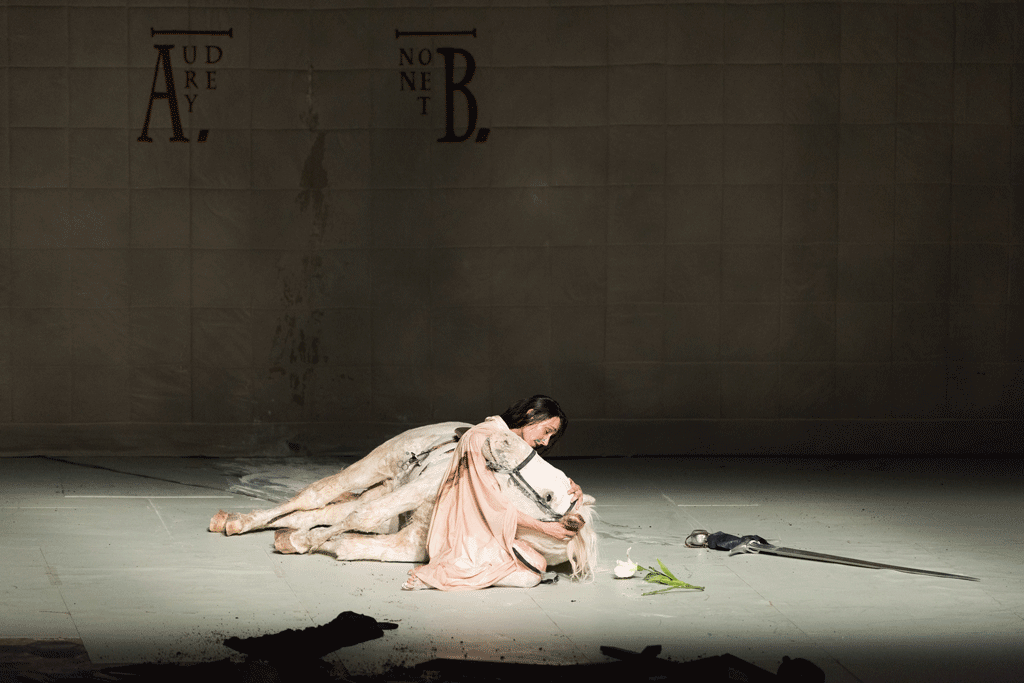Voir aussi la critique de David Verdier dans Wanderer
Après un magnifique Couronnement de Poppée de Klaus Michael Grüber, voilà la stupéfiante Elektra de Ruth Berghaus, je mets en avant les metteurs en scène et non les compositeurs, parce que la force de l’idée de ce festival « Mémoires », c’est la célébration de la mise en scène comme révélation d’une œuvre. En sortant de l’Elektra triomphale de Lyon, qui faisait renaître un spectacle né en 1984 à Dresde, aux temps de la DDR – é!ément déterminant – et disparu en 2009 en pleine santé, même si la production jouée près de 80 fois avait fait son temps à la Semperoper, se confirme l’idée qu’il y a des mises en scène qui sont des œuvres dont la puissance jamais ne s’éteint. Nous avons la chance avec Elektra d’être devant un opéra rarement médiocre musicalement, un peu plus souvent scéniquement.
Ce que nous montre Berghaus, c’est le Regietheater, dans sa grandeur brechtienne, avec son effet immédiat sur le public, y compris physique, et ce que nous montre le spectacle dans son ensemble, confié musicalement à Hartmut Haenchen qui créa la production à Dresde, c’est que le travail conjoint metteur en scène-chef d’orchestre, lorsqu’il est profondément lié à une construction conceptuelle partagée, aboutit au chef d’œuvre. On m’accusera sans doute de superlatifs inutiles et répétitifs, mais le spectacle que nous avons vu à Lyon dépasse tout ce que nous avons vu récemment en matière d’Elektra, et que le travail musico-scénique effectué place cette production (de 1984) au-delà de ce qui s’est fait depuis, y compris ce qui s’est fait de meilleur.
La direction de Hartmut Haenchen se place dans la lignée des Böhm, des Barenboim, des Abbado, nous sommes à un très haut niveau, fait de rigueur et de simplicité : on joue les notes, des notes qui se suffisent à elles-mêmes et qui ne sont pas surjouées : apparaît alors l’extraordinaire construction de la composition straussienne, sa subtilité, ses moments retenus, son lyrisme, son extrême raffinement : et l’orchestre de l’Opéra de Lyon a été mené au sommet par ce chef à la rigueur bien connue et à la disponibilité infinie envers les musiciens. Et on voyait le chef, au geste épuré, mobile mais pas trop, et en tous cas jamais spectaculaire, qui était l’autre personnage de l’œuvre, parce que la mise en scène de Berghaus fait de l’orchestre un personnage, un ensemble d’acteurs dans un dispositif de théâtre sur le théâtre, dans un dialogue visible avec les chanteurs, dont les modulations épousent celles de l’orchestre, qui jamais ne les couvre, dans un dispositif où, sur scène, chacun doit veiller à contrôler le volume. Les chanteurs la plupart du temps perchés sur le décor-plongeoir de Hans Dieter Schaal devaient à la fois jeter un œil sur le chef, plus bas, chanter vers la salle, et jouer dans un espace de quelques mètres carrés.
On aurait pu croire que le volume de l’orchestre aurait couvert et tout emporté comme un tsunami sonore : il n’en est rien et ce n’est pas là la moindre surprise que de voir l’énorme phalange réussir à maîtriser les volumes : on sait que c’est l’impossibilité de mettre tout l’orchestre en fosse à Dresde qui est à l’origine du dispositif scénique, et que sa reprise à Lyon a été suggérée par Hartmut Haenchen parce que la fosse de Lyon ne peut accueillir non plus Elektra en fosse. Le chef réussit à jouer sur les contrastes sonores, et sur le contrôle du son jusqu’au presque rien et à l’ineffable en ne faisant que ce qui est écrit, sans jamais chercher l’effet. L’orchestre de l’Opéra de Lyon dans cette production n’a rien à envier à d’autres phalanges plus prestigieuses, ou médiatiquement plus favorisées. C’est un travail de joaillerie époustouflante qu’a effectué Hartmut Haenchen, et en même temps un travail d’une rare « objectivité », quelque chose de la Neue Sachlichkeit de la fin des années vingt (encore les années Brecht), une entreprise qui projette l’œuvre de Strauss dans son futur et puisque Haenchen lui-même déclare qu’Elektra est l’irruption e Strauss dans la musique contemporaine : nous sommes aux antipodes d’une direction narcissique, qui ferait du son pour le son, qui nous montrerait le chef au miroir de son ego. Il y a là les notes, dans leur sécheresse et jamais sèches, prodigieusement tendues, et il y a là volonté de ne rien « surfaire », et tout aboutit à une multiplication de la tension, un peu comme le chef Hermann Scherchen mettait les salles à genoux par un Boléro de Ravel métronomique et sans autre effet que l’exécution des notes dans leur agencement sans jamais accélérer les tempi ou le volume. Haenchen impose une Elektra autosuffisante, dans un dispositif scénique où les musiciens deviennent des profils d’une œuvre et non des outils pour l’œuvre.

Le dispositif scénique donne la première place à l’orchestre, masse imposante à vue qui s’interpose entre le spectateur et les chanteurs qui émergent de la mer des instruments: les rares fois où les chanteurs chantent au bas du décor ils sont derrière l’orchestre et deviennent des ombres dont le chant est étouffé par la masse, voire disparaissent dans l’anonymat de l’orchestre, et là aussi, le jeu scène-orchestre est impressionnant. C’est bien cette articulation entre le dispositif scénique et ses exigences en arrière-plan, devant un cyclorama, avec l’orchestre au premier plan, qui produit un effet inattendu, et sans doute voulu celui d’un orchestre accompagnant un film muet.. Le cyclo derrière le décor, le jeu des ombres, les mouvements et les gestes même des chanteurs (Clytemnestre !) rappellent en effet les films expressionnistes muets (un comble dans une œuvre à l’énorme volume sonore): le monde même qui a vu naître la vocation de Bertolt Brecht.
Car le travail de Ruth Berghaus, reconstitué par Katharina Lang (Staatsoper Berlin), est un travail multipolaire, qui s’intéresse à l’histoire d’Elektra, qui s’interroge sur le sens du mythe, en 1984 en République Démocratique Allemande, dans une Allemagne encore séparée en deux, où les créateurs de l’Est commencent à travailler (ou émigrer) à l’Ouest.
Berghaus a fait quatre Elektra : à la Staatsoper de Berlin (appelée alors Deutsche Staatsoper) en 1971, puis à Mannheim en 1980. A Dresde en 1984, le théâtre de l’Est au plus grand prestige qui avait vu naître l’Elektra de Strauss accueille celle est alors l’une des stars de la mise en scène, déjà accueillie à l’ouest et toujours contestée, qui a dirigé le Berliner Ensemble à la mort d’Hélène Weigel en 1971, et qui depuis 1980 travaille aussi à l’ouest, puisqu’elle n’a plus de charges officielles en DDR. C’est Ruth Berghaus qui commence à mettre en scène les textes de cet autre auteur de la DDR qu’est Heiner Müller. En 1984, elle s’intéresse désormais uniquement à l’opéra, elle qui fut d’abord chorégraphe, puis metteur en scène de théâtre. Elle fera une dernière Elektra à Zürich en 1991.
Mais la production de Dresde reste sans doute la plus marquante, à cause de la solution scénique globale qu’elle adopte avec Hans Dieter Schaal, le décorateur qui va travailler avec elle sur une dizaine de productions, une solution originale et impressionnante, percher les chanteurs sur un plongeoir en béton, mettre l’orchestre en dessous comme une « mer musicale », un plongeoir qui est en même temps une sorte de tour de guet où veille jalousement une Elektra chienne de garde dont c’est le domaine.
Quand le rideau se lèvre, très lentement, et fait découvrir les pieds, puis les jambes des musiciens assis, puis l’orchestre dans son ensemble puis le plongeoir sur toute la hauteur de scène (de fait les surtitres sont latéraux), l’image est déjà impressionnante en soi, puis saisissante lorsqu’on voit les servantes chassant les mouches d’un lieu encore malgré le temps passé baigné des remugles sanglants du meurtre d’Agamemnon : ce plongeoir, c’est le lieu de l’assassinat. On sait en effet qu’Agamemnon est tué dans son bain. Et du bain au plongeoir, il n’y a qu’une logique brechtienne à interpeller. La construction de béton est abandonnée, avec son armée de servantes qui chassent les mouches d’un espace, devenu tombeau abandonné, le Tatort, lieu du crime auquel Elektra s’accroche et qu’elle protège, installée et attachée par des cordes, comme un chien, et réfugiée dans le coin droit, seul endroit sans rambarde, où le béton est brisé dont on imagine bien que c’est là que le crime a eu lieu. Cet appendice de béton donnant sur le vide, c’est son espace, elle y monte et elle s’y couche, comme le chien sur la tombe de son maître, c’est ainsi couchée, regardant sa mère Clytemnestre perchée en haut du décor que débutera leur dialogue.
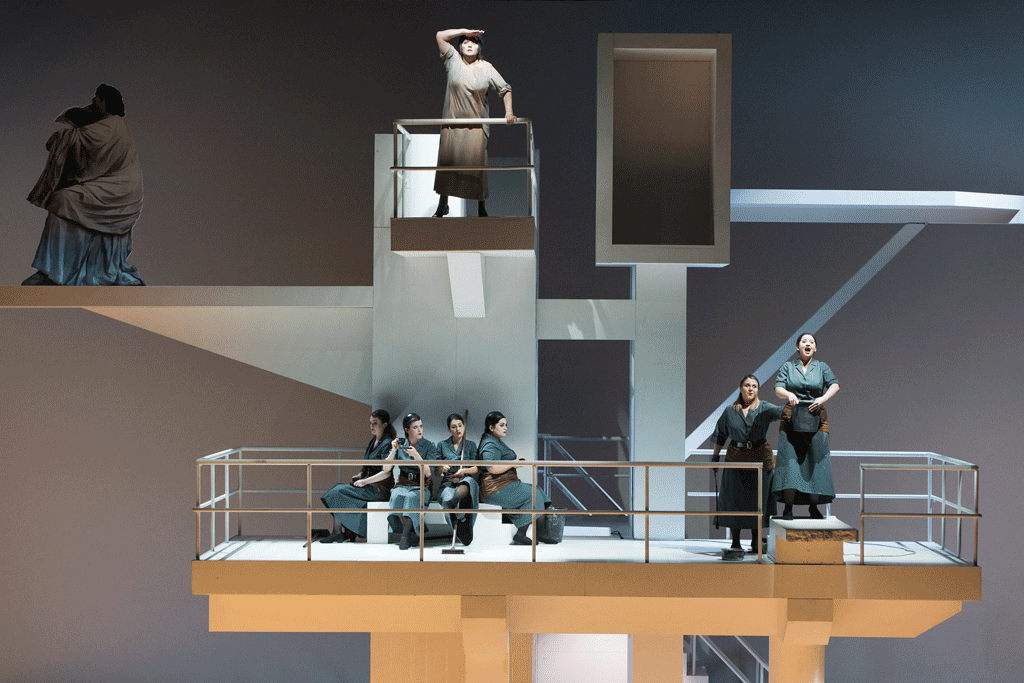
Lorsque les servantes dans la première scène l’évoquent sans aménité, elle erre entre elles, presque l’une d’elles, en robe grise, pendant que le spectateur observe en haut à gauche une silhouette qu’on pourrait croire prête à intervenir, qui est une représentation d’Elektra, une statue acrotère d’un temple, accrochée en position d’amazone, comme si elle était en fuite. Cette image fixe accentue le sens désespéré de l’histoire : elle évolue au premier niveau, sur une plateforme de quelques mètres carrés qu’elle ne peut parcourir puisqu’elle est attachée ;mais au deuxième niveau, il y a une sorte de vigie centrale et cette image d’Elektra fuyant, fixe un mouvement immobile, celui d’Elektra, l’héroïne impuissante qui fait tout faire par les autres (Oreste, Chrysothémis).
Peu d’outils, aucun élément anecdotique, mais seulement du symbolique : Clytemnestre aux cheveux roux, vaguement sorcière avec son long sceptre-bâton qu’elle va ficher dans la niche centrale du décor, en réalité le sceptre d’Agamemnon, rappelant ainsi le rêve que Chrysothémis raconte à sa sœur dans la tragédie de Sophocle : On dit que Clytemnestre aurait vu notre père à nous deux reparaître devant elle et qu’il aurait planté dans notre foyer le sceptre qu’il portait jadis, avant qu’Égisthe le lui eût pris. De ce sceptre alors aurait jailli une jeune pousse capable de couvrir à elle seule de son ombre toute la terre de Mycènes. Tel est le récit que je tiens d’un homme qui se trouvait là lorsqu’elle exposait son rêve au Soleil. (Le récit existe aussi chez Euripide).
Ce geste spectaculaire de Clytemnestre, qui plante le sceptre dans la niche, intervient juste avant qu’elle ne descende de sa vigie pour entamer son monologue Ich habe keine gute Nächte. Ce geste va faire de ce long sceptre le regard d’Agamemnon sur toute l’œuvre, qui s’éclairera une fois le double meurtre accompli. Autre détail : la hache qu’Elektra cherche est figurée par une pièce de bois rectangulaire, rouge comme le sang, comme le couvercle ensanglanté d’une cache.
Quand Oreste arrive il est vêtu dans le même gris que sa sœur, dans la fraternité terrible unie dans la vengeance et dans le sang..
Nous sommes dans un univers symbolique, distancié, un univers vaguement effrayant avec ses ombres portées, avec ses éclairages (magnifiques) de Ulrich Niepel, très mobiles qui changent de couleur, qui sont tour à tour crus ou chauds, et qui rendent le spectacle fascinant, comme la coloration écarlate du cyclo à la fin, quand le sang de nouveau a coulé dans le palais d’Agamemnon et que tout est accompli.
Mais nous sommes aussi dans un univers où tout obéit au livret de Hofmannsthal, sans aucune initiative qui en transformerait le sens. La scène initiale des servantes, dont la conversation porte sur Elektra, clairement comparée soit à un chat sauvage au début puis à la fin comme une chienne, se termine par une sorte de rituel où deux servantes lui enfilent un manteau-camisole, qui dissimule son corps et ses mains, c’est ce manteau qui est attaché, comme si enfiler le manteau lui donnait après la scène des servantes, le rôle théâtral qu’elle doit jouer et qu’on veut qu’elle joue, comme si Elektra jouait un rituel au quotidien, entrait en scène au quotidien pour jouer son rôle de chienne attachée à sa niche-tombeau, comme si seule l’animalité pouvait la qualifier. D’ailleurs, dès qu’Oreste a accompli ce qu’il doit, elle se libère et abandonne son manteau. Cette ritualisation renvoie Elektra et l’ensemble des Atrides à une composition huilée où les costumes (de Marie-Luise Strandt) fixent les fonctions : Elektra et Oreste en gris, de ce gris même du cyclo, Chrysothémis en jaune (chryso…en or), et Clytemnestre en rouge, mais d’un rouge jamais éclatant, couleur de sang séché, avec cette longue étole dont Elektra va s’envelopper, comme si elle s’enveloppait dule sang paternel . On reconnaît bien là l’approche déictique et didactique chère à Brecht.

Autre élément de fidélité à Hofmannsthal, le rire de Clytemnestre à la fin de l’entrevue avec Elektra est l’un des plus longs et des plus spectaculaires qu’on ait entendus (Et Lioba Braun s’en donne à cœur joie), mais nous sommes aussi dans un univers où Elektra se donne toujours à voir, perchée au-dessus du volcan ou de l’océan sonore comme rappel de l’inexorable. Dernier élément hautement symbolique, qui apparaît à la scène finale, pendant qu’Elektra meurt enveloppée du manteau d’Egisthe, Oreste et Chrysothémis guettent quelque chose au loin, comme si le drame qui venait d’exploser en son moment paroxystique annonçait une suite, comme si alors ce plongeoir qui était mémoire et exclusivement mémoire devenait cette tour de guet où l’on guette un futur qui ne vient pas (à la manière du Rivage des Syrtes, de Julien Gracq), subtil moyen pour Berghaus de souligner la période, l’avenir incertain des républiques du bloc oriental, et l’attente anxieuse de la suite (nous sommes cinq ans avant la chute du mur). Oreste ne cessera de guetter de haut en bas du décor, avant de disparaître, guetteur vain d’un monde incertain.
Comme on le voit, comme sur ce plongeoir il y a plusieurs étages et plusieurs niveaux, il y a plusieurs éléments qui s’imbriquent. De la libération mortifère d’Elektra à une libération aux contours incertains, qu’on attend et qu’on ne voit pas venir.
J’ai d’abord voulu évoquer la performance époustouflante de l’orchestre, puis la mise en scène, parce que l’orchestre en scène devient le foyer sur lequel se concentrent les regards et le fonctionnement du spectacle : ce spectacle prodigieux exige une direction aussi austère que le dispositif scénique, sans volutes, une direction qui sans jamais être plate ou sans âme, vibre de la seule force d’une musique déchainée qui quasiment fait naître ou surgir le drame sans jamais seulement l’accompagner. Tel est le travail de Haenchen.

A ce couple chef-mise en scène répond l’engagement d’une distribution vraiment exceptionnelle par son intelligence : dans une œuvre où on a souvent l’impression qu’il suffit de voix énormes pour que tout passe, c’est l’inverse qui se produit, tout passe parce que les voix d’abord chantent et souvent subtilement.
C’est bien là la surprise de la soirée. On s’attendait à un ouragan sonore, et on a le son, sans l’ouragan. Une prosopopée du son qui se dresse devant nous et qui nous fascine, nous implique totalement, tant le texte, tant les subtilités de la partition nous atteignent en direct, droit au but. Ce travail sur le texte, c’est évidemment la direction musicale qui le détermine, parce qu’elle veille avec rigueur et précision pointilliste à ce que les chanteurs ne soient jamais couverts, malgré l’écran orchestral au premier plan. Bien sûr, la position élevée des chanteurs le permet, mais l’impression qui ressort est bien un travail de projection particulièrement élaboré.
Déjà, les servantes, qui bougent de haut en bas, s’entendent chacune avec un timbre et un volume particulier, et la cinquième servante, la plus jeune et la seule qui défende l’héroïne, avec un regard qui rappelle celui de Kundry vers Parsifal « Ich will die Füße ihr salben und mit meinem Haar sie trocknen », est d’ailleurs très crânement chanté par Marianne Croux. Voix claire, haute, magnifiquement projetée du haut même où Elektra veille habituellement.
Les rôles de complément, le précepteur d’Oreste (Bernd Hofmann), jeune et vieux serviteur (respectivement Patrick Grahl et Paul Henry Vila) s’insèrent de manière fluide dans le flot sonore et toutes les servantes, dans ce chœur très diversifié soit dans l’expression soit dans le volume n’appellent aucune remarque. Thomas Piffka dans Egisthe a la voix un peu abîmée qui convient, mais on y aimerait pour ces courtes interventions plus de caractère et plus de manière, on aimerait un chant grinçant, on a un chant sans âme. L’Oreste de Thomas Fischesser est remarquable : son timbre clair et chaud, à la couleur juvénile, la projection impeccable, la diction et l’articulation exemplaires font de son intervention et notamment son duo avec Elektra un moment clé, tant les deux voix se répondent, entre l’urgence (Elektra) de l’une et l’étrange sérénité de l’autre. On se souviendra aussi longtemps de la manière lente dont il s’éloigne, traversant comme suspendu et étranger les transes des deux sœurs et l’agitation des servantes et de l’orchestre déchainé, et disparaissant lentement tantôt dans la lumière et tantôt dans l’ombre, en guettant on ne sait quoi dans une fixité hallucinée.

La Clytemnestre de Lioba Braun secoue aussi le spectateur, d’abord par ses cris bestiaux au moment où Oreste la frappe, mais aussi par son rire convulsif à la fin de la scène avec Elektra : elle a su rendre parfaitement l’errance du personnage entre humanité et bestialité, entre tension angoissée et recherche désespérée d’apaisement. Lioba Braun est une vieille connaissance de la scène allemande, une de ses artistes qui n’a jamais été de premier plan, même si elle a chanté un peu partout les grands rôles du répertoire, dont Brangäne dans production Heiner Müller/Barenboim à Bayreuth, mais toujours solide, toujours sans reproche, incarnant toujours de manière intéressante les personnages (je me souviens d’une Kundry frappante). Elle a d’ailleurs dans Clytemnestre la sauvagerie et la douleur d’une Kundry vieillissante : elle sculpte chaque mot, distille chaque expression, et utilise une voix « qui fut » mais qui n’est plus tout à fait, de la manière merveilleuse et prodigieuse des grandes dames du chant dont la technique et l’intelligence supplée aux inévitables problèmes d’usure. Son spectre vocal, qui va du contralto au soprano (Kundry, Brangäne, Eboli, Marschallin et même Isolde), lui permet des ruptures de ton, des changements de registres brutaux, une expressivité audacieuse qu’on n’entend pas toujours dans ce rôle. Elle la joue expressionniste : une artiste à la Edvard Munch. Impressionnante.
Katrin Kapplusch, en troupe à Essen, chante les sopranos dramatiques, de Lady Macbeth à Turandot, de Tosca à Rusalka. Elle campe une intense Chrysothemis, particulièrement à l’aigu qu’elle soutient avec force et grande justesse de ton.
Il lui manque peut-être un peu d’homogénéité dans la voix, notamment les centres et les passages, pas toujours bien négociés, mais l’engagement et la présence sont tels, les aigus (dans la scène finale) sont tellement bien projetés et épanouis qu’on oublie les quelques menus problèmes techniques de ligne de chant. C’est l’intensité qu’on retient, et la présence et aussi l’émotion.

J’ai suffisamment dans ce blog émis des réserves sur Elena Pankratova, à qui je reprochais un chant puissant, au volume immense, mais sans subtilité ni autre intérêt que le volume, pour saluer aujourd’hui sans réserve une performance exceptionnelle. D’abord, elle a le physique exact de Birgit Nilsson ce qui dans le rôle campe un profil ! Elle n’en a pas la voix, mais elle en a la présence.
Ce qui surprend, c’est que là où l’on s’attendait à du volume, on a une incroyable variété de tons, d’approches, d’expressions. Le travail avec le chef sur le texte, la manière dont l’orchestre soutient, fait que jamais on a entendu Pankratova aussi fragile d’une certaine manière, aussi contrastée, aussi colorée. Son Elektra a une sorte de grandeur tragique dans sa fixation obsessionnelle, dans son rôle de chienne enchaînée, et en même temps dans son extrême fragilité, qu’elle sait rendre dans sa voix que j’ai rarement entendue aussi diversifiée dans l’expression. Si les aigus sont bien là, mais pas aussi puissants qu’on pourrait penser, il y a surtout tout le reste et c’est le reste qui est passionnant. Elle est tour à tour butée, émouvante, terrible, bourreau et victime. On a entendu de très grandes Elektra à commencer par Herlitzius, ou Polaski, ou Behrens et bien sûr Nilsson ; Elena Pankratova se place dans cette lignée : c’est une très grande performance qu’elle a offerte au public lyonnais.
Au sortir de ce spectacle, on ne peut que souligner l’extraordinaire travail d’une Berghaus visionnaire, qui projette à la face du spectateur une complexité qui n’a d’écho que dans la complexité sonore illustrée par la direction musicale, dans un système allégorique qui révèle en même temps la puissance du mythe, qui ne cesse de renaître, quels que soient les temps. Ces gens qui guettent angoissés le futur forcément noir d’un monde tragique, c’étaient les habitants de la DDR en 1984, et aujourd’hui, c’est évidemment nous, au bord du plongeoir d’où nous risquons de chuter. [wpsr_facebook]