
Ce Pelléas était très attendu.
La popularité d’Esa-Pekka Salonen dans le monde musical et chez les critiques faisait que la présence du chef finlandais avait un air d’événement, d’autant que la distribution était attirante, tout autant que la mise en scène de Katie Mitchell, très en faveur à Aix-en-Provence où depuis d’arrivée de Bernard Focroulle, elle a signé plusieurs mises en scène plutôt bien accueillies. Le triomphe est total. Le public et la presse ont accueilli ce travail de manière éminemment positive.
À une quinzaine de jours de la Première à laquelle j’ai eu la chance d’assister, le recul salutaire va permettre sans doute, pour chacune des productions de cette cuvée 2016 du Festival d’Aix, de se faire une idée moins immédiate et plus réfléchie, peut-être aussi plus pondérée.
Il est heureux de constater la fortune actuelle du Pelléas et Mélisande de Debussy, considéré comme un de ces chefs d’œuvres à l’accès difficile. Cette saison, il y a à peine un mois, c’était à Zurich la production de Dmitri Tcherniakov dirigée par Alain Altinoglu, la saison dernière, c’était Daniele Abbado à Florence qui mettait en scène aux côtés de Daniele Gatti ou Constantinos Carydis qui dirigeait la production de Christiane Pohle en ouverture du Festival de Munich 2015.
Pour beaucoup d’amateurs d’opéra, Pelléas est une œuvre qu’on apprécie après avoir vu toutes les autres. Pour certains, on commence par Wagner et on finit par Debussy. Pour d’autres au contraire, on commence par Debussy et on finit par Wagner. Le lien de Debussy à Wagner est en effet très fort, un « je t’aime moi non plus » fait de refus, mais aussi de citations presque textuelles (Parsifal dans Pelléas par exemple). Pelléas et Mélisande appartient à un moment où le monde intellectuel français littéraire ou musical courait à Bayreuth. C’est évidemment une œuvre qui se confronte à Tristan und Isolde, autre histoire de couple, autre version des relations entre Eros et Thanatos. D’ailleurs, le décor monumental de Lizzie Clachan à Aix n’est pas sans rappeler dans son organisation même celui de Boris Kudlička à Baden-Baden, avec deux niveaux, un escalier métallique à Jardin, plongeant vers les ténèbres, et des espaces contigus et changeants. Car c’est bien ce décor imposant qui frappe durablement, au point d’être ce qui reste de la mise en scène après deux semaines, si imposant qu’il nécessite une armée de machinistes pour le transformer pendant les intermèdes (qui viennent tous saluer de manière pleinement justifiée à la fin). Ce décor est celui d’une maison de poupée en coupe, rappelant celui de Written on Skin ou Alcina par sa structure, avec ses chambres et ses espaces, isolant chaque scène, lui donnant un contexte particulier avec comme climax les scènes de la piscine intérieure vidée, hyperréaliste, avec la vision de la nature à l’extérieur, mais laissant les personnages derrière une verrière étouffante pour les scènes qui sont parmi les plus célèbres de l’œuvre (les scènes de fontaine). Le décor d’ailleurs réussit à être hyperréaliste et onirique à la fois, implantant une ambiance surannée, temporellement si marquée qu’elle en devient intemporelle, voire étouffante.
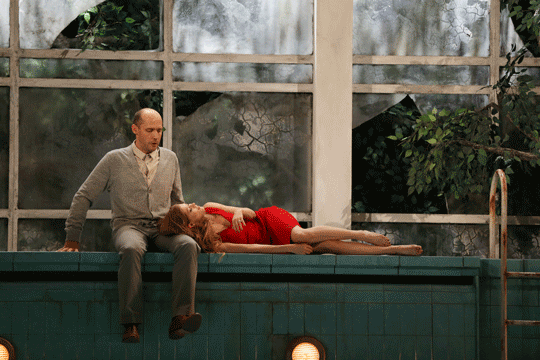
Comment rendre le mystère de Pelléas et Mélisande, une histoire en soi banale : un mariage plus ou moins forcé, un amour naissant hors mariage, un jaloux mal aimé. Une histoire qui rappelle beaucoup par son étrangeté La Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, notamment à travers le personnage du Prince de Clèves, bien proche de Golaud. L’atmosphère de mystère et d’étrangeté qui entoure la princesse (voir la scène du tableau et de la canne des indes observée de l’extérieur par un Nemours dévoré par le désir) me rappelle celle qui entoure Mélisande, étrangère au monde, venue de nulle part et dont la présence détruit la grise routine familiale, comme Dmitri Tcherniakov l’a si bien montré à Zürich.
Pour expliquer ce mystère et cette atmosphère et justifier d’une dramaturgie à ellipses, Katie Mitchell et son dramaturge Martin Crimp choisissent de faire du drame un rêve (prémonitoire) de Mélisande, à peine revenue de son mariage avec Golaud (elle est en robe de mariée), un mariage contraint générateur d’angoisse qui explique un rêve pour le moins tendu, mais référencé fortement à l’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, sauf que de merveilles, il y en aura peu dans ce rêve. C’est un choix dramaturgique cependant assez commun, on ne compte plus sur les scènes les rêves de personnages qui expliquent une action dramatique. Sans la référence à Lewis Carroll, on tout aussi bien pu concevoir un rêve de Golaud pris par le désir de possession, ou de Pelléas pris par celui d‘échapper à l’étouffement familial. Étouffement que l’on perçoit par des signes évidents dans la première partie, notamment à travers le personnage de Pelléas, engoncé, fagoté en « petit vieux » avant l’âge, un vieil enfant rempli de tics et de mouvements brusques, magistralement rendus par Stéphane Degout dont c’est hélas le dernier Pelléas.
Atmosphère pesante aussi à table, avec la vision d’un repas familial silencieux et raide. Bien sûr on pense aussi à l’atmosphère familiale de la production de Tcherniakov, mais le cadre de la maison, moderne, « design », ouverte, n’a rien à voir et de produit pas la même impression : les couleurs du décor, vert passé, le style de l’ameublement du premier XXème siècle, les éclairages pâles et timides, tout concourt à donner l’impression d’une maison où le temps s’est arrêté, qui génère un ennui abyssal, et un désir de respirer. Chaque scène est un espace clos vieillot, chambre à coucher, salle à manger, piscine même, et les circulations sont étroites (escalier en colimaçon).C’est aussi un espace envahi par le rêve, avec cet arbre qui prolifère dans la chambre, ou la terre, C’est vraiment le décor qui donne l’ambiance.
Katie Mitchell fait évoluer ses personnages dans cet espace hyperdétaillé. Il y a d’ailleurs plus de travail sur les personnages que sur la dramaturgie proprement dite. Au centre, la Mélisande de Barbara Hannigan, comme si la mise en scène était construite sur mesure pour elle, une femme déjà mûre, qui n’a rien du petit oiseau fragile qu’on a pu voir ailleurs (Tcherniakov par exemple), qui parcourt tout l’espace en regardant toutes les scènes, ou se regardant (elle regarde souvent son double), dedans et dehors comme dans les rêves. Hannigan avec son art suprême du mouvement et sa manière de gymnaste de se relever quand elle est allongée face contre terre, avec sa grâce et avec son corps qui se construit et tout à la fois se déconstruit, rend une Mélisande présente, mais met au centre le drame d’une femme assez manœuvrière et manipulatrice dont l’innocence et la fragilité se discutent fortement. Tout cela est magistral de la part de la chanteuse, mais n’ajoute rien à la lecture ou au sens de l’œuvre. Tcherniakov avec le même présupposé était pour mon goût plus convaincant.
Du même coup, la première partie m’est apparue quelquefois distante et vaguement ennuyeuse, sauf la scène prodigieuse du petit Yniold (Chloé Briot, très fraîche) et de Golaud forçant à regarder par la lucarne.

La deuxième partie plus dramatique et plus tendue par nature permet de relever l’intérêt avec des moments particulièrement bien construits entre les personnages : par exemple la scène où Golaud et Arkel saisissent Mélisande sur la table, ou les scènes sur le lit entre Golaud et Pelléas, ainsi que la scène sacrificielle où Golaud égorge Pelléas comme Abraham son fils (laissant supposer par le choix de la mort une préméditation). Scènes très tendues, très fortes, qui laissent une durable impression.
Comme on le voit, Katie Mitchell sait rendre l’atmosphère pesante, et sait conduire un travail d’acteur particulièrement détaillé, mais le propos général reste moins convaincant. Il y a certes du mystère et de la poésie, mais cela s’inscrit dans une atmosphère de drame familial au total assez banal. Quand Mélisande entre dans cette famille, cette dernière est déjà en déliquescence, au bord du gouffre et Mélisande n’est que la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Chez Tcherniakov, c’était la présence même de Mélisande comme révélateur qui déclenchait le processus délétère de destruction familiale de l’intérieur… Aussi le travail de Katie Mitchell, précis, intéressant parce que le rêve permet de développer plusieurs points de vue et de conjuguer vraisemblances et invraisemblances, ne me semble pas rendre compte de toutes les ambiguïtés de l’œuvre. Un travail onirico-réaliste, et en ce sens même acrobatique. Mais on a envie de dire : et après ?

Elle est servie, et c’est son immense chance, par une distribution particulièrement engagée et qui semble partager le point de vue qu’elle exprime. Chacun est un chanteur acteur de très grand niveau, la Geneviève à la fois discrète et timide de Sylvie Brunet-Grupposo, dont la lecture de la lettre est un modèle de parlar-cantando contrôlé, naturel et sans prétention ni théâtralité excessive, l’Arkel monumental de Franz-Josef Selig, patriarche lui aussi bousculé par les manipulations de Mélisande, le Golaud de Laurent Naouri, toujours magistral, avec son faux air de Butler, qui réussit à chanter le texte sur le ton de la conversation, avec un naturel confondant, à la fois distancié et impliqué. Ce que réussit Katie Mitchell, grâce aux éminentes qualités de cette distribution, c’est de faire de chaque personnage ou presque un Janus bi-face, avec une face au monde et une face cachée, face externe et interne. Et Naouri est ici un chanteur exceptionnel d’intelligence, intérieur, retenu, mais en même temps ravagé, avec un sens rêvé du texte et de l’expression et une diction modèle.
Stéphane Degout est Pelléas depuis plus de cinquante fois. C’est d’abord un Pelléas musicien avec un sens du texte exceptionnel, dont il réussit à exprimer les moindres nuances, les moindres inflexions, de la douceur à la violence, de la tendresse à la tension, de l’innocence au désir, la diction est éblouissante (une qualité largement partagée par l’ensemble du plateau d’ailleurs), elle atteint le stade de la perfection quand elle s’allie à une telle expressivité, c’est une diction théâtrale presque avant que d’être musicale. Et puis il y a le personnage, merveilleusement conduit dans son évolution, depuis le Pelléas engoncé, plein de tics, étouffé et timide du début, celui soumis au « paterfamilias » Arkel, qui ne va pas voir Marcellus mourant, paralysé par la maladie paternelle et par l’interdiction d’Arkel, au Pelléas plus accompli par l’amour de la deuxième partie, plus ouvert et plus libre.
Justement, l’Arkel de Franz-Josef Selig joue vraiment le « Paterfamilias », aux mouvements calculés, plus souvent assis à la table à « présider » comme un Arkel « commandeur ». La diction est soignée, l’expression bien contrôlée, ainsi que la projection, avec un langage clair, qui exprime l’autorité et qui n’empêche pas le feu intérieur qui s’allume au contact de cette Mélisande volontairement perturbatrice. Un Arkel lui aussi Janus, aux limites de son contrôle sur lui-même. Belle composition de Chloé Briot en Yniold chantant en équilibre instable sur une échelle, même si je préfère les Yniold interprétés par de jeunes garçons (le magnifique enfant du Tölzer Knabenchor à Zürich). Quant à Thomas Dear, il prête un beau timbre, très présent, à la figure fugace du médecin.
Dans ce monde un peu paralysé, vaguement fossilisé, Mélisande a évidemment le statut d’élément perturbateur : elle est la femme, plus mûre mais encore jeune, d’une séduction presque animale. Elle n’a rien de l’oiseau fragile dont le texte parle. En scène elle est affirmée, notamment lorsqu’elle porte cette robe rouge-vermillon, couleur de la passion, qui l’isole par rapport aux teintes pastel presque effacées ambiantes. Aucun des costumes des autres ne possède cette agressivité. La présence scénique d’Hannigan fait le reste, un oiseau (de proie ?) sensuel et mûr vaguement destructeur. Comme toujours son chant peut diviser : sa diction, peut-être d’un souffle moins parfaite que celle de ses partenaires lui donne justement un souffle d’étrangeté et d’absence, mais l’expression est décidée, le ton est affirmé, la voix est merveilleusement placée à tous les degrés du registre et magnifiquement expressive par de multiples modulations. Je la préfère néanmoins dans la Marie manipulée de Die Soldaten à Munich que dans cette Mélisande manipulatrice où elle est néanmoins admirable. Peut-être aussi est-ce d’ailleurs la nouveauté du personnage qui me trouble. En tous cas, et c’est la magie des festivals, je ne vois pas quelle autre chanteuse pourrait incarner Mélisande dans cette production si elle entrait dans le répertoire d’un théâtre. C’est une production construite pour elle et autour d’elle, c’est sa grandeur et aussi sa faiblesse que d’être un Pelléas et Mélisande-Hannigan plutôt qu’un Pelléas et Mélisande.
On attendait aussi beaucoup, comme je l’ai écrit au début, de la direction d’Esa-Pekka Salonen particulièrement adapté aux œuvres de la première moitié du XXème siècle, dans une œuvre qui a priori est faite pour lui et qu’il connaît sur le bout des ongles, d’autant qu’il y dirigeait son Philharmonia Orchestra.
J’avoue avoir été moins sensible à son travail qu’en d’autres occasions. On a plusieurs manières d’aborder Pelléas, une manière impressionniste, miroitante, relevant chaque son en faisant une sorte de multiplication de reflets diamantesques : c’était le cas jadis d’Abbado, qui savait cependant, en immense chef de théâtre qu’il était, accompagner le drame et donner de la tension. Ce fut aussi le cas de Gatti à Florence, qui avec une incroyable clarté, révélait l’ensemble des secrets de la partition, dans des conditions acoustiques difficiles, mais rendant chatoyant et riche de tous ses reflets un texte musical imprégné de l’ambiance littéraire de la période et pas seulement de Maeterlinck. Maazel jadis à Paris (avec Jorge Lavelli, Frederica Von Stade, Richard Stillwell et Gabriel Bacquier) avait su conjuguer l’onirique, le poétique et de dramatique. C’est à lui que je dois mon amour pour cette œuvre que je regardais avec distance dans ma prime jeunesse, tout occupé à découvrir Wagner. J’aime les directions musicales qui illuminent et qui éclairent tous les détails de ma mosaïque debussyste, faite de tesselles orientées différemment, tout à la fois ombres et lumières, et qui néanmoins savent créer tension et drame.
Je n’ai pas trouvé tant de tension dans l’accompagnement musical du drame surtout dans un première partie que j’ai trouvée trop linéaire. Certes, on peut dire que Salonen suit en cela la mise en scène, dans sa continuité et sa fluidité dramatique qui passe de scène en scène comme un regard presque extérieur au drame (celui de la Mélisande rêvant). J’ai écrit linéaire, je devrais dire lisse, trop lisse, sans aspérités, et avec une discrétion étonnante qui fait qu’à certains moments on n’entend peu l’orchestre. Un parti pris de discrétion qui me perturbe parce que je n’y entend plus les chatoyances, les différences de couleurs, les ruptures aussi, mais une sorte d’uniformité.
Certes, la deuxième partie plus dramatique donne un peu plus de relief à l’ensemble, mais sans jamais être abrupt, ou brutal. Ce parti-pris me paraît courir le risque de ne pas rendre justice à l’œuvre, de ne pas lui rendre sa profondeur, au profit d’une certaine fadeur, de la couleur un peu passée du décor, un son lointain et quelquefois indifférent.
J’entends bien que le parti-pris scénique, un rêve qu’on regarde, contribue à éloigner, et peut induire le chef à proposer un son sans le son, une sorte de second degré, de vision derrière la vision et donc éloigner le choc direct, j’entends bien – pour le défendre à chaque fois- que le chef et le metteur en scène ne peuvent jouer des partitions différentes, mais j’avoue avoir quelque peu regretté un relief qui me paraît si indispensable ici.
Indiscutablement cette production interroge et ce n’est pas la seule du festival (on le verra bientôt avec Cosi fan tutte). C’est intéressant de proposer un Pelléas et Mélisande d’un « réalisme onirique » qui a incontestablement trouvé un ton. Pourtant, malgré l’excellence de la distribution et sa justesse de ton, je suis resté un peu sur ma faim.
Il y a un mois, j’étais à Zürich pour un autre Pelléas et Mélisande, dirigé par Alain Altinoglu et mis en scène par Dmitri Tcherniakov, qui proposait lui aussi une vision de famille en déliquescence, mais avec une violence inouïe et inédite dans cette œuvre (magistral Golaud de Kyle Ketelsen, imposante Geneviève d’Yvonne Naef et incroyable Arkel de Brindley Sherratt) que relayait dans la fosse un Alain Altinoglu original et poignant, très expressionniste (certains ont dit puccinien), plein de couleurs et de tensions, de contrastes, de dynamique, très surprenant dans sa manière d’emprunter une voie inédite. J’ai préféré ce Pelléas coup de poing, ou le Pelléas suspendu et ailleurs de Christophe Honoré à Lyon, plutôt que ce goût amer et lointain laissé par le travail de Katie Mitchell, au contact d’artistes admirables, nous laissant des images souvent belles, mais ni le cœur lacéré, ni l’âme en capilotade. [wpsr_facebook]






