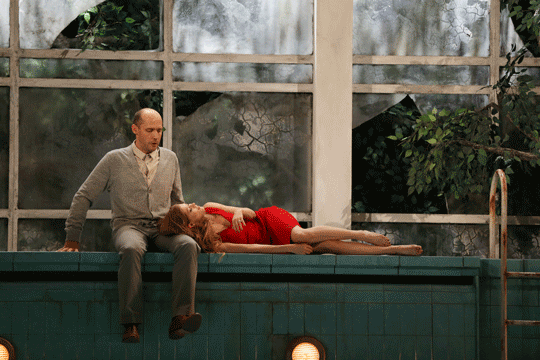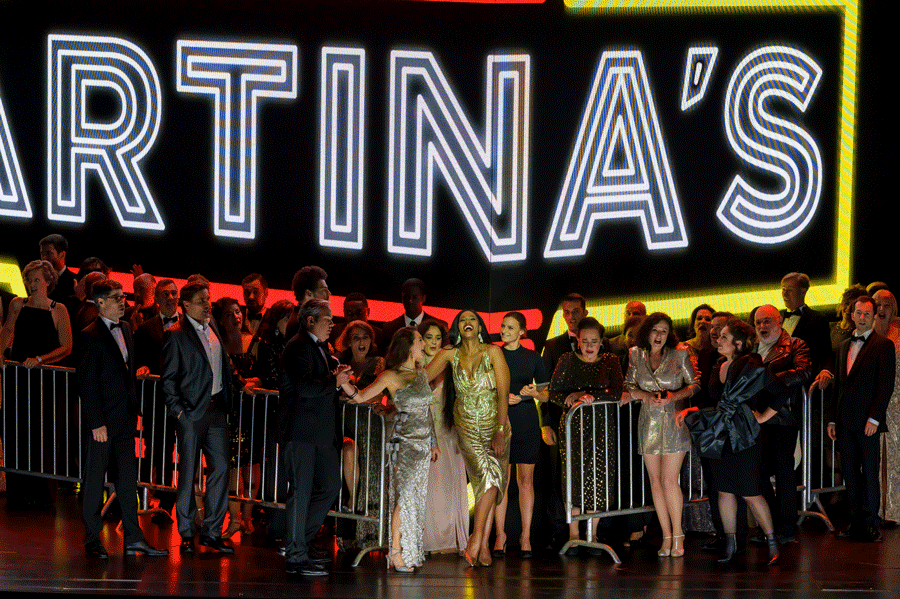
En 2014, l’Opéra de Paris, l’impulsion de son directeur Nicolas Joel, homme de goût, choisissait de remplacer la belle production de Traviata, si originale et si juste, de Christoph Marthaler créée sous Mortier en 2007 par une médiocre, signée Benoît Jacquot.
En 2019, parce qu’il faut avoir une Traviata digne au répertoire, Stéphane Lissner appelle Simon Stone, nouvelle coqueluche des scènes, avec une distribution enviable, Pretty Yende, pour une prise de rôle, Benjamin Bernheim qui devient à juste titre un des ténors français en vue, et Ludovic Tézier, l’un des plus grands barytons actuels avec un chef qui est aujourd’hui une des grandes références dans Verdi, Michele Mariotti. Et c’est le triomphe : opération pleinement réussie donc.
Si l’opération est réussie dans son management, est-ce pour autant dans tous ses éléments une Traviata de référence au niveau artistique. Je n’en suis pas si sûr.
On connaît la nature du travail de Simon Stone qui à l’opéra et au théâtre est passionné par la relation entre l’œuvre de répertoire et la société d’aujourd’hui et il s’est ainsi fait une spécialité des transpositions modernes d’œuvres classiques, avec une véritable originalité, comme dans ses Trois Sœurs de Tchekhov ou Die Tote Stadt à Bâle : une manière de montrer une éternité du genre et peut-être d’attirer un public nouveau. Avec Lear au festival de Salzbourg, il obtient une reconnaissance internationale qui en fait une des références de la mise en scène qui pour une fois ne doit rien au Regietheater allemand, mais suit une voie très contemporaine qui essaie de respecter scrupuleusement la lettre ou l’esprit des œuvres.
Avec Médée au Festival de Salzbourg cette année, il a proposé un spectacle qui a fait beaucoup discuter, parce qu’il en fait un drame de couple d’aujourd’hui, se débarrassant des dialogues originaux, ce qui aux dires de beaucoup a montré les limites de l’exercice. En démythifiant totalement l’histoire réduite à un fait divers tragique, il enlevait peut-être tout le côté archétypal que le mythe pouvait avoir.
Entreprise voisine dans cette Traviata transposée de nos jours où Violetta est une reine de la nuit suivie par des milliers de followers sur Twitter passant de boîte en boîte, vendant ses produits dérivés (le parfum « Villain »)et pianotant sans cesse sur son smartphone, avec sa mère ou ses amies, son docteur ou sa banque (au troisième acte).
La Traviata est une œuvre difficile pour le chant, on va le voir, et difficile pour la mise en scène avec une tradition fortement marquée par le travail de Luchino Visconti avec Callas, continué par Franco Zeffirelli son élève le plus doué qui en a fait plusieurs mises en scène (dont une très belle à Paris, appelé par Bogianckino en 1984) et un film, et qui récemment juste avant sa disparition au printemps dernier, en a proposé une version ultime pour Vérone (voir notre compte rendu sur Wanderersite).
Si l’on quitte ces versions merveilleusement montées, mais archéologiques, trois productions à mon avis ont marqué ces dernières années :
- Celle de Willy Decker en 2005 à Salzbourg, puis au MET, qui outre le fait d’avoir révélé définitivement Anna Netrebko, était un travail épuré et plein de sens sur le dernier soubresaut amoureux dans une course à l’abîme.
- Celle de Christoph Marthaler, à Paris en 2007 géniale transposition de l’histoire de Violetta qu’il identifie au dernier amour d’Edith Piaf pour Théo Sarapo. Une production sensible, d’une rare justesse, mais qui requérait des artistes spécifiques, et peut-être pas transposable à d’autres chanteurs que la merveilleuse Christine Schäfer et l’encore jeune Jonas Kaufmann. C’était une parfaite fusion entre musique et mise en scène, évidemment critiquée par les grincheux, mais dont la direction de Sylvain Cambreling avait suscité les réactions les plus violentes, parce que c’était un principe à Paris que de toujours siffler Cambreling.
- Celle de Dimitri Tcherniakov à la Scala en 2013, (voir notre compte rendu dans ce blog) profonde, nostalgique, sur la mémoire, sur la solitude, magnifiée par la direction extraordinaire de Daniele Gatti, mais production si honnie du public de la Scala (dont on connaît l’aversion pour les mises en scènes un peu « décalées ») que Pereira est revenu prudemment à la production très traditionnelle et sans intérêt de Liliana Cavani qui date de 1990.
Intelligemment, Lissner propose, comme Mortier, cette Traviata à Garnier, cadre idéal pour cet opéra né au Second Empire (On se souvient comme la production Zeffirelli semblait une sorte de prolongement de la salle sur la scène) avec une relation scène-salle à l’équilibre parfait pour faire naître l’émotion.
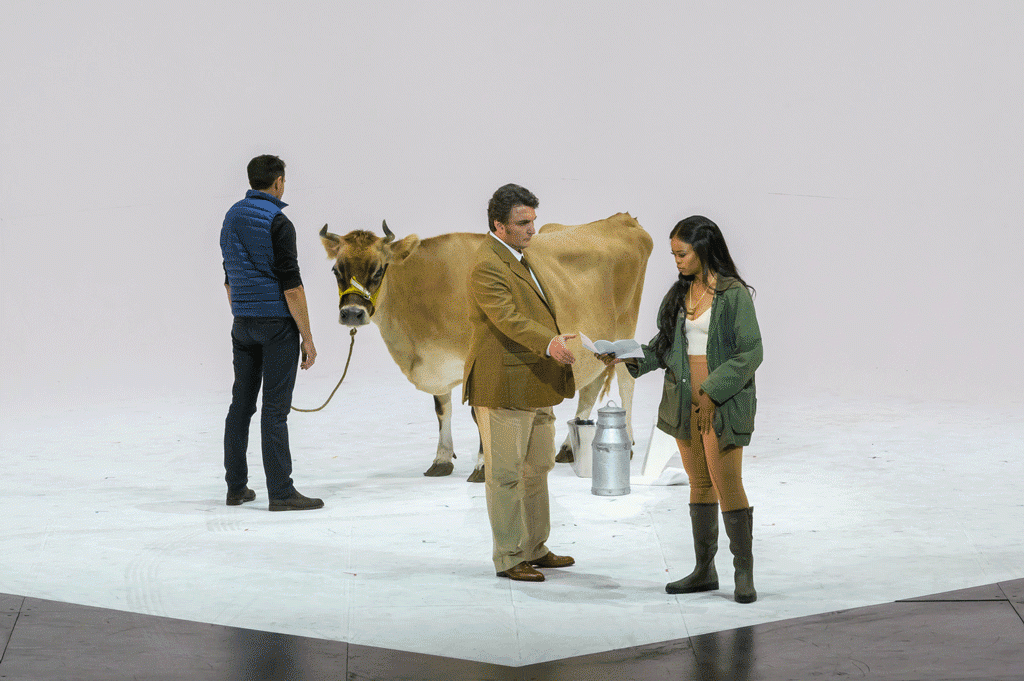
La transposition proposée par Simon Stone fonctionne globalement avec certaines idées intéressantes, et d’autres inutiles: avec la vache du deuxième acte on passe du Veau d’Or Castellucien clairement référencé ici (toujours l’intertextualité des mises en scène), à la vache à lait stonienne. Tcherniakov avait rendu exactement la même idée de retrait du couple dans un monde nouveau au style « retour à la terre » en faisant simplement pètrir la pâte de la pasta à Alfredo (ce qui ulcéra les spectateurs milanais : un Alfredo ne pétrit pas la pasta). Ici Violetta trait une vache et Alfredo piétine le raisin pour en faire son vin. Si Milan fut ulcéré de la pasta, Paris glousse devant lait et raisin. On comprend l’intention très démonstrative de Simon Stone, mais on reste dubitatif devant les outils de la démonstration, comme une volonté très didascalique, très didactique de surligner au stabilo un changement d’état du couple comme pour s’assurer que le public comprendra bien la situation, et aussi pour s’amuser un peu, et sans doute enfin pour laisser entendre par cet excès même le probable échec de cette retraite.
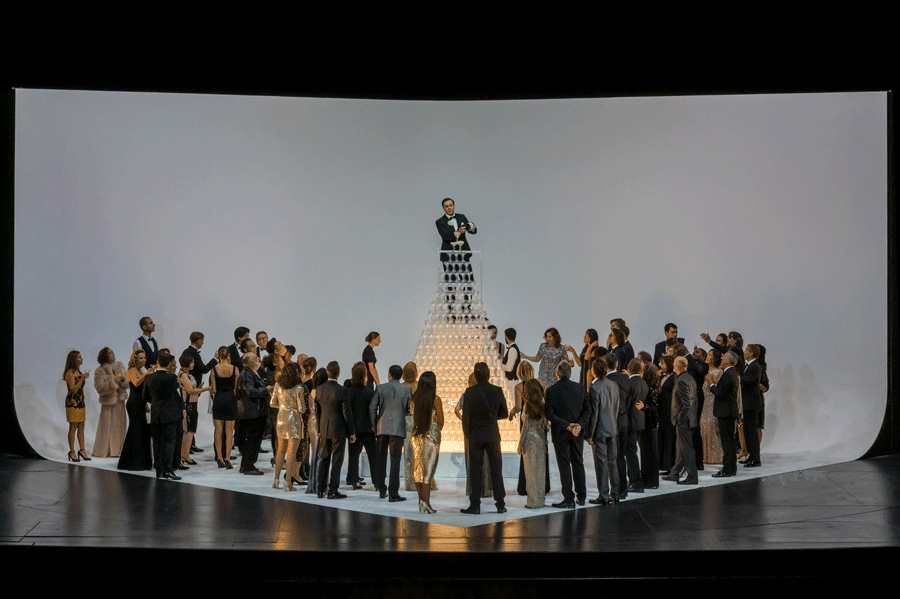
Le premier acte souligne que « Paris sera toujours Paris », avec ses fêtes délirantes, une société riche qui s’amuse, un culte de l’apparence dominant : Violetta vend du cosmétique, elle vend son visage et le reste, et n’a pas le droit d’afficher maladie ou faiblesse. Par son allure excessive et vulgaire, c’est une société non du grand monde, mais du demi-monde qui claque son fric pour montrer sa puissance. Alors que des salons Second Empire rutilants soient remplacés par les boites à la mode où l’on alimente une fontaine à champagne, pourquoi pas ? Mais qu’est-ce que ça change ?
Et pour faire bonne mesure et pour montrer que la roche Tarpéienne est près du Capitole, quand Violetta s’isole pour se reprendre, elle passe dans les « coulisses », dans « l’arrière -cour » au container d’ordure, comme si le trash était le lieu de l’intimité…
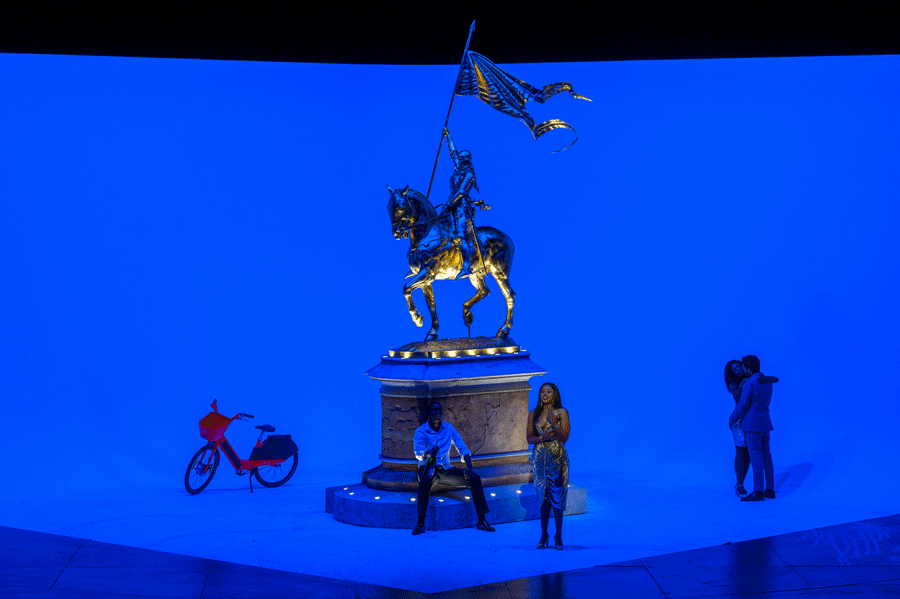
Quelques détails font un peu too much, comme le kiosque à Kebab (merci à Frank Castorf d’avoir donné au Kebab une légitimité lyrique) ou la limousine où elle s’engouffre en chantant Ah fors’è lui. Un peu plus subtile (?) la statue de Jeanne d’Arc de la place des Pyramides, enlevée à la mythologie du Front National pour devenir un lieu des amants (et une allusion à la nouvelle virginité à laquelle Violetta aspire, à relier avec la chapelle du deuxième acte).
Le deuxième acte est le plus démonstratif, on la dit, l’un fait son vin et l’autre son lait, mais on aperçoit aussi au hasard des tours de la tournette qui est sans cesse en mouvement (l’idée que le temps avance, que la roue tourne, – que Willy Decker avait rendu intelligemment jadis par une horloge omniprésente sur la scène dans sa fameuse mise en scène à Salzbourg puis au MET), une petite chapelle de campagne, pour souligner non seulement le retour à la terre, mais aussi aux valeurs de la religion, mais une religion de la simplicité plus intimiste, rappelées au moment où Germont demande au nom des valeurs sociales (ou des préjugés) à Violetta de quitter la scène.
D’ailleurs, un des points les plus problématiques d’une transposition moderne de Traviata est justement l’intervention de Germont, improbable dans la société d’aujourd’hui. Germont est le représentant typique de la morale bourgeoise du XIXe (dont le Valentin de Faust est le versant borné) mais pas du XXe. Pour faire passer cette pilule-là au XXe, il faut donner dans la caricature et Stone choisit de motiver la visite de Germont par le mariage de sa fille à un prince saoudien. Plus c’est gros et plus ça passe.

On voit défiler les titres de la presse qui montent en épingle la situation.
D’une part, il est clair que si Violetta a jadis vendu son corps, Germont (un Ludovic Tézier habillé non en vieillard – comme dans la tradition – mais plutôt en père quinquagénaire assez ordinaire) a vendu sa fille (on pense à Senta vendue par Daland au Hollandais pour quelques diamants) et ainsi Stone jette une lumière crue sur la société d’aujourd’hui, aussi vendue que celle du XIXe, et du même coup, montre une amoralité communément partagée et l’hypocrisie d’un Germont demandant à une Violetta sincère de se sacrifier pour sauver un mariage arrangé.

La fête chez Flora devient une sorte de fête carnavalesque décadente, plutôt licencieuse avec ces néons de couples copulant joyeusement, comme un bal des échangistes, et une Violetta en blanc, mais complètement artificielle, produit d’affichage, de façade d’une tristesse insigne, et toujours ce passage en coulisse devant les ordures…
C’est très clair, très fléché, et au total pas très subtil. Il y a un côté vignette de bande dessinée, qui désigne l’essentiel signifiant, pour donner au public des clefs évidentes et lisibles de compréhension, pour créer un cadre contemporain reconnaissable au premier coup d’œil.
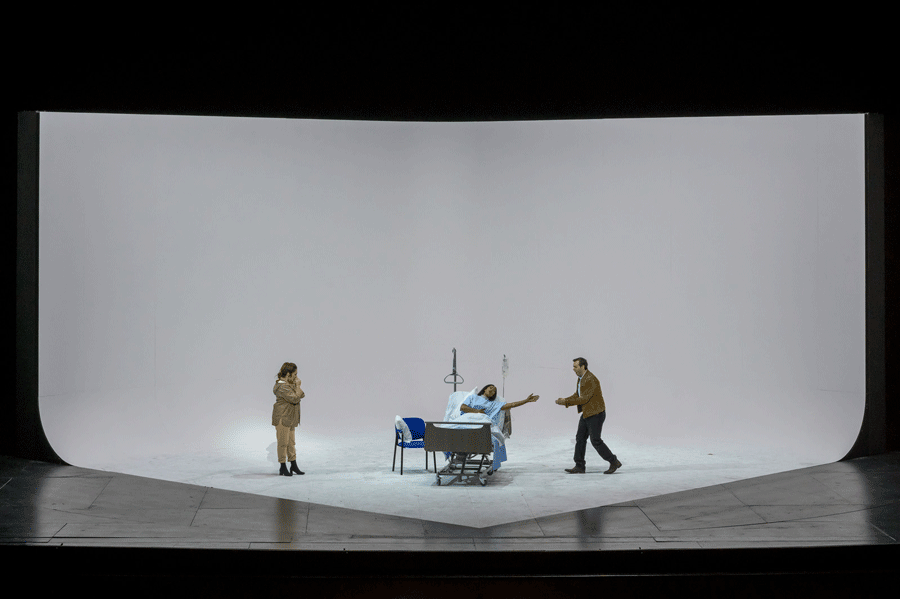
Un peu plus intéressant la manière dont le troisième acte est proposé. Violetta ruinée est en unité de soins palliatifs (elle souffre d’un cancer en phase terminale…autre adaptation : aujourd’hui on ne meurt plus de phtisie) au milieu d’autres malades, dans une salle d’hôpital, elle n’est pas seule et singulière, mais une parmi d’autres devenue anonyme. Le fait même qu’elle soit au milieu d’autres malades renforce sa solitude. Et du coup, aussi bien Annina que le Docteur Grenvil sont hors champ, comme rêvés et Violetta sort du champ pour retrouver dans la file d’entrée de la boite du premier acte Martina’s (avec le logo de l’apéritif Martini bien connu…Alcool, délires et mort) Annina en robe de boite et Grenvil en smoking comme occupés ailleurs, non concernés, et c’est une jolie manière de considérer la situation finale de l’histoire, cela rend le personnage d’autant plus émouvant, par l’ambiance et le cadre. L’extérieur tout à ses fêtes ne peut supporter la vision du malheur. Il ne fait pas bon être malade dans ce monde-là qui ne connaît pas les grands sentiments, mais que les gros portefeuilles. Et l’Addio del passato qui voit défiler tous les lieux du bonheur, est à ce titre particulièrement bien réglé.
Simon Stone s’occupe en effet plus du cadre d’ensemble que de la conduite d’acteurs : dans cette ambiance outrageusement, caricaturalement contemporaine, le jeu des chanteurs n’est pas vraiment travaillé, chacun est plus ou moins laissé à lui-même. Changeons le décor et les costumes et retournons dans une bonne vieille mise en scène XIXe et ils feront exactement les mêmes gestes de l’éternel opéra de la main sur le cœur et des bras écartés.
En changeant le cadre, Simon Stone ne change rien de ce qu’attend le public ravi de rester dans sa zone de confort. il transpose, mais ne dérange pas, ne démontre rien de différent de ce que Zeffirelli pouvait montrer (de fait, la mise en scène de Vérone de ce dernier est tout aussi émouvante, sinon plus et ne dit rien de moins que Stone, l’un à grand renfort de foules et de palais Second Empire, l’autre de néons et de vaches): on en sort sans rien avoir appris de plus sur l’œuvre. Autant dans ses Trois sœurs, il montrait la modernité de Tchékhov dans ce Tchékhov sans Tchékhov, il réinsérait l’auteur russe dans un monde contemporain désespérant, autant ici il se montre un conquérant de l’inutile. C’est très bien fait, Simon Stone est à l’évidence un artiste habile qui sait manœuvrer les idées, mais ici, il finit par faire système, et se perd dans l’anecdote qu’il fait passer pour signe : une Traviata qui se veut une sémiologie du contemporain et qui n’est en grande partie qu’une vision anecdotique d’un quelconque téléfilm.
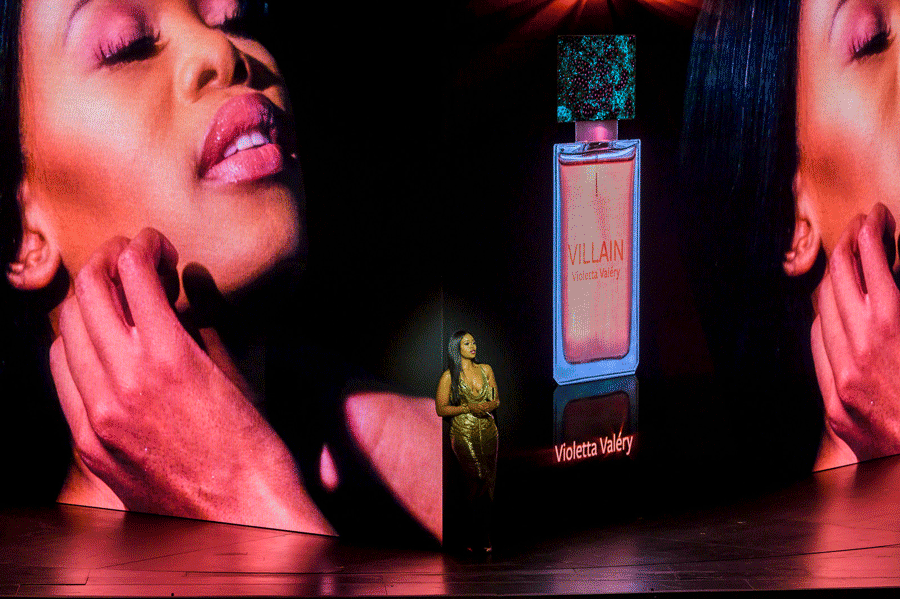
De plus, pour qu’elle fonctionnât totalement, il eût fallu une Violetta totalement incarnée, pleinement dans le rôle et pas seulement pleinement dans les notes, ce qui n’est pas le cas ici. Pretty Yende bénéficie à Paris notamment depuis ses Lucia en 2016 d’un a priori très favorable, mais beaucoup avaient déjà noté sa Teresa discutable de Benvenuto Cellini.
On serait injuste de ne pas noter une fois de plus une voix splendide, magnifiquement timbrée, et l’étendue du registre du grave à l’aigu : elle sait parfaitement en jouer et c’est techniquement sans failles.
Mais dans Traviata, avoir les notes est une chose, incarner en est une autre, et les grandes Violetta qui, à peine entrées en scène, par un geste, par un regard, suscitent l’émotion sont relativement rares. Elle réussit à émouvoir dans l’Addio del passato, plus par la situation et par le cadre de la mise en scène (le défilé du passé) peut-être que par le chant qui est maîtrisé certes mais convenu ; mais le travail de Stone en fait ce petit oiseau isolé qui touche le spectateur. Violetta est un personnage protéiforme, une reine sociale et donc une personnalité forte, on voit avec quelle autorité elle répond à Germont, elle prend des décisions, elle est résolue. Mais c’est aussi une amoureuse, qui sacrifie tout à cet (ultime) amour. Alfredo ne sacrifie rien, il a papa derrière et on ne réussira pas à voir en lui autre chose qu’un jeune homme riche qui a pris, comme on dit en italien una cotta (qui s’est entiché) pour Violetta. Lui survivra…
Pretty Yende a un côté victime qui peut plaire aujourd’hui où l’on préfère les victimes aux héroïnes, mais surtout son chant si précis, si maîtrisé reste pauvre en couleur et n’est jamais vraiment émouvant, même dite alla giovine chanté mais pas vraiment ressenti et amami Alfredo qui manque d’intensité malgré un orchestre sublime. La différence est grande avec une Lisette Oropesa, qui à Vérone, même dans un cadre tout sauf intimiste, réussissait à toucher immédiatement. Mais peut-être aussi le personnage voulu par la mise en scène ne lui convenait il pas
Gageons que c’est une prise de rôle, que la jeune chanteuse n’a pas encore la maturité ni le poids voulu pour une Violetta. Je suis néanmoins heureux pour elle de la longue standing ovation reçue à Garnier. C’est toujours une joie qu’un artiste soit ainsi récompensé, mais la prestation à mon avis ne valait pas un tel triomphe.
Benjamin Bernheim est Alfredo, il lui rend ce côté chien fou amoureux au deuxième acte, et il a lui aussi sans aucun doute possible une voix claire, magnifiquement projetée et un timbre lumineux exceptionnel. Mais si cette voix le prédispose aux grands rôles de ténor lyrique, notamment du répertoire français, la diction italienne tellement sculptée, un peu maniérée, enlève du naturel et de la fluidité à la prestation, comme si Werther s’essayait à Alfredo. Son italien n’est pas suffisamment délié pour apparaître naturel, il est ici trop apprêté. Ce style peut convenir à un Faust, à un Werther ou à un Roméo, pas à un Alfredo. On ne peut pas être un chien fou qui surveille tellement son débit et son phrasé. Le naturel voulu par le rôle se heurte ici à l’artifice, et c’est dommage dans un rôle dont il a parfaitement la voix, et quelle voix. Je n’avais pas remarqué cela dans son magnifique Cassio à Salzbourg, mais il est vrai que le rôle était plus court et moins exposé.
Ludovic Tézier, annoncé malade (une bronchite), n’a pas laissé paraître dans sa prestation l’ombre d’une difficulté. Son Germont est complètement maîtrisé à tous les niveaux, homogénéité sur tout le registre, phrasé, délié de la diction et surtout couleur et expression, pleine de retenue, presque pudique. Toutes les nuances y sont, notamment le passage de l’agressivité à l’empathie, et il démontre, une fois de plus, être un des grands barytons de ce temps pour Verdi, par le timbre et l’expression le plus proche de Piero Cappuccilli, le dernier des immenses barytons-Verdi des cinquante dernières années. C’est une leçon de chant que de l’entendre, un chant toujours naturel, jamais prétentieux, jamais surjoué. C’est pour moi le sommet de la soirée, même si le jeu reste limité, mais ici tout est dans la voix, qui se suffit presque à elle-même. Grandiose, même malade.
Les rôles de complément (tous les autres rôles sont très épisodiques) sont tenus très correctement, notamment Flora (Catherine Trottman), un Douphol (Christian Helmer) qui existe plus que d’habitude, ou le docteur Grenvil plutôt réussi de Thomas Dear. Le chœur préparé par José Luis Basso est comme souvent impeccable et parfaitement réglé.
Pour mon goût, le véritable triomphateur est le chef Michele Mariotti, qui réussit par l’accompagnement orchestral à donner une vraie couleur à la soirée.
Mariotti donne une impulsion et une tension dramatique fortes, mais sait aussi rendre les moments les plus lyriques vraiment émouvants. Les premières mesures de l’ouverture installent d’emblée un climat, et tout le deuxième acte est un chef d’œuvre de soutien discret, rythmé, palpitant, à l’écoute des chanteurs et essayant en même temps de les entraîner. L’accompagnement orchestral d’amami Alfredo qui doit par son intensité transcender la voix du soprano est anthologique.
Le troisième acte réussit aussi à créer une couleur, une émotion qui naissent peut-être plus de l’orchestre que des voix. Cette direction est magistrale, parce qu’elle garde la pulsion et le tempo vif, caractère des grandes directions italiennes, mais en même temps d’une clarté exemplaire qui rappelle celle de Gatti de 2013 à la Scala, en ce qu’elle cherche sans être démonstrative, sans jamais être appuyée, à montrer la construction et les raffinements de la partition de Verdi. Elle tient l’ensemble à bout de bras.
Le beau, ardent et triste, cher à Baudelaire.
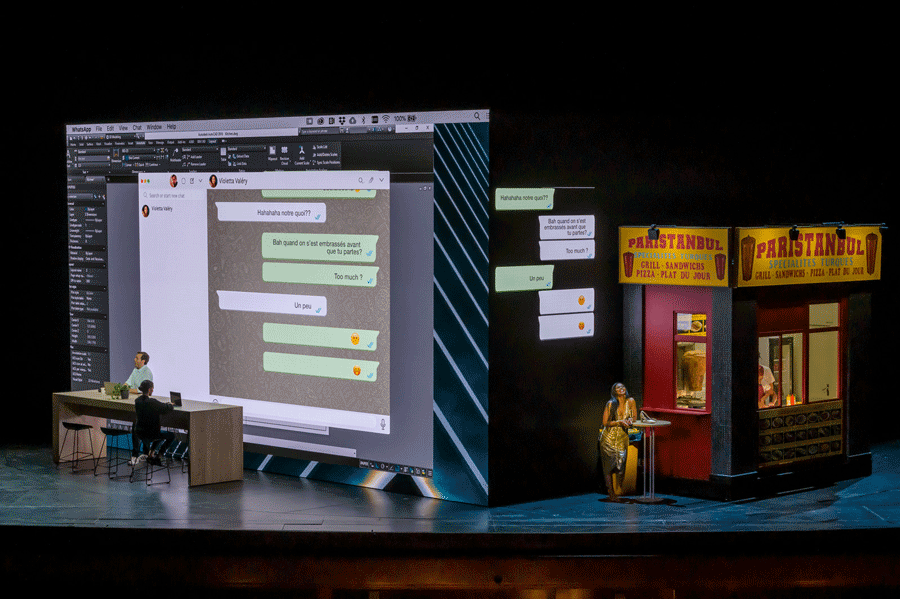
Voilà donc une soirée qui ne réussit pas à convaincre avec du très grand et du perfectible et une mise en scène bien faite mais un peu trop démonstrative, qui brille par le tape-à-l’œil, moins par une substance qui ne va pas au-delà de ce qu’on a toujours su de l’œuvre, dont l’adaptation dans le monde des réseaux et de la société du spectacle laisse un peu indifférent. Même si c’est mieux que la production Jacquot (ce qui n’est pas difficile) ce n’est pas un coup de maître. À la prochaine donc.
Photos: © Charles Duprat / Opéra national de Paris