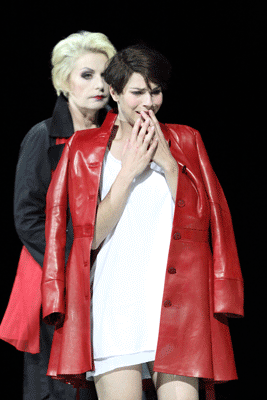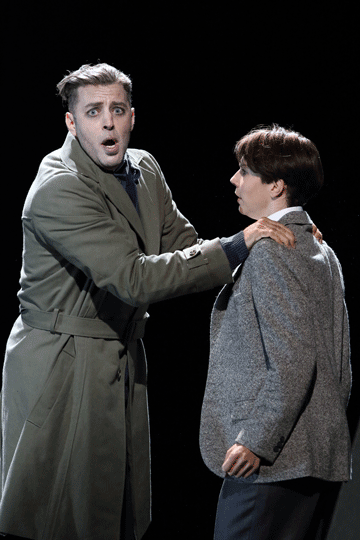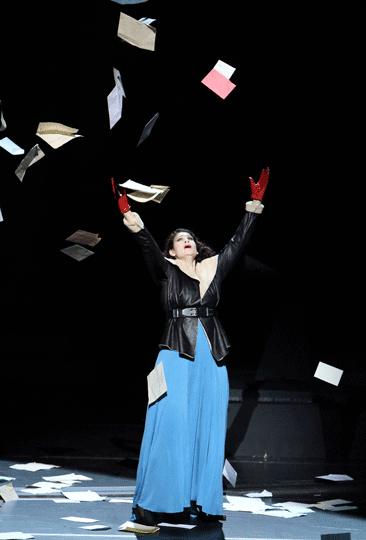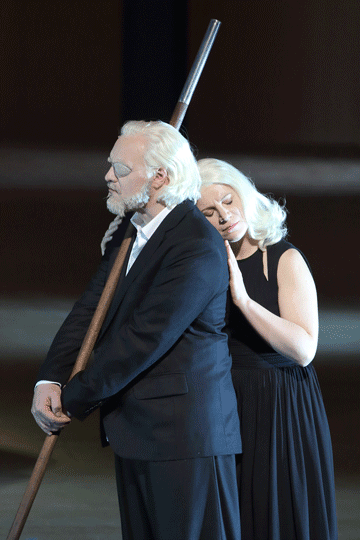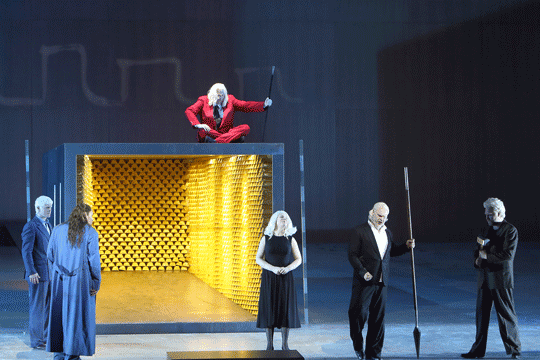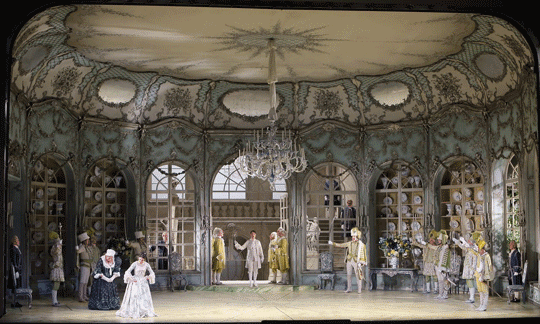

Le buste de Richard Strauss qui trône dans l’entrée face à celui de Wagner, les deux compositeurs tutélaires de la maison était fleuri de roses fuchsia ce soir, il y avait d’ailleurs des roses partout dans la maison, et c’était effectivement la fête. On parlera sans doute longtemps de ce Rosenkavalier qui fut un miracle. Au fond, mieux vaut qu’Anja Harteros n’ait pas chanté à Paris, elle n’aurait pas été pleinement Maréchale comme ce soir elle l’a été, parce que ce soir il y avait en fosse Petrenko qui a transformé ce Rosenkavalier en formidable et inoubliable rencontre. Je suis encore sous le choc. Dans la salle et dans la production où j’entendis Carlos Kleiber plusieurs fois pensant que j’avais atteint le sommet, je peux dire que ce soir, nous y sommes à nouveau, dans la même production, 34 ans plus tard, avec un chef qui a l’âge de la production qu’il dirige (né et née en1972).
Otto Schenk a fait en Europe deux productions de Rosenkavalier, à Vienne et à Munich, qui sont encore au répertoire. Celle de Vienne remonte à 1968 (dirigée alors par Leonard Bernstein, avec Christa Ludwig en Maréchale, Gwyneth Jones en Octavian, Walter Berry en Ochs et Reri Grist en Sophie), celle de Munich est donc postérieure de 4 ans, avec de nouveaux décors, plus construits (ceux de Vienne sont pour partie en toile peinte) et c’est Carlos Kleiber qui dirigeait la Première et qui a continué à diriger la production pendant près de vingt ans. L’orchestre de Munich, c’est connu lui déposait sur le pupitre une rose rouge. Il existe un DVD de la production munichoise repris en 1979 (Jones, Fassbaender, Popp) et de Vienne repris en 1994 (Lott, von Otter, Bonney) lors des dernières représentations de l’œuvre dirigées par Kleiber. Ces productions sont donc très largement chargées du souvenir de Carlos Kleiber ; j’ai eu la chance de le voir diriger l’œuvre quatre fois dont les dernières fois en 1982.
Der Rosenkavalier est l’un de ces opéras qui bénéficie toujours d’une distribution flatteuse, on voit rarement de productions médiocres dans les grands théâtres . À Paris, où Liebermann le reprit en janvier 1976, ce fut d’abord Ludwig, Popp, Minton mais on vit entre 1976 et 1985 aussi bien Troyanos, Te Kanawa, Blegen, Fassbaender, Donath, Söderström, et les Ochs de Moll, Ridderbusch et Sotin. Du côté des chefs, ce fut Horst Stein, Silvio Varviso, Marek Janowski et d’autres. Tout ça pour dire qu’à Paris, on eut les grandes titulaires des trois rôles, et je vous assure que le trio final avec Ludwig, Minton et Popp, c’était quand même quelque chose.
Même si je peux paraître un ancien combattant de l’opéra, le monde n’est pas fait d’un présent médiocre et d’un passé mythique. Il y a encore de grandes productions, je viens d’évoquer il y a quelques jour la magnifique soirée scaligère avec Zubin Mehta et la production Kupfer. Trois semaines après, de nouveau une soirée à marquer d’une pierre blanche, sans doute un sommet musical.
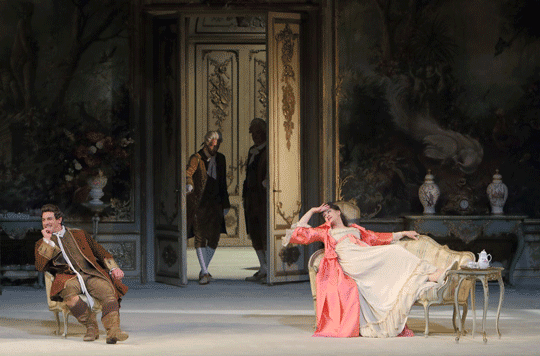
Je passe aussi pour un adepte incorrigible des mises en scènes dites modernes, ou du Regietheater. Pourtant j’aime le travail d’Otto Schenk, qui est un grand metteur en scène, et qui a laissé à Munich un Rosenkavalier de 44 ans qui porte encore vigoureusement son âge, aussi grâce aux décors de Jurgen Rose (un vrai chef d’œuvre) et qui plaît au public (applaudissements à scène ouverte, rarissimes à Munich, à l’ouverture du rideau de l’acte II), c’est évidemment très « classique », mais remarquablement fait.

C’est un Rosenkavalier auquel il ne manque aucun détail, avec une belle gestion des personnages (la rencontre des regards entre Sophie et Octavian respirant la rose est un must), une gestion très précise et très ciblée, avec un souci du texte et de sa correspondance scénique incroyable, et une vraie organisation de l’espace. Bref, j’aime ce classique quand il ne se fane pas. La production de Vienne (surtout à cause du décor de Rudolf Heinrich) a un peu vieilli en revanche.
Ainsi donc, l’écrin pour cette distribution de 2016 était très agréable, et même, oserais-je, non dépourvu de fraîcheur. Après tout il y a des quadragénaires qui ne font pas leur âge…Même s’il y eut à Munich une velléité de nouvelle production (Luc Bondy) , Bachler a renoncé avec raison: il faut dans chaque grande institution une production historique symbole, ce sont les Nozze di Figaro de Strehler à Paris, c’est La Bohème à la Scala…
Mais on ne venait pas pour voir la production, même si je crois celle-ci a pris sa part du succès. On venait pour une distribution de grand niveau, Anja Harteros en Maréchale, Daniela Sindram en Octavian et Hanna Elisabeth Müller en Sophie, tandis que Günther Groissböck promenait à nouveau son Ochs inauguré à Salzbourg en 2014, avec le GMD Kirill Petrenko en maître des cérémonies.

Anja Harteros chante la Maréchale depuis 2011, elle en est l’une des titulaires de référence. Après ses prestations avec Christian Thielemann à Dresde et avec Sir Simon Rattle à Baden-Baden, j’ai à peu près cerné le caractère de sa Maréchale, une femme dans la force de l’âge, vive, ouverte, avec beaucoup d’autorité, et non une femme déjà mûre, plutôt maternelle et déjà distanciée que d’autres interprètes privilégient. Ce qui caractérise cette Maréchale, c’est l’énergie, c’est aussi une voix forte, des expressions impératives (surtout à l’acte III à l’égard de Ochs) . Sur la scène de Munich, il y a évidemment cela, mais il y a encore bien plus, tant elle soigne les inflexions et toutes les expressions de son discours avec une attention renouvelée, avec une expressivité inouïe et le ton idoine, d’une incroyable justesse et d’un naturel rarement entendu. Je me suis demandé pourquoi, alors qu’elle est la meilleure Maréchale aujourd’hui sans conteste, une vraie différence avec ses autres prestations. Cela tient je crois à son rapport au contexte. Elle chante dans son théâtre, dans sa ville, et on sait (les parisiens l’ont appris à leurs dépens) qu’elle ne se déplace pas volontiers trop loin. Et elle chante avec Kirill Petrenko, qui a un soin tout particulier pour la relation texte et musique, et qui met donc le chanteur qu’il suit pas à pas, dans les conditions de travailler le texte, d’envisager les inflexions en fonction d’un orchestre qui respire avec la syllabe, comme dans Le Ring (acte II Walkyrie), et notamment dans Rheingold, comme dans Meistersinger, c’est-à-dire ces œuvres dont certaines parties doivent beaucoup à la Komödie für Musik, où le dialogue (ou le monologue) de théâtre demande concentration et attention, mais aussi vie, naturel, expression, couleur, mot par mot, syllabe par syllabe, des moments où la parole conduit la partition
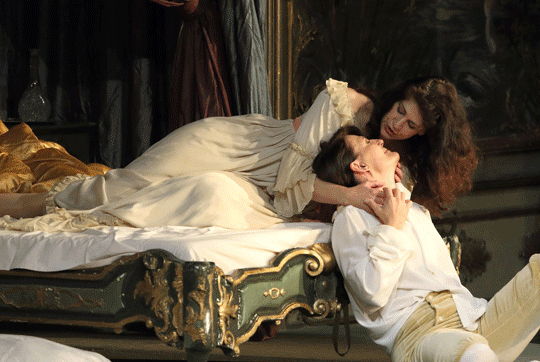
Rarement on a entendu une telle virtuosité dans le moindre détail au moment du monologue de la Maréchale dans le premier acte, symphonie de couleurs, harmonie expressive qui passe du sourire au sarcasme, à l’ironie, à l’amertume, et à la résignation. Rarement j’ai mieux ressenti que tout est dit dès le premier acte, mais en même temps, la vivacité avec laquelle cette Maréchale réagit au départ d’Octavian, montre ce que sont les intermittences du cœur, les contradictions de la personne. Une interprétation d’une rare profondeur, d’une rare intelligence, saisissante, comme au théâtre, avec l’urgence et le naturel du théâtre : le triomphe indescriptible de l’artiste face au salut du 1er acte en dit long sur le ressenti de tous.
Mais il y a aussi une voix, une voix qui sait à la fois sussurer et imposer, une voix qui n’a rien de métallique ou d’âpre, mais une voix qui a des aigus incroyables et triomphants, dans une forme extraordinaire : le trio final, pris par Petrenko sur un tempo large, permet aux trois voix de se sentir à l’aise, d’abandonner toute urgence et de s’abandonner à la pure musique, car c’est un des trios les plus extraordinaires entendus ces dernières années, avec une osmose singulière des trois artistes, une respiration commune, une puissance émotive d’une rare intensité.
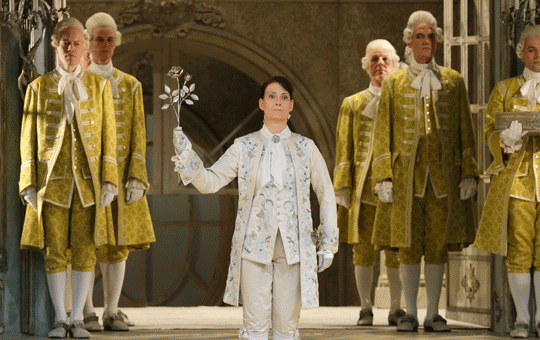
Face à elle, Daniela Sindram est Octavian. Un Octavian très mesuré, et en même temps d’une vraie fraîcheur, spontanée et sensible. La voix est charnue, sans être d’une puissance marquée (comme Koch) mais très présente et ronde, avec une rare capacité à adoucir, à moduler elle-aussi et surtout, qualité éminente, un chant qui écoute le chant de l’autre, qui sait s’y adapter, s’y fondre, et donc un chant éminemment intelligent dans le sens où il cherche à faire harmonie et non démonstration. J’ai entendu quelquefois cette artiste notamment dans Rienzi, et ce fut une très belle surprise. Dans Octavian, elle se place immédiatement dans les toutes premières, parce qu’elle sait dire le texte, parce qu’elle est désopilante en Mariandl, parce qu’elle sait donner un ton, faire ses simagrées sans exagérer, mais avec cette touche comique qui fait immédiatement rire le public, un public qui n’en est pourtant pas à son premier Rosenkavalier. Elle est un exemple de chant maîtrisé, et de modestie : mais il y a des moments totalement magiques (les deux duos du second acte avec Sophie, la rencontre) sans parler aussi du trio final où entre les deux sopranos qui rivalisent à l’aigu, cette voix s’entend, parfaitement, grâce aussi au soutien de la fosse. Quant au duo final, c’est un miracle de simplicité, de fluidité et de retenue.

Enfin, Hanna Elisabeth Müller était Sophie. Elle a tellement marqué dans Zdenka d’Arabella qu’on l’attendait dans un rôle marqué par d’immenses chanteuses : pour moi c’est Lucia Popp à jamais. Elle a en commun avec Christiane Karg (vue à la Scala il y a peu) la fraîcheur et la jeunesse et déjà Karg était « évocatoire » dans son chant que j’ai beaucoup apprécié. Ici, la voix est à la fois jeune, fraîche, mais incroyablement intense, avec des aigus d’une puissance qui trancherait presque avec ce corps de toute jeune fille. Cette Sophie-là vous fait immédiatement fondre le cœur : la presque-perfection du chant (peut-être le duo initial de l’acte II était un tout petit peu fort), mais le second duo était magique, fusionnel, bouleversant, et quelles interventions de l’acte III, avec le jeu qui allait avec : crainte,déception, gestes un peu enfantins ou boudeurs! Le trio final trouvait avec Anja Harteros un incroyable équilibre, une merveille à n’en pas croire ses oreilles car on comprenait par la fusion même des voix le choix déchirant d’Octavian, les deux femmes, Sophie et la Maréchale, rivalisant d’intensité voire de gravité ; quant au duo final avec Daniela Sindram, il fut apaisé, tendre, poétique, élégiaque : elle a tout dans cette voix surprenante parce que jeune, fraîche et particulièrement présente et puissante. Ne jamais plus manquer Hanna Elisabeth Müller dans Sophie, elle partage désormais avec Karg la maîtrise du rôle, j’aime Karg, mais Müller a totalement emporté mon cœur.

Trois semaines auparavant j’avais entendu Groissböck dans un Ochs inhabituel, construit pour lui et en fonction de son physique et de sa personnalité. Cette fois-ci, Groissböck de nouveau, mais dans un Ochs traditionnel, conçu il y a 44 ans avec un profil correspondant à des Walter Berry ou Kurt Moll. Et c’était impressionnant de le voir se fondre avec ses qualités et même son élégance dans cet Ochs-là. D’abord, avec une voix exceptionnelle, des notes aiguës incroyables, une puissance presque inédite, des graves tenus au-delà du raisonnable : Kirill Petrenko le conduisait et l’a poussé au maximum de ses possibilités : il en est résulté un Ochs qui s’installe désormais durablement dans les grands Ochs du moment sinon l’Ochs du moment. Inutile de dire le naturel et l’élégance avec lesquels il dit le texte, avec un accent qu’il connaît par cœur, si drôle, si marqué, mais aussi avec une bonhommie particulière, déjà notée à Milan. Bien sûr, quand on l’a vu à Milan ou Salzbourg, la prestation ne surprend pas, car elle est débarrassée de bien des tics du rôle. Alors dans une mise en scène aussi « classique », il compose un Ochs jeune, vigoureux, assez sympathique au demeurant qui fait adhérer le public au personnage : son monologue de l’acte II est un modèle qui contient peut-être – même si les rôles conviennent mieux à un baryton-basse- un futur Falstaff…ou son pendant Sachs.

Martin Gantner n’a pas le style ni la dégaine de Adrian Eröd, que j’aime beaucoup dans le Faninal qu’il dessine avec Kupfer. C’est un Faninal présent, classique, traditionnel et donc un peu en retrait par rapport au quatuor dont on vient de parler ; voilà un chanteur valeureux, qui n’est pas pris en défaut, mais qui n’a rien de plus que d’autres Faninal, un rôle ingrat d’ailleurs: la prestation est bonne, il tient la scène, rien d ‘autre à signaler.
Annina (Heike Grötzinger) et Valzacchi (Ulrich Ress) sont des piliers de la troupe, très présents, avec une Annina plutôt jeune et élégante, et un Ulrich Ress comme toujours très caractériste (il est un Mime intéressant) : toute la troupe d’ailleurs est distribuée dans les « petits » rôles, chacun toujours très bien caractérisé, aussi bien Dean Power (Haushofmeister bei der Marschallin), Kevin Conners (Haushofmeister bei Faninal), Christian Rieger (Ein Notar) mais aussi les jeunes « Gäste » comme Scott Conner (Polizeikommissar), la très sonore Jungfer Marianne Leitmetzerin de Miranda Keys ou Josep Kang, un chanteur italien très correct sans avoir l’aura de Benjamin Bernheim à la Scala.
Tout ce beau monde est dans les mains de Kirill Petrenko. On connaît depuis Die Frau ohne Schatten les affinités du chef russe avec l’univers straussien et à force d’entendre ses interprétations, on arrive à comprendre aussi son souci à l’opéra, notamment sur le répertoire post romantique et du début du XXème siècle. Son Ring, sa Lulu, ses Maîtres chanteurs ont comme commune caractéristique un souci du texte souligné par un accompagnement mot à mot par la partition, mettant en valeur le texte (un caractère initié par Wagner) et soulignant par la partition les moments textuels particuliers. C’était, je l’ai dit plus haut, le caractère de l’accompagnement musical du monologue de la Maréchale au premier acte. Ce qui fait dire à certains qu’il n’est pas spectaculaire, à d’autres qu’il n’a rien à dire, comme si le « massage musical » était, après Wagner, autiste, sans tenir compte de ce que disait le livret. Car c’est bien ce que la révolution wagnérienne a porté, la question du livret se pose de manière bien différente avant et après Wagner. Même Verdi, dans sa collaboration avec Arrigo Boito, écrivain et compositeur, la repose à la fin de sa carrière.
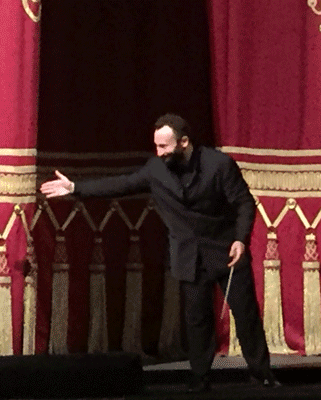
De tout cela évidemment Kirill Petrenko tient compte, notamment dans des œuvres construites sur une collaboration écrivain/compositeur, comme c’est le cas de Rosenkavalier. Bien sûr, nous avons aussi appris la leçon de Meistersinger von Nürnberg où la parole par son rythme, ses jeux de mots, ses métaphores, sa couleur détermine une manière d’entendre aussi la partition.
C’est d’abord cette manière de conduire la musique qui « étonne », tant elle suit le rythme de la parole, c’est frappant dans la manière d’accompagner Ochs, on l’a vu, dont la voix devient presque instrumentale, et du même coup, on entend les grands duos (je pense à ceux de l’acte II entre Sophie et Octavian) différemment, avec un souci de fusion orchestre-parole, mais aussi celui de faire que les mots et l’expression se distinguent, que la musique ne couvre pas, mais stimule les voix : voilà aussi ce qui pousse les voix à « aller jusqu’au bout » et rend aussi urgente l’impression d’ensemble, tout en décuplant l’émotion.
Ce qui frappe dans l’approche de Petrenko, ce n’est pas tant la clarté ou la précision des sons, cela, d’autres chefs « savent faire » comme on dit aujourd’hui ; c’est une clarté au service du texte, c’est une clarté qui prend place dans un « système », qui se lit dans sa manière même de diriger, sa gestique multiple, où, à la stupéfaction de ceux qui l’observent, tout est mobilisé : on dirait en souriant qu’il est “le Shiva de la direction d’orchestre”, tant œil bras main sont partout, du geste léger demandant à un chanteur d’avancer sur scène, aux attaques de tous les chanteurs, avec en même temps un souci de chaque pupitre. Il fascine parce qu’il est partout, et quelle manière extraordinaire aussi de rassurer les artistes qui sont ainsi portés.
Un autre élément qui a fasciné tous les auditeurs avec qui j’ai échangé est la manière dont il a dirigé le troisième acte, et notamment tout le début. On connaît l’exercice de style obligé de ce début de troisième acte, qui fait entendre notamment aux bois des « bruits divers », une sorte de kaléidoscope sonore qui avait tant réussi à Franz Welser-Möst à Salzbourg jouant sur le clavier céleste des Wiener Philharmoniker en lévitation. C’est sûr, ce début d’acte III est un « morceau de choix » de la direction d’orchestre.
Petrenko, après l’accord initial explosif, met tout en sourdine, n’en faisant absolument pas une démonstration sonore, mais comme un bruissement, installant une ambiance extraordinairement nouvelle, qui va en quelque sorte mimer l’impression de Ochs voyant surgir les monstres. Petrenko installe l’ambiance de préparatifs, secrets, mais qui doivent aussi être essayés pour fonctionner. Il en résulte un rythme rapide, toujours cette clarté phénoménale malgré le volume abaissé qui tranche tant avec d’autres interprétations, mais aussi quelques traits de flûtes, à la limite de l’atonalité, qui eux, sont donnés à plein volume : il en résulte des contrastes violents et assez proches de ce qu’on entend dans la Tempête de la Pastorale de Beethoven, et ces traits, à la limite du grinçant, du désagréable pour l’oreille semblent préparer un sabbat au fantastique très berliozien : la musique n’est plus accompagnement ici, elle est action et part de l’action, d’autant que le lever de rideau de change rien à l’ambiance continue qu’il installe, jusqu’à la musique de scène, à qui, sans jamais en augmenter le volume, il donne une importance inconnue jusqu’alors (on prête souvent peu attention à la musique de scène), étirant le tempo, jouant là aussi sur les contrastes, installant une sorte de danse rassurante en fond de scène, qui contraste avec l’ambiance inquiétante qu’il a installé en fosse. Ce travail tout en contrastes, en jeu sur le volume, en jeu aussi sur les pupitres tour à tour interpellés, font que ce début n’est jamais démonstratif, tout le contraire d’un Welser Môst ou même d’une Thielemann, mais qu’il est exclusivement fonctionnel : il installe une ambiance scénique, une couleur, il fait fonctionner la dramaturgie, rien qu’avec ce jeu musical inédit. On en reste bouche bée.
En grand chef d’opéra, il installe les chanteurs dans un confort qui leur permet de travailler les émotions et l’expression, donnant aux voix toute leur place lorsqu’elles doivent être au premier plan (trio final), mais en même temps isole aussi à l’orchestre des moments étonnants et surprenants : je n’avais jamais remarqué comment certaines phrases de l’acte II, dans la deuxième partie, rappellent l’Elektra, de deux ans antérieur, et comment notamment les phrases « apaisées » qui accompagnent Ochs blessé, (là aussi avec des interventions des bois stupéfiantes) ou l’arrivée tardive d’Annina, semblent rappeler en écho celles qui accompagnent Egisthe, dans une sorte d’ironie grinçante, qui joue sur le contexte, souriant ou tragique.
Enfin, comment oublier aussi tout ce qui danse dans cette musique, où Petrenko démontre combien cet univers viennois (il a étudié et vécu toute sa jeunesse en Autriche) lui est consanguin. On l’avait bien compris dans Fledermaus. Il y a du rythme et de la légèreté, mais cette légèreté qui masque la mélancolie, et fait garder malgré tout un sourire, même si un peu automnal.
On ne cesserait de trouver des caractères nouveaux à une direction musicale fédératrice et stimulante, qui entraine le plateau, sans jouer le dramatisme gratuit, sans jouer la démonstration de l’ego en rut, sans jouer autre chose que la comédie, le « drama » c’est à dire l’action, le texte : jouant en quelque sorte, encore et toujours la « Gesamtkunstwerk » et installant une totalité (gesamt) plutôt qu’une prééminence de la fosse qui ne serait que se regarder au miroir sans servir l’œuvre.
Dans ce merveilleux travail, comment ne pas souligner l’incroyable performance de l’orchestre, soumis corps et âme à son chef, capable des plus subtils contrastes, en volume comme en tempo, capable des envolées les plus lyriques et des moments les plus intimes. Certes, Der Rosenkavalier fait partie des gènes d’une maison où Strauss est chez lui, mais faire nouveau dans cette œuvre, accepter de rompre avec des habitudes séculaires, c’est aussi la marque d’une phalange disponible et heureuse de faire de la musique et non du répertoire. Car même si cet orchestre (avec ce chef) a joué au TCE un Rosenkavalier qui fut je crois apprécié, rien ne remplace le confort de sa maison, de son public, avec la respiration si particulière de vivre le merveilleux chez soi, où l’on a rien à prouver, et où l’on fait de la musique ensemble, tout simplement.
J’ai voulu essayer de dire pourquoi je considère cette soirée comme l’une des plus grandes qu’il m’ait été donné d’entendre dans cette œuvre (et visiblement je n’étais pas le seul), à l’égal des soirées des années Kleiber, dans cette salle. Il n’y a pas de podium de champions: le signe, ce sont les larmes qui coulent sans savoir pourquoi, qui coulaient alors et qui ont coulé ce dimanche 17, dans ce désespoir si sympathique de ne jamais réussir à cueillir l’instant fugace du bonheur, dans la stupéfaction d’entendre sans en croire ses oreilles, qu’il est toujours possible de vivre le mythe vivant, sans le voir confiné systématiquement dans les « grands disparus », dans les vinyles ou les CD. Moi qui suis souvent un « ancien combattant » de l’opéra, j’étais en ce 17 juillet le combattant d’un paradis bien présent.[wpsr_facebook]