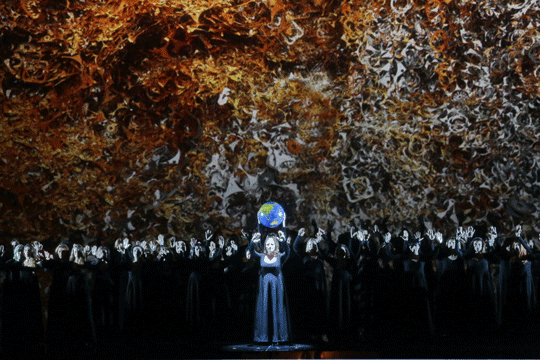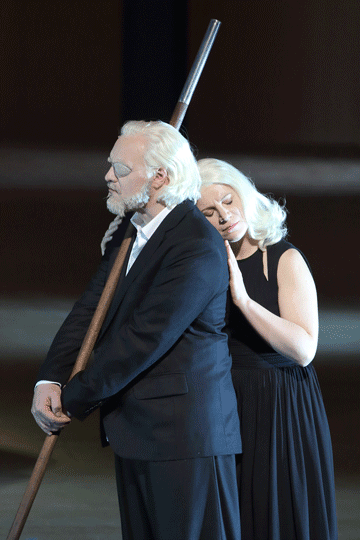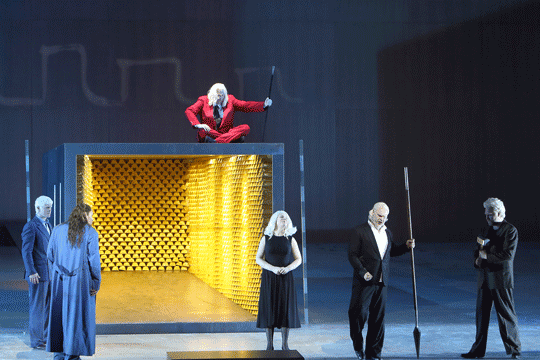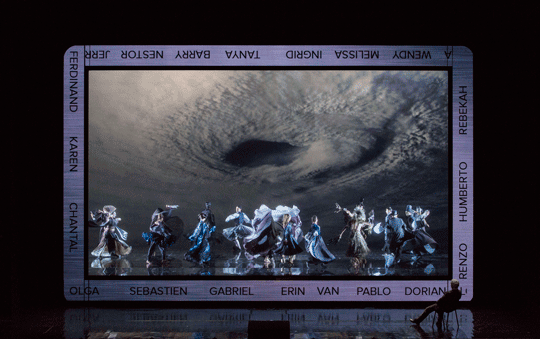
Tout d’abord une petite correction. On lit çà et là que l’opération CO2 est liée à une EXPO 2015 dédiée à la préservation de la planète et de fait, la congruence est frappante. Mais c’est seulement la conséquence d’un heureux hasard dû au « retard à la livraison » d’une œuvre commandée à l’époque par Stéphane Lissner à Giorgio Battistelli dont la genèse remonte à 2007 et qui devait être créée en 2011. Inutile de gloser donc sur l’à propos d’une programmation Expo 2015 largement plus dédiée aux « standards » populaires qu’aux créations, mais il reste que C02, proposée pendant le premier mois de la programmation EXPO de la Scala, est une œuvre bienvenue vu le contexte.
Contrairement à ce qu’on croit souvent, le nombre de créations à la Scala est impressionnant, c’est même je crois le théâtre qui tout on long de son histoire a créé le plus, y compris dans les périodes le plus récentes. On citera dans les quarante dernières années non seulement Nono, Berio, Stockhausen, mais aussi Manzoni, Donatoni, Corghi. Certes, on ne glosera pas sur les reprises de ces créations, il reste néanmoins que dans le domaine de l’opéra, la Scala est sans doute l’un des théâtres les plus ouverts à la création contemporaine, même si en général son public l’est moins. C’était le cas en cette soirée d’abonnement A, le plus exclusif. Beaucoup de trous dans les rangs d’orchestre, mais néanmoins, vu les réactions diverses à la sortie, le public était visiblement satisfait.
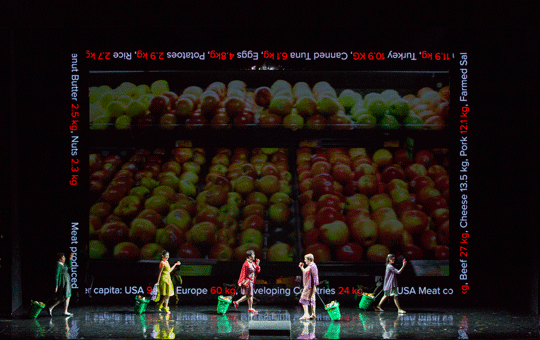
C’est que l’œuvre de Battistelli n’est pas vraiment de celles qui effarouchent: la réalisation musicale confiée au jeune Cornelius Meister et la production confiée à Robert Carsen ont su chacune dans son ordre séduire le public ; même si Carsen est plus habitué à diriger des œuvres plus classiques, il a réussi de nouveau à entrer dans l’univers de Battistelli, comme il l’avait fait naguère avec Richard III à Strasbourg (sur un livret, là aussi, de Ian Burton).
Mais la gageure est d’un autre ordre : il n’y a pas derrière un texte canonique, et l’on a abandonné l’idée de n’appuyer le livret que sur le texte de Al Gore qui pourtant fournit l’idée initiale. C’est un livret qui essaie de retranscrire la modernité sous tous ses aspects et c’est par ce point de vue que Carsen entre dans l’œuvre.

Le livret mime en fait une conférence sur le climat où le conférencier présente au public (la Scala est éclairée) une série d’exemples, pris çà et là, aujourd’hui, hier, dans les mythologies, en Europe ou ailleurs, qui évoquent les dérèglements de la planète et en particulier le dérèglement climatique : c’est du point de vue dramaturgique le vieux motif (depuis Bach) du récitant (le conférencier) qui commente des scènes-exemple, ou qui les évoque ; Les scènes, au nombre de 9 défilent donc, chantées, chorégraphiées, en une succession dont la cohérence ou l’unité viennent de l’idée de Carsen de munir le conférencier d’une tablette, et ainsi de faire du décor un écran de tablette aux dimensions du plateau et où celui-ci va faire défiler des diapos ou des petites reprises filmiques et passer de l’une à l’autre comme des séquences prises chacune comme un exemple particulier.
Et on a donc des exemples dans toutes les langues, dans tous les lieux possibles du hall d’aéroport au jardin d’Eden où évoluent Adam et Eve s’étonnant des miracles de la nature. Il en résulte des scènes très diversifiées, jamais ennuyeuses, que Carsen habille de manière variée, vivante, non dépourvue d’humour, ainsi de l’apparition de Gaia, soutenue d’un hymne choral en grec ancien, qui pourrait rappeler celle, plus familière, d’Erda dans Rheingold ou Siegfried, mais aussi avec les perspectives inquiétantes qui nous guettent (scène 4, ouragans). Ainsi Battistelli use à la fois du plurilinguisme global, faisant ainsi sonner des langues variées avec sa musique, et de cette globalité aborde, outre la question centrale de la planète, celle du multimédia, des nouveaux moyens de communication, des bilans carbone de nos activités, notamment à travers le travail très maîtrisé de Robert Carsen. Ce devait être originellement William Friedkin, le réalisateur de l’Exorciste, mais c’est finalement Carsen qui a été choisi.
Il n’y a pas de dramaturgie proprement dite dans le livret assez réussi de Ian Burton, sinon une série de petits drames au sens originel, c’est à dire d’actions scéniques, liés par le propos du conférencier Adamson (au nom assez prédestiné) qui finira sa conférence par une sorte de grave appel :
« If this is not my planet, whose is it
If this is not my responsability, whose is it ?
If am the cause, then am I not also the cure ? »

La musique de Giorgio Battistelli est intéressante en ce qu’elle globalise elle aussi les apports de toutes les musiques, appuyée fortement sur les percussions qui rythment et donnent à l’ensemble une couleur ancestrale, un peu brute ou primitive. Elle contient aussi des échos divers qui plongent dans l’histoire de la musique du XXème siècle, mais l’œuvre est un peu conçue comme un oratorio moderne, où parties chorales et orchestrales sont étroitement tissées entre elles. Ainsi de la salle de l’aéroport, très polyphonique et plurilingue où la langue devient son et musique, avec un rythme très marqué par les percussions, ainsi aussi de la scène de Kyoto, magistrale avec cette impression de désordre ordonné et construit qui m’a fait vaguement penser au final de l’acte II de Meistersinger par le traitement des masses vocales.
Le chant est très soigné : en bon italien, Battistelli en explore toutes les possibilités , le chant, raffiné, avec des mezze voci, des éléments d’un grand lyrisme, mais aussi le parlato voire le Sprechgesang. Mais dans une œuvre où l’individuel rencontre sans cesse le collectif, le rôle du chœur est essentiel : tantôt éclatant, tantôt murmuré, tantôt d’une légèreté marquée, le chœur de la Scala offre une prestation magistrale qui est peut-être ce que je retiens de plus impressionnant, même si les solistes
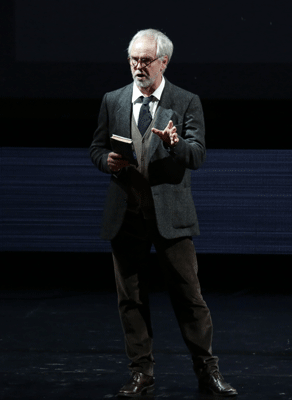
sont particulièrement valeureux, s’y détachent Anthony Michaels Moore au premier chef dont la ductilité vocale alternant chant et parole est notable : on connaît l’élégance de ce baryton, dont la présence vocale est notable et la Gaia du mezzo soprano Jennifer Johnston, totalement convaincante, voix profonde, aigus soutenus, présence vocale rare.
Mais la délicieuse scène d’Adam et Eve, où Carsen et son décorateur Paul Steinberg s’en donnent à cœur joie, est aussi un des moments les plus amusants de l’opéra avec un serpent d’anthologie (David DQ Lee) l’ Eve solide de Pumeza Matchikiza et l’Adam fragile (peut-il en être autrement ?) de Sean Panikkar.
L’orchestre emmené par le jeune chef Cornelius Meister, l’un des plus prometteurs de la jeune génération allemande est d’une grande précision et surtout d’une très grande agilité. On passe subitement de moments où tout l’orchestre est sollicité, fortissimo, à des moments où c’est le murmure léger des cordes qui domine, presque sans transition, avec la même précision et surtout un très grand contrôle : c’est visible dans les scènes où chœur et orchestre se mélangent dans une sorte de tourbillon sonore (notamment à la fin, où la musique est plus tendue), Cornelius Meister domine toutes les masses, et propose un travail d’une très grande qualité et d’une très grande probité. Un chef sans nul doute à suivre, et on se réjouit de le voir invité à la Scala : il faut dire aussi que l’orchestre de la Scala donne une très belle preuve de sa qualité. Confronté au neuf, confronté à la difficulté, cet orchestre sait se surpasser et montrer de quelle tradition il provient.
A un moment d’Exposition Universelle, ce thème universel aujourd’hui de la préservation de la planète est traité ce soir par un opéra global qui joue sur tous les claviers musicaux et vocaux, confié à une troupe cosmopolite dans des langues cosmopolites unifiées par un anglais globalisé confié à un baryton british (jadis lauréat du concours Pavarotti) d’une vraie élégance. Avec en plus un orchestre italien confié à un chef Allemand et une mise en scène faite par un canadien vivant entre Londres et Paris, nous avons l’image d’une planète dont les hommes ont la charge, tous les hommes, de toutes races et de toutes couleurs (la distribution est elle même très multi-culti) et l’opéra devient la métaphore de cette responsabilité globale : il en résulte une jolie soirée, et il reste à souhaiter que CO2 n’ait pas le destin de tant de créations, qui une fois sorties à l’air libre, retournent aussitôt après dans les tiroirs où elles sont oubliées. Voilà une production qui mérite de vivre plus longtemps que l’espace d’une EXPO.[wpsr_facebook]