
J’ai souvent écrit dans ce blog que Richard Strauss a deux maisons, Vienne et Munich. À Munich, il est chez lui, dans sa patrie de naissance. L’opéra est son théâtre. Il y a une tradition straussienne qui remonte à loin: dans les quarante dernières années, c’est à Munich que Wolfgang Sawallisch a présenté tous les opéras de Strauss, c’est à Munich que Carlos Kleiber a réservé ses Rosenkavalier de légende.
Au Festival cet année, deux opéras de Strauss, Die schweigsame Frau dont nous avons rendu compte dans ce blog à l’automne 2014, et une nouvelle production d’Arabella, confiée à Philippe Jordan qui a ainsi conduit, en l’absence du GMD Kirill Petrenko à Bayreuth, les deux moments les plus forts du Festival, le Tristan und Isolde des adieux au rôle de Waltraud Meier, et cette Arabella superbement distribuée.
Kirill Petrenko va en 2016 participer pour la première fois au Festival de Juillet, où sont présentées les nouvelles productions de l’année la plupart du temps dans les distributions des premières et quelques reprises de prestige : il y dirigera Tosca (Kaufmann, Harteros, Terfel), Der Rosenkavalier (Harteros, Groissböck, Sindram, Hanna-Elisabeth Müller), South Pole (la création de l’année avec Hampson et Villazon), Die Meistersinger von Nürnberg (Kaufmann) qui concluront le 31 juillet le Festival en revenant à une tradition profondément enracinée qui veut que la dernière représentation de la saison soit Die Meistersinger von Nürnberg : Wolfgang Sawallisch n’y manqua jamais.
Enfin, signalons que les Festspiele 2016 présenteront pour la première fois au répertoire de la Bayerische Staatsoper un opéra de Rameau, Les Indes Galantes (Ivor Bolton Siri Larbi Cherkaoui) au Prinzregententheater.
Le Festival, c’est en quelque sorte le témoignage (et la confirmation) que cette maison est l’une des plus prestigieuses du monde.
L’Arabella munichoise, ce sont d’abord deux étoiles, Anja Harteros, la star maison, au firmament, et Hanna-Elisabeth Müller, la nouvelle star montante, c’est ensuite un chef réputé pour ses Strauss, Philippe Jordan, et un metteur en scène venu du cinéma et de la TV, accessoirement né à l’Est, Andreas Dresen. C’était presque une garantie sur le papier, c’est un must après l’avoir écoutée, moins après l’avoir vue.
La production d’Andreas Dresen n’est pas en effet de celles qu’on rangera dans les travaux définitifs sur l’œuvre, comme la plupart des productions d’Arabella d’ailleurs, dont personne ne se souvient tant elles sont inodores et sans saveur, sinon celle de la crème fouettée gorgée de sucre. Qui se souvient encore de la dernière apparue sur le marché international, signée Florentine Klepper, au Festival de Pâques de Salzbourg puis à Dresde?
Il est vrai que le livret de Hoffmannsthal n’est pas forcément l’un des plus réussis, même si il a quelques vertus littéraires et quelques moments ou répliques émouvantes (Matteo à Zdenka Acte III : O du mein Freund ! du meine Freundin !).
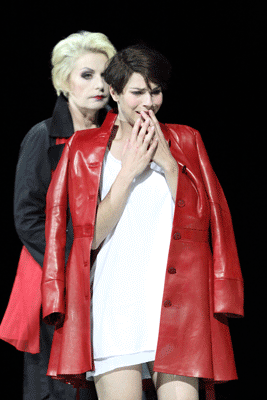
Un couple d’aristocrates désargentés et ruinés par la passion du jeu du mari, négocie au plus offrant sa fille aînée Arabella, pendant qu’il dissimule la cadette Zdenka pour éviter de devoir la doter, et la fait passer pour un garçon. Des deux héroïnes, Zdenka est sans doute la plus attachante. C’est par elle qu’arrive involontairement le nœud de l’intrigue (mince) au deuxième acte et c’est par elle qu’il se dénoue volontairement au troisième. Zdenka est secrètement amoureuse de son « ami » Matteo, fasciné par Arabella dont il reçoit des lettres fraîches et passionnées, écrites en fait par Zdenka qui ainsi lui avoue son amour en se faisant passer pour sa sœur, puisqu’elle ne doit pas apparaître au monde comme une fille. Zdenka se fera passer pour Arabella pendant leur première nuit d’amour, enchanteresse, et c’est ce qui qui provoque la “crise” dans le livret.
De son côté Arabella, courtisée avec insistance par trois jeunes nobles, a été frappée par le regard d’un bel étranger ténébreux qu’elle a croisé et qui se trouve être à Vienne pour la rechercher. Le comte Waldner, père d’Arabella, a en effet proposé sa fille à son vieil ami richissime Mandryka, mort entre temps, et dont le Mandryka actuel se trouve être le neveu. Unique héritier de son oncle, il a donc reçu la lettre de Waldner et la photo d’Arabella : il en est tombé immédiatement amoureux.

Voilà l’essentiel de l’intrigue, bien grêle, qui mêle un regard attendri sur une Vienne dont l’aristocratie fout le camp, et sur les émois des jeunes filles. « À quoi rêvent les jeunes filles » voire « À l’ombre des jeunes filles en fleurs » pourraient être les sous-titres de cette histoire si Musset et Proust ne les avaient pas préemptés. Fin crépusculaire d’un modèle social, regard attendri sur la psyché féminine, y compris celle d’Adélaïde, la mère des deux sœurs, voilà les éléments de ce livret écrit à la fin des années 20 (Hoffmannsthal meurt en 1929) et créé en juillet 1933 dans les premiers mois du nazisme. D’ailleurs c’était Fritz Busch, dédicataire, qui devait le créer mais celui-ci (qui n’était pas juif) avait déjà quitté l’Allemagne nazie et c’est Clemens Krauss et sa femme Viorica Ursuleac qui le créèrent à Dresde avec un immense succès.
Le metteur en scène refuse, et c’est sans doute la seule chose qu’on puisse vraiment lui créditer, le côté crème fouettée qu’on aime tant dans Strauss depuis qu’un critique a trouvé la voix de Renée Fleming, l’Arabella des dernières années, « crémeuse », une expression aussi fascinante que vide. Comprenne qui peut.
Pas de sucrerie, pas de complaisance sur ce monde sombre, à dominante noire et rouge du drapeau nazi, dans un décor monumental représentant sous toutes ses coutures deux volées d’escaliers qui se croisent en svastika stylisée et arrondie. D’ailleurs, à la fête de l’anniversaire d’Arabella, on croise de nombreux officiers en uniforme noir et bottes cirées qui nous rappellent quelque chose. Si l’histoire devrait se passer vers 1860, elle est créée en juillet 1933, une date évidemment qui sonne sinistre dans l’histoire de l’Allemagne. Andreas Dresen a donc souligné à la fois l’ambiance et l’époques, plutôt maussades : on ne rit pas vraiment à cette fête et même Fiakermilli a plutôt l’air d’une domina en rut que de la joyeuse mascotte des fiacres de carnaval.

Car l’anniversaire d’Arabella vire à l’orgie générale où la Fiakermilli s’use en vocalises de jouissance (comme dans l’Alcina d’Aix, voir ce blog) sous les coups de boutoir d’un Mandryka désespéré.
Comme vous le devinez, quand on est désespéré par un amour qu’on croit ruiné, on se jette dans les plaisirs les plus bestiaux pour noyer son chagrin. Dresen nous montre une société usée, supposée prête à se donner corps et âme au nazisme. Les parents, Adélaïde et Waldner, sont assez caricaturaux eux aussi, produits du temps, produits de l’aristocratie ruinée, disposés à s’offrir au premier venu pourvu qu’ils puissent en récupérer un peu d‘argent.
En dehors de cet acte central qui donne la couleur à l’ensemble, peu de choses à dire sinon que la mise en scène ne dérange pas, et que au troisième acte, la grande scène de l’aveu de Zdenka est plutôt bien traitée, grâce à une Hanna-Elisabeth Müller miraculeuse de jeunesse, de fraîcheur et de naturel. Face à elle Anja Harteros, forcément plus mûre, plus femme, un tantinet plus rêche et distante, compose un personnage qui non seulement ne s’en laisse pas compter par les hommes, mais découvre sa faiblesse en croisant le regard d’un Mandryka magnifiquement campé par Thomas Johannes Mayer, beaucoup plus cohérent avec le profil de hobereau bûcheron décrit par Hoffmannsthal qu’un Thomas Hampson, trop élégant (à Salzbourg) : l’aristocrate décadente et hésitante, qui refuse l’amour d’hommes qu’elle fait sauter comme crêpes à la chandeleur, tombe amoureuse d’un sauvage au grand cœur, par chance richissime. Anja Harteros, dont on découvre dans ces rôles straussiens (c’est aussi évident dans sa Maréchale) la subtilité, les petits gestes un peu gauches et si vrais, les hésitations, mais aussi une certaine générosité, y fait montre d’une vraie profondeur.
Si c’est la mise en scène qui a permis de dégager ces caractères (que Florentine Klepper avait à Salzbourg soigneusement laissés dans leur crème fouettée), alors il faut remercier Andreas Dresen qui au moins a monté une Arabella un peu plus agressive et un peu moins gnan gnan que d’habitude.
Mais c’est ce soir la musique et ses deux trépieds, direction et chant, qui nous emportent.
Je le dis avec d’autant plus de netteté que je ne suis pas un fanatique de l’approche musicale de Philippe Jordan, même si c’est un bon chef pour Strauss. On retrouve sa précision, sa netteté, ses lignes bien dégagées et sa prise sur l’orchestre. Tout est au point, tout est propre, mais cette fois-ci c’est aussi expressif. Et beaucoup plus expressif, beaucoup plus dynamique qu’à l’accoutumée. Sans doute aussi l’extraordinaire qualité de l’orchestre et sa familiarité avec l’univers de Strauss y sont pour quelque chose. Sans doute enfin l’incroyable engagement du plateau n’y est pas étranger, mais tout de même, je n’avais pas entendu ce Jordan-là depuis longtemps et il est l’un des artisans, sans aucun doute possible, du triomphe de la soirée. Il porte l’orchestre et le plateau à incandescence, bien plus chaleureux et bien plus sensible qu’un Thielemann soucieux de précision sonore millimétrée, mais incapable de transmettre toute chaleur et tout allant prêts à s’exhaler.
Le plateau est de ceux qui emportent totalement l’adhésion et pas seulement à cause des deux stars féminines de la soirée. C’est d’abord un plateau homogène et engagé, où la troupe de Munich confirme une fois de plus un degré de qualité étonnant. La manière de composer la distribution montre aussi un haut degré de professionnalisme : jusqu’au moindre petit rôle, y compris les deux acteurs jouant Jankel (Tjark Bernau) et Djura (Vedran Lovric).
Heike Grötzinger promène son beau mezzo dans la cartomancienne (die Kartenaufschlägerin), les « trois comtes » amoureux, sont remarquables, à commencer par le Lamoral de luxe de Steven Humes, déjà à Salzbourg l’an dernier, mais qu’on a l’habitude de voir dans des rôles de basse wagnérienne, mais aussi les deux membres de l’ensemble munichois, le Graf Dominik d’Andrea Borghini, baryton formé à l’opéra studio de Munich, et Dean Power, le ténor irlandais qui semble être ici de toutes les distributions et toujours excellent.

On aurait aimé peut-être une Fiakermilli moins acide que la jeune norvégienne Eir Inderhaug: la voix fait les aigus demandés, l’actrice fait le rôle de Domina excitée voulu par la mise en scène , mais la composition d’ensemble est bien moins séduisante que d’autres Fiakermilli (Daniela Fally l’an dernier à Salzbourg ou plus loin dans le temps, Natalie Dessay qui était tout simplement phénoménale) : c’est proche du cri, cela manque de rondeur, c’est légèrement vitriolé et donc pas très agréable.
Kurt Rydl semble inusable : il était déjà Publio dans ma première Clemenza di Tito à Salzbourg (Levine)…en 1979. La voix a toujours un grave sonore, mais évidemment quelques accrocs, mais la composition est vraiment remarquable de naturel et d’efficacité dans ce père roublard et désespérant.

Doris Soffel à 67 ans reste impressionnante ; déjà son naturel en scène, ce côté à la fois aristocrate un peu passée (dans sa robe de chambre) au premier acte et un tantinet vulgaire au deuxième acte (elle s’éclipse pour quelques galipettes avec l’un des trois comtes), pour être maternelle et pétrie d’humanité au troisième acte. La mise en scène lui donne aussi un rôle plus élaboré et la voix est toujours puissante, toujours présente, toujours sans vraie faille : une vraie composition.
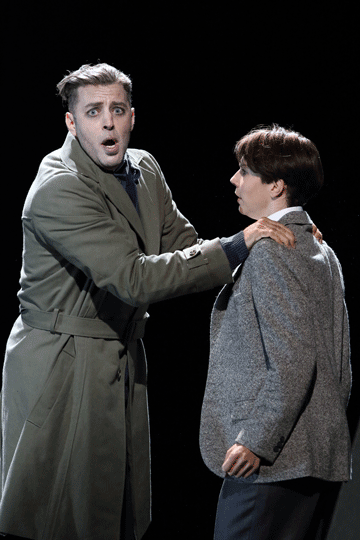
Le Matteo de Joseph Kaiser est bien connu, c’est même l’un des rôles que le ténor américain promène dans à peu près tous les opéras du monde. Il m’a semblé un peu en retrait vocalement ce soir, certes toujours efficace en scène, mais un Daniel Behle l’an dernier à Salzbourg était plus émouvant, plus intérieur, moins superficiel. La prestation reste très propre, mais sans couleur ni vraie personnalité musicale.
Thomas Johannes Mayer ne chante pas Mandryka, il est Mandryka: toutes ses attitudes, son jeu sont une incarnation du personnage voulu par Hoffmansthal, un sanguin au grand coeur, peu au fait des usages sociaux de l’aristocratie viennoise. Et cette facilité dans le rôle, on la retrouve dans un chant magnifique, comme on ne l’avait pas entendu depuis longtemps. On retrouve ses qualités intrinsèques comme un sens de la parole et une diction exemplaires, mais en plus il y a la puissance, il y a l’éclat, il y a même la jeunesse d’une voix qui semblait prématurément vieillie. Ce sont de véritables retrouvailles avec un artiste dont on connaît l’intelligence et la sensibilité, et qui fait montre ce soir de toutes les qualités qu’on craignait disparues au vu de certaines représentations difficiles ces dernières années.

Et nos deux sœurs : depuis l’an dernier, nous connaissons la Zdenka d’Hanna-Elisabeth Müller qui a déjà triomphé à Salzbourg à Pâques, un pur produit maison, formée à l’opéra studio de Munich et désormais membre de la troupe, d’une incroyable fraîcheur et d’une sûreté vocale impressionnante. Elle a dans la voix un étonnant potentiel d’émotion. Son troisième acte est éblouissant de tendresse : le personnage est rendu dans ses moindres replis, il y a la timidité, il y a l’allant et l’élan, il y a la fraîcheur, il y a aussi la résolution, au-delà de toute honte bue.
Dans toute la partie travestie, elle est aussi vraie. En bref, on y croit, grâce à une voix vibrante, aux aigus triomphants. Le fameux duo du premier acte Ich red’im Ernst entre Arabella et Zdenka est peut-être le plus beau entendu sur une scène depuis longtemps, avec une harmonie entre les deux voix, une homogénéité que je n’ai pas trouvée depuis des lustres : on en tremblait tant c’était bouleversant.
Aurait-on trouvé une future Lucia Popp ?
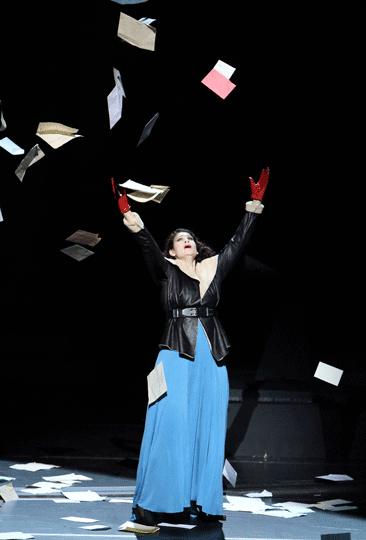
Enfin, Anja Harteros, pour qui c’est une prise de rôle s’inscrit d’emblée dans la légende des Arabella : je l’ai rarement entendue si naturelle et si émouvante. Certes, Strauss lui va bien, car elle lui donne une vie avant de lui donner une voix. Elle est en scène plus jeune femme que jeune fille, très maternelle avec Zdenka, elle est avec les trois comtes un peu coquette, et quand elle est seule en scène, elle retrouve une fraîcheur et une insécurité de jeune fille. Et toutes ces inflexions se retrouvent dans une voix d’ailleurs un tout petit peu hésitante au départ, et puis qui rapidement reprend son assise (le duo dont il était question précédemment est évidemment une merveille) avec des aigus d’une facilité et d’un éclat déconcertants, mais surtout des accents d’une vérité aujourd’hui unique. L’art du chant à son sommet. Un chant décidé, un chant quelquefois presque agressif, un chant incarné pour une incarnation unique d’une Arabella enfin sortie de la Chantilly et qui crie la vie, et qui crie la femme, et qui crie l’amour. Pour tout dire, je suis émerveillé par cette interprétation rayonnante.
Et ce bonheur qu’elle semblait partager avec la salle lors des saluts, éclairait son visage comme je l’ai rarement vu.
Voilà une soirée mémorable, comme il y en eut pas mal ces derniers jours à Munich, et comme il y en a souvent dans les Strauss joués dans cette maison.
Habemus Arabellam, pour de longues années. [wpsr_facebook]


Totalement d’ accord!!!
Je me suis réjouie de la décision de l’opéra de Munich de retransmettre en livestream cet Arabella (plutôt qu’un Pelleas et Mélisande que j’ai vu à Munich quelques jours avant mais qui m’a laissé perplexe), car, comme vous le dîtes si bien, ce fut un grand moment musical (et scénique) de tous les points de vue.
Anja Harteros a déjà chanté le rôle à Dresde, mais de fait, c’est une prise de rôle à Munich (et dans cette nouvelle production). En tout cas, elle fait très largement oublier Renée Fleming (mais pas totalement Karita Mattila, il y a quelques années au Châtelet). J’étais également à la représentation de vendredi soir et j’en suis encore bluffé !