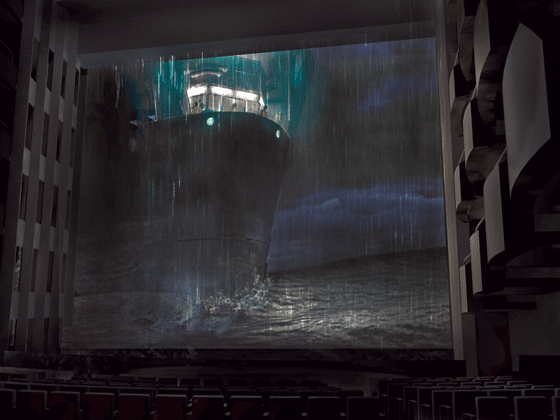Première production de la saison, ce Fliegende Holländer était très attendu, notamment à cause de la mise en scène d’Alex Ollé (La Fura dels Baus) et parce qu’un Wagner est toujours attendu, comme les choses rares.
On connaît l’approche d’Alex Ollé, très esthétique, mais bien moins dramaturgique que celle de alter ego à la Fura dels Baus, Carlus Pedrissa et de ce point de vue, le spectacle de Lyon est à la fois techniquement et esthétiquement l’un des plus accomplis et dramaturgiquement moins original, presque traditionnel.
L’idée de départ est d‘identifier dans le monde un lieu suffisamment perdu et pauvre où un homme pourrait vendre sa fille, et Ollé imagine les landes sablonneuses et mouvantes d’un Bangladesh où finissent les vieux navires en instance de dépeçage. Une sorte d’enfer sur terre où tout vaisseau devient fantôme.

Le décor de Alfons Flores (qui a déjà signé ceux de Tristan und Isolde et d’Erwartung à Lyon) représente une étendue sablonneuse et une haute proue de navire rouillée. Le plateau lyonnais, assez vaste, ce que masque une ouverture de scène de largeur moyenne, permet des décors monumentaux. C’est le cas ici et c’est assez impressionnant.
Sur cette structure fixe, vont être projetées des vidéos de Franc Aleu qui s’adaptent au décor avec des effets d’illusion et de trompe l’œil hallucinants: tempête, rivage rocheux, ciels tourmentés, tout y est, et c’est stupéfiant de réalisme avec des images d’une grande beauté.
La proue de navire unique est Le Vaisseau par antonomase : elle va servir pour figurer le navire de Daland, puis celui du Hollandais, et ensuite être cette carcasse morte qu’on dépèce, tout le village participant à l’opération, les hommes arrachant et transportant (un peu facilement) des pièces de fonte énormes, les femmes triant tout le petit matériel résiduel (compteurs pièces métalliques, vis, clous etc…) au lieu de filer comme dans la version traditionnelle. Car le navire unique est tout à la fois, celui qu’on conduit, celui qu’on dépèce, et celui qui traversé par la mort, présente dans tous les instants, devient le fantôme qui hante ces rivages.

On nous propose en fait la vision d’une petite communauté pauvre dont le chef Daland amène les navires à dépecer. Tous ces navires en fin de vie deviennent tour à tour des fantômes. D’où le symbole évident du dépeçage en arrière plan quand l’histoire se déroule : cette communauté vit de la mort des vaisseaux, elle fabrique du fantôme. Il y a une logique au rêve de Senta.
D’un point de vue dramaturgique, rien de bien neuf comme souvent chez Alex Ollé : tout est dans les images, à vrai dire magnifiques, tout est dans la fascination du spectacle, comme un grand livre de rêve ou de cauchemar: quelque part, nous spectateurs, nous vivons tous le rêve de Senta.
Comme toute cette histoire est transposée quelque part au Bangladesh, le chœur des « fileuses » danse une sorte de danse indienne, avec des gestes adaptés, c’est le seul côté faussement authentique et vaguement ridicule de l’entreprise.

Les personnages évoluent dans une étendue sablonneuse, en fait le sable est au premier plan, le reste est constitué d’un sol mouvant, une structure gonflable (un peu comme dans la Flûte Enchantée de la même Fura dels Baus) sur laquelle il n’est pas facile de marcher, sur laquelle on trébuche, comme si on était sans cesse en déséquilibre. Mais cette structure est parfaitement adaptée aux projections : lorsqu’on y projette les vidéos représentant les rochers ou la mer, elle apparaît comme autant d’îlots lorsque les personnages sont éclairés par les beaux éclairages d’Urs Schönebaum qui contribuent à les isoler et les mettre en danger.
Et à la fin, si le hollandais disparaît avec ses marins, noyés, Senta reste, debout sur son îlot, ou debout sur les eaux, comme dans les grandes morts d’amour, comme on a vu des Isolde mourir debout, ou des Brunnhilde, ou même des Traviata, sur une mer désormais apaisée. Magnifique image finale.

Au total, un travail sur le réalisme et la fantasmagorie, sur une histoire du XIXème dans un cadre contemporain parmi les plus désolés du monde, celui où vie et mort se côtoient et se superposent (les projections évoquent à la fois de manière hyperréaliste les flots et les rochers, mais aussi les cadavres ou les fantômes, qui pourraient être les marins du hollandais comme les ouvriers bangladais morts à la tâche, tués par la pollution, l’effort ou la sécurité défaillante, comme le figure la passerelle d’accès au navire si raide et si haute, défi à la sécurité des hommes (et des chanteurs).
Musicalement, on a toujours l’impression que la direction de Kazushi Ono est sèche, mais en l’occurrence je pense que l’acoustique du théâtre participe beaucoup de cette impression. Certes, Kazushi Ono est habituellement moins à l’aise dans le romantisme que dans le XXème siècle qui est plutôt son univers, mais ici son approche est cohérente, nerveuse, dramatique, sans pathos (alors que c’est si facile), mais sans froideur non plus. L’orchestre est très bien tenu, le son est plein, et même si on note quelques scories çà et là dans les cuivres, l’ensemble est très honorable. Dans cet « opéra romantique » qui combine la continuité dramatique, comme un crescendo, et des formes encore héritées de l’opéra italien, airs, duos, ensembles, il est difficile de choisir entre le romantisme un peu échevelée comme l’époque pouvait l’aimer et une lecture appuyée sur les racines de la musique de l’avenir. D’ailleurs Wagner est revenu sur sa composition notamment en 1860 en lui donnant la forme qui est jouée par tous les théâtres ou presque aujourd’hui, en modifiant l’ouverture et la scène finale, supprimant les brutaux accord finaux pour y insérer le thème de la rédemption par l’amour, qui est structurel de toute sa dernière période créative. Le final de 1841 insiste sur le drame de Senta et scande une fin « définitive », le final de 1860 est plus ouvert et plus positif, insiste en quelque sorte sur le thème de la Liebestod, et dit la force de l’amour. Kazushi Ono a choisi une version médiane, optant à l’ouverture pour les accords de 1841, et respectant la version de 1860 pour le final, faisant ainsi de ce récit l’histoire d’une évolution et la naissance de la force de l’amour.

Au service de cette conception très engagée, le chœur de l’Opéra de Lyon, dirigé par Philip White, se montre à la hauteur de l’ensemble, on l’a rarement entendu plus engagé et plus somptueux, c’est dans cette œuvre un protagoniste et le début du 3ème acte est impressionnant vocalement comme visuellement (où la scène rappelle vaguement, très vaguement par ses éclairages la mise en scène de Harry Kupfer à Bayreuth).
Du point de vue vocal, les rôles masculins sont plutôt bien tenus, voire excellents.
Le Daland de Falk Struckmann ne doit pas être rapporté à ses Wotan décevants des dernières années. D’abord, le rôle est différent, ensuite, au-delà de l’état réel de la voix aujourd’hui, l’artiste démontre ici un sens du phrasé, un souci de la parole et de la sculpture du mot qui font de son Daland un vrai modèle du genre. Le timbre reste intéressant et si la voix a un peu vieilli, la prestation d’ensemble est de premier ordre . C’est pour moi au niveau de l’expression et de la couleur sans doute la prestation la plus accomplie du plateau. Et pourtant, il n’est pas épargné par la mise en scène au premier acte où il doit descendre (attaché à un fil de sécurité) et surtout remonter une passerelle très raide et haute de plusieurs mètres. On le sent d’ailleurs à la peine dans la remontée…pas très bon pour le souffle tout ça.
À ce Daland si soucieux de la vérité des mots et si remarquable, le Hollandais de Simon Neal donne une réponse très forte, malgré un timbre moins chatoyant. Non que la prestation soit médiocre, mais le timbre est moins riche, et la voix un peu plus opaque. C’est assez cohérent dans la logique de la mise en scène, mais on a l’habitude de Hollandais plus spectaculaires et plus sonores. Il reste qu’il n’y a pas de défaut technique particulier, la diction, comme toujours ou presque chez les chanteurs anglo-saxons, est impeccable (je l’avais déjà noté dans son Œdipe à Francfort) pour cet artiste habitué des scènes allemandes, et les aigus sont très bien négociés et très puissants. C’est un Hollandais de grande facture, et l’opposition Daland/Hollandais est ainsi très bien construite. À noter que Samuel Youn, le Hollandais de Bayreuth, l’a remplacé le 24.
L’Erik de Tomislav Mužek, qui chantait aussi le rôle à Bayreuth m’est apparu encore plus à l’aise que sur la colline verte. La personnalité scénique est touchante, et Alex Ollé en fait un personnage un peu décalé (dans l’histoire, c’est un chasseur – un terrien- perdu dans un monde de marins et raillé par les autres) toujours armé, un peu perdu dans ce monde marin comme Senta est un peu perdue dans le monde tout court.
Le timbre n’est pas exceptionnel, mais le contrôle sur la voix et la technique sont remarquables, la voix est homogène dans sa montée à l’aigu et la couleur est vraiment celle d’un futur ténor dramatique ; Erik n’est pas une voix légère, et bien des futurs Siegmund ou même des Siegfried (Manfred Jung) l’ont chanté. Il y a dans la voix et dans la technique de Tomislav Mužek quelque chose qui me fait penser à un futur Siegfried, avec cependant dans la voix une très belle technique pour alléger ou pour filer les notes, presque une technique à l’italienne. Voilà pour moi une voix à suivre, qui devrait aller se développant.
Le Steuermann du ténor canadien Luc Robert m’est apparu avoir une voix presque trop large pour le rôle, ou d’une couleur un peu plus sombre que d’habitude. Luc Robert est habitué à des rôles de lyrique un peu plus lourds comme Don Carlos ou Ernani qu’il fera au MET alternant avec Francesco Meli qu’il doublera probablement. Mais la prestation est bien dominée, et le chanteur est assez émouvant, même si la couleur n’est pas exactement celle attendue dans le rôle.
Une belle surprise avec la Mary de Eve-Maud Hubeaux, jeune mezzo genevoise, deuxième prix du concours du Belvédère. On a plus l’habitude de voir des mezzo plus murs, voire hors d’âge que des jeunes chanteuses dans ce rôle. Et le timbre chaud, la voix large et assise de cette jeune chanteuse née en 1988 se remarque et donnent à Mary une véritable présence, c’est clairement pour moi l’une des meilleures Mary entendues. Une jeune chanteuse riche d’avenir.

J’ai gardé pour la fin la Senta de Magdalena Anna Hoffmann, qui à vrai dire ne m’a pas autant enthousiasmé que dans Erwartung à Lyon en 2013 (toujours avec Alex Ollé). Incontestablement il y a dans ce chant de l’intelligence et une vraie volonté de coloration, d’interprétation dans le travail du texte, il y a aussi dans le personnage et le jeu beaucoup d’émotion et de sensibilité : l’engagement scénique est total. Mais du point de vue vocal, les aigus redoutables de Senta restent un peu serrés, et quelquefois criés plus que chantés, comme si la voix était aux limites. On sent qu’il y a très peu de réserves et l’artiste paraît moins à l’aise vocalement que lors d’autres prestations dans d’autres rôles. C’est dommage, mais il reste que l’engagement de l’artiste et son incandescence dans les grandes scènes (la ballade, la scène finale, les duos avec Erik) font que la personnalité emporte l’adhésion et que la performance reste passionnante.
Au total, cette première production de la saison est vraiment convaincante, on pourra la voir à Lille dans le futur (coproduction avec Lille, Bergen et Sydney) : un grand spectacle, impressionnant et particulièrement bien dominé techniquement, une direction musicale vigoureuse, avec un orchestre très bien préparé, qui anime et entraîne un plateau de haut niveau. Une fois de plus, l’opéra de Lyon ne manque pas à sa réputation et ce Vaisseau ouvre une saison qui s’annonce très riche et particulièrement stimulante. [wpsr_facebook]