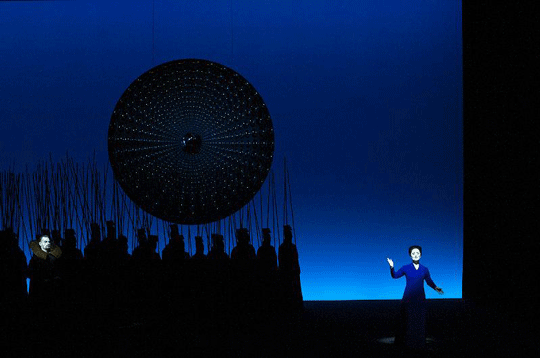J’ai aimé, j’ai adoré Bob Wilson. Je n’ai manqué aucun de ses spectacles entre la fin des années 70 et les années 90. Je suis même allé au fin fond de l’Ohio voir une de ses premières œuvres « Poles », une installation en pleine campagne en face d’une école Montessori à Grailville, à quelques encablures de Cincinnati où je séjournais. J’ai vu Einstein on the beach, Parsifal, Salomé, Le Ring, Orlando (avec une fulgurante Isabelle Huppert), Butterfly et plein d ‘autres choses encore.
J’avoue qu’il n’arrive plus à m’étonner, même si ses spectacles restent fascinants, et cette Norma produite en 2010-2011 à l’Opéra de Zurich et reprise pour la première fois cette saison n’y fait pas exception.
Quand je fais le bilan de mon parcours lyrique, je n’ai pas souvent vu Norma. Ma première fut à Orange en 1974, lors d’une représentation mythique avec Montserrat Caballé et Jon Vickers, Joséphine Veasey en Adalgisa sous la direction de Giuseppe Patanè injustement oublié et pas toujours bien considéré, au temps où Orange représentait quelque chose dans le paysage. Cette représentation existe en vidéo, et il faut sans cesse y revenir pour comprendre ce que peut et doit être Norma.
À la Scala, dans la mise en scène de Mauro Bolognini (1972) reprise deux fois (en 1974-75 et 76-77) avec dans les trois séries Montserrat Caballé en Norma et Cossotto, Cortez et Troyanos en Adalgisa, l’œuvre n’a plus été reprise. Et c’est un signe.
Les dernières divas qui ont marqué le rôle en Norma sont Joan Sutherland, qui a chanté essentiellement dans les pays anglo-saxons, Beverly Sills, qui n’a pratiquement jamais quitté les USA, et Montserrat Caballé qui l’a chanté un peu partout. Cela remonte aux années 70…
Bien sûr je n’oublie pas Callas ni Gencer, hors compétition, ni Gruberova, merveilleuse chanteuse, mais que je n’arrive pas à sentir en Norma, ni la récente Bartoli, impressionnante en scène à Salzbourg. Le reste est broutille.
Car il faut pour Norma à la fois la rondeur et la douceur sonores, le lyrisme éthéré et un sens dramatique aigu, sans que le rôle ne verse dans le répertoire de soprano dramatique. Et d’ailleurs si l’on a coutume de donner Norma à un soprano et Adalgisa à un mezzo soprano, il n’est pas sûr que les choses soient aussi claires. Au niveau du timbre, Adalgisa est un timbre plutôt clair et Norma un timbre plutôt sombre : écoutons Leyla Gencer dans le rôle et écoutons les premières répliques du personnage. Ecrit à un moment où les caractéristiques vocales n’étaient pas aussi délimitées qu’aujourd’hui, le rôle de Norma sied à une large palette de tessitures, des mezzos qui ont envie d’être sopranos, des sopranos qui sont en réalité des mezzos manqués : il faut engagement vocal et dramatique, il faut les aigus et suraigus, il faut du grave et surtout une capacité à passer du grave à l’aigu sans vaciller, il faut l’agilité, il faut la souplesse, il faut savoir filer les notes, il faut le contrôle. Bref, il faut tout et son contraire et c’est la raison pour laquelle seules des sopranos d’exception, les artistes planétaires, d’une intelligence et d’une intuition peu communes ont pu triompher dans ce rôle ou bien plutôt le marquer à jamais.
Cela n’empêche pas qu’aujourd’hui bien des chanteuses se frottent au rôle, et même avec succès, mais c’est un opéra qu’on donne assez peu, et le public ne mesure pas toujours les exigences du rôle, l’importance de l’orchestre, et la nécessaire homogénéité de la distribution : toute Adalgisa se rêve un jour Norma, si par hasard elles ne chantent pas alternativement les deux. On a même vu côte à côte la mezzo Bartoli en Norma, et la soprano Sumi Jo en Adalgisa.
Tout de même, si la créatrice du rôle Giuditta Pasta est à l’origine un mezzo comme la Malibran, la tendance aujourd’hui est de le distribuer à un soprano (et Bartoli fait exception, mais elle se l’est distribué..).
Il était donc d’autant plus intéressant de profiter de ma présence à Zurich pour un autre opéra moins complexe à distribuer (Tristan) et d’aller voir cette Norma proposée il y a quatre ans dans une mise en scène de Robert Wilson (on disait plutôt Bob, on dit aujourd’hui Robert…) alors avec Elena Mosuc (qu’on a vue dans Norma à Lyon et Paris en concert l’an dernier) et cette fois avec Maria Agresta, qui est en train de gravir à grande vitesse les sentiers de la gloire, sous la direction du directeur musical de Zurich, Fabio Luisi.
Bien m’en a pris parce que ce fut une belle soirée.
Norma est à l’origine une tragédie (1831) d’Alexandre Soumet, Norma ou l’infanticide, qui est à la Gaule ce que Médée est à la Grèce. Beaucoup de mauvaises tragédies ont fait de très beaux opéras, et les bonnes tragédies peuvent faire de beaux opéras, mais ce n’est pas systématique. La même année, Bellini en fait un opéra. C’est une tragédie et donc Bob Wilson crée un espace tragique, une action tragique, comme si tragique rimait avec désincarné, distant et hiératique. C’est beau, c’est lointain, c’est lent…et le travail de Bob Wilson n’est pas différent de ce qu’il fait ailleurs pour d’autres œuvres, inspiration du Nô japonais, hiératisme des figures, gestes lents et personnages isolés, ne se touchant pratiquement jamais, dans une sorte de jeu de marionnettes humaines où apparaissent çà et là des animaux mythiques (Licorne) ou symboliques (Lion), le tout dans des éclairages merveilleux, avec des transitions subtiles et des références théâtrales précises : les croisements des traines, Giorgio Strehler l’avait utilisé avec quel brio et quelle justesse dans Macbeth…en 1975, et bien des techniques d’éclairage (les contre jour) avaient déjà été expérimentées et utilisées par le grand metteur en scène italien.
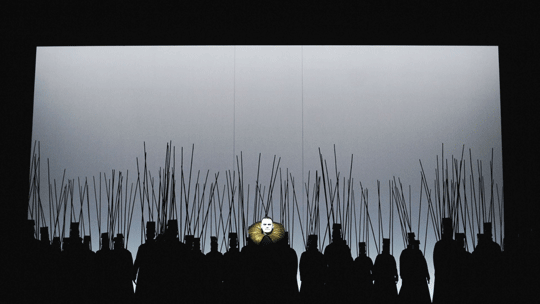
Il y a de belles images comme le chœur (vraiment excellent, dirigé par Ernst Raffelsberger) affublé de rameaux effeuillés, qui est à la fois chœur et forêt décharnée quand il est assemblé, mais qui rappelle aussi des armes ou des lances, et donc l’ambiance guerrière qui règne ou du moins l’attente de l’attaque et d’une révolte que Norma repousse systématiquement en utilisant ses prérogatives de prêtresse et ses dons de medium. Elle fait en somme ce que tous les prêtres de l’antiquité (et d’époques plus récentes) installés auprès des oracles ou des politiques faisaient (et font?), de l’exégèse religieuse dictée par la nécessité politique, par l’opportunité du moment, par les intérêts particuliers et, ici, personnelle.
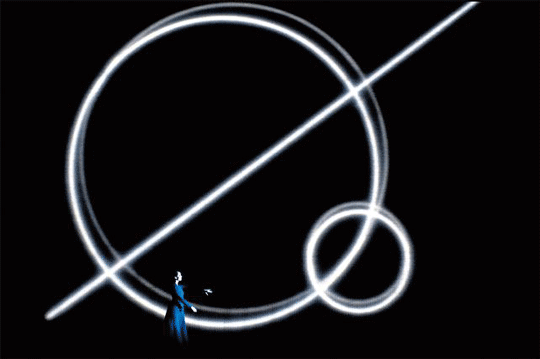
Pas d’autre dramaturgie qu’une succession de symboles, cercle traversé par des traits, lumières isolant des personnages, système solaire figuré scandant le dernier duo Norma-Pollione, des variations de lumières au milieu de décors essentiels, minéraux (trio final du 1er acte) ou métalliques. C’est beau, c’est même quelquefois fascinant (dernière scène et montée au bûcher), mais c’est tout de même un peu systématique (son Incoronazione di Poppea qu’on voit actuellement à Milan est une sorte de spectacle jumeau et on n’a pas l’impression d’avancer ou d’évoluer). Un travail wilsonien, pour ne pas dire un lieu commun wilsonien, ni plus, ni moins.

Il en va différemment musicalement, dans une salle aux dimensions idéales pour ce type de répertoire et pour les voix.
Le premier artisan en est Fabio Luisi. Sa très longue fréquentation du répertoire (il a passé grande partie de sa carrière comme chef de répertoire à Vienne, à Berlin et ailleurs – mais pas en Italie où finalement il n’a été redécouvert qu’assez récemment) en fait un chef très attentif au plateau, très soucieux de ne jamais pousser les chanteurs dans leurs retranchements, un chef à l’écoute, plutôt qu’un chef autiste comme il y en a beaucoup à l’opéra et surtout un chef ductile, capable de (bien) diriger Wagner aussi bien que Verdi.
Je trouve qu’au-delà du plateau, Fabio Luisi est l’artisan de la réussite de la soirée par une approche de la partition qui sait faire la place à l’épique et au lyrisme, par des variations de couleur qui ne se limitent pas aux seules variations de tempo : la manière rapide de diriger certains moments du chœur (« guerra ») ou l’ouverture se retrouve chez d’autres chefs notamment italiens, même si Bonynge nous a habitués à des tempos moins contrastés. En ce sens Fabio Luisi s’inscrit dans la vraie tradition italienne.
Moins traditionnel en revanche le souci de fouiller la partition, d’en relever certaines phrases, de clarifier les différents niveaux, d’exalter certains pupitres, de savoir alléger jusqu’au murmure. Moins traditionnels l’élégance des transitions et la souplesse des phrasés. Fascinants les pizzicati « cachés » qu’il nous révèle, le soin mis à exalter altos et violoncelles, comme pour nous indiquer que la partition n’est pas un écrin pour chanteurs, mais qu’elle porte en elle à la fois et couleur et profondeur, et qu’elle est la créatrice de la dynamique musicale de la soirée. À ce titre, la scène finale, à l’orchestre, est vraiment bouleversante, et crée bonne part de l’émotion qu’elle diffuse.
Doit-on rappeler l’admiration que Wagner portait à Bellini : il a lui-même dirigé Norma à Riga, et a écrit sur la mélodie bellinienne et son apparente simplicité des lignes bien senties. Et Wilhelmine Schröder-Devrient, qu’il admirait et qui fut sa créatrice de Senta, d’ Elisabeth et d’Adriano de Rienzi, fut une notable Norma qu’elle interpréta même sur la scène de Zurich.

Nous devons reconnaître qu’ici Luisi travaille dans le tissu de la partition, dont il révèle des détails inconnus, et donc un tissu orchestral plus complexe et profond qu’il n’y paraît : Bellini va plus loin que la mélodie auquel on le réduit souvent et cette direction donne a l’ensemble une grande cohérence; elle permet notamment d’homogénéïser le plateau. Un plateau globalement satisfaisant, avec de belles personnalités, émergentes ou non.
La Clotilde de Judith Schmid s’impose par une voix forte, bien projetée, mais sans vraie couleur, un peu trop « droite » tandis que le Flavio de Dmitry Ivanchey, droit venu de l’Helikon de Moscou et qui appartient à la troupe (excellente) de Zurich se sort avec honneur du rôle qu’il aborde, tout comme sa collègue pour la première fois.
La surprise très agréable vient de l’Oroveso de Wenwei Zhang, jeune basse chinoise qui a travaillé à l’Opernstudio de Francfort, désormais en troupe à Zurich. Une voix qui, sans être forcément large, est parfaitement projetée, et qui donc convient parfaitement à la salle. Son visage asiatique sied aussi aux maquillages wilsoniens et c’est l’un de ceux dont la tenue en scène correspond le mieux par son hiératisme et sa fixité à la volonté de la mise en scène. De plus, la diction est claire, l’émission parfaite, le phrasé soigné, chacune de ses apparitions a été un vrai moment musical. Ce n’est pas pour l’instant une voix spectaculaire, mais c’est incontestablement une voix. À suivre sans aucun doute : voilà un chanteur qui montre du goût, de l’intelligence et une vraie présence.
Marco Berti est un artiste qu’on voit beaucoup sur les scènes, il fait partie de la catégorie (rare) des ténors italiens. C’est une voix forte, avec des aigus placés et triomphants. Il répond sans aucun doute pour cela aux exigences du rôle de Pollione …s’il ne fallait que cela. Mais Pollione est un de ces rôles ingrats qui ne font jamais triompher, tant la présence de Norma est écrasante. Un Pollione, fût-il Vickers, fût-il Bergonzi, ne construira jamais sa carrière sur ce rôle. Rôle ingrat aussi que d’être une sorte de vilain, d’infidèle, même amoureux. Car l’amour, n’est-ce pas, n’explique pas tout.
Un rôle ingrat parce que, comme les rôles féminins, il n’est pas clairement défini. Pour sûr ce n’est pas un ténor di grazia, mais pas plus un ténor dramatique. C’est un ténor pour rôles difficiles de type Florestan ou Enée, nécessitant une voix large, mais modulée, des aigus dardés, mais du style, mais de la couleur, un dramatico-belcantiste (catégorie qui n’existe pas), aujourd’hui on pense à Brian Hymel, à John Osborn, peut-être qui excella à Salzbourg. Ce fut aussi Vickers parce que Vickers savait ce que chanter signifie (n’oublions pas qu’il fut aussi bien Tristan qu’Otello ou Nerone de Poppea), ce que colorer signifie. Ce fut Bergonzi parce que en matière d’émission et de style, il était unique. Marco Berti chante à peu près Bellini comme il fait Puccini, aigus dardés, trop poussés (au début notamment dans une salle aux dimensions très moyennes) manque de legato, manque de style et difficultés à affronter les passages, les agilités et les modulations pour lesquels il a systématiquement de gros problèmes de justesse. Avec sa technique, son intonation est en permanence au bord de la rupture, un peu comme le fut Salvatore Licitra, Marco Berti répond en force contrôlée, mais pas en élégance, mais pas en style. Il en ressort un personnage qui sonne vériste, cinquante ans avant le vérisme.

Roxana Constantinescu est une jeune mezzo roumaine, qui aborde ici Adalgisa pour la première fois. Sans nul doute il y a du style, un soin très sourcilleux apporté aux notes filées, à l’expressivité, à l’élégance. Sans nul doute aussi il y a une technique bien maîtrisée acquise à l’école de Mozart ou de Rossini qu’elle a beaucoup chantés déjà, il y a quelquefois de l’émotion et toujours de la vie. Ce qui lui manque le plus souvent c’est de la couleur, c’est une personnalité vocale affirmée. Son Adalgisa est bonne, mais elle manque d’incarnation. Le timbre est assez quelconque et il faut à mon avis qu’elle travaille plus l’expressivité. Il est vrai que la mise en scène un peu vitrifiée de Bob Wilson n’aide pas à se revêtir d’un rôle, mais elle aurait dû peut-être lui permettre d’aller fouiller le chant et la musique. Je tournais autour du pot mais je crois avoir trouvé ce qui pour mon goût fait problème, c’est quelque part la musicalité, ou l’intuition musicale. Il reste que la prestation est fort honorable. Mira o Norma fut un vrai moment de bonheur.
Maria Agresta fait figure de nouveau phénix du chant italien et on l’a vue aborder tous les grands rôles de soprano verdien, mais aussi Puritani à Paris.
J’ai souligné les difficultés de Norma et les pièges de ce rôle aux multiples facettes. Et la soprano italienne s’en sort avec tous les honneurs. Elle triomphe grâce à une belle présence scénique, grâce à une grande sûreté vocale sur toute l’étendue du registre, le registre aigu et suraigu bien sûr et le registre grave, bien dominé et jamais détimbré. La couleur est plutôt claire, mais l’assise est large. Et la présence vocale prend de plus en plus d’assurance, le deuxième acte est vraiment émouvant, contrôlé, très senti.
Certes, on relève dans Casta Diva non des difficultés, le mot serait trop rude, mais quelques menus problèmes de passages (avec les conséquences sur quelques petits problèmes d’intonation), de trilles, et un certain manque d’homogénéité, mais n’est pas Caballé qui veut et même Caballé avait ses détracteurs, voir ses chiens galeux qui hurlaient à son passage. D’ailleurs Agresta n’a pas vraiment une voix profilée « bel canto » au sens où on l’entend aujourd’hui, ces voix sous verre qui m’agacent et qui ne touchent pas, ces machines parfaites ou « crémeuses » qui vont droit à l’oreille mais jamais droit au cœur encore moins à l’âme. Agresta est plutôt de celles qui vivent, qui risquent, qui donnent, et c’est pourquoi elle me plaît. Hier, même dans la mise en scène de Bob Wilson qui revendique une sorte d’intériorité ou de « répression expressive », une sorte de formalisme qui pourrait être une gangue, Agresta vibrait, Agresta donnait, Agresta vivait et diffusait une jeunesse et presque une fraîcheur émouvante. C’est avec Wenwei Zhang celle qui a le mieux réussi à entrer dans le monde wilsonien.
Comme souvent à Zurich, une belle soirée musicale : malgré les réserves sur Wilson, monde à la fois minimaliste par ce qu’il montre et maximaliste par ce qu’il évoque, le spectacle donne à voir et à rêver, et la musique, vraiment, a fait le reste. Dans le genre Norma « traditionnelle » (c’est à dire sans instruments anciens, sans orchestre baroque, sans rêves bartoliens), on peut difficilement faire mieux à mon avis.[wpsr_facebook]