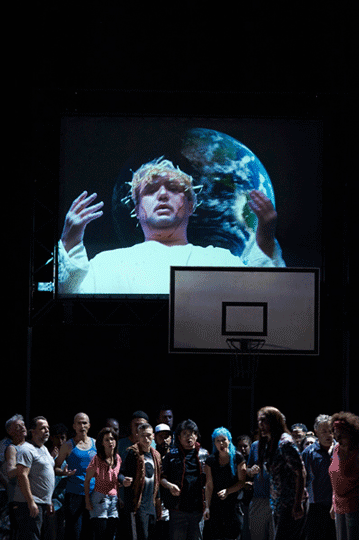Deux nouvelles productions de Meyerbeer à quelques semaines de distance, l’une à Berlin (Vasco de Gama – L’Africaine) l’autre à Karlsruhe (Le Prophète) ; ces dernières années on a vu aussi réapparaître Les Huguenots (à la Monnaie et à Strasbourg, mais aussi à Nuremberg) et on l’annonce à Paris. Que se passe-t-il au royaume de l’Opéra ? Meyerbeer reviendrait il à la mode ? L’auteur le plus populaire du XIXème siècle joué et rejoué à satiété, on dira même jusqu’à l’écœurement, devenu terrible routine parce que victime de son succès, mais aussi victime de l’antisémitisme (il sera interdit par les nazis) a disparu des scènes lyriques depuis des dizaines d’années. Pourtant, dans mon souvenir, Robert Le Diable programmé par Massimo Bogianckino à Paris en 1985 fut plutôt un succès malgré la piètre mise en scène de Petrika Ionesco (quelle distribution il est vrai ! Rockwell Blake, June Anderson, Samuel Ramey…), mais ce fut un coup d’épée dans l’eau car il n’y eut ni reprise, ni Meyerbeer Renaissance.
Meyerbeer est difficile à monter, à cause de l’énormité des spectacles (longs, onéreux, exigeant des chœurs ordinaires et extraordinaires), à cause de la rareté du répertoire qui exige de la part des orchestres une étude ex nihilo et donc un long travail de préparation, à cause surtout de l’extrême difficulté du chant qui combine le bel canto romantique et le bel canto rossinien, notamment pour les ténors, et qui demande un nombre de chanteurs de grand niveau à peu près impossible à réunir. C’est donc une entreprise assez risquée, qui engage, et aujourd’hui les managers n’ont pas droit à l’erreur.
Cette difficulté rend d’autant plus méritoire que des théâtres comme Nuremberg et Karlsruhe se soient lancés dans l’aventure : certes ils représentent une vraie tradition, sont des Staatstheater, théâtres d’Etat, et ils ont des troupes valeureuses, et de bons orchestres, Karlsruhe notamment. Mais on reste un peu étonné que ces théâtres qui ne font pas partie des plus importants d’Allemagne (mais souvent des plus intéressants) osent ce qu’aucun théâtre français n’a osé ces dernières années (Strasbourg excepté), même si Nice coproduit Les Huguenots de Nuremberg.
Ayant été séduit par le travail de Tobias Kratzer sur Les Huguenots de Nuremberg, et enthousiasmé par ses Meistersinger à Karlsruhe, j’ai repris la route pour la capitale badoise lorsque j’ai su qu’il s’y montait Le Prophète. Bien m’en a pris, c’était sans nul doute l’un des meilleurs, sinon le meilleur de tous les spectacles vus en ces premiers mois de la saison, remarquable par sa mise en scène, mais aussi par une réalisation musicale qui sans réunir les plus belles voix du monde pour ce répertoire, réussit à convaincre à tous les niveaux. Je l’écris d’emblée : cette production est visible jusqu’au début du mois d’avril, et vous auriez grand tort de ne pas faire le voyage, a fortiori si vous êtes alsacien ou lorrain.
On a tellement écrit sur la médiocrité de la musique de Meyerbeer, – il fallait donc que le XIX° siècle eût bien piètre goût pour porter au pinacle un tel compositeur – que lorsqu’on entend ce Prophète (que j’ai en CD, mais que je n’avais jamais entendu en salle), on demeure très surpris de la qualité de cette musique, de son sens dramatique, de son dynamisme, mais aussi, et ce n’est pas toujours vrai des opéras de Meyerbeer, de la qualité du livret, ou du moins de la qualité de l’intrigue et des questions qu’elle pose. Et de plus le travail de Kratzer a rendu au livret une légitimité et une urgence dont il pourrait être dépourvu dans d’autres mains.
C’est enfin une musique spectaculaire, tendue, nerveuse, qui sait aussi être ironique, qui sait aussi être subtile et raffinée, et qui montre des moments d’un très grand lyrisme et d’une très grande émotion. L’orchestration n’est pas simple, bien au contraire: Meyerbeer sait mettre en scène l’orchestre, mettre en valeur l’instrument (les harpes!), et c’est un grand connaisseur des voix (il faisait répéter les chanteurs lui-même) que l’orchestre accompagne toujours avec efficacité, sans jamais les couvrir, même dans les ensembls et dans les concertati. Bien sûr Meyerbeer doit beaucoup à Rossini, à qui il vouait une admiration sans bornes (ils ont le même âge à un an près) – et qui ne doit pas à Rossini?- mais il était curieux de tous les compositeurs de l’époque, Donizetti, Bellini (dont il adorait Norma) et Verdi (dont il verra la plupart des opéras). Partageant sa vie entre Paris et Berlin, il succèdera à Spontini à Berlin, l’autre précurseur du Grand Opéra, que Napoléon adorait, que Wagner admirait, et dont Paris (où pourtant il a vécu de 1803 à 1820) n’entend plus parler depuis des dizaines d’années.
Mais si c’est un compositeur en prise directe avec son temps, Meyerbeer a aussi préparé la suite, et notamment Wagner, qui lui emprunte beaucoup, notamment au début de sa carrière (n’a-t-on pas dit que Rienzi est le meilleur opéra de Meyerbeer ?). En matière d’orchestration, en matière de structuration des partitions, en matière de leitmotiv, Meyerbeer est un précurseur.
Le Prophète est le troisième de ces immenses succès parisiens avant L’Africaine, parce qu’il en a interrompu la composition à cause d’un conflit avec le directeur d’alors, Léon Pillet. Dès que Pillet quitte l’Opéra, en 1847, Meyerbeer revient, et Le Prophète est créé en 1849, notamment par Pauline Viardot, pour qui le rôle de Fidès est écrit. Comme tous les Grands Opéras, c’est un drame historique, qui se passe à Dordrecht (Pays Bas) et Münster (Allemagne) au XVIème siècle et qui retrace l’histoire de Jean de Leyde et de la révolution des anabaptistes (1533-1536). Le livret, de Scribe comme la plupart des livrets des opéras de Meyerbeer, s’inspire notamment de L’essai sur les mœurs et l’esprit des nations, de Voltaire (1756) et prend beaucoup de liberté avec l’histoire.
Jean vit avec sa mère Fidès ; il est fiancé avec la jeune Berthe. Orpheline, celle-ci doit demander l’autorisation de se marier au Seigneur du village, Oberthal. Ce dernier la trouvant fort à son goût la lui refuse et retient la jeune fille et Fidès qui l’avait accompagné.
Au même moment, trois anabaptistes sillonnent le pays pour pousser les paysans à la révolte et cherchent à attirer Jean en qui il voient un futur roi tant sa ressemblance avec un portrait du Roi David dans la cathédrale de Münster est frappante, celui-ci refuse.
Berthe et Fidès réussissent à échapper à Oberthal, Berthe se réfugie chez Jean, mais Oberthal survient et menace de tuer Fidès si Berthe ne lui est pas livrée. Jean abandonne Berthe à Oberthal pour sauver sa mère.
Mais il décide de se venger. Pour cela il va rappeler les anabaptistes et s’y associer. Il part avec eux prêcher la révolte, mais doit abandonner sa mère et partir seul mener la lutte religieuse parce que désormais il est le « fils de Dieu » .
Si ce début est assez complexe, la suite est plus simple : Jean à la tête des anabaptistes vole de victoire en victoire, mais aussi de violences en violences au nom de la religion : au début de l’acte III, le chœur des anabaptistes réclame « Du sang ! ». Jean oublie sa vengeance, et devient assoiffé de pouvoir, manœuvré par les trois anabaptistes qui l’avaient « recruté », il devient une sorte de faux prophète « fils de Dieu » et conquiert Münster dans la violence, les religieux s’enrichissent en spoliant les riches ou en récupérant leurs biens après les avoir tués. Mais la victoire est fragile. Et déjà les trois anabaptistes songent à le livrer à l’ennemi pour sauver leur peau.
Fidès reconnaît son fils dans le faux prophète, ils finissent par se retrouver, Jean retrouve Berthe aussi, mais il est trop tard pour retourner au bonheur et Berthe se suicide tandis Oberthal surgit avec les trois anabaptistes pour se saisir de Jean, horrible explosion et tous périssent dans les flammes.
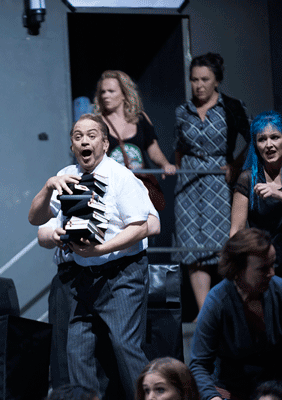
J’ai tenu à raconter cette histoire avec un relatif luxe de détails pour bien faire comprendre comment Tobias Kratzer sans rien transformer du livret, va en faire une histoire d’aujourd’hui, sur la manière dont la religion est utilisée pour manipuler les plus pauvres et ceux qui sont aux marges de la société, et sur la manière dont les guerres de religion cachent toujours des objectifs politiques ou économiques. Il pointe au passage les prédicateurs évangélistes outrageusement enrichis, les enlèvements contre rançon, et les dérives pédophiles de religieux abusant de leur pouvoir (dans la limousine de luxe de Jean, comme Oberthal violait Berthe dans la voiture de police)
Kratzer décide donc de transposer l’intrigue en France, dans une de ces cités en périphérie des villes. Le décor de Rainer Sellmaier installé sur une tournette (merci Castorf) représente d’un côté le café de Jean (aubergiste dans le livret) et la pièce attenante qu’il partage avec sa mère, et en dessous une sortie de parking et un garage entrepôt où des jeunes du quartier passent leur temps, sur le côté une voiture de police cabossée, et lorsque tout cela tourne, on découvre une dalle de béton sur laquelle les jeunes se réunissent autour d’un terrain de basket.

Si les lieux évoluent, la structure reste la même, on va passer du café de Jean à une pièce où les anabaptistes (vêtus en mormons) gèrent leur com, comptes twitter, vidéos etc…et la voiture latérale va être ensuite une carcasse qui brûle (lorsque le peuple se révolte violemment) et puis, quand Jean triomphe, une « limo » gigantesque.
Cette transposition recrée les rapports du livret original, en y superposant les violences des cités, la force de la religion avec laquelle on manipule les jeunes, la manipulation par la vidéo par les images et par le net. La fidélité au livret est totale, mais la transposition éclaire évidemment ce que la France vit depuis quelques années.
Tobias Kratzer imagine faire d’Oberthal un « flic » ripou qui commence par violer Berthe (un viol en réunion) et cette violence initiale appelle en retour la violence des pauvres, assoiffés de sang au nom de Dieu, voulant punir les mécréants et dépouillant les puissants.
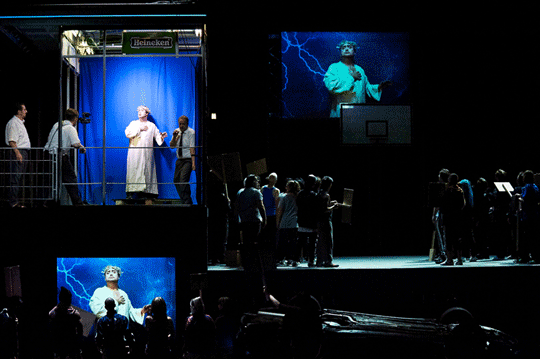
A cette lecture sociale s’ajoute évidemment l’évolution de Jean, brave type au départ, manipulé par les trois anabaptistes, comme dans le livret, qui s’engage à leurs côtés pour se venger, mais qui est entraîné dans la spirale infernale de la violence, du sang, mais aussi de l’argent et du pouvoir : il finit par croire en ce qu’il est pour la foule, un prophète suivi aveuglément, alors qu’il n’est qu’un prédicateur charlatanesque. Une des scènes les plus drôles est le discours qu’il fait à la foule pour la calmer, un discours sur écran où l’on voit à la fois le tournage en studio et le résultat sur écran avec le montage, les images superposées et les quelques hésitations et erreurs désopilantes en surimpression comme des chats danseurs, une mire, ou un film porno, sur la trace de ce qu’avait fait Tcherniakov pour La fiancée du Tsar à Berlin et à la Scala. Autre scène magistrale et idée géniale, l’arrêt sur image initial de l’acte III, partie de basket saisie en plein mouvement, suivie par le très fameux ballet des Patineurs (un must de ma prime jeunesse que j’écoutais en boucle), transformé en ballet breakdance incroyablement réussi, réaliste et parfaitement en phase avec la musique, qui remporte d’ailleurs un triomphe.

À la fin s’accumulent des scènes d’émotion, de trahison, de cynisme où les personnages sont enchainés à leur destin auquel ils ne peuvent finalement échapper, au milieu des airs, duos trios qui s’accumulent et s’enchaînent, et au milieu du sang, des meurtres, dans une violence désormais structurelle qui envahit tout le plateau et qui semble impossible à arrêter ou canaliser.
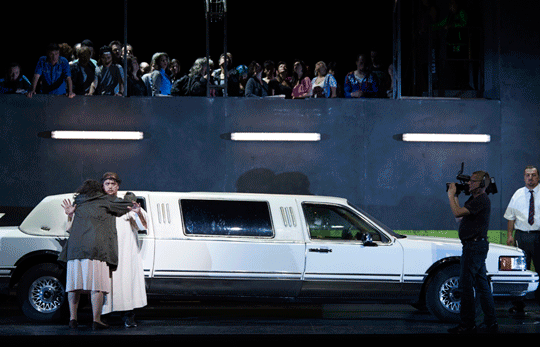
L’explosion finale prévue par le livret est mise en situation et légèrement postposée, provoquée non par l’arrivée d’Oberthal, mais par la réponse de Jean qui se fait exploser avec une ceinture d’explosifs et sa mère à ses côtés. C’est tellement saisissant que le public en reste interdit quand le rideau tombe.
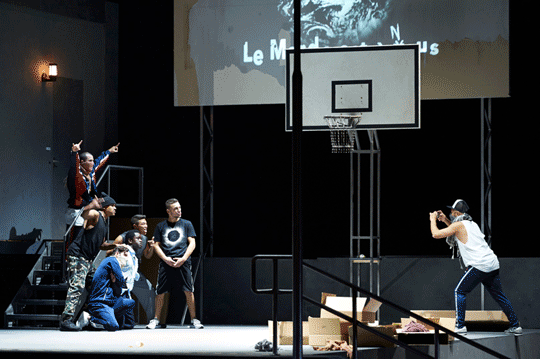
Ce qui frappe dans ce travail c’est d’abord l’extraordinaire précision scénique, dans les rapports humains, dans le jeu des chanteurs, dans la finesse avec laquelle les personnages sont caractérisés, petits gestes, regards, qui donnent un incroyable réalisme presque cinématographique à l’ensemble. C’est ensuite le reflet du livret original, sans aucune trahison, sans aller au-delà, mais en reprenant simplement les scènes sans rien y changer (et de fait, peu de coupures), mais en transposant les situations qui leur donnent une présence, une vérité, une crudité qui va jusqu’au malaise : les jeunes laissés à eux mêmes, leur oisiveté forcée, la manière dont ils dévorent la Bible, puis deviennent des soldats de Dieu assoiffés de mort. Kratzer disait s’être inspiré des attentats de janvier mais ce sont aussi les mécanismes des attentats de novembre qu’il nous décrit (cette mise en scène remonte à octobre dernier).
Enfin, on sent que Tobias Kratzer est un spectateur assidu : son travail, comme dans Meistersinger, est plein de références : on a parlé de Tcherniakov, mais il faut aussi parler de Castorf avec ce réalisme pointilleux et le discours idéologique sous entendu, et enfin Bieito à qui il emprunte la ceinture d’explosifs, vue dans Don Carlos à Bâle, un de ses spectacles les plus forts faisant de Carlos un terroriste de la gare d’Atocha, là aussi, en démontant la logique du livret sans jamais trahir ni Verdi, ni Schiller. Dans ce Don Carlos, le duo final Elisabeth Carlos était la préparation de l’attentat, et Elisabeth attachait à Carlos la ceinture d’explosifs en chantant un duo devenu prémonitoire. Kratzer reprend des idées, sans les copier, sans plagiat, parce que son travail a une rigueur et une logique implacables et tient en haleine le spectateur du début à la fin. Mais en même temps, il tient un discours intertextuel sur le théâtre d’aujourd’hui, sur les grands metteurs en scène actuels, sur les influences du cinéma, avec l’utilisation efficace de la vidéo, tantôt en direct à la Castorf pour donner au spectateur un autre point de vue, tantôt par des montages de films, tout cela combiné avec un jeu hyperréaliste, voire trash (la scène de viol) mais mêlant aussi à la violence le burlesque, l’ironie, le rire, les larmes, le pathos, la distance. Un travail prodigieux qui provoque, après le silence interdit (et le cri d’un spectateur le soir où j’y étais) à la dernière mesure, par un très grand succès et de longs applaudissements.
Tobias Kratzer est déjà un très grand, il sera un incontournable dans les prochaines années.
À ce travail remarquable qui confine quelquefois au génie, correspond un engagement du plateau rarement vu sur une scène : le chœur est d’une vérité criante, dans les attitudes, dans les gestes, dans l’allure, dans la manière aussi de dire le texte français, les danseurs de breakdance semblent sortis du portique de l’Opéra de Lyon qu’ils occupent régulièrement, les chanteurs donnent tout, jusqu’à épuisement. Il est vrai que Meyerbeer leur réserve des airs d’une incroyable longueur et d’une tension insoutenable (Jean à l’acte IV).
Enfin, l’orchestre est mené avec une précision et une subtilité vraiment exemplaires par Johannes Willig, premier Kapellmeister à Karlsruhe (dont le GMD est Justin Brown). À Johannes Willig a été confiée cette nouvelle production qu’il ne reprend donc pas au GMD comme souvent dans les théâtres de répertoire . La précision de son geste est prodigieuse, à guider les masses scéniques impressionnantes, à conduire chaque chanteur et à accompagner les nombreux solos des différents pupitres. Il faut dire aussi que l’orchestre lui répond avec une justesse rare : pas de scories, pas de décalages, tout est net, tout est dominé.
Johannes Willig montre bien sûr l’énergie et la dynamique de cette musique, mais aussi tout ce qu’elle peut avoir de lyrique, de retenu, de léger même. Il conduit l’orchestre sans jamais couvrir le plateau, un orchestre d’une clarté cristalline, d’une lisibilité incroyable, et lorsqu’il fait sonner tout particulièrement forte, qu’il appuie sur un accord, on sent que c’est voulu, parce qu’il y a là dans les fortissimos tout les contrastes possibles du Grand Opéra, d’une musique protéiforme qui cultive les extrêmes.
Intelligence, rigueur, netteté : un chef à suivre, un nom à connaître.
Quant au plateau, il est composé de chanteurs inconnus, tous remarquables. Le plus connu ce soir était Guido Jentjens qui remplaçait le chanteur prévu (et la doublure, car ils étaient tous deux grippés) pour Zacharias l’un des trois anabaptistes. Une assistante à la mise en scène jouait le rôle, et Jentjens chantait avec la partition sur scène, dans des espaces qui ne gênaient pas la mise en scène, mais qui permettaient à la musique de se dérouler normalement . Sa voix de baryton basse, bien sonore, son français assez clair, ont fait que ce remplacement était très réussi.
La distribution mêlait la distribution A et B (vu la rareté de l’œuvre, il a été prévu deux distributions pour pallier les accidents éventuels, dont celui de ce soir sur Zacharias, qui a d’ailleurs abouti à une solution extérieure). Et la distribution du jour était un mixte des deux casts.

Ainsi Fidès était Ewa Wolak. Dans un rôle qui a été au disque l’un des rôles fétiches de Marilyn Horne, elle est impressionnante d’engagement, et vocalement un exemple : voix grave et profonde, incroyable d’étendue, et d’homogénéité, avec des agilités impressionnantes et des écarts graves/aigus exceptionnels. Sans avoir une qualité de timbre particulière, elle frappe par sa personnalité, par sa sûreté et par la précision. C’est un rôle qui la magnifie et qu’elle devrait assumer sur d’autres scènes.
Jean était Erik Fenton, un ténor américain d’une singulière endurance, même si la voix (comment pourrait-il en être autrement) accuse la fatigue, notamment au quatrième acte. Belle étendue vocale pour un rôle qui accumule les difficultés, la voix doit avoir une certaine épaisseur, mais avoir des aigus et suraigus sûrs, maîtrisés, tenus. Plus tendu que Raoul des Huguenots, qu’Arnold de Guillaume Tell, il rappelle un peu les exigences de Benvenuto Cellini, mais avec une voix plus large encore . Un mixte de Lohengrin, Rienzi, et Cellini. Il lui faut une ductilité pour les aigus, il lui faut largeur et appui pour les ensembles, il lui faut une ligne vraiment dominée. Erik Fenton a des atouts, une voix claire, bien posée, bien contrôlée, bien timbrée, et une très belle technique de projection. Il « fait le job » comme on dit, sans histrionisme, et avec conscience et justesse.

Berthe était la jeune soprano polonaise Agnieszka Tomaszewska, voix claire et puissante, bien posée, bien projetée avec un joli contrôle. Toutes les notes sont chantées, sans trucage, et le personnage existe, très naturel, très vrai aussi et très émouvant, dès le début d’ailleurs : la scène avec Fidès dans le café pour partie sans paroles est merveilleusement réglée et pose les personnages. Mais c’est à l’acte V qu’elle est la plus engagée et la plus bouleversante. Très belle prestation et belle présence scénique.
Des trois anabaptistes, nous avons déjà parlé de Guido Jentjens, James Edgar Knight (Jonas) et Lucia Lucas (Mathisen) sont tout à fait excellents, belle présence et jolis ensembles, auxquels s’ajoute l’Oberthal de Andrew Finden, qui n’a rien du méchant d’opéra, mais au contraire se fond dans les gens ordinaires. Sa barbarie et son pouvoir en sont d’autant plus dangereux. C’est bien de la barbarie des gens ordinaires, de ceux qu’on croise chaque jour, qui est dénoncée ici et Andrew Finden avec son jeu sans excès et sa « normalité » est très intéressant, en particulier dans la scène du “trio bouffe” du 3ème acte, où il est reconnu et épargné par Jean; la voix est très bien projetée et la prononciation française correcte.
D’ailleurs force est de constater que le travail scénique est si passionnant, l’intelligence des situations si bien rendue, la musique si énergique et dynamique que l’on ne note pas avec un soin si jaloux la prononciation des chanteurs. Disons que dans l’ensemble, ils s’en sortent sans trop de difficultés.
Si l’ensemble de la troupe est vraiment au rendez-vous, je voudrais souligner le triomphe mérité remporté par les danseurs de Breakdance, du groupe (de Stuttgart) TruCru/Incredible Syndicate, ils sont merveilleusement en phase avec la mise en scène, et ont un sens du rythme, de la pulsation, qui colle parfaitement à la musique, quand ils dansent, mais pas seulement: à chaque fois qu’ils sont en scène, où ils apparaissent souvent, ils sont confondants par leur naturel, leur allure, leur démarche et focalisent les regards.
On aura compris qu’il n’y qu’une urgence, c’est acheter un billet au théâtre de Karlsruhe (prix maximum 44,50 €) : avec un tel rapport qualité-prix, on ne pourra jamais dire que (à Karlsruhe au moins) l’opéra n’est pas un art populaire. Et pour s’y rendre, quelques heures de TGV Est puisque Karlsruhe n’est qu’à 40 km de la frontière. Le Prophète est la production qu’il faut avoir vu, celle qui peut réconcilier avec l’opéra, et qui en tous cas nous réconcilie avec Meyerbeer.[wpsr_facebook]