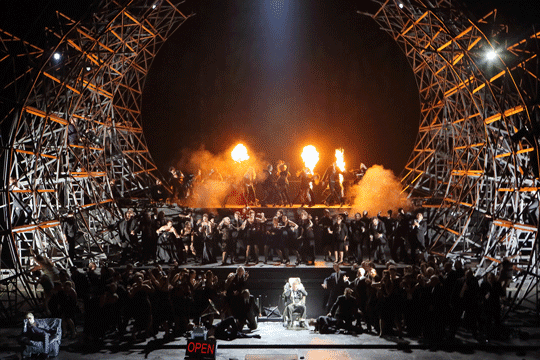
Voir Mefistofele de Boito plus d’une fois dans sa vie ? C’est le type d’opéra qu’on va voir par curiosité, et dont on entend les airs célèbres dans les concerts ou les concours de chant, mais que beaucoup méprisent souvent sans le connaître et probablement sans jamais avoir pu en voir vu une représentation. Voyons, Mefistofele? …pas vraiment fashion…un seul petit tour méphistophélique et puis s’en va.
Ma première fois (et la seule) fut à la Scala, en 1995, quand Riccardo Muti en proposa une nouvelle production (Mise en scène : Pier’Alli, avec Ramey, La Scola, Crider) après une trentaine d’années d’absence depuis la production dirigée par Gavazzeni en 1964 (Mise en scène : M.Wallmann, avec Ghiaurov, Bergonzi, Kabaivanska). C’est dire que ce n’est pas non plus une œuvre donnée fréquemment (à cause des masses qu’elle nécessite et des exigences vocales), même à la Scala, là où elle a été créée en 1868. A Vienne, créé en 1997, dans la même production qu’à la Scala, Mefistofele eut 24 représentations jusqu’en 2001. A Paris la création eut lieu en 1912 sous la direction de Tullio Serafin avec Chaliapine et depuis… ?

La création de Mefistofele à Munich, l’opéra le plus important d’Allemagne, est donc forcément un événement et Nikolaus Bachler n’a pas lésiné sur les moyens, ni sur la distribution puisque trois des grandes stars de l’opéra aujourd’hui René Pape, Kristine Opolais, Joseph Calleja en constituent le noyau, et que la mise en scène de Roland Schwab est l’une des plus spectaculaires qu’on ait vues sur cette scène. Enfin, le chef Omar Meir Wellber, protégé de Daniel Barenboim, faisait pour l’occasion ses débuts munichois.
Entre l’objet musical non identifié qu’est la Damnation de Faust de Berlioz (1846) et celui bien plus identifié et plus conformiste qu’est le Faust de Gounod (1859), Boito, issu d’une famille intellectuelle, lié aux milieux littéraires d’avant-garde italiens (la Scapigliatura) francophone et admirateur de Stendhal, a choisi une voie médiane : il connaissait les deux œuvres et admirait Berlioz. De plus il a vécu à Paris au moment des débats autour du Tannhäuser de Wagner dont il y a des traces dans l’orchestration du prologue. Il était donc parfaitement au fait des discussions sur le drame musical et sur l’évolution de la scène lyrique. Certains méprisent ou ignorent cette œuvre, mais il ne faudrait pas ignorer le compositeur, d’un éclectisme intellectuel rare, et d’une grande ouverture, une figure de la modernité à qui Verdi, qui l’a connu assez tard, doit la révision du livret de Simon Boccanegra en 1881 et les livrets d’Otello et de Falstaff. Boito est une grande figure de la culture italienne dont la musique a été soutenue par Toscanini, Bernstein, Muti.
La surprise du public munichois devant cette œuvre s’est sentie par l’enthousiasme grandissant et le succès important au rideau final, avec une petite vingtaine de minutes d’applaudissements nourris.
On doit brièvement rappeler que la création à Milan en 1868 fut une catastrophe, et qu’il fallut beaucoup d’insistance pour l’œuvre révisée soit reprise en 1875 à Bologne, où cette fois elle connut le succès. C’est la seule œuvre achevée de Boito, l’autre opéra, Nerone, a été terminé par Vincenzo Tommasini e Antonio Smareglia, sur commission de Toscanini qui l’a créé à la Scala en 1924.
Mefistofele est une œuvre monumentale, exigeant un chœur énorme, un chœur d’enfants et trois rôles à tenir par des interprètes d’exception. Tous les grands interprètes du répertoire italien, basses, ténors, sopranos, ont enregistré ou interprété Mefistofele : les distributions ne sont qu’une liste de légendes du chant. Boito s’y montre fidèle à l’esprit fantasmagorique du Faust de Goethe, et dramaturgiquement peut être plus proche de ce que voulait Berlioz que ce qu’a fait Gounod. Il se montre attiré par la mélodie continue et le drame musical wagnérien, mais garde aussi des formes traditionnelles de l’opéra italien. Bien sûr, l’histoire de Marguerite en reste le noyau dur, mais se trouve un peu diluée dans de grands ensembles comme la nuit de Walpurgis qui clôt le deuxième acte. Pat ailleurs, il prend des éléments du second Faust, l’apparition d’Hélène, par exemple, ou le salut final de Faust qui échappe au pouvoir de Mefistofele. Boito voulait sans doute à travers son Mefistofele, recréer quelque chose du gigantisme de l’œuvre de Goethe (5 actes à la création en 1868), et sans doute, en bon italien, lui donner une couleur dantesque, mais il dut réduire pour Bologne à 4 actes, outre un prologue et un épilogue, ce qui a affaibli la dramaturgie de la partie finale.
Il y a dans la musique quelque chose de spectaculaire, de grandiose, d’énorme, qui fait de ce travail un opéra qui n’a pas l’intimisme ni la poésie de Berlioz, mais qui a une vraie singularité, et le metteur en scène Roland Schwab (qui réalise sa première mise en scène a Munich) a volontairement surexposé l’histoire, dans un décor monumental de Piero Vinciguerra, un tunnel métallique rappelant le très fameux décor (de Peter Sykora) du Ring de Götz Friedrich de la Deutsche Oper ; Schwab a étudié chez Friedrich à Hambourg : ceci explique sans doute cela.

Ce tunnel est comme une sorte de tourbillon, une image des cercles de l’Enfer dantesque (Boito lecteur de Dante connaissait d’ailleurs la Dante Symphonie de Liszt qui date de 1857 et s’y est peut-être référé)
Il y a entre la première partie (Prologue, actes I et II) et la seconde (actes III, IV, épilogue) une grande différence de parti pris et d’ambiance. Dans la première partie, défilent tous les poncifs de la diablerie faustienne, avec un royaume de Mefistofele qui ressemble à un Venusberg échevelé, ou à une Oktoberfest décadente dans un style spectaculaire assez proche du musical avec les chorégraphies de Stefano Gianetti. Boito a voulu montrer une sorte de totalité du monde, le bien et le mal, Paradis (dans le prologue) et Enfer ; Schwab les met pratiquement en face et en phase, en gardant la même structure, comme Boito qui utilise des phrases de sa musique similaires d’un côté comme de l’autre. Cela indique de toute manière l’ambition de l’entreprise, souligné dans la mise en scène et dans la construction de l’œuvre.

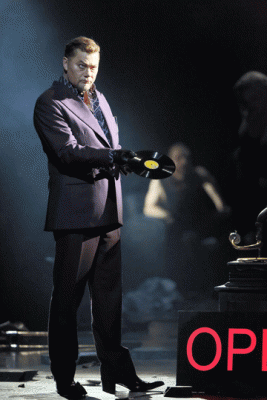
Quand apparaît Mefistofele, il est une sorte de maître des lieux, deejay (sur un Gramophone…) d’une énorme boite de nuit satanique, toujours ouverte (OPEN s’affiche au premier plan) et semble un boss mafieux plutôt spirituel et à la mode. René Pape se délecte de ce rôle qui une fois de plus fait du diable un personnage toujours séducteur et plutôt attirant, un manipulateur de foules et d’ambiances. Le Faust de Boito, qui n’est pas le personnage principal, n’est pas le scientifique amer en fin de vie, c’est presque un quidam, un homme parmi d’autres que Mefistofele choisit comme par hasard. Ce Faust émerge de la foule et va suivre le maître, qui l’attire par le piège de la femme, qu’il suscite comme si elle était une apparition et qui va lui aussi venir un jouet sur lequel en lettres de sang on inscrira bientôt “Reue” (repentir): tout n’est que surgissement et magie, comme si les personnages comptaient moins que les scènes ou les ambiances.
Roland Schwab ménage quelques effets avec la vidéo (de Lea Heutelbeck) : Mefistofele regarde un avion voler autour de Manhattan (toute allusion…) avec une délectation non feinte.
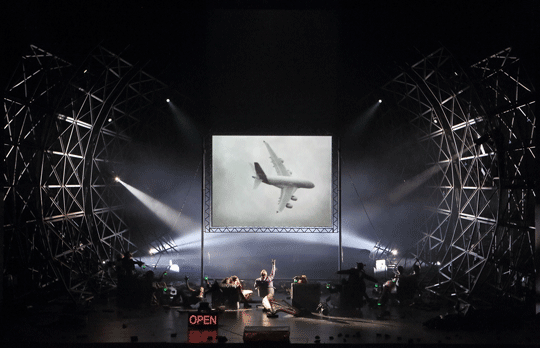
L’idée est claire et pessimiste : le mal est installé dans le monde et s’y vautre. Là où officie Mefistofele, des chaises, un sofa, un tuba, comme des reliques modernes, traînent et montrent qu’il a investi le monde.

Du même coup, Marguerite n’est plus qu’un jouet une Poupée hallucinée que Mefistofele met en scène pour Faust. Mais c’est une brève rencontre et Mefistofele emporte très vite Faust vers la nuit de Walpurgis. C’est l’occasion pour Schwab de démonter de visu l’illusion théâtrale sur une vieille Harley Davidson, chevauchée par les deux personnages, avec un gros ventilateur installé par Mefistofele lui-même pour donner l’illusion cinématographique de la vitesse. Image à la fois frappante et amusante, presque irréelle, qui nous amène à la scène finale de l’acte II, le climax de l’œuvre et le triomphe de Mefistofele, souvent assis au premier plan dans un fauteuil, laissant ce qu’il a déclenché se dérouler. Un monde fou sur scène, ponts qui montent et descendent, surgissements des dessous, éclairs de flammes : un spectacle à la fois impressionnant et quelque peu factice, une fête du Diable qui semble une fièvre du samedi soir dans une boite à la mode où Marguerite est violée par Faust : ne serions-nous pas nous-mêmes l’Enfer?
La deuxième partie après l’entracte (actes III et IV) est très différente et peu enfiévrée, après le climax, la chute, et les échecs de Mefistofele. Marguerite résiste à Faust et ne se laisse ni emporter ni libérer, l’ambiance est sombre et solitaire après le feu d’artifice du final de l’acte II, c’est le moment le plus lyrique de l’intervention de Marguerite. La vision hallucinée que Kristine Opolais réussit à imposer de manière magistrale fait basculer dans un autre type de cauchemar. Face au mal triomphant et explosif, le bien est bien discret fait bien peu spectacle. Encore plus au quatrième acte, qui devrait-être la vision extatique d’Hélène, et qui se passe, comme dans le plus pur style « Regietheater », dans une maison de retraite. Faust y arrive et y est installé, comme un malade d’Alzheimer, ou comme un dément, et Hélène et ses compagnes ne sont que les infirmières qui gardent les vieillards avec bonhommie, jouent avec et font conversation.

La vision est terrible, et la fantasmagorie est finie, ce qui était cauchemar hollywoodien en première partie, où nous regardions cet Enfer un peu amusés, devient cauchemar authentique car il nous renvoie à notre possible avenir, à notre vieillesse et à notre déchéance, à notre Enfer futur. L’Enfer ici, c’est encore nous, et Faust n’est que l’un de nous, dont l’expiation des péchés passe par la folie. Faust sera racheté par sa folie même, qui le protège : on est bien près de l’Erasme de l’Éloge de la folie : nous avons assisté au spectacle du monde comme Enfer, et seule la Folie peut nous en protéger. Le monde est un tunnel, presque une caverne platonicienne dont nous n’avons vu que des ombres illusoires, et la Folie est là, dans ce monde déréglé et dézingué, et ce qu’on appelle folie devient raison, comme chez Erasme. Faust fou et oublieux devient du même coup protégé et sauvé, pendant que Mefistofele titube et voit sa victime lui échapper.
Roland Schwab voit Mefistofele comme l’emblème de notre monde, qui a choisi délibérément l’Enfer et dont Faust n’est qu’un échantillon. Dans ce monde, malgré le prologue, il n’y a plus de Dieu ni de Paradis, il n’y a qu’un Enfer universel. Seul contact avec le réel, le futur de l’homme est dans sa maladie et dans la maladie bénie de son oubli, dans ses fantasmes peut-être, qui peut le faire sortir de ce noir universel. La solution par la folie, la solution par Alzheimer, s’abstraire dans un ailleurs clinique voilà ce qui est proposé pour échapper à l’universel Enfer. L’avenir est radieux.
Cette vision qu’on pensait superficielle au départ et assez m’as-tu vu, se révèle dans sa deuxième partie plus profonde et plus sentie que prévu, nous sommes donc pris à revers d’une dramaturgie et d’une musique qui prétendent à une vision universellement noire : le titre Mefistofele est clair de ce point de vue. L’allusion à Dante et au monde dantesque, que Boito connaît parfaitement, pétri qu’il est de l’auteur fondateur de la littérature italienne, est évidente, ne serait-ce que par la configuration du décor. Nous pensions trouver Goethe, et la boite de Pandore s’ouvre sur Dante.
Il s’agit bien d’un effort pour construire une musique dantesque, qui aille du Paradis à l’Enfer et sans Purgatoire. Et l’énorme machine des chœurs, et l’énorme crescendo sonore de l’orchestre, tout concourt à cette vision. A travers le Faust de Goethe, c’est bien l’Enfer de Dante qu’on y lit. On est en bonne compagnie.
Au service de l’entreprise, une réalisation musicale de haut niveau. Omar Meir Wellber tient parfaitement la construction orchestrale, surtout en première partie où il maîtrise les ensembles, le chœur et l’orchestre, avec une grande précision et un geste chorégraphique mais précis. Il produit un son volontairement surmultiplié, excessif, énorme pour tout dire qui convient parfaitement à l’entreprise. La seconde partie cependant, est moins chorale, plus centrée sur les individus et sur les situations, avec d’ailleurs des faiblesses dramaturgiques plus marquées : couper Goethe quand on veut faire du Dante est une entreprise délicate ! Mais l’orchestre, lancé par le chef à tout volume, ne semble pas s’apercevoir qu’on a changé d’univers, et cela devient beaucoup trop fort, jusqu’à couvrir les voix, toutes les voix, et notamment celle de René Pape. C’est vraiment le problème dominant dans la deuxième partie, alors que par ailleurs l’orchestre est parfaitement tenu, et montre notamment au niveau des cordes et dans le détail des pupitres une grande précision sonore : on sait quelle est la qualité de cet orchestre, et on ne peut qu’en apprécier la prestation dans l’univers d’un compositeur pour lui inconnu encore. L’excès du volume est d’autant plus regrettable que le crescendo final est sans doute l’un des moments les plus impressionnants de l’œuvre et réalisé ici avec un exceptionnel brio. Les dernières mesures sont si impressionnantes qu’on en sort presque sonné, presque assommé de tant de puissance et de grandeur.

La distribution est dans l’ensemble à la hauteur, avec une belle homogénéité dans les rôles de complément, à commencer par l’excellent Wagner d’Andrea Borghini, seul italien du cast, qui fait partie de la troupe depuis 2014, et la Marta très juste d’Heike Grötzinger, elle aussi pilier de la troupe, mais aussi Rachael Wilson (Pantalis) et Joshua Owen Mills (Nereo).
Alors que souvent, la même artiste tient les deux rôles, Marguerite ici est chantée par Kristine Opolais et Elena par Karine Babajanyan. Cette dernière, dans une partie très tendue à l’aigu, qui requiert volume et puissance, s’en sort avec beaucoup d’aplomb et de présence, et remporte un très gros succès, mérité : c’est un nom à retenir.
C’est bien ce qui fait la difficulté des deux rôles quand on les donne à la même chanteuse ; il faut sans aucun doute un lirico spinto qui puisse aussi avoir des moments très lyriques (Caballé a chanté Marguerite, Tebaldi aussi, mais aussi Freni ou Kabaïvanska).

Kristine Opolais est une artiste douée d’une présence scénique et d’un engagement peu communs, elle se donne à fond en scène, reste toujours très expressive, elle est notamment une Butterfly bouleversante. Mais c’est en même temps une voix tendue, qui n’a pas tout à fait les moyens des rôles qu’elle chante, notamment dans le répertoire italien, elle est par exemple une très belle Manon, mais elle y épuise ses réserves.
Elle est une belle, une magnifique Marguerite, émouvante, présente, hallucinée, une splendide interprète, mais les aigus sont très tendus, voire proches du cri, et cela devient gênant quand c’est systématique. Il est heureux qu’elle n’ait pas chanté Elena, elle s’y serait perdue. Je ne sais si elle a intérêt à aborder des rôles de ce type pour lesquels elle n’a pas tout à fait le format vocal.

Joseph Calleja à l’inverse est parfaitement à l’aise dans le rôle de Faust, où il développe un sens du phrasé, une diction qui sont un modèle de beau chant. De plus son timbre solaire, sa voix claire mais très présente, son volume maîtrisé, dominant les hauteurs de l’orchestre, tout cela produit une prestation en tous points impeccable, voire anthologique et un très grand triomphe mérité.
René Pape abordait le rôle pour la première fois et j’ai souligné plus haut que toutes les grandes basses du siècle l’ont eu à leur répertoire. Il campe un personnage déluré, presque léger, et inhabituel pour les spectateurs qui ont plutôt l’habitude de le voir dans des rôles plus « composés » et plus raides. Il bouge, danse, s’amuse y compris avec le public (notamment lorsqu’il annonce l’entracte), en bref, un aspect différent et plutôt divertissant. Vocalement, on reconnaît ses notes basses et caverneuses, sonores et profondes dans lesquels il n’en finit pas d’étonner. Il a un peu plus de mal dans les aigus et surtout dans la manière de les négocier. Il est vrai que l’orchestre ne l’aide pas. En fait, il n’a pas l’habitude de la ductilité du chant italien et n’a pas toujours la souplesse vocale voulue, notamment dans les deux premiers actes. Il chante bien sûr Philippe II, mais le rôle ne requiert pas la souplesse que requiert Mefistofele. Boito, lui aussi, se souvient de Rossini et il y a là une technique spécifique au chant italien que Samuel Ramey, qui a beaucoup chanté Rossini, possédait et qui met quelquefois René Pape à la peine, et pour le volume, et pour la dynamique, et aussi pour la diction. Il reste un Mefistofele de grand niveau, mais ce n’est peut-être pas un rôle, pour l’instant du moins, où il peut montrer toute l’étendue de son talent.
Au pays de Faust, il fallait sans doute monter Mefistofele, et alla grande . Tout est complet jusqu’à la dernière le 15 novembre, avec deux représentations supplémentaires pendant le Festival 2016 en juillet. Il reste à savoir combien de fois la production sera reprise, au-delà de sa première série triomphale, et pour combien de temps.[wpsr_facebook]

