
Le Regietheater
Voilà un mot qui aujourd’hui encore fait polémique, car on met dans ce vocable tout ce qui du point de vue de la mise en scène fait hérisser les poils d’un certain public. Le Regietheater est-il mort ? À lire certains critiques, oui, bien évidemment, et le mot Regietheater sonne aujourd’hui poussiéreux et rétrograde, avec des relents marxistes (une pente horriblement démodée !).
Non les metteurs en scène du jour les plus critiqués ne sont sans doute pas des tenants du Regietheater pur et dur, mais lui doivent souvent leur manière de lire les œuvres. Car le Regietheater fut une approche qui eut son heure de gloire en Allemagne entre 1980 et le début des années 2000 (pas si loin de nous) : le Ring de Jürgen Flimm à Bayreuth en fut un des derniers avatars, mais ses tenants légendaires que furent Ruth Berghaus, Heiner Müller moururent dans les années 90, Klaus Michael Grüber (le co-directeur de la Schaubühne de Berlin dans les années 70 avec Peter Stein) à peine plus tard. De cette période de scandales et de gloire restent Peter Konwitschny, Hans Neuenfels ou Harry Kupfer. Quant à Peter Stein, il a renié cette approche.
La question de la réception
Pour comprendre la démarche du Regietheater à l’opéra, et le refus d’un certain public, il faut distinguer le processus de création (que nous avons essayé d’évoquer dans le texte précédent) du processus de réception.
Nous avons dit combien la démarche du Regietheater devait à la dramaturgie brechtienne et à l’idée que le théâtre est lecture du monde, avec des clefs philosophiques, politiques et idéologiques, que ces clefs impliquaient une décentration de la lecture du texte, pour en comprendre les ressorts quelquefois implicites. Il s’agit donc de rechercher les implicites d’un texte et la manière dont il peut nous parler, nous apparaître évident, à l’éclairage de notre vécu collectif.
Si le texte est un donné immuable, sa lecture varie évidemment selon l’époque : on ne lit plus Cosi fan tutte comme à l’époque de Mozart ou même comme dans les années 1950. Il en va de même pour toutes les œuvres d’art. L’œuvre n’est jamais reçue comme elle a été pensée ou créée. Elle est l’objet de regards et d’interprétations diverses, du metteur en scène comme du spectateur. Il est clair que Mozart a conçu l’œuvre en fonction de son monde qui n’est plus le nôtre, d’un théâtre qui n’est plus le nôtre, de conditions de représentations techniques et sociales qui ne sont plus les nôtres. C’est justement ce qui fait de Cosi fan tutte une œuvre : elle résiste aux temps, non parce qu’elle est immuable et que sa lecture est univoque, mais parce que quel que soit le contexte ou l’époque de la réception, elle peut répondre aux questions de qui la regarde, qui sont la plupart du temps très différentes de loin en loin. C’est encore plus clair lorsqu’on considère la tragédie grecque. Nous avons très peu à voir avec l’Athènes du Ve siècle et pourtant ces pièces nous parlent, elles sont « Question », mais elles sont l’objet de regards radicalement différents aujourd’hui, y compris à l’opéra d’ailleurs.
Le metteur en scène dans son processus de production considère la pièce dans ce qu’elle dit aujourd’hui, il reçoit l’œuvre et l’interroge en fonction de ce qu’il voit et de ce qu’il sait du monde, le spectateur reçoit cette vision, que le metteur en scène soit « moderniste » ou « traditionnaliste », quelle que soit l’approche, elle reste tributaire d’un regard d’aujourd’hui, un regard qui est forcément interprétation, donc forcément « infidèle », y compris pour les tenants de ceux qui croient être les défenseurs d’une fidélité… C’est la théorie de la réception, fondamentale dans les dernières décennies, théorisée par H.R.Jauss dans les années 1970 à propos de la littérature, mais applicable à toute œuvre artistique [1]. Jauss se fonde sur les approches de Hans Georg Gadamer, le philosophe de l’herméneutique, qui a ouvert la voie aux théories de l’interprétation et qui justement impose l’idée de la variation du regard en fonction des contextes de réception.
C’est le premier point : l’œuvre est produite comme un objet donné, ce que nous en recevons est divers et contradictoire. Autant de spectateurs, autant de regards, autant d’opinions aussi. Rappelons la phrase de Gide « Que l’importance soit dans le regard et non dans la chose regardée ». En matière d’art, en matière d’interprétation, en matière de lecture, il n’y a pas de référence absolue.
Les divers regards sur le théâtre : quelques exemples
La tradition allemande

La culture allemande par tradition historique accorde au théâtre une place prépondérante. Il y a en Allemagne (même si les choses se tassent) des centaines de théâtres de répertoire disséminés dans les villes, métropoles, grandes, moyennes et petites. Ces théâtres fonctionnent sur la force des abonnements, avec une troupe permanente, et une alternance comprenant quelques nouvelles productions et des reprises puisées dans le répertoire avec moins de répétitions et avec une troupe rompue à l’exercice. L’amateur de théâtre d’une ville moyenne voit donc bien plus de théâtre qu’ailleurs en Europe : pour l’éducation du public, c’est le système de référence parce que l’œuvre théâtrale est davantage accessible.
La nécessité du théâtre (même si cela évolue) se résumait il y a encore une vingtaine d’années dans cet aphorisme qu’on m’avait susurré : « le théâtre en Allemagne, c’est obligatoire, comme la sécurité sociale ». Cela signifie que le public allemand est en général plus préparé, souvent plus averti et par l’histoire même du théâtre allemand et l’importance de Brecht en Allemagne. En ce sens, il est disponible pour les mises en scènes plus dramaturgiques .
L’héritage brechtien dans toute la culture théâtrale allemande a aussi déterminé une typologie de mises en scène à laquelle l’acteur est formé, souvent longuement, et à laquelle le public est culturellement habitué, au-delà de la question de la qualité qui se pose là comme ailleurs.
Ce système où le nombre de représentations et de productions a induit des métiers liés à la production comme celui de dramaturge, n’a pas eu en France ni ailleurs la même fortune : on commence seulement depuis quelques années à voir des dramaturges un peu partout en France seconder des metteurs en scène, alors qu’ils étaient encore rares il y a quelques décennies (ce fut par exemple très tôt le cas d’Alain Satgé auprès de Jorge Lavelli), c’est en revanche un métier qui écume les théâtres allemands qui ont chacun un ou plusieurs dramaturges attitrés. Les grands metteurs en scène en ont la plupart du temps un qui leur sont personnellement attachés comme Alexander Meier-Dörzenbach avec Stefan Herheim.
Le rôle du dramaturge est assez clair, il s’agit pour lui dès qu’une production est en vue, de préparer le terrain de la production en repérant les textes clefs, les options possibles de lecture, les productions existantes et passées, les problématiques qui pourraient intéresser le metteur en scène pour lequel il travaille, pour que l’équipe de création (essentiellement metteur en scène et décorateur) puisse avoir à disposition une palette ouverte possibles pour l’élaboration de la production. Il s’agit aussi de soutenir théoriquement (c’est-à-dire par des textes référentiels) le choix de production et d’orientation. La plupart du temps, les dramaturges sont souvent chargés dans les programmes de salle d’écrire des textes analytiques ou de mener des interviews du metteur en scène.
La mise en scène propose une lecture de l’œuvre, une vision qui tient compte de ses possibles idéologiques, philosophiques, politiques ou artistiques (ces dernières années les références intertextuelles au cinéma sont par exemple particulièrement fréquentes). Cette vision répond à des axes de lecture critique du texte, d’où la nécessité de montrer par l’image théâtrale les options de lecture : il s’agit donc d’un regard intellectuel qui va se traduire en choix d’images, qui n’induisent pas forcément une transposition de la trame, mais qui répondent à une lecture d’aujourd’hui.
Que peut dire l’œuvre aujourd’hui, à un regard ou à une pensée d’aujourd’hui ? On est donc face bien à la fois à une lecture du texte, mais aussi à une prise en compte de sa réception (d’où mon allusion aux théories de Gadamer et de Jauss un peu plus haut.). Cette approche demande au spectateur un effort pour comprendre les références, pour éventuellement les rechercher après le spectacle : la mise en scène dans ce cas devient œuvre intellectuelle, et c’est un effort qui est demandé au spectateur au lieu de la seule émotion partagée. Cela ne fait pas toujours du metteur en scène un génie, ni une référence, cela n’empêche ni le manque de profondeur ou de subtilité, ni les plagiats, ni les approches erronées ni les partis pris extrêmes (voir le Tannhäuser de Baumgarten à Bayreuth) : cela n’empêche jamais le mauvais théâtre d’exister, comme partout. Nous parlons ici de la démarche, qui est celle du Regietheater, dans un contexte d’histoire culturelle, de formation théâtrale données. On est bien dans une démarche qui distancie le texte pour en faire un objet qui interroge l’aujourd’hui et cela vient bien en général du théâtre épique brechtien.

La mise en scène : une question prioritairement européenne
Dans les débats qui placent le Regietheater à l’opéra comme responsable de la fuite du public, torpilleur de l’auteur et traitre au compositeur, nous devons rappeler que presque tout au long du XXe siècle, la question de la mise en scène et des débats autour du théâtre sont une question presque exclusivement européenne, et indépendamment des circonstances politiques et espaces idéologiques, même si celles-ci peuvent être fatales aux artistes (voir Meyerhold et Staline). Il y a en Allemagne et en Russie un très grand intérêt pour la chose théâtrale qui transcende l’idéologie et la politique. Ces débats et cette réflexion fut sensible en Angleterre (Edward Gordon Craig grand théoricien de l’espace scénique et de la lumière, parallèlement et au même moment qu’Appia) en Russie (Stanislavski, Meyerhold et d’autres), plus tard dans la Pologne communiste (Grotowski ou Kantor), et nous avons déjà évoqué l’Allemagne de l’Est, la France, l’Italie. Elle n’atteindra vraiment les USA qu’au moment de l’Actors Studio de Lee Strasberg (très influencé par Stanislavski) qui prend son essor au début des années 1950 et sera une référence mondiale vers les années 1960.
Dans le monde anglo-saxon on retient bien sûr aussi Orson Welles, mais c’est tout de même autour de l’acteur que le théâtre anglais se concentre (voir Shakespeare et Lawrence Olivier). Les grands metteurs en scène anglo-saxons historiques (les Peter Brook, les Peter Sellars, les Robert Wilson) ces cinquante dernières années ont été révélés par leurs travaux en France ou en Europe continentale. Si Peter Sellars est aujourd’hui l’un des plus grands, il a été révélé par ses Mozart/Da Ponte qui doivent beaucoup au Regietheater qui triomphait à l’époque dans les années 1980 et c’est l’Europe qui les a consacrés : quand en 1980 il produisit aux USA son Don Giovanni, Opera News, la grande revue spécialisée américaine le qualifia d’« act of artistic vandalism », quant à Bob Wilson, c’est le Regard du sourd qui le révèle au Festival de Nancy 1970, mais c’est à partir d’Einstein on the Beach (avec Philip Glass) qui à la fin des années 70 est le point de départ d’une grande carrière presque exclusivement européenne. Ainsi trouve-t-on une cohérence chronologique où les mêmes moments clés scandent l’histoire de la mise en scène : fin du XIXe, fin des années 1920, années 1950, années 1970…
Le théâtre est élément fondamental de culture européenne : c’est un art aux racines communes (l’Antiquité), aux références communes et au répertoire partagé. Il en est de même très largement pour l’opéra. Seulement, ce partage-même crée les différences d’approche, voire des oppositions selon les traditions dramaturgiques…
Enfin, le continent européen est celui de la mise en scène. Ce continent a fait naître une typologie théâtrale, traduit par une architecture qu’on retrouve peu ou prou dans tous les pays, par une histoire théâtrale et dramaturgique spécifique (Shakespeare en Angleterre, Goethe et Schiller en Allemagne, d’Aubignac et Diderot en France), mais de larges points communs dans l’histoire de la représentation. Aujourd’hui, et depuis l’après-guerre, vers les années 1950, alors qu’il y a à la fin du XIXe de grands théoriciens anglo-saxons, qui s’inspirent beaucoup de la pensée wagnérienne, comme Edward Gordon Craig, même si celui-ci s’installera en France en 1936 et y mourra en 1966.
La grande tradition russe, marquée notamment par le théâtre d’art de Stanislavski, puis les théories de Meyerhold montre aussi comme en Allemagne d’ailleurs, que les régimes politiques n’ont pas eu de prise sur la réflexion théâtrale. Les grands metteurs en scène des années 1970 russes aux temps de l’URSS (Tarkovski, Lioubimov), héritiers de la grande tradition théorique russe (Meyerhold l’a payé de sa vie) ont eu à faire face à des problèmes « administratifs ».On se souvient de l’affaire de La Dame de Pique de Youri Lioubimov annulée à Paris à la fin des années 1970[2]. Mais en dehors de ces exceptions notables, l’opéra en URSS était resté peu ou prou encore dans une esthétique « toile peinte » très XIXe siècle et on en a encore des traces aujourd’hui. Il reste que l’Europe continentale est le lieu où la mise en scène s’est développée, lieu de débats esthétiques et d’écoles, qui vont déterminer l’histoire du genre opéra depuis une cinquantaine d’années.
Et la France ?
En France, la question de la mise en scène était cependant souvent secondaire par rapport à celle de l’acteur. Alors que les théories de Diderot préparent le lit de Brecht (la question de la distance, de l’expression de l’émotion suprême quand l’acteur est le plus distancié) celles de Stanislavski plongent l’acteur au cœur de lui-même et de ses émotions et c’est cette voie que suit la tradition française au prix d’un gauchissement singulier qui pèse sur la rigueur de la formation, l’acteur étant quelquefois assimilé à l’artiste pris de fureur divine sans besoin de formation approfondie. Et à l’opéra encore plus : dans les années 1950, à l’opéra la référence est la fameuse production de Maurice Lehmann des Indes galantes de Rameau, où au-delà de la tradition du grand spectacle, c’est le triomphe de la production illustrative jusqu’aux parfums diffusés dans la salle…on est loin de Brecht, de Wieland Wagner, voire de Strehler qui fait dans ces années les premières mises en scène d’opéra.
C’est une fois de plus dans les années 1970 que les choses bougent puisque Rolf Liebermann appelle pour ses principales productions, outre Giorgio Strehler, Jean-Pierre Ponnelle, Patrice Chéreau, Peter Stein, Klaus Grüber, Jorge Lavelli voire des metteurs en scène anglo-saxons comme John Dexter qui reprend sa mise en scène des Vespri Siciliani du MET avec les décors de Josef Svoboda, pur sous-produit de Craig et d’Appia.
La tradition théâtrale française, elle, n’est pas brechtienne mais aristotélicienne. Depuis le XVIIe elle privilégie la puissance de l’émotion, les passions, l’adhésion directe au texte et l’identification du spectateur, la mimesis[3] : c’est l’inverse de la démarche brechtienne. Elle accorde donc à l’acteur et à sa capacité à transmettre l’émotion une très grande valeur, alimentée au XXe par les théories de Stanislavski. Quand Aristote parle de catharsis, de purgation des passions, il montre un théâtre du collectif, apte à faire en sorte que le spectateur y puisse vivre en vase clos les grandes passions humaines.
Le processus d’identification était d’autant plus important dans le théâtre antique qu’il était lié à des manifestations religieuses où la question de la « représentation » dans l’antiquité grecque est difficile à concevoir. Si un Dieu est représenté en statue par exemple, la représentation porte en elle le divin (si un dieu est représenté, la statue est ce dieu, on retrouve cela dans le culte des icônes dans le monde orthodoxe). Il est probable (mais cela demanderait un tout autre développement) que dans la tragédie, la relation à la représentation était du même ordre puisqu’on raconte qu’à l’apparition de Darius dans Les Perses d’Eschyle, les spectateurs prirent peur et fuirent.
Ainsi donc le théâtre d’identification qui est l’inverse de la distanciation est profondément ancré dans les habitudes du public: on va au théâtre pour ressentir et se voir au miroir.
Il en va de même à l’opéra, où la puissance d’émotion de la musique amplifie et justifie encore le phénomène. On a alors l’impression que la mise en scène renforce, illustre et prolonge l’émotion musicale, et l’on en sort emporté et ravi.
On comprend alors qu’un metteur en scène qui va distancier et didactiser un texte ou un livret d’opéra ne peut que déranger profondément ce processus auprès d’un public plus habitué à faire du théâtre un objet d’identification plutôt que de distanciation réflexive : d’où le refus du Regietheater auprès d’un certain public d’opéra mais aussi de théâtre : l’accueil hystérique de La Dame aux Camélias de Frank Castorf à l’Odéon en 2012 en est un exemple.
Ce que ce public prend pour de la provocation est le résultat d’une différence idéologique d’approche : là où l’on attend une manifestation directe de l’œuvre, on voit représentée une interprétation qui nécessite distance et réflexion, voire quelquefois recherche au-delà de la représentation. Le public résiste…
Thomas Jolly à propos de Fantasio (de Jacques Offenbach, Opéra-Comique et Grand Théâtre de Genève) est très clair à ce propos : « Dans un opéra, qui est le maître, le chef d’orchestre ou le metteur en scène ?
Le chef d’orchestre, sans aucune hésitation. C’est la musique qui prime. Pour être plus précis, ma vision du metteur en scène s’inscrit à contre-courant des 50 dernières années, où celui-ci occupait un statut trop important. Contrairement au texte théâtral, dans une partition, tout est écrit : les nuances, les rythmes, les silences. Dans cet exercice, mon rôle consiste à révéler la poésie de l’œuvre. »
En parlant de « révéler la poésie » de l ‘œuvre, Thomas Jolly se veut metteur en scène révélateur, au sens où il accorde au metteur en scène le rôle de prolongateur de la musique, ce qui voudrait dire que la musique ne dit pas tout. Il y a là sinon contradiction du moins ambiguïté. Jolly affirme aussi que le metteur en scène a eu un rôle trop important pendant les cinquante dernières années, une phrase qui appelle un certain nombre de remarques lues ou entendues un peu partout comme un lieu commun, un cliché fortement médiatisé.
Si on a eu l’impression que le metteur en scène avait à l’opéra un « statut trop important », c’est essentiellement pour trois raisons :
- D’une part le metteur en scène n’existant pratiquement pas auparavant, son arrivée a été vécue comme dérangeante : on se focalise sur l’élément nouveau en l’occurrence souvent vécu comme perturbateur. L’invité tardif et non souhaité, le pique-assiette en quelque sorte.
- D’autre part, la plupart des metteurs en scène qui se sont emparés de l’opéra au départ ont été des metteurs en scène venus de l’école brechtienne, avec les contradictions vécues par le spectateur, plongé dans l’émotion et l’empathie par la musique, et rejeté dans la distance avec la mise en scène, d’où écartèlement et de nouveau sentiment que la mise en scène dérange parce qu’elle « tue » l’émotion.
- Enfin pour des raisons d’organisation : souvent le chef d’orchestre arrive après les répétitions scéniques, qui durent plus longtemps, on en retire l’impression d’un travail parallèle, d’un manque de communication, et d’une suprématie de l’un sur l’autre. Quand metteur en scène et chef travaillent ensemble (Chéreau-Boulez/Petrenko-Castorf) non seulement les choses ne se passent pas parallèlement, mais en synergie. Et le spectacle y gagne évidemment.
Cette question est importante car elle détermine aussi les impressions et les traces d’une production : mettez un metteur en scène « hardi » avec un chef médiocre dans Verdi (et il y en a tant) le résultat sera sans doute la bronca. Si à l’inverse le chef est magnifique et la mise en scène pâle, cela passera pour le public, même si la critique dont la mission est de rendre compte d’une représentation dans sa totalité pourra tordre le nez. Pour le public, la réalisation musicale reste évidemment l’essentiel.
Pourtant, les très grandes productions verdiennes des 50 dernières années proviennent de spectacles où grand chef et grand metteur en scène ont travaillé main dans la main, comme la collaboration Abbado-Strehler pour Simon Boccanegra et pour Macbeth, dont on parle encore. En revanche on se souvient de l’Otello de Kleiber à la Scala, moins de la mise en scène de Zeffirelli, qui pourtant n’était pas médiocre.

Certaines mises en scène à l’opéra demandent quelquefois un travail approfondi pour en connaître toutes les clefs (le fameux Parsifal de Christoph Schlingensief à Bayreuth, par exemple) là où un certain public attend une manifestation lisible. Là aussi il y a une incompréhension de départ : le public dans sa majorité et notamment à l’opéra, n’attend pas d’exercice intellectuel, et le metteur en scène l’y contraint manu militari.
Par ailleurs si le public sent la musique, une mince frange la connaît suffisamment pour percevoir les caractères précis d’une direction musicale : on se fie essentiellement aux signes extérieurs de la direction (la gestique du chef), éventuellement à la comparaison avec son disque préféré, où avec d’autres représentations. On a plus de propension à juger de la mise en scène, terrain plus sûr… L’homogénéité du ressenti notamment au niveau de la convergence du rythme Théâtre/Musique est là aussi une question de perception plus souvent que d’analyse. En réalité, et à l’opéra surtout parce que le texte est moins perceptible, parce que la force de l’habitude est plus enracinée, parce que l’opéra est rarement considéré comme un art « intellectuel », mais plus émotionnel, ces points font problème. La meilleure preuve des incohérences de la réception par le public, est que l’on supporte beaucoup plus une mise en scène Regietheater sur une œuvre du XXe siècle ou contemporaine (que le public a longtemps fui) que sur un Verdi. Les plus grands scandales sont nés de travaux sur Aida ou Nabucco dans les années 80, jamais sur Berg (considéré et classé à la FNAC comme « musique contemporaine » dans les années 1980).

L’accueil hostile du public est d’une certaine manière assimilable à une incompréhension culturelle de type proxémique. De même qu’on ne comprend pas certaines manifestations extérieures de cultures éloignées (comme le rôle du sourire chez les asiatiques), de même alors qu’on s’attend au donné d’un quotidien théâtral ancré dans sa propre culture et ses propres représentations, on est contraint à la décentration, qu’on refuse : le spectacle devient donc « provocation », « n’importe quoi ». Ce qu’on accepte pour un théâtre d’une autre culture, exemple, le théâtre japonais ou l’opéra chinois (donnés comme étrangers), on ne l’accepte pas d’une culture ou d’une posture qu’on pense voisine, sur des textes théâtraux connus et partagés et à l’opéra, sur des œuvres nées internationales et donc qui sont du domaine culturel partagé de l’Europe occidentale.
La question est donc profonde : est-on disponible pour les lectures plurielles d’un texte ou d’une œuvre ? A l’opéra le texte est forcément pluriel puisqu’il y a double texte (livret et partition), le texte peut dire une chose et la musique une autre et en tout cas cela autorise des doubles lectures, d’autant plus d’ailleurs si le metteur en scène connaît bien la musique. D’où l’ambiguïté et d’où surtout l’incompréhension : seulement il s’agit d’une incompréhension née d’un refus de disponibilité du spectateur. Indisponibilité qui confine à l’intolérance, désormais habituelle dans nos cultures occidentales. D’où les réactions d’une rare violence, notamment aux USA mais pas seulement contre le Regietheater et ses épigones[4], où on l’accuse de tous les maux du théâtre.
Cet écartèlement du spectateur d’opéra, pris entre son horizon d’attente (l’émotion) et ce qui lui est visuellement servi (la distanciation) fut un des grands motifs des broncas diverses que l’opéra a connues ces dernières années et d’imprécations régulières sur les blogs et les forums.
La mise en scène a déterminé malgré tout des transformations profondes à l’opéra
Les choses évoluent cependant : la présence du metteur en scène et les exigences scéniques ont imposé à l’opéra des éléments visuels nouveaux, par exemple une adéquation entre le rôle chanté et le physique du chanteur ; la Callas avait commencé, mais c’est dans les quarante dernières années, à cause des « exigences » de la mise en scène, que le physique des chanteurs s’est profondément transformé, effet induit essentiel : il y a très peu de Castafiore aujourd’hui sur les scènes.
L’autre évolution, c’est que le public refuse tout autant un Regietheater pur et dur que des spectacles générateurs d’ennui où la mise en scène est une ombre. Il en existe encore beaucoup, notamment les mises en scène alimentaires d’opéras italiens ; l’opéra italien est la plupart du temps le champ clos des débats, à cause du rôle du chant, à cause des amateurs de gosiers qui n’ont pas envie que les délices de l’audition soient « gâchés » par des visions : l’opéra italien est le champ clos des émotions et de la tradition.
Enfin les goûts du public évoluent vers une véritable attente de la mise en scène, pas forcément d’ailleurs de style Regietheater. Le succès d’un Romeo Castellucci à l’opéra, alors qu’il a eu tant de mal à imposer son style de théâtre pendant des décennies, montre une évolution des attentes (les lois de la réception…). Ce théâtre rituel, au carrefour de la performance, avec ses images sublimes, plait au public, même si le sens en est lointain ou abscons. Le public alors se laisse guider par la succession d’images. Même phénomène autour de Warlikowski, créateur d’images, créateur d’ambiances, avec son goût pour le cinéma. Dimltri Tcherniakov (pour citer les trois grâces de la mise en scène du moment) fait plus débat, parce qu’il est plus proche du Regietheater à l’allemande par son goût de la distanciation et sa manière de questionner les livrets. En Allemagne enfin, les stars du Regietheater sont au crépuscule de leur carrière, même si Castorf fait encore peur et la génération suivante est plus critique (voir un Tobias Kratzer). Un metteur en scène comme David Bösch très prisé et souvent invité dans les opéras est plutôt « traditionnel » dans sa manière d’aborder les livrets.
La France ne produit pas actuellement de figures définitives de la mise en scène d’opéra. Olivier Py est un bel esthète, il produit de la forme séduisante, plus discutable du côté du fond. Stéphane Braunschweig ne convainc pas à l’opéra (son Ring d’Aix-Salzbourg n’est pas une réussite). Il faudrait regarder du côté de Christophe Honoré, analyste sensible, et bon lecteur de textes dont l’approche est assez radicale (voir son Cosi d’Aix).
Mais le théâtre français, dont l’histoire évolue entre deux pôles qui sont l’acteur et la fidélité au texte, élément central (depuis la tragédie classique) n’est décidément pas disponible pour une approche distanciée.
On peut par ailleurs s’étonner qu’un pays qui a porté la danse contemporaine et qui a tant essaimé n’ait pas produit de chorégraphes/metteurs en scène d’opéra. C’est en Flandres qu’il faut chercher (Anna Tereza de Keersmaker ou Sidi Larbi Cherkaoui) la Flandre qui produit l’un des théâtres les plus inventifs, soit techniquement (Cassiers), soit idéologiquement (l’utilisation de la violence chez un Jan Fabre par exemple) et qui en même temps est très liée à la tradition du Regietheater (voir Ivo van Hove). La Flandre a été le terrain de l’invention théâtrale et chorégraphique, mais aussi – faut-il y voir un signe ? – du renouveau des managers (Mortier, Dorny). Le suisse Aviel Cahn pourra-t-il oser à Genève ce qu’il ose au quotidien à Anvers ?
La fidélité aux intentions de l’auteur
Dans les arguments développés contre les mises en scène un peu acides, l’un des principaux consiste à dire que l’auteur est trahi, que la musique est contredite, que les intentions de l’auteur sont foulées aux pieds ; ce type d’argument a été utilisé contre Wieland Wagner, contre Chéreau, contre Castorf, à propos des représentations wagnériennes, parce que Wagner est à la fois celui qui intéresse sans doute le plus les metteurs en scène et celui dont le temple est jalousement gardé par des centaines de vestales investies d’on ne sait quelle mission mystique. Sans doute la vestale wagnérienne a-t-elle reçu les stigmates en prostration sur la colline verte. Comme en plus Wagner a beaucoup écrit et théorisé, il est évidemment facile de défendre des « intentions de l’auteur ».
Si l’auteur a exprimé des intentions, il est juste de les connaître, mais pas forcément juste de les suivre, eu égard à la théorie de la réception et aux lois de l’herméneutique signalées plus haut.
Prenons l’exemple, une fois de plus de la tragédie grecque. Nous sommes éloignés dans le temps et dans la culture des conditions de la représentation de la tragédie. Nous sommes encore plus éloignés des « intentions » des auteurs, dans la mesure où peu de pièces nous sont parvenues, où nous savons peu de choses sur leurs auteurs, et surtout, dans la mesure où ils vivaient dans un espace et dans un monde complètement autres. Respecter les intentions de l’auteur, c’est respecter nos fantasmes modernes de Grèce ancienne : ainsi la représentation de la tragédie grecque est –elle déjà, même dans la vision la plus traditionnelle, une trahison.
La tragédie grecque ne nous parle que dans son rapport à notre monde, et personne ne nous rebat les oreilles sur « les intentions de l’auteur » qu’on ne connaît pas.
Pourquoi en serait-il autrement pour des auteurs plus récents ? Les conditions de la représentation jusqu’au milieu du XIXe sont radicalement différentes de celles d’aujourd’hui, les conditions technologiques, les théâtres, les publics n’ont plus grand chose à voir non plus avec les publics et les lieux actuels. Il faut donc toujours agiter avec prudence les intentions d’auteurs dont nous ne savons rien, ou peu et sur lesquels nous projetons nos propres représentations, envies et goûts. Le rapport au lecteur du romancier est du même ordre : quand le livre est publié, c’est le public qui le fait sien ou pas. Stendhal par exemple a eu un vrai succès environ 40 ans après les publications de ses romans.
Nous ne prêchons pas une « infidélité » systématique à l’auteur, nous alertons seulement sur le danger d’agiter des concepts qui ne sont pas fondés ou qui sont partiellement applicables. Les « intentions de l’auteur » qu’on agite n’étant souvent que les représentations qu’on a des opinions de l’auteur, nées des lectures, des habitudes, de la formation individuelle, bien plus que sur de connaissances avérées.
La question posée par l’œuvre varie selon les époques, on l’a vu, et donc on ne fait le plus souvent que prêter à l’auteur un regard qui n’est que le nôtre. La richesse d’une œuvre d’art vient de sa pluralité de lectures ou de regards : en peinture, le grand public s’interroge moins sur les « intentions » du peintre.
Le Regietheater a souvent révélé des questionnements et des possibles des œuvres qui avaient échappé, y compris sur la question musicale (voir la nouveauté conjointe de l’approche de Chéreau et de Boulez), et donc a contribué à enrichir le corpus analytique des œuvres. D’où mon hésitation devant les initiatives de chefs d’orchestre tenant à mettre en scène (l’exemple le plus célèbre étant Karajan) c’est-à-dire à disposer l’espace scénique de manière à ce qu’il ne dérange pas la volonté du chef. La scéniquement médiocre Aida salzbourgeoise l’été dernier est un autre exemple, Riccardo Muti dont la méfiance envers les mises en scène est bien connue est intervenu sans doute implicitement, mais cela rejoint la tout aussi médiocre Aida (scénique) de Karajan dans le même lieu. A chacun son métier. Quand un chef d’orchestre cherche à faire de la mise en scène, il ne fait que nier l’existence du metteur en scène et lui dénier son professionnalisme spécifique.
Le concept de fidélité à l’œuvre et à l’auteur est donc à manier avec une extrême précaution ; il cache quelquefois la volonté d’une mise en scène illustrative voire de la négation de la mise en scène. Pour certains le décor est bien suffisant (que bien des spectateurs confondent avec la mise en scène quand on les interroge) pour illustrer l’œuvre, avec le chœur déployé pour un grand spectacle photographique et une mise en espace plutôt qu’en scène.
Certes, il y a la place pour toutes les lectures, des plus riches aux plus pauvres, les plus riches n’étant pas forcément du côté du Regietheater. D’ailleurs il existe une géographie implicite des théâtres d’opéra, une sorte de lutte entre nord (dramaturgique) et sud (moins dramaturgique et plus « esthétique ») qui cache de profondes contradictions.
Je suis frappé par exemple par l’ignorance actuelle de certains jeunes critiques, par exemple, qui déclarent qu’ils ne comprennent pas qu’un Giorgio Strehler eût pu être le phare qu’il fut, et font tomber leurs oukases à partir de captations ou des Nozze di Figaro de Bastille, qui ne sont qu’une resucée affadie en 1981 de sa mise en scène originale de 1973.
Ni les captations, ni les reprises de spectacles anciens ne pourront sans doute rendre l’impression d’un spectacle de Strehler, qui avait cette immense qualité de savoir à la fois et distancier et émouvoir, qui savait trouver la musique de l’œuvre en travaillant étroitement avec les chefs (même si son caractère était difficile) et qui plus que pour Chéreau, est difficile à lire dans les captations qu’on a de ses spectacles. Je reste persuadé, au vu des très médiocres productions actuelles de Simon Boccanegra, à commencer par celle de la Scala, que la reprise de la production Strehler la repropulserait au premier rang, définitif.
L’exemple très différent du travail de Ruth Berghaus sur Elektra à Lyon l’an dernier montre qu’il y a des mises en scène qui sont des œuvres. Le Ring de Chéreau, celui de Castorf, sont de cette race. C’est-à-dire qu’au-delà des époques, elles ont à nous dire quelque chose, elles traversent le temps. Pour les mises en scène, c’est très rare, car souvent elles correspondent seulement aux exigences et aux modes du moment. Celles qui les dépassent ont droit au statut d’œuvre d’art, un statut que beaucoup hésitent à donner à une mise en scène.
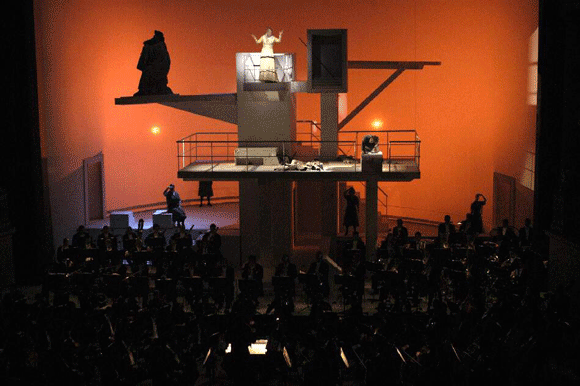
Regietheater, Mise en scène, management et crise du public
Il y a eu incontestablement renaissance du genre « opéra » par une popularité accrue dans les années 70 et 90 : en témoignent le nombre de salles construites ou reconstruites à cette époque dont l’Opéra Bastille est en France un emblème. Mentionnons aussi Helsinki ou Gênes, la plupart des opéras asiatiques, et ailleurs. Mais cette renaissance n’a pas stabilisé le public et l’on constate une crise aujourd’hui un peu partout, qui est aussi une crise des coûts : à 300€ la place, le public de la Scala ne suit plus, et avec raison.
La capacité de Bastille (2700 spectateurs) a été évaluée à un moment où l’on se battait pour avoir des places à Garnier. La capacité du MET (3800 places)a été calculée au moment où le MET était une référence notamment par le management de Rudolf Bing et l’extraordinaire floraison de vedettes que le MET possédait. Aujourd’hui, ces salles peinent à remplir, comme la Scala, par une politique de prix prohibitifs, en dépit du caractère public de ces institutions, qui ne correspondent pas au niveau de qualité moyenne des spectacles proposés. Seul l’Opéra de Vienne affiche des taux de remplissage à faire pâlir avec une politique de chanteurs et de chefs, moins de mise en scène : les très grandes salles n’ont pas intérêt à afficher trop de Regietheater ou similaire. Le public le plus large est aussi le moins disponible aux expériences, même si Vérone est en grosse crise. Mais Vérone tourne seulement sur 5 titres…
La mise en scène était dans les années 1980 et 1990 le gage de modernité d’un art qui tournait dans les grandes maisons autour d’une quarantaine de standards : le répertoire ne bougeant pas, pour ne pas lasser le public, les mises en scènes « modernes » étaient le gage que l’opéra n’était pas un art mort. Le contemporain est entré à l’opéra par la mise en scène et pas par la musique.
Aujourd’hui, c’est l’inverse, les salles de capacité moyenne marchent bien (Anvers/Gand, Lyon, Zurich, Bâle) avec une politique résolument anticonformiste au niveau des productions : œuvres moins connues et mises en scène souvent hardies (Zurich essaie cependant de travailler à équilibrer l’offre): le public est habitué, éduqué.
Le cas de Lyon est emblématique d’une salle à la capacité moyenne, et une offre programmatique qui a une longue histoire commençant au TNP de Planchon/Chéreau, qui a construit le goût du public, transféré ensuite à l’opéra avec Erlo/Brossmann qui s’est poursuivie par Serge Dorny après quelques années d’instabilité artistique et managériale. Et Lyon a un public plus jeune et un taux de remplissage enviable malgré (à cause de?) une programmation sans concessions.
Si l’on regarde sous le rapport des mises en scènes les trois grands opéras nationaux hors Paris: Strasbourg avec sa nouvelle directrice qui vient de Stuttgart ne sera sans doute pas un théâtre « conformiste », même si sa première programmation est prudente. Nous avons parlé de Lyon, et des trois, Toulouse apparaît un fief de la tradition, à quelques exceptions près. La géographie française des grands opéras régionaux reste donc équilibrée : Lyon résolument contemporain, Toulouse résolument classique, et Strasbourg pour l’instant entre deux.
Car si pour un théâtre comme Lyon la mise en scène est un donné de base, pour les très grands théâtres, l’appel à des metteurs en scène très contemporains (Warlikowski, Castellucci, Tcherniakov) pour ne citer que les plus réclamés actuellement est quelquefois moins une opération artistique que de marketing. Il s’agit de faire buzz : il ne faut jamais oublier que le scandale, les broncas servent l’opéra qui les vit : la Scala a vécu de cette légende-là notamment sur le chant mais pas seulement. Paris les vit au quotidien sur bien des mises en scène, et les médias avides de sang frais les répercutent. On espère ainsi que l’odeur du sang attirera le public
La mise en scène fait parler, souvent plus que la musique (il est plus facile, on l’a vu, de parler de mise en scène que de musique) et le Regietheater sert aussi de faire valoir, de vitrine de modernité. Dans le cas de Paris : après les années Mortier il y eut le virage Nicolas Joel, gris et sans intérêt ni idées : Stéphane Lissner a donc eu besoin de redorer le blason y compris par des broncas qui le servent. Le Regietheater (et sa descendance), les metteurs en scène– et leur public révulsé- sont aussi instrumentalisés par les managers et les directeurs artistiques.
Dernier point : les metteurs en scène de théâtre sont aussi venus à l’opéra pour des raisons alimentaires : l’opéra paie plus que le théâtre et il peut y avoir quelqu’intérêt à passer un mauvais moment au moment des saluts s’il y a de menues compensations.
Conclusions et pistes pour le futur
Ainsi ce qu’on appelle aujourd’hui Regietheater est mis dans le creuset global des mises en scènes dites modernes alors que c’est un phénomène bien inscrit dans le temps. Nous sommes évidemment dans l’après, marqué aussi par un retour à une vision moins désacralisante. On observe avec intérêt les choix d’un Klaus Bachler à Munich, cherchant à équilibrer les regards, à offrir du classique de la modernité (Kupfer) et la mode (Castellucci), n’allant jamais aussi loin qu’un théâtre comme Bâle. Mais Delnon à Bâle menait une politique qu’il ne mène plus à Hambourg, une maison vénérable qui doit en offrir pour tous les goûts. On retourne au spectacle (par l’utilisation de la vidéo, du laser, du numérique) et à l’effet, en témoigne la mise en scène du Ring de Robert Lepage au MET, qui commence avec un stupéfiant Rheingold et se termine par un poussif Götterdämmerung, dans un travail de mise en scène exclusivement fondé sur l’effet et qui ne tient pas la distance dramaturgique.

Aux conditions géographiques (l’opposition entre le Nord et le Sud de l’Europe) s’ajoutent aussi l’influence de l’histoire de la représentation : le sud catholique, est fortement marqué par la période baroque, par le spectaculaire et l’illusion, France, Italie, Espagne (encore aujourd’hui l’Espagne a une tradition lyrique fortement liée à l’Italie) ont cultivé le genre lyrique en se fondant sur des traditions spectaculaires : pièces à machines, Grand Opéra par exemple. Le nord plus dramaturgique (Flandres, Pays Bas, Allemagne Scandinavie) peut-être parce que protestant est plus lié à l’interrogation sur le Livre, et donc le texte, et en conséquence moins sur l’effet produit que sur le sens et le rapport du sens au monde. Ce sont des questions qui mériteraient plus de développements sans doute. Objet d’un futur article…
On comprend bien dès lors la complexité du problème du Regietheater, et plus largement de la mise en scène à l’opéra. Le mot Regietheater est employé pour cibler des mises en scène qui à quelque niveau dérangent. Il cache un usage de la mise en scène à la fois question naturelle posée au texte et levier pour attirer du public et faire parler de soi, et donc chiffon rouge : dans une période d’instabilité du public, l’équilibre est délicat.
Ainsi la mise en scène contemporaine est-elle peut être un outil qui ennoblit le genre parce qu’elle aide à montrer dans les opéras des questions posées au monde, mais aussi un outil de communication dans le champ lyrique aujourd’hui, un instrument au service d’autre chose qui pourrait être la survie de l’opéra…
[1] Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Trad. de l’allemand par Claude Maillard. Préface de Jean Starobinski
Collection Bibliothèque des Idées, Gallimard , Paris, 1978
[2] Une production de La Dame de Pique de Youri Lioubimov fut dénoncée par des collègues russes engagés dans d’autres spectacles, et cela aboutit à l’annulation de la production, remplacée par Madama Butterfly (Jorge Lavelli, venue de la Scala)
[3] « …en représentant la pitié [eleos]et la frayeur [phobos], elle réalise une épuration [katharsis]de ce genre d’émotions. »(Poétique, VI)
[4] https://www.earlymusicworld.com/regietheater-the-death-of-opera
