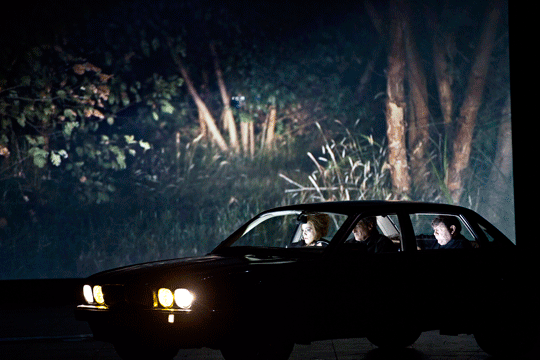
Le mal d’amour.
Pelléas et Mélisande est la nième variation sur l’amour d’un couple irrégulier et d’un mari mal aimé. La Princesse de Clèves, que Christophe Honoré connaît bien, raconte un peu la même histoire. Le Rouge et le Noir aussi, Tristan et Yseult et donc Tristan und Isolde, ainsi que le Roi Arthus de Chausson si récemment redécouvert et bien d’autres. C’est dire combien a priori ce thème n’a rien de neuf quand Maeterlinck s’en empare en 1892, c’est au contraire un topos littéraire.
Maeterlinck en fait sa version « symboliste », moyen âge rêvé, forêt mystérieuse, personnages venus de nulle part dans un royaume au nom déjà évocateur : Allemonde, une alliance de alle- qui pourrait bien venir du ἄλλος grec (autre) et du mundus latin, l’autre monde, le monde autre, qui pourrait être aussi un jeu sur « allemande » à une époque où l’Allemagne est vraiment l’autre et qui rappelle le nom qu’il choisit pour la villa qu’il achètera à Nice, la Villa Orlamonde. Je délire dans la forêt des symboles, qui raconte une histoire somme toute a priori bien commune. Il faut donc que le travail de mise en scène en fouille les spécificités pour en faire une histoire singulière.
Pelléas et Mélisande, dans l’univers fantasmatique culturel français, c’est un moyen âge de contes, salles hautes, tours élevées d’où Mélisande fait tomber sa mythique longue chevelure car c’est bien là aussi ce qu’on retient de Mélisande, une chevelure longue dans laquelle Pelléas se perd (mais non, il n’y pas de métaphore érotique, voyons !), un couple de vieillards, un mari mur (Mélisande observe dès la première rencontre ses cheveux blancs), un enfant Yniold totalement instrumentalisé et un Pelléas post-adolescent, en bref, sur le plateau s’exposent la plupart des âges de la vie.
L’univers de Pelléas et Mélisande est d’abord littéraire, le choix de Debussy de ne pas toucher au texte original de la pièce est aussi un choix esthétique : c’est la musique qui habite un texte préexistant et qui a sa vie propre, et même une vie qui a perturbé nombre d’auditeurs, à commencer par les premiers spectateurs, (les réactions fameuses à « Je ne suis pas heureuse ») essentiellement dues à mon avis au fait que le texte apparaît comme un texte de prose ordinaire alors que c’est un “Poème” de Maurice Maeterlinck et qu’il est en vers libres d’où la tension entre une langue réellement poétique, et une réception qui semble être celle d’un texte prosaïque en tous les sens du terme.

Jorge Lavelli à qui l’on doit un magnifique travail à Paris en 1977, dirigé par un non moins magnifique Lorin Maazel, pour l’entrée au répertoire de l’Opéra, disait dans une interview que les interprètes devaient s’exprimer en donnant l’impression qu’ils ne chantent pas et « s’expriment à travers le chant comme on pourrait le faire en parlant » (sic) . Un ami qui voyait l’opéra pour la première fois et qui avait lu le texte de Maeterlinck évoquait « Les parapluies de Cherbourg » pour traduire l’impression d’étrangeté voire de contraste entre un texte de prose apparemment ordinaire et une musique qui s’y adapte. Aussi étonnant que puisse être ce rapprochement, il traduit la gêne devant la présence inhabituelle de ce type de texte à l’opéra et surtout la manière qu’il a de s’imposer, selon la volonté même de Debussy mais il traduit aussi une belle intuition puisque Christophe Honoré revendique l’héritage de Jacques Demy.
En plus on en a souvent fait un texte « poétique » au sens gauchi du mot, éthéré, lointain, mystérieux comme les forêts profondes, alors qu’il y a des moments extraordinairement violents et cruels et que la censure en 1902 s’en est même mêlée…
Il y a dans Pelléas et Mélisande un aspect chair et sang qu’il n’y a pas avec la même prégnance dans Tristan und Isolde, auquel on le compare. Il y a dans Pelléas quelque chose de bien plus dramatique et urgent à cause du personnage de Golaud, qui occupe bien plus d’espace que Marke dans Tristan. Comme je l’ai déjà écrit y compris dans le présent texte, à cause du côté retenu de personnages amoureux qui dans la tradition, ne se touchent pas, et qui subissent la marque du troisième personnage, malgré leur « innocence », la situation me rappelle La Princesse de Clèves. La Princesse et Nemours s’aiment et se désirent comme Madame de La Fayette nous le fait sentir fortement lors de la fameuse scène de la canne des Indes portant les couleurs du duc dans le texte commençant par « les palissades étaient fort hautes » où le duc contemple de loin la princesse rêveuse et rêvant. Dans un autre contexte, Golaud fait regarder des amants par Yniold , et Honoré le fait regarder par dessus un haut mur -. Mais surtout avant de mourir le discours violent, injuste, lacérant, du Prince de Clèves à la princesse possède le ton désespéré et vengeur qu’un Golaud eût pu prononcer. La princesse se refusera ainsi définitivement à Nemours. Une différence de taille cependant : la princesse dit la vérité au prince, lui avoue cet amour, et ainsi fait naître jalousie, doute et destruction, et Mélisande au contraire confie ne mentir qu’à Golaud, avec d’ailleurs le même résultat. Mais il y a sans conteste des motifs littéraires voisins.
A entendre certains commentaires ou à lire certaines critiques de ce spectacle, on a vaguement l’impression qu’un peu de fumigènes, une fontaine mal éclairée et une forêt obscure suffiraient pour caler l’évocation de Pelléas et Mélisande, pour laisser le spectateur dans l’enchantement de la musique. Prima la musica ? prima le parole ? Debussy, travaillant sa musique sur le texte même de Maeterlinck a choisi…de ne pas choisir, et de proposer cette double exigence, imposer un texte et imposer une musique qui s’entrecroisent, au point qu’il n’avait pas prévu à l’origine les intermèdes qui vont avoir un bel avenir dans la musique du XXème siècle, et qui créent et renforcent cette action continue qu’il appelait de ses vœux.
Il y a par ce choix une force de la parole qu’il n’y pas dans les autres opéras français « à livret » : pas de livret forcément au service de la musique ici, mais au contraire une musique qui entend servir les paroles, et donc qui donne au théâtre une valence particulière. Bien entendu, on va penser à Wagner. Mais Wagner écrivait lui même ses textes, Debussy choisit de mettre en musique un texte qui fonctionne déjà comme texte de théâtre, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.
Pour toutes ces raisons, le texte de Pelléas, plus qu’un autre livret en français, nécessite un travail tout particulier sur la diction et sur la transmission, et sans doute aussi est-ce le motif pour lequel l’œuvre est relativement rare sur les scènes étrangères, alors qu’elle est mondialement connue : il est difficile pour un chanteur étranger dans rentrer dans cet univers si particulier.
« Les tableaux de la nature, les actions des humains, tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes ; ce sont là des apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques avec leurs Idées primordiales » : voilà ce qu’affirme Jean Moréas dans son Manifeste du symbolisme. Pourtant, même si les personnages de Maeterlinck apparaissent surgir dans l’action sans histoire, sans passé, il se dit des choses qui sont très concrètes et qui construisent une histoire et retissent un passé. Christophe Honoré choisit donc de suivre scrupuleusement le livret pour en déduire un univers, qui n’est certes pas celui habituel de Pelléas, mais qui s ‘appuie sur des éléments parfaitement vérifiables.
L’univers de Pelléas et Mélisande est un univers de contes de fées qui convient bien au symbolisme : on y trouve un peu tous les éléments du conte : Moyen-âge, Princes, lieux imprégnés de mystère et d’une sorte de vie secrète (forêt, grotte), on y trouve aussi le surgissement de Mélisande venue de nulle part peut-être, mais d’un nulle part suffisamment noir pour qu’elle ait à le fuir, un nulle part qui fait du mal, un nulle part dont elle possède une couronne qu’elle jette pour la voir disparaître.

Ce surgissement magique pose le premier élément. Jorge Lavelli avait bien montré cet univers avec cette ombre de château vaguement médiéval revu XIXème siècle. C’était une de ses belles mises en scène (Paris 1977)

Antoine Vitez, dans la mise en scène la plus poétique et la plus juste de l’œuvre, que j’ai eu la chance de voir quatre fois (Scala, Vienne, Londres), insistait sur un univers d’innocence peu à peu effilochée et détruite. Lavelli et Vitez s’appuyaient sur un univers dessiné, au total abstrait. Mais l’univers du conte est un univers de non-dit partagé. Christophe Honoré va se confronter à l’œuvre en faisant, pour évoquer un célèbre ouvrage, une « psychanalyse du conte de fées » Pelléas et Mélisande, et essayer de sortir du conformisme dans lequel l’œuvre a été souvent scéniquement enfermée.
Il la traite donc de manière théâtrale, c’est à dire comme objet d’analyse et de réflexion sur la nature d ‘un texte dont la nature dite « symboliste » ne se suffit pas à elle-même. Il cherche donc, en s’appuyant sur le livret à chercher les motivations cachées des personnages, leurs désirs, leurs limites, leurs lacérations.
Dans sa lettre aux chanteurs qui illustre le programme de salle, il affirme « rendre au désir sa nature incongrue, ridicule, déplacée, crâne, sale, absolue ». Le désir est souvent présent dans l’espace tragique, mais souvent aussi étouffé par la « bienséance » : il y a derrière tout vers racinien, la brûlure du désir « j’ai fait couler dans mes brûlantes veines » dit Phèdre…Phèdre parle à Hippolyte de manière si rapprochée qu’il sent son souffle et qu’on l’entend « Mais fidèle, mais fier et même un peu farouche » au point qu’il en rougit « cette noble pudeur colorait son visage ». Effacer le désir de la représentation tragique est non seulement une erreur, mais un contresens. De même dans l’opéra: le duo de Tristan est tout de même la métaphore musicale de la montée d’un orgasme (interrompu), et le dernier mot du texte de l’opéra est « Lust » : les mots ont un sens.
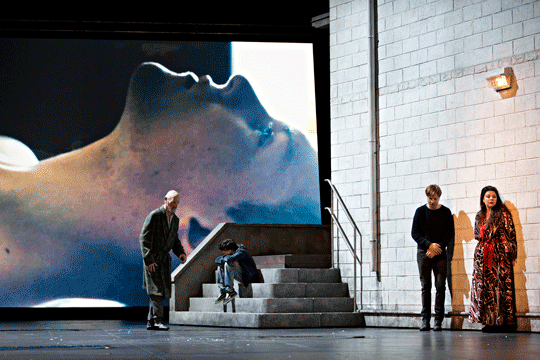
D’un autre côté, Christophe Honoré tire le texte vers la question de l’adolescence qui, on le sait, l’intéresse. Il fait de Pelléas et Mélisande un couple adolescent fragile, « la très grande force des corps et leur très grande vulnérabilité ». La fragilité est l’un des éléments centraux de l’œuvre, physiquement montrée à plusieurs moments chez le personnage de Mélisande, mais il étend cette fragilité à tous les personnages, dont il fait des personnages à fêlure, à ambiguïté: la vision d’un Marcellus mourant du SIDA offert aux regards sur l’ écran lorsqu’il est évoqué par Pelléas jette un regard particulier sur son passé et donne à l’ordre d’Arkel de différer son départ une valeur singulière qui contraint Pelléas (comme Hippolyte dans Phèdre d’ailleurs, tiens tiens) à ne cesser d’annoncer son prochain départ.
Dans cette construction intellectuelle et intelligente d’un Pelléas et Mélisande vu en version cachée, derrière les yeux, et je rajouterais derrière les corps, l’ambiance construite a évidemment une valence particulière, ainsi que la manière dont la soirée est construite : l’opéra est présenté en deux parties, une première avec toutes les scènes d’exposition, jusqu’à la scène de la grotte, puis la seconde partie qui raconte l’histoire jusqu’à son climax. Le décor d’Alban Ho Van a une présence notable, voire envahissante, voire insupportable dans ce travail, et notamment le contraste avec la scène I (ainsi que la dernière scène) espace vide avec Jaguar (la voiture) dans une nuit brumeuse, et une forêt à peine visible sur l’écran qui projette les images que le texte ne dit pas mais suggère, ou que les personnages sentent ou rêvent ou que le public a peut-être envie de voir. Dès la deuxième scène (la lettre, magnifiquement dite par la Geneviève incarnée de Sylvie Brunet Grupposo) commence un ballet insupportable de structures lourdes de décor qui font beaucoup de bruit par leur déplacement et qui dérangent.
Je suis tombé dans le piège, et à l’entracte je disais ne pas entrer dans le spectacle, être dérangé et être bien peu convaincu de l’approche.

D’ailleurs, d’autres spectateurs n’hésitent pas à sortir dès l’entracte. Ce qu’il ne faut jamais faire en principe, et en particulier ici, car le sens de ces mouvements, de ces hauts murs qui obstruent toute vision, qui ne laissent aucun horizon, apparaît dans toute sa logique dans la deuxième partie. Un monde d’arrière cour, de sorties de service, de garages ou de dépôts, un monde de murs à la fois cru et glauque (au sens d’aujourd’hui), mais qui finit d’ailleurs par dégager par contraste une sorte d’irréalité, voire de poésie : la poésie de l’étouffement. D’ailleurs, Honoré utilise non seulement ces bâtiments énormes qui envahissent la scène (et qui nous rappellent que la scène de Lyon est bien plus grande que ne le laisse montrer l’ouverture sur la salle), mais aussi des murs, avec de petites portes, qui cachent un extérieur ou un intérieur lui aussi obstrué. Pelléas apparaît plusieurs fois perché sur des murs, Golaud fait regarder Yniold par dessus un mur, un univers qui étouffe, fermé, où l’enfermement fait penser inévitablement à une prison, annonciatrice de mort : n’est-ce pas une porte percée dans un mur qui annonce la fin de Pelléas ? N’est-ce pas contre un mur qu’il est poignardé ? Alors, ces déplacements bruyants de la première partie, ces structures monumentales et aveugles, sont apparemment inutiles parce qu’elles n’imposent pas de parcours, mais imposent une réduction des espaces et des mouvements, mais rendent aussi facile de se dissimuler aux autres et voir sans être vu : Néron regardant Junie dans ce palais labyrinthique qu’est la Domus Aurea. Ces mouvements agacent, mettent mal à l’aise, lassent même : et finissent par installer chez le spectateur le sentiment qu’Honoré veut transmettre : l’envie d’air, l’envie d’espace l’envie de l’extérieur, l’envie, en bref, que ça finisse. Honoré est trop fin pour ne pas l’avoir voulu : ni une erreur, ni une maladresse mais une perturbation volontaire.
De même, volontaires, les interruptions (que Debussy ne voulait pas) le rideau qui se baisse, la mélodie interrompue là où Debussy voulait un flot ininterrompu, l’œuvre découpée en « séquences » pour peser, pour déranger, pour installer chez tous le cathartique malaise. Il y a quelque chose de cinématographique dans tout cela, non pas par la présence de l’écran (quelquefois caché ou partiellement dévoilé) qui dirait ce que la scène ne dit pas , ce serait aujourd’hui trop simple et trop banal, mais plutôt dans l’ensemble des mouvements, de l’ambiance imposée, de la couleur même, des jeux entre les scènes vues en grand angle (le duo final de Pelléas et Mélisande, magnifique) et les zoom où l’action se concentre dans un petit espace. Il y a quelque chose qui rappelle certains films de Kazan, un cinéaste qui prend racine dans le monde du théâtre (fondateur de l’Actor’s Studio), mais qui s’intéresse aux ambiances étouffantes (les univers à la Tennessee Williams que Kazan connaît bien). Rien de moins réaliste, rien de moins quotidien, rien de moins ordinaire que cet univers presque abstrait, une sorte de cour de récréation (ou de promenade, pour accentuer la métaphore de la prison) qui devient le champ clos des passions ou des désirs, tout comme l’espace tragique des classiques. Des murs, des palissades, sans horizon, les gens se croisent, se heurtent, s’aiment et se tuent.
Il n’est pas dit d’ailleurs que le « réel » soit sur la scène et le « fantasmé » sur l’écran, il n’est pas non plus interdit que des scènes emblèmes de l’œuvre soient vues d’une manière moins évocatoire et plus directe. Il n’est donc pas interdit que la scène de la chevelure si mythique soit directement érotisée, devienne crue et « sale » pour reprendre un adjectif utilisé par Honoré, mais Baudelaire avait déjà avant lui fait de la chevelure un objet poétique et érotique.
D’ailleurs Honoré s’amuse avec la chevelure : il sait bien que pour tous les spectateurs, Mélisande c’est d’abord une chevelure : alors, sa Mélisande va porter des perruques diverses, devenant un avatar de Lulu, un avatar de prostituée, au gré des désirs de Golaud qui l’a épousée, ou qui la possède (en tous les sens du terme), devenant par là-même une sorte d’autre namenlose sans identité que celle qu’on lui met sur la tête. Et la perruque devient « signe » de Mélisande au point qu’Yniold s’en coiffe et qu’Arkel le confonde avec elle et l’embrasse: Mélisande réduite à un accessoire.
A ce propos d’ailleurs, d’aucuns ont vu s’ouvrir un espace pédophile, un concept à la mode aujourd’hui. Je ne vois ni intérêt ni cohérence dans cette interprétation qui tourne court. J’y ai vu plutôt l’idée d’un Yniold qui protège les amants (disparus dans le bâtiment) et qui met la perruque de Mélisande pour donner le change et « détourner l’ennemi», ce qui met Yniold l’enfant du côté des deux autres enfants, comme les appelle Golaud en les surprenant, ne l’oublions pas, et qui renvoie le couple au monde des enfants, des plus jeunes, d’une certaine innocence, de cette insouciance des « jeux interdits », ce qui me paraît plus riche et plus cohérent avec le sens du travail proposé.
Si l’on disserte sur la chevelure et ses avatars et les perruques successivement portées par Mélisande, il faut remarquer que Mélisande à mesure qu’elle se libère de Golaud quitte ses habits de bourgeoise chic ou de prostituée fantasmée pour être de plus en plus naturelle, ce qu’elle est lorsqu’elle avoue son amour à Pelléas. Dès que l’amour est avoué, dès que la vérité est étalée, dans son naturel et sa netteté, plus de perruque, plus de place pour l’artifice : c’est la fin des jeux de faux semblants et d’une certaine manière, du marivaudage. C’est la fin du « faire comme si ». Il y a une exigence du « dire vrai » ou de « l’être vrai » quand l’amour est avoué. Il en est ainsi entre les deux amoureux, comme chez Marivaux (final des fausses confidences) ou même comme chez Stendhal (dans le Rouge et le Noir, la scène de la visite de Madame de Rénal en prison).
Je ne sais si je sens « vrai », mais je n’ai pas vu les scènes un peu plus crues où les héros se touchent comme des scènes « vraies » au sens où c’est ce que vivent forcément les personnages : c’est possible sans doute parce qu’ils sont dominés par leurs désirs, mais ce peut-être aussi une représentation directe du fantasme et du désir sans que celui-ci forcément s’accomplisse « en vrai ». Comme le rêve de Mélisande projeté à l’écran, dormant entre deux hommes la lutinant immédiatement après une image de Mélisande dormant comme si elle était morte dans une mare de sang (voir photo conclusive du texte) constitue un raccourci d’Eros-Thanatos. Et par la même un signe.
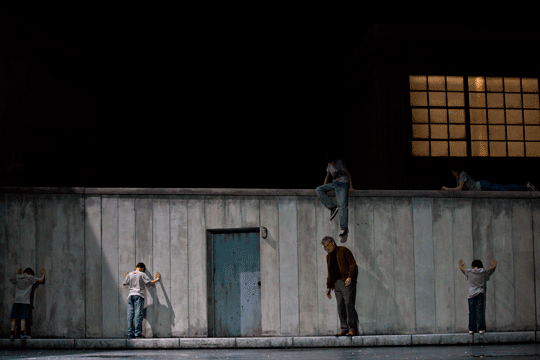
Mais la scène très théâtrale où les cinq enfants apparaissent lorsque Golaud force Yniold à regarder n’est pas plus « réelle » et eût pu être vue à l’écran. Les limites entre ce que dit la représentation scénique et ce que dit l’écran ne sont pas très nettes ; il serait trop simple de n’y voir que la différence entre réel et fantasme.
Ce qui m’intéresse dans ce travail, c’est son regard vers les possibles du texte, les sous-textes, les non dits. Dans ce texte tout en litotes, c’est à dire en réalité tout en force réprimée, représenter scéniquement la litote n’a pas un intérêt très novateur, c’est une paraphrase réussie si elle est bien réalisée par la mise en scène, terriblement ennuyeuse si elle n’est qu’illustration voire répétition.
L’intérêt du travail de Christophe Honoré, c’est qu’il est intelligemment dérangeant, qu’il ne va jamais contre tous les possibles d’un texte qui n’est pas si éthéré qu’on croit. Quand il montre Mélisande jeter l’anneau volontairement dans l’eau comme elle a jeté la couronne au départ, il nous oppose à « l’acte manqué » un acte volontaire, qui dit quelque chose de Mélisande qu’on sent mais qu’on préfère ne pas voir.
La magnifique scène où le couple, au IVème acte, s’avoue son amour, et justement traitée à l’opposé : plus d’attouchements, mais deux êtres à l’opposé dans l’espace qui envahissent de paroles cet espace vide; un espace rempli par l’écran au fond qui raconte peut-être l’histoire que nous voudrions voir vivre. L’amour arrive, et tout ce qui faisait le désir non exprimé, le non dit, la vérité cachée, s’éclipse avec une intensité inouïe. Et c’est à ce moment que Golaud , quand le doute n’est plus permis, poignarde contre le mur( !), Pelléas, piégé par l’espace clos et les portes fermées (par Yniold qui est, comme Arkel, un spectateur muet et actif à la fois de l’accomplissement des destins…).
Le mal aimé construit son univers par le fantasme et le jeu des interprétations d’un geste, d’un regard, de mouvements qu’il traduit en douleur, mais aussi en espérance folle de reconquête. Quand la vérité éclate, il faut finir : en tuant Pelléas, Golaud casse le couple mais s’inscrit à jamais dans leur histoire de couple, comme Phèdre condamnant à mort Hippolyte a enfin un rôle dans sa vie, lui qui ne l’a jamais regardée. En tuant Pelléas, Golaud existe enfin pour Mélisande, qui en meurt, et qui meurt de cet enfant de lui qu’elle ne peut plus accepter.
Honoré, je l’ai écrit plus haut, fait vraiment de l’enfant Yniold un vrai rôle, comme un chœur muet le plus souvent qui observe avec une vie propre vue à l’écran, une vie cachée, une vie d’ado, et qui prend part, sinon parti dans la trame qui se noue, et donc je pense qu’il faut l’ajouter aux trois protagonistes. Ainsi, face aux quatre personnages Pelléas, Mélisande, Golaud et Yniold, le couple Geneviève-Arkel a une fonction singulière, vieux couple opposé au « jeune couple », qui vivent cette histoire par procuration, eux dont l’histoire semble arrêtée, et décatie : Geneviève chante au début, mais apparaît plusieurs fois dans plusieurs costumes, du dimanche, de ménagère, en robe de chambre, dans une sorte de quotidien du couple qui en a fini avec les histoires d’amour et qui se confronte au quotidien, pas très drôle, pas très reluisant. Arkel moins extérieur accompagne et commente l’action, il n’est jamais bien loin, comme si lui aussi était amoureux de Mélisande, mais un amoureux qui avec la distance de l’âge, n’attend plus rien, un amoureux qui est quelque part un vague prédateur (voir la scène avec Yniold déguisé, qui le trompe et le fait sortir du bois) son physique à la Nosferatu y fait penser.
Certains – et ce n’est pas faux – ont vu des rapprochement avec Lulu, non dans le caractère de Mélisande, mais dans la manière dont elle est présentée, dont Golaud l’habille de manière artificielle, outrancière, apprêtée, dont elle surgit sans « avant », vêtue comme une prostituée trouvée au bord de la route, et surtout dans la manière dont elle est vue par les hommes, dont elle est « habillée » par les hommes. Il y a dans le regard d’Arkel sur Mélisande quelque chose de ce genre. Et il n’y pas à s’étonner de le voir prendre une part active à sa fin (chloroforme), comme un Jack l’éventreur (ou un Nosferatu) en l’occurrence chloroformeur. Comme on chloroforme les chatons avant de les étouffer ou de les noyer. Arkel qui a compris que les murs sont infranchissables et qu’il vaut mieux le grand saut. On peut aussi penser que si Golaud a tué Pelléas, le père efface Mélisande en une sorte de solidarité intergénérationnelle et amoureuse.
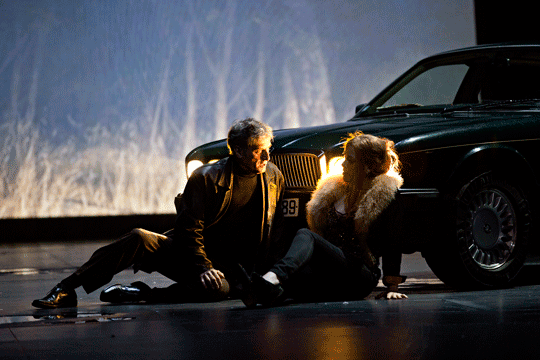
Le spectateur se confronte à la complexité d’une analyse d’un livret qui emmène ailleurs, avec de vagues rapports avec ce que nous avons l’habitude de voir, même si les murs peuvent de manière lointaine rappeler les murs d’un château, mais qui se retrouve détourné et conduit sur une autre voie, sur un autre chemin, tout aussi abstrait malgré un décor envahissant et un faux réalisme caricatural comme la fameuse Jaguar qui ouvre et qui ferme l’œuvre.
Voilà une voiture qui évidemment est là comme première image « choquante » d’un univers que Christophe Honoré veut imposer. On attend une forêt, on l’a retrouve projetée sur un écran, on attend le moyen âge et on a une Jaguar un peu ancienne trônant au milieu d’un espace brumeux.
Voilà une image « hyperréaliste » certes, mais aussi quelque part symboliste, qui renvoie à cause du chauffeur à l’idée de pouvoir et de richesse, d’une richesse sans doute un peu passée : que fait une voiture dans la nuit, attendant le maître parti chasser, au pied de laquelle une jeune femme clairement vêtue en prostituée est lovée. La chasse de Golaud dans les bois ressemble à une chasse moins animalière : on peut même se demander qui il a tué pour revenir avec une lame sanglante et du même coup Mélisande refusant qu’on la touche est presque une prise, une proie trouvée par hasard qui va être possédée et qui sent confusément cette violence. Golaud veuf et seul cherche fortune, et trouve à ses pieds la proie idéale, celle qu’il va posséder et habiller : ce que nous dit Honoré ici, c’est que Golaud est dès le départ un danger.
À la fin, la voiture retrouve une fonction symbolique, comme si ce qui venait d’être vécu se bouclait. Tout s’était ouvert par le surgissement Mélisande, et finit sur Mélisande renvoyée dans le néant d’où elle semble venue. Mais cette fois-ci c’est Arkel qui officie.
Chloroforme, sac poubelle qu’on sort de la malle arrière, c’est pour moi une scène elliptique, suspendue, où sur l’écran Mélisande va se noyer et laisse le monde, et qu’on va noyer, qu’on va effacer, dans un sac poubelle. Où est le réel ? où est le figuré ? La grandeur du suicide ou une mort à la Gilda dans un sac ?
Il n’est pas interdit de penser que la Mélisande du début se laisse mourir au moment où on la trouve et qu’à la fin on l’y aide et on la pousse, comme un petit objet qui a perturbé un moment l ‘étrange Allemonde, et qui va passer hors le monde (comme Orlamonde). Il y a là des motifs auxquels on pense, sans que la scène ne nous donne clairement la solution, comme d’ailleurs la vision traditionnelle de la mort de Mélisande sans raison, sans motif autre qu’un effacement.

Christophe Honoré ne donne pas toujours d’explications claires, offrant au spectateur un choix, des chemins, et c’est sa manière à lui de traiter le symbolisme, un symbolisme passant par des images concrètes, des ambiances presque cinématographiques (on parlait plus haut d’Elia Kazan) et donc un symbolisme post-cinématographe.
Aussi ne réduit-il pas l’action à 3 protagonistes et 3 ou 4 spectateurs. Les spectateurs, Geneviève, Arkel, Yniold et le chauffeur qui est aussi le médecin (Jean Vendassi) ont chacun une part du drame, Yniold fait mouvoir consciemment ou non (tantôt l’un tantôt l’autre comme les enfants dangereux) les leviers de l’action, Arkel n’est plus le commentateur, mais à la fin l’acteur. Honoré accorde aux personnages non principaux des rôles, y compris muets

(servantes qui rampent comme des Erinyes à l’acte IV annonciatrices de mort et qui sortent par une porte dérobée, pourquoi ? pour où ? ), le tout au service d’une ambiance d’une infinie tristesse, sans lueur, sans rien de magique, et étouffante, et mortifère.
Voilà un travail très construit, avec un savant équilibre entre une première partie de mise en place (y compris musicale) volontairement « lourde » et un peu démonstrative ou vécue comme telle et une seconde partie où les « pièges » de la première se referment et où s’éclairent les choix initiaux.
Dans cet univers, les chanteurs – diseurs- acteurs ont un rôle particulier, essentiel, qui fait qu’on ne peut vraiment séparer le chant de la mise en scène. Il y a un lien plus essentiel et plus profond entre les deux aspects.
Le petit Yniold confié à un enfant de la maîtrise (excellente) de l’Opéra de Lyon (Léo Caniard, vraiment émouvant sur scène et la voix fragile et si juste de Cléobule Perrot) est une bonne initiative alors qu’il est confié le plus souvent à un soprano : la voix non encore faite, encore un peu vive comme le vin nouveau, fait pendant à la voix vieillie et presque défaite de Vincent Le Texier, il y a là entre le père et le fils un contraste bienvenu et frappant, qui renvoie d’autant plus Golaud dans le monde des anciens, le monde des non-jeunes. Le monde de la finitude.
La Geneviève de Sylvie Brunet-Grupposo est d’abord une silhouette et un personnage, sa lecture de la lettre qui est tout le rôle, est l’un des moments forts de la partition et de la soirée. Même si elle a un petit vibrato qui m’a un tantinet gêné, elle dessine un univers proche du Lied qui impose un temps suspendu. Vraiment magnifique. Elle remporte un joli succès personnel, tout à fait justifié parce qu’elle est très présente dans la mise en scène, sorte d’écho féminin à Mélisande qu’elle accompagne, sorte d’ombre au milieu de ses servantes, jamais étrangère à l’action, et jamais dans l’action.
Arkel, on l’a vu, participe de manière plus directe au drame, jusqu’à être protagoniste de la fin de Mélisande et non plus commentateur ou spectateur. Jérôme Varnier lui prête une voix au timbre encore frais, un peu clair, moins fatigué que celui de Le Texier dans Golaud, et il en paraît donc presque plus jeune avec une diction parfaite, d’une rare clarté. La prestation musicale est dans l’ensemble de très bon niveau même s’il n’évite pas quelquefois des sons un peu fixes. Son travail d’acteur, avec ses déplacements hésitants, ses gestes esquissés, son allure de Don Quichotte égaré (version soft) ou de Nosferatu (version maléfique) en fait une silhouette forte de l’ambiance voulue par Honoré une silhouette à la fois fantomatique et d’une présence quasi permanente bien que discrète.
Golaud est un chasseur au couteau ensanglanté, voilà comme il nous est présenté. Ce début mystérieux renvoie Golaud dans le monde de ceux qui tuent, dans le monde de ceux qui font gicler le sang. Et la mort de Pelléas est la mort d’une proie.
Vincent Le Texier promène son Golaud depuis longtemps sur les scènes. La voix accuse de la fatigue, le timbre est plus opaque, mais la diction reste bonne et l’interprétation forte. Même si le jeu n’a pas la distance et la noblesse d’autres Golaud, et confine notamment à la fin à l’expressionnisme qui n’est peut-être pas le chemin voulu par l’œuvre, il reste que ce Golaud reste puissant. Christophe Honoré appuie très durement sur la dernière scène avec Mélisande où l’on atteint un paroxysme : non seulement les paroles sont très violentes et rappellent d’autres discours de mal aimés, comme je l’ai souligné plus haut, mais les gestes aussi, puisque Mélisande mourante est prise derrière la voiture, comme une prostituée. Vincent Le Texier n’installe aucune distance dans le personnage aucune distinction, mais seulement une image de lacération et une volonté de destruction . Toutefois, cette voix un peu fatiguée convient à l’idée de vieillesse installée dès le départ par Mélisande. Ce Golaud reste inquiétant et presque plus mystérieux que Mélisande.
Se pose d’ailleurs la question du statut de cette famille installée dans un monde désaffecté, une famille dont certains ont lu une part d’ombre vaguement mafieuse (Jaguar, Chauffeur, couteau ensanglanté) où la mort est donnée sans hésitation, d’Arkel à Golaud voire à Yniold. …Il y a aussi quelque chose d’une perdition mystérieuse dans ces mouvements de servantes, dans la manière d’épier l’autre, qui renforce l’atmosphère irrespirable. Si l’on est proche d’un univers racinien, ce serait Phèdre, Britannicus et Bajazet tout à la fois, si l’on est au cinéma, j’en reviens à Elia Kazan, dont les origines grecques (mâtinées d’Arménie) le rendent évidemment sensible à l’univers tragique. Cette volonté d’Honoré de rendre sensible un univers clos m’a fait penser vaguement à ce que faisait Chéreau de l’univers d’Elektra, notamment par les servantes et par le fait qu’il y ait toujours quelqu’un qui regarde.
Le Pelléas de Bernard Richter est pour moi la confirmation de la qualité de cet artiste. Confier Pelléas à un ténor, c’est du même coup modifier les équilibres vocaux des voix masculines, où l’on a habituellement plutôt une variation sur la couleur barytonale, Pelléas baryton Martin, Golaud baryton, Arkel basse ou baryton basse.
Du même coup, la voix de ténor modifie les harmoniques vocales d’une distribution où l’on a déjà souligné la couleur juvénile de l’Arkel de Jérôme Varnier , mais où cette voix claire et marquée s’oppose à celle plus éteinte de Golaud. Une voix juvénile et un corps adolescent, cela change complètement l’image de Pelléas. Je me souviens de François Le Roux, à la voix homogène, extrêmement ronde et douce (voir l’enregistrement d’Abbado), je me souviens même de Richard Stilwell à Paris avec Lavelli et Maazel, plus mâle et tout aussi tendre. Il y a dans la voix de Richter quelque chose d’un étonnement juvénile, quelque chose de direct et d’incisif qu’on ne trouve pas souvent dans le personnage de Pelléas. Il faut d’abord saluer la diction impeccable et l’engagement dans le rôle, et les aigus, un peu appuyés ou gonflés au départ mais qui deviennent à mesure qu’avance l’action de moins en moins « agressifs », et même si les graves sont quelquefois moins audibles, le discours reste éminemment conforme à ce qu’on veut du personnage, avec ses déchirures, ses fêlures, ses ruptures, ses hoquets. Cette voix pas tout à fait homogène mais parfaitement conduite, rend justice à un personnage lacéré, mais adolescent, bouillonnant de jeunesse, de désir. On croit à ce Pelléas et l’ensemble du rôle est très bien conduit, très bien tenu et très bien maîtrisé. Une vraie réussite.
On croit aussi à Hélène Guilmette, qui comme Bernard Richter, a quelques graves détimbrés, notamment à la fin, mais sa Mélisande est d’un bout à l’autre remarquable de naturel. Elle est naturelle même lorsqu’elle est si “artificielle”, en poupée à la Lulu, naturelle quand à la fin, elle revêt les simples habits de l’amour avec une robe non apprêtée, avec cette fois une vraie chevelure sans perruque platinée. La voix est présente, nette, moins diaphane qu’on a pu le dire, avec une vraie présence et pas cette présence-absence qu’on voit trop souvent chez les Mélisande, elle est à certains moments très émouvante notamment à la fin, mais elle marque aussi bien toute la première partie où elle est une Mélisande protéiforme, qui ne s’appartient pas, perpétuellement autre et pourtant la même avec une fraicheur dans le geste qui l’identifie parfaitement, la voix et la diction assurées, les multiples couleurs miroitantes du rôle parfaitement exprimées, et en même temps une jeunesse hésitante et une sûreté dans le geste et la présence. Cette Mélisande est sans cesse ambiguë ou plutôt presque bifrons, enfant et adulte, jeune fille et jeune femme, alors que le Pelléas de Richter est d’abord adolescent. La Mélisande d’Hélène Guilmette a vécu un avant et cette maturité transpire dans le chant et dans les attitudes. C’est une très belle performance qui réussit à montrer sans les résoudre les mystères du personnage.
Au service de cette distribution et de ce travail Kazushi Ono est lui aussi presque surprenant dans sa manière d’aborder la partition. On l’a connu plus froid et plus distant. Il est notamment au début particulièrement rond, presque lyrique et doux.
Claudio Abbado en faisait une sorte de flot continu de couleurs et de reflets, de sons imbriqués sans jamais de rupture. Ici, nous l’avons vu, la rupture est structurelle dans ce spectacle. Mais la manière dont Ono conduit l’orchestre donne à la fois une unité et une cohérence : c’est un travail éminemment clair, limpide, où tout est entendu ou mis en valeur, mais en même temps en une jolie construction loin des moirures symbolistes, plus directe, plus incisive à l’image des voix et notamment celle de Richter ; une direction qui à l’instar de l’ambiance scénique, est tendue à l’extrême, mais qui à son opposé n’est jamais étouffante, et toujours aérée, toujours nette, avec une énergie qui rend justice à une partition jouée quelquefois de manière trop alanguie . C’est une des lectures les plus convaincantes du chef japonais, qui donne à l’ensemble une couleur parfaitement cohérente avec ce qu’on voit sur scène. Très grande réussite d’une direction à la fois chirurgicale et attendrie, attentives aux couleurs, variée, et qui rend justice à une partition plus diverse et plus dramatique qu’on ne le pense souvent.
En conclusion, nous nous trouvons devant un spectacle complexe, qui peut rebuter et qui a rebuté. On a l’habitude de voir des Pelléas noyés dans un univers d’une nature mystérieuse et vaguement hostile, mais omniprésente : voilà qui contraste avec un univers de murs où la nature est complètement effacée sauf à l’écran, qui l’évoque (la forêt, la mer), mais seulement comme la projection rêvées d’âmes étouffées. On a aussi l’habitude de voir des personnages hiératiques qui se touchent peu et qui ici ne cessent de chercher à se toucher voire plus. On a enfin l’habitude de voir des Pelléas plus enfants et plus innocents et ici il n’y a aucune innocence nulle part, même pas celle d’Yniold.
Cet univers nous bouscule, qui joue à la fois sur le réel et le figuré, sur l’image et la scène, sur théâtre et cinéma, mais il reste pour moi tout de même un univers symboliste, même si revisité : il n’y a rien de vraiment concret dans ce travail, malgré un décor envahissant. Le concret quand il est évoqué ne trouve pas de place claire : ce qu’on voit est-il ce qui est ? Ce qui est en image est-il le fantasme du public ou des personnages, ou une suggestion d’une réalité presque « augmentée » ? Ce qui est représenté est-il effectif ou fantasmé ? Représente-on les personnages dans l’action ou les fantasmes de personnages qui se rêvent agir ? Cela reste volontairement ambigu et pour tout dire, c’est sans importance.
Il reste à la fin une tension forte, et des questions sans réponses, comme toujours d’ailleurs lors d’une représentation de Pelléas et Mélisande. En ce sens, Christophe Honoré n’échappe pas à la règle commune ; ce tissu imbriqué entre prose, poésie et musique n’aura ni imitateur ni continuateur et fonctionne parfaitement y compris dans ce travail qui soulève tant de questions et qui surprend, voire prend à revers.
Aussi faut il accepter et admirer le travail très fin que Christophe Honoré a conduit, un travail d’une grande épaisseur, qui essaie de fouiller le texte jusqu’à l’impossible, avec ses questions sans réponse : était-il si nécessaire d’ajouter des images filmées ? Marcellus mourant du SIDA s’imposait-il ? La scène où à la fin, Golaud viole quasiment Mélisande était-elle si inévitable?
Il y a ainsi un fil et des séquences, des briques qui se construisent dès le départ, avec une construction très fragmentaire où le spectateur est vraiment désarçonné, puis, ces briques s’assemblent dans une démarche constructiviste, avec néanmoins quelques trous, avec quelques éléments en suspens, qui font de ce Pelléas une question avant d’être une réponse et pas vraiment un continuum mais une succession de séquences au sens cinématographique du terme, comme des épisodes qui peu à peu conduisent à la catastrophe.
Christophe Honoré en quelque sorte nous propose la « possibilité d’un Pelléas et Mélisande » où des particules à la fois élémentaires et élaborées croisent des ambiances, des regards, des actions , des possibles convaincants ou non, mais toujours dans un véritable univers, cohérent avec l’œuvre dans sa distance et son étrangeté. Ainsi Honoré nous dérange, nous implique, nous fait réagir, et rejoint Gide : « Que l’importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée ! » [wpsr_facebook]








