
C’est désormais traditionnel, il y a chaque année une création à Aix, l’an dernier Svadba (Noces) l’opéra de la compositrice canadienne d’origine serbe Ana Sokolovic. Cette année, on passe de la Serbie en Orient, avec la création d’un opéra en langue arabe avec récitatifs et dialogues en français. Le compositeur, Moneim Adwan, originaire de ka bande de Gaza, est dépositaire des plus anciennes traditions, qu’elles soient classiques ou populaires, et travaille à relier les traditions orientales et occidentales. Kalîla wa Dimna est un opéra au livret (de Fady Jomar et Catherine Verlaguet) d’après Kalîla wa Dimna, un texte arabe traduit en castillan au XIIIème siècle, lui-même repris d’un texte persan attribué à Ibn al-Muqaffa’ du VIIIème siècle, et probablement antérieur. C’est un livre de contes fameux dans tout l’orient et l’histoire racontée ne manque pas d’échos dans notre monde actuel, naturellement.

Kalîla, la récitante, entreprend de raconter l’histoire de son frère, d’origine modeste mais dévoré d’ambition. Il devient conseiller du roi, et sentant une crainte chez le souverain, il va s’engouffrer dans la faille pour en tirer avantage.
Le souverain a appris qu’un poète, Chatraba, chante les souffrances du peuple et sa mère lui conseille de se méfier des voix qui émergent du peuple. Dimna essaie de s’occuper de la question en amenant au roi le poète. Une amitié naît et Chatraba fait connaître au roi la situation réelle du royaume. DImna en prend ombrage et va ourdir quelque chose pour y mettre fin. Les deux femmes Kalîla d’un côté et la mère du roi de l’autre s’inquiètent : instruire un prince n’est jamais sans risque..
Dimna insinue que les poèmes de Chatraba contiennent des graines de révolte, le roi convoque le poète mais prend sa sincérité pour de la fourberie. et le condamne à mort.
Chatraba est donc exécuté, mais devant la révolte du peuple, la mère du roi le proclame poète national, montrant ainsi qu’elle sépare l’homme de l’œuvre, et fait juger Dimna sans exécution sommaire. Chatraba entre chez les morts, Kalîla fait d’amers reproche à son frère et la reine accuse Dimna en montrant à son fils la réalité : un roi n’a pas d’amis et doit se méfier de tout, et de tous.
Voilà une histoire édifiante sur l’éducation des princes, la solitude du pouvoir et surtout le pouvoir de la poésie : les mots restent même si les révolutions sont matées. Que ce soit Schiller ou Wagner, ils ont choisi non de faire la révolution, mais d’écrire des textes qui, au-delà des révolutions, auront un poids définitif. Le poète est « un voleur de feu » comme écrivait Rimbaud à Paul Demény. Et faire taire les poètes est une entreprise vaine, les mots vont plus vite que les balles.
Il y a dans cette réalisation des moments très émouvants, auxquels je suis très sensible : d’abord, les surtitres en arabe et en anglais lorsque les artistes parlent en français, et lorsqu’ils chantent en arabe, les surtitres en français et anglais. Il n’y a rien là que de très normal, et pourtant nous vivons un malheureux moment où les caractères arabes et la langue arabe n’ont pas hélas bonne presse, et où les haines et ceux qui les attisent emportent le bébé avec l’eau du bain. Rappeler que la langue arabe (mais aussi le persan) véhicule une des cultures les plus hautes et les plus riches de notre monde, est essentiel, et rappeler que les langues sont véhicules de savoir et de culture n’est pas inutile de nos jours. Dans un monde qui construit haines et frontières, où certains de nos politiques les plus imbéciles et les plus indignes appellent de leur vœux la clôture et le repli, c’est important de souligner que la culture, la poésie, les textes, traversent le monde, traversent les mondes, et ce depuis toujours. Imaginez le trajet de ce texte, venu de très loin, passé par la Perse, l’Arabie et arrivé en Espagne pour être traduit en castillan au XIIIème siècle ! Les pires des obscurantistes n’y pourront rien : ils sont vaincus d’avance. C’est bien cette histoire qui nous est ici racontée, une histoire de liberté. Le pouvoir quel qu’il soit ne peut rien contre la culture, contre les traditions, contre ce qui circule malgré tout. Il aura beau mettre toutes les barrières, il sera vaincu et les barrières inutiles, tout comme les frontières. Combien d’écrivains et de poètes condamnés dans l’histoire qui survivent par leurs textes…
Cette longue introduction pour inviter les spectateurs de Lille, de Dijon et d’ailleurs puisqu’une grande tournée est prévue à aller voir ce spectacle lorsqu’il passera dans leur ville.
La réalisation, dans l’écrin délicieux du théâtre du Jeu de Paume bénéficie d’abord du dispositif simple et efficace de Philippe Casaban et Eric Charbeau pour le décor, intégrant chanteurs et musiciens, sur plusieurs niveaux, celui de la cour au sommet et celui du peuple sur le plateau, et la prison dans un soupirail, pendant que les musiciens prennent place sur le côté (Jardin)., avec des costumes assez simples et évocateurs (celui du Roi…) de Nathalie Prats.

C’est une équipe souvent jeune sortie de l’académie du Festival, qui a pris en charge la production, comme Yassir Bousselam (violoncelle), Selahattin Kabaci (clarinette) , Abdulsamet Çelikel (Qanûn) et le metteur en scène Olivier Letellier . Le spectacle dans son ensemble et le jeu sont assez simples, la question du théâtre se pose moins dans la mesure où le système de récitation et la succession de petites scènes assez brèves entourent les airs qui restent évidemment l’armature principale. On aurait peut-être aimé un peu plus de théâtre, c’est à dire un peu plus de second degré en scène, mais ce n’est pas l’option qui a été prise, qui est celle de la fraîcheur directe, du naturel et de l’absence d’artifice, c’est celle d’un conte qui peut être perçu par les enfants. Mais cette option a prise sur le spectateur, peu habitué à ces formes et à cette musique. Une musique qui allie occident et orient, mais avec des accents et des rythmes orientaux marqués – j’adore le chant arabe ; c’est ce qui m’a séduit, au point qu’à la sortie le dernier air de Chatraba (Jean Chahid) me restait dans la tête. Il y a dans les airs une alliance évidente de culture populaire et de culture élaborée : le chant de la mère du roi (Reem Talhami, qui m’a beaucoup plu) est à l’évidence plus élaboré. Les musiciens (cités plus haut, auxquels il faut ajouter Wassim Halal aux percussions et au violon et à la direction musicale Zied Zouari) s’en tirent plutôt bien, en rythme et en fusion de sons orientaux et occidentaux, une musique qui soutient toujours les chanteurs et qui est très présente et assez agréable. Dans une œuvre où la raison est portée par les femmes et la déraison par les hommes (Chatraba parce qu’il ne faut jamais être l’ami d’un roi, Dimna pour son ambition dévorante, et le roi pour son ignorance des lois de la politique), les femmes ont les meilleurs moments de chant, même si Chatraba a la forme la plus populaire et la plus directe, assez bien défendue par le jeune libanais Jean Chahid, ce qui se comprend : le chant qui doit se diffuser dans le peuple doit immédiatement saisir et séduire. Monem Adwan lui-même s’est donné le mauvais rôle, celui de Dimna, tandis que Kalîla sa sœur est confiée à l’excellente Ranine Chaar. La distribution est composée d’artistes formés à l’école traditionnelle mais aussi aux formes occidentales de musique (jazz, flamenco, classique) et c’est ce syncrétisme qui frappe et qui séduit.
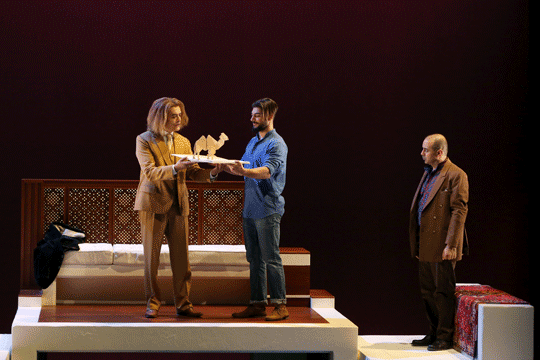
Je serais évidemment bien incapable d’analyser par le menu des styles que je ne connais pas, mais ce dont je puis témoigner, c’est de l’enthousiasme réel du public, c’est de l’extrême naturel de l’entreprise, c’est du plaisir communicatif de l’aventure. On en s’ennuie pas une seconde, même si on est à des années lumières des formes des autres spectacles du Festival, même si le spectacle tout bien conçu qu’il soit n’a pas la forme élaborée des autres spectacles vus ici : on peut le regretter d’ailleurs. Mais il y a de la vie, il y a de l’intelligence, il y a de la Méditerranée, il y a de la musique pour le cœur et cela suffit bien. Je n’ai vraiment pas boudé mon plaisir : impossible de juger ce spectacle à l’aune du reste des productions aixoises, ni même sans doute à l’aune du genre opéra, mais à l’aune du plaisir du moment, ce fut vraiment réussi.
[wpsr_facebook]

