
Les choses ont un peu bougé cette saison en Italie : un des phares de la musique de la péninsule, Daniele Gatti a quitté la direction musicale de l’Opéra de Rome où il a magnifiquement réussi, pour prendre celle du Mai Musical Florentin, dirigé par Alexander Pereira depuis 2020 et son départ de la Scala, reconstituant ainsi un couple artistique né à Zurich.
L’Opéra de Florence est une machine musicalement forte depuis des décennies, sans doute l’institution la plus ouverte d’Italie, avec un des meilleurs orchestres, un chœur vraiment exceptionnel dirigé par Lorenzo Fratini. Désormais, à la salle de l’Opéra construite il y a dix ans, s’est ajouté en décembre dernier l’auditorium adjacent, Sala Zubin Mehta, faisant de l’espace qui occupe les boulevards extérieurs de Florence, à la lisière du Centre-Ville (et à quelques centaines de mètres de l’ancien Comunale, une immense salle pas très jolie mais que j’aimais bien) un espace dédié à la musique, une Città della Musica version florentine.
L’Opéra de Florence gère aussi le petit Teatro Goldoni, sur la rive gauche de l’Arno pas très loin de la Cappella Brancacci et de ses Masaccio, et peut aussi occuper de temps à autre le Teatro della Pergola, l’un des plus anciens d’Italie, où fut créé Macbeth de Verdi en 1847 sur la rive droite pas très loin du Duomo Santa Maria del Fiore. En bref, la ville pas si grande a une solide implantation musicale et la décision de Daniele Gatti de s’y transférer n’est pas étrangère à l’ensemble des possibilités offertes.
Alexander Pereira est quant à lui un manager solide, qui n’a plus néanmoins le goût du risque, et dont les metteurs en scène de référence qui ont fait la gloire de ses années zurichoises ont disparu, ou n’ont pas l’heur de plaire au public italien, peu enclin à accepter les « nouvelles mises en scène ». plus si nouvelles d’ailleurs
Il est vrai que la situation du théâtre parlé en Italie est un désastre, que la vie d’acteur est difficile, et que le seul grand metteur en scène italien actuel qu’on voit partout à l’opéra dans les grandes salles européennes, Romeo Castellucci n’a jamais fait d’opéra en Italie ou presque (sinon Parsifal à Bologne, mais l’initiative venait de La Monnaie de Bruxelles, son théâtre d’attache).
Ni Strehler, ni Ronconi n’ont su faire école, et les metteurs en scène qui occupent les opéras de la péninsule sont souvent bien médiocres. Un seul exemple, le programme du festival de Pesaro 2022 est une misère du point de vue théâtral…
Dans ce contexte, que nous offre l’Opéra de Florence, avec sa saison « ordinaire » et son festival de Printemps, plus connu sous le nom de Mai Musical Florentin ?
Florence est une ville moyenne, aristocratique, qui vit du tourisme et des touristes, tout au long de l’année, et l’Opéra de Florence dépend de ce double public, local (tout de même assez réduit) et touristique, essentiellement saisonnier. Tous les théâtres d’Europe ont des problèmes de remplissage, comment s’en sort Florence ?
Par chance, désormais, les transports en Italie ont fait d’extraordinaires progrès : Florence est à 1h30 de Milan et 1h30 de Rome par le train à grande vitesse et le public mélomane peut désormais circuler avec plus de facilité. Il est vrai que ce public a toujours été mobile, mais l’amélioration du transport ferroviaire épargne les longs trajets en voiture qui émaillaient (quand j’habitais Milan) nos virées lyriques à Turin, Bologne ou Florence.
Pour comprendre l’organisation de la saison florentine, il faut considérer à part le « Mai Musical » qui est le Festival de Printemps (Avril-Juillet) prestigieux, fondé en 1933 par le chef d’orchestre Vittorio Gui, l’un des grands chefs italiens pas toujours si connu hors d’Italie. C’est un Festival prestigieux qui a vu la participation de chefs d’envergure comme Erich Kleiber qui y fit des Vespri Siciliani légendaires avec Maria Callas et Boris Christoff en 1951, ou Hermann Scherchen, parce que le Mai Musical stimula la diffusion de la musique du XXe siècle. Parmi les plus récents directeurs musicaux, Riccardo Muti de 1969 à 1981 qui y construisit sa carrière de chef lyrique et plus récemment Zubin Mehta de 1985 à 2018, qui est direttore emerito principale a vita. Daniele Gatti est devenu cette année le directeur musical jusqu’en 2025.
On ne compte pas les enregistrements de l’orchestre avec divers chefs, c’est en effet l’une des phalanges de référence en Italie.
En dehors du Mai musical, dont le programme est annoncé plus tard, il y a une saison d’automne et une saison d’hiver, appelées l’une « Festival d’automne » (5 productions et 1 spectacle jeunesse) et l’autre « Festival de Carnaval » (6 productions, dont deux plus légères essentiellement offertes aux solistes de l’Accademia del Maggio Musicale) , appellations qui tendent à montrer qu’à Florence règne un festival permanent (ça, c’est la com…)
De fait, la saison (qui court de septembre à avril) a tout pour séduire musicalement. Pas un théâtre en Italie peut se targuer d’afficher autant de chefs de grand renom, ou de très grande qualité : Zubin Mehta bien sûr (trois productions), Daniele Gatti (trois productions), mais aussi James Conlon, Ingo Metzmacher ou Gianluca Capuano.
Certain « plus grand théâtre lyrique du monde » à 1h30 de train vers le nord pourrait en prendre un peu de graine.
Les distributions sont elles aussi plutôt flatteuses, Francesco Meli semble y être chez lui, mais aussi Cecilia Bartoli, Nicola Alaimo, Placido Domingo, Nadine Sierra, Roberto Frontali.
Seule ombre au tableau, une politique de mises en scène dans l’ensemble médiocre, qui ne correspond en rien à la qualité musicale affichée, dont le nom le plus intéressant est Damiano Michieletto, avec pour les autres l’inévitable et désolant Livermore, Leo Muscato, ou Frederic Wake-Walker, qui ni les uns ni les autres n’ont inventé la poudre scénique.
Il faudra quand même un jour que l’Italie lyrique sorte de cette misère scénique qui la caractérise depuis les disparition de Strehler et Ronconi ou que les managers comme Pereira se secouent un peu la poussière. Seule note « historique » et plutôt positive, la présence de Piero Faggioni (né en 1936…) pour Carmen dont la mise en scène sera sans doute fille de celle que créa Berganza à Edimbourg en 1975. Metteur en scène traditionnel, élégant, et intelligent.
Très grande qualité musicale, sans doute le plus grand niveau en Italie, qualité scénique médiocre, en cela pas si loin de ce qui est affiché à la Scala alors que Naples et Rome font quelque effort pour dépoussiérer, voilà le bilan. Il reste que plusieurs voyages à Florence sont à prévoir pour les amateurs, ce qui n’est jamais désagréable…
Enfin, Pereira qui connaît son public limite les représentations à quatre ou cinq et alterne les salles entre l’auditorium très modulable, tout nouveau, aux capacités scéniques limitées mais muni de dispositifs techniques aptes au montage de productions légères (ce qui limite les frais) et à la jauge moyenne (1100 spectateurs qu’on peut aussi limiter à 500) et la Grande Sala (grande salle) de 1800 places. Ce jeu entre les salles permet sans doute de substantielles économies et d’adaptation.
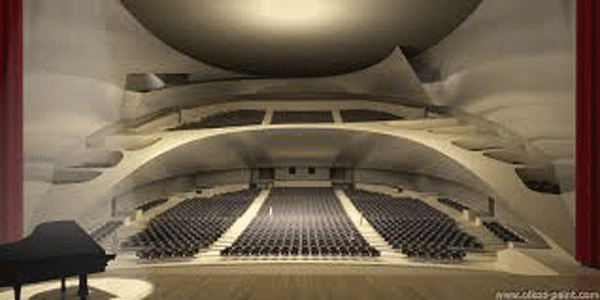
SAISON LYRIQUE
Festival d’automne, dédié à Giuseppe Verdi
Septembre 2022
Gioachino Rossini
Il Barbiere di Siviglia
5 repr. du 8 au 15 sept. 2022 – Dir : Daniele Gatti/MeS : Damiano Michieletto
Avec Ruzil Gatin, Vasilisa Berzhanskaja, Nicola Alaimo, Fabio Capitanucci
On oublie souvent que Daniele Gatti est un chef exceptionnel pour Rossini, aussi bien bouffe que sérieux (Mosè, La Donna del Lago…). La distribution est dominée par la Rosine du moment Vasilisa Berzhanskaja que les français ont découvert à Aix dans Moïse, et par Nicola Alaimo qui est aujourd’hui la basse bouffe la plus en vue pour Rossini, sans compter l’intéressant Ruzil Gatin pour Almaviva. Vaut le voyage, évidemment, et puis, Florence en septembre… Mise en scène de Damiano Michieletto archi connue (même à Paris…) et réussie.
Septembre-Octobre
Giuseppe Verdi
Il Trovatore
4 repr. du 29 sept. au 7 oct – Dir : Zubin Mehta/MeS : Cesare Lievi
Avec Maria José Siri, Amartuvshin Enkhbat, Fabio Sartori, Ekaterina Semenchuk etc…
Retour à l’opéra de Cesare Lievi, qui fut familier de Zurich aux temps de Pereira, et qui à la fin des années 1980, était un des grands espoirs de la scène avec son génial frère, le scénographe Daniele Lievi, mort prématurément à la même époque. Vous voulez connaître Daniele ? Une exposition lui est dédiée au MuSa (Musée de Salò, au bord du lac de Garde) jusqu’au 30 novembre 2022. Faites le voyage, vous ne le regretterez pas…
Distribution solide à défaut d’être excitante, Amartuvshin Enkhbat et Fabio Sartori sont une garantie de qualité, Ekaterina Semenchuk qu’on voit beaucoup dans la saison devrait être une bonne Azucena. Maria José Siri a la voix à défaut du charisme. Et puis bien sûr Zubin Mehta, l’un des grands chefs de référence pour cette œuvre.
Octobre 2022
Georg Friedrich Haendel
Alcina
5 repr. du 18 au 26 octobre – Dir: Gianluca Capuano/MeS Damiano Michieletto
Avec Cecilia Bartoli, Carlo Vistoli, Lucía Martín Cartón, Kristina Hammarström etc…
Les Musiciens du Prince – Monaco
Cecilia Bartoli fut sous Pereira abonnée à l’Opernhaus Zurich, qu’elle continue pour notre bonheur à fréquenter. L’an prochain, elle a programmé Alcina à Monte-Carlo dans une autre production, et c’est donc un peu une année Alcina, et à Florence, les Musiciens du Prince – Monaco seront aussi dans la fosse avec leur chef Gianluca Capuano, ce qui nous garantit une exécution exemplaire. Distribution solide avec notamment Carlo Vistoli, le meilleur contre-ténor italien et mise en scène de Michieletto, qui pourrait être intéressante. Vaut le voyage évidemment.
Novembre 2022
Giuseppe Verdi
Ernani
5 repr. du 10 au 20 nov – Dir : James Conlon/MeS : Leo Muscato
Avec Maria José Siri, Francesco Meli, Roberto Frontali, Vitalij Kowaljow
Quatuor vocal solide une fois de plus, même si ni Siri, ni Kowaljow ne font rêver, mais Francesco Meli, dans un de ses meilleurs rôles, et Roberto Frontali, le meilleur et le plus subtil des barytons italiens, sont aptes quant à eux à nous ravir. Mise en scène de Leo Muscato dont il n’y pas grand-chose à attendre, et direction musicale de James Conlon, un des chefs lyriques les plus réguliers, une garantie sinon d’originalité, du moins de cohérence et de fidélité à Verdi.
Décembre 2022
Faust
9 repr. du 24 nov. au 2 déc. – Musiques de Berlioz, Gounod, Mozart, Bach
Un spectacle de Venti Lucenti avec 80 jeunes du projet “All’Opera… in campo!”
Un spectacle largement dédié aux jeunes et aux écoles
Au Teatro Goldoni
Décembre 2022-Janvier 2023
Giuseppe Verdi
Don Carlo (Version en 4 actes)
5 repr. du 27 déc. au 8 janv. – Dir: Daniele Gatti/MeS: Roberto Andò
Avec Mikhail Petrenko, Francesco Meli, Ekaterina Semenchuk, Alexander Vinogradov.
On aurait évidemment préféré la version française, mais on se contentera de la version italienne en quatre actes, plus courte, plus ramassée et donc sans doute plus économique. Pas encore d’Elisabetta affichée, mais Francesco Meli est une garantie, et Semenchuk peut-être dans le Don fatale, mais sûrement pas dans la canzone del velo, et pour moi aucune garantie pour un Mikhail Petrenko comme Filippo II, u timbre trop clair pour le rôle.
Mise en scène Roberto Andò, qui s’attaque là à une oeuvre trop grande pour lkui…
Mais Daniele Gatti en fosse, cela nous garantit un Verdi fouillé, limpide, dramatique. C’est lui qui vaut le voyage initial de 2023.
Festival de Carnaval, dédié à Faust et Goethe
Janvier 2023
W.A.Mozart
La Finta semplice
4 repr. du 24 au 29 janvier – Dir : Theodor Guschlbauer/MeS : Claudia Blersch
Avec Benedetta Torre, Luca Bernard, et des solistes de L’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino
Au Teatro Goldoni
On change de Festival et on passe au Carnaval. Pereira aime beaucoup Theodor Guschlbauer, autrichien comme lui, dont les strasbourgeois se souviennent qu’il fut pendant 14 ans (1983-1997) directeur du Philharmonique de Strasbourg. C’est un chef de style « Kapellmeister », auquel les musiciens peuvent se fier, pas forcément inventif, mais garantie musicale. Il dirige ce Mozart dans le cadre intime du Teatro Goldoni avec la jeune Benedetta Torre et les solistes de l’Accademia del Maggio… la mise en scène est signée Claudia Blesch à qui l’on doit l’adaptation semi-scénique de la Cenerentola avec Bartoli qui a fait le tour du monde.
Si vous ne connaissez pas le teatro Goldoni et si vous passez par là…
Février 2023
Ferruccio Busoni
Doktor Faustus
5 repr. du 7 au 21 février – Dir : Ingo Metzmacher/MeS : Davide Livermore
Avec AJ Gluckert, Olga Bezsmertna, Wilhelm Schwinghammer, Thomas Hampson/Dietrich Henschel.
Continuant la tradition XXe siècle du Mai Musical Florentin, voici le rare Doktor Faustus du rare Busoni, une œuvre taillée exactement pour le chef Ingo Metzmacher, qui aime cette période de la musique (1924). L’œuvre pas tout à fait achevée malgré une composition qui dura six ans requiert un orchestre important. C’est Thomas Hampson en alternance avec Dietrich Henschel (sur une date) qui tient le rôle principal, c’est dire la qualité d’ensemble qu’on doit attendre d’une bonne distribution par ailleurs. Mise en scène de Davide Livermore qui au seul nom de Faust doit déjà mettre en place son cirque folie-bergérien.
Mais pour l’œuvre, devrait valoir le voyage.
Février 2023
Giuseppe Verdi
La Traviata
4 repr. du 12 au 22 fév. – Dir : Zubin Mehta / MeS : Davide Livermore
Avec Nadine Sierra, Francesco Meli, Placido Domingo/George Petean
Une Traviata de légende, signée Franco Zeffirelli dont fut tiré un film, est née à Florence, et même venue ensuite à Paris.
C’est une fois encore à David Livermore à qu’on a confié la production. C’est à croire qu’il n’y a que lui de disponible en Italie, même pour une Traviata. Choix lamentable de Pereira. Je ne suis pas zeffirellien a priori, mais j’aurais plus volontiers revu la vieille production.
Au contraire, c’est musicalement sans doute un must qui va faire courir les foules : Sierra, Meli, Domingo, c’est un trio de choc et même quand Domingo ne chantera pas, c’est l’excellent Petean qui sera Germont avec dans la fosse un Zubin Mehta qui dirigeait à Florence et à la reprise parisienne en 1986 (d’ailleurs sifflé par les arbitres du bon goût parisien, je veux dire les imbéciles patentés de notre scène nationale). Comme on le sait, aux vieux pots la meilleure soupe, même à la grimace Livermore.
Mars 2023
Igor Stravinsky
The Rake’s progress
5 repr. du 12 au 26 mars – Dir: Daniele Gatti / MeS: Frederic Wake-Walker
Avec Sara Blanch, Matthew Swensen, Vito Priante, Marie Claude Chappuis, Adriana di Paola
Daniele Gatti est un grand admirateur de la musique de Stravinsky, et il avait prévu ce Rake’s Progress à Rome dans une mise en scène de Graham Vick, ce qui était autre chose que Frederic Wake-Walker, un metteur en scène assez pâle et plus paillettes que substance. Mais ce Rake’s Progress romain a été annulé (Covid) et Graham Vick est décédé.
Alors sans doute à cause du désir de Gatti, l’œuvre réapparaît à Florence et c’est une excellente idée, dans une autre distribution avec la charmante (et excellente) Sara Blanch, le très intéressant Vito Priante en Nick Shadow et le jeune ténor Matthew Swensen déjà vu à Florence (Cosi fan tutte notamment) comme Tom Rakewell.
Vaudra le voyage, d’abord pour le chef et l’orchestre.
Mars-avril 2023
Georges Bizet
Carmen
5 repr. du 28 mars au 16 avril – Dir : Zubin Mehta / MeS : Piero Faggioni
Avec Clémentine Margaine, Valentina Nafornita, Francesco Meli, Mattia Olivieri
Zubin Mehta dirige le chef d’œuvre de Bizet, encore une série de représentations apte à attirer du public local et extérieur. On y note la Carmen de Clémentine Margaine, qu’on voit peu en France et c’est dommage, la charmante Valentina Nafornita en Micaela, et le Don José de Francesco Meli qu’on voit décidément beaucoup cette saison à Florence, mais on notera avec intérêt l’Escamillo du baryton qui monte en Italie et ailleurs, l’excellent et sympathique Mattia Olivieri.
On l’a déjà écrit, appeler le vétéran Piero Faggioni pour une mise en scène créée pour Teresa Berganza qui a marqué l’histoire de l’œuvre (vue à Edimbourg, Paris Opéra-Comique et à la Scala) n’est pas en soi une mauvaise idée. Mieux vaut une mise en scène ancienne mais marquante, que tant de médiocres faussement modernes.
Gioachino Rossini
L’Italiana in Algeri per le Scuole
5 repr. du 31 mars au 5 avril – MeS : Grisha Asagaroff
Solistes de l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino
Pour les écoles, sans doute (vu le metteur en scène) une adaptation de la mise en scène de Ponnelle
La suite lorsque le programme du Mai Musical Florentin 2023 sera annoncé
SAISON SYMPHONIQUE

La saison symphonique reflète l’impression de richesse musicale de la saison lyrique, on y retrouve évidemment et Zubin Mehta et Daniele Gatti dans des programmes très divers, faits de « must » et de pièces moins connues– un seul exemple, Daniele Gatti dirige un concert de compositeurs italiens du XXe siècle peu fréquents dans les programmes, même en Italie (le 24 novembre), les chefs invités du lyrique (Theodor Guschlbauer, Ingo Metzmacher, James Conlon) sont aussi affichés dans la saison symphonique, et d’autres comme Andrés Oroczo Estrada, Sir Mark Elder, Marc Albrecht ou Dame Jane Glover (seule femme dans la série) sont par ailleurs programmés. Deux orchestres extérieurs, le prestigieux Gustav Mahler Jugendorchester avec à sa tête le non moins prestigieux Herbert Blomstedt et l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo (Charles Dutoit) avec Martha Argerich complètent un riche tableau où chaque programme est donné une seule fois, mais où la saison affiche 24 concerts différents.
2 septembre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Theodor Guschlbauer, direction
Andrea Lucchesini, piano
Mozart, Beethoven
(Cavea del Maggio – en plein air )
4 septembre 2022
Gustav Mahler Jugendorchester
Herbert Blomstedt, direction
Schubert, Bruckner
(Auditorium)
9 septembre 2022
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Zubin Mehta, direction
Mandy Fredrich, soprano
Marie-Claude Chappuis, mezzosoprano
Maximilian Schmitt, ténor
Tareq Nazmi, basse
Cycle Beethoven
Symphonies 8 et 9
(Sala Grande)
6 octobre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Zubin Mehta, direction
Guglielmi, Cherubini, Schumann
(Sala Grande)
13 octobre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Zubin Mehta, direction
Bruckner,
Symphonie n°8
(Sala Grande)
16 octobre 2022
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Daniele Gatti, direction
NN, Soprano
Wagner,
Parsifal, prélude acte I, Verwandlungsmusik acte I, Enchantement du Vendredi Saint (Acte III)
Verdi,
Quattro pezzi sacri
(Sala Grande)
19 octobre 2022
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Zubin Mehta, direction
Eleonora Filopponi, mezzosoprano
Mahler,
Symphonie n°3
(Sala Grande)
23 octobre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Andrés Oroczo Estrada, direction
Haydn, Ravel, Strauss(R)
(Sala Grande)
29 octobre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Zubin Mehta, direction
Maurizio Pollini, piano
Schubert, Mozart Haydn
(Sala Grande)
30 octobre 2022
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Charles Dutoit, direction
Martha Argerich, piano
Ravel
Valses nobles et sentimentales
Concerto en sol
Stravinsky
Le sacre du printemps
(Sala Grande)
12 novembre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
James Conlon, direction
Respighi, Chostakovitch
(Auditorium)
19 novembre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Dame Jane Glover, direction
Luca Benucci, cor
NN, soprano
Prokofiev, Mozart, Haydn
(Auditorium)
24 novembre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Daniele Gatti, direction
Petrassi, Ghedini, Casella
(Auditorium)
27 novembre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Christoph Eschenbach, direction
Bruckner
Symphonie 7
(Auditorium)
3 décembre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Daniele Gatti, direction
De Falla, Debussy, Ravel
(Auditorium)
15 décembre 2022
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Sir Mark Elder, direction
Weber, Mahler
(Auditorium)
22 décembre 2022
Concert de Noël
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Diego Fasolis, direction
Lenneke Ruiten, soprano
Lucia Cirillo, mezzosoprano
Juan Francisco Gatell, tenor
Georg Nigl, baryton
Bach,
Oratorio de Noël
Cantates 1, 2 et 3
(Auditorium)
31 décembre 2022
Concert de fin d’année
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Daniele Gatti, direction
Lenneke Ruiten, soprano
Eleonora Filopponi, mezzosoprano
Maximilian Schmitt, ténor
NN, baryton
Beethoven
Symphonie n°9
(Auditorium)
13 janvier 2023
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Marc Albrecht, direction
Liszt
(Auditorium)
21 janvier 2023
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Ingo Metzmacher, direction
NN, soliste
Mahler, Schubert
(Auditorium)
18 février 2023
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Zubin Mehta, direction
Brahms, Bartók
(Auditorium)
28 février 2023
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Daniele Gatti, direction
Rudolf Buchbinder, pIano
Wagner, Beethoven, Moussorgsky, Stravinsky
(Auditorium)
10 mars 2023
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Daniele Gatti, direction
Jessica Pratt, soprano
Vivaldi, Bach, Stravinsky
(Sala Grande)
24 mars 2023
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Zubin Mehta, direction
Christiane Karg, soprano
Michèle Losier, mezzosoprano
Mahler
Symphonie n°2 “Résurrection”
(Auditorium)
CONCLUSION:
On tiendrait là la meilleure saison de l’année de tous les théâtres de la péninsule si des efforts un peu plus marqués avaient été faits du côté des metteurs en scène, mais peut-être aussi les saisons en Italie ne sont pas faites suffisamment à l’avance pour s’assurer les meilleurs qui sont forcément pris ailleurs. Quoi qu’il en soit, on tient sans conteste la saison musicale la meilleure de la Péninsule, et parmi les théâtres de stagione, une des meilleures en Europe, il suffit de comparer avec d’autres théâtres pour le constater . Florence a la chance d’avoir dans sa maison deux chefs pratiquement à demeure qui font partie des références musicales de ce temps, Zubin Mehta, au crépuscule d’une immense carrière mais qui continue d’étonner, et Daniele Gatti qui vient d’être choisi comme successeur de Christian Thielemann à la Staatskapelle de Dresde, excusez du peu. Peu d’institutions musicales peuvent se prévaloir de tels chefs qui se partagent la saison.
C’est donc le moment de fréquenter Florence, en essayant de faire contre mauvaise fortune (la scène) bon cœur (la fosse et les plateaux).
