
Les prochains comptes rendus porteront exclusivement sur les concerts ayant eu lieu dans les divers festivals que j’ai eu la chance de visiter au mois de mars et qui m’ont donné tout le loisir d’entendre quelques uns des grands orchestres de la scène musicale du moment. Cela a commencé le 14 mars avec le Bayerisches Staatsochester, plus fréquent dans la fosse que sur la scène, pour le sublime concert de Kirill Petrenko dont j’ai rendu compte et dont la magie s’est répétée aux dires des auditeurs avec les Wiener Philharmoniker début avril. Avant de parler des Berliner à Baden-Baden et la Staaskapelle Dresden et du Royal Concertgebouw, je rends compte des concerts de l’autre orchestre munichois, celui de la Bayerischer Rundfunk (la Radio Bavaroise) dirigé par son chef Mariss Jansons, dans sa mini-résidence annuelle à Lucerne où l’orchestre donne chaque année un grand concert choral et un grand concert symphonique.
Mariss Jansons est très régulier depuis très longtemps à Lucerne, où il vient au moins une fois par an, et cette année, les deux concerts étaient exceptionnels, l’un parce qu’on a pu y entendre le très rare poème symphonique de Rachmaninov, Les Cloches, le second pour l’exécution de la désormais plus rare Symphonie « Leningrad » de Chostakovitch.
SAMEDI 19 MARS
Beethoven, ouverture pour Coriolan, op.62
Mendelssohn, concerto pour violon en mi mineur op.64, soliste, Julian Rachlin
–
Rachmaninov : Les cloches, op.35, poème symphonique pour soprano, ténor et baryton, chœur et orchestre
Voilà un programme qui laissait la place à la grande tradition, avec Beethoven et Mendelssohn, et à un répertoire plus rare avec le poème symphonique de Rachmaninov, fondé sur un texte de Konstantin Balmont, d’après Edgar Poe.
Dans Coriolan, un morceau de bravoure toujours utilisé comme apéritif dans les programmes de concerts, les musiciens se mettent en ordre et le son obscur et l’ambiance tendue de la musique de Beethoven (pour un drame shakespearien qui ne l’est pas moins, l’un des plus sombres de son théâtre), permettent de mettre les montres à l’heure : l’orchestre de la Radio bavaroise est aujourd’hui l’une des phalanges les plus remarquables au monde : par l’homogénéité sonore faite d’excellents instrumentistes, voire exceptionnels, par le souci de la précision et par l’harmonie qui règne entre le chef et l’orchestre, une harmonie marquée par les réponses, immédiates, par la manière aussi de prévenir les intentions : le classicisme de ce Beethoven se marque par un son plein, mais jamais massif, et par une interprétation tendue, mais équilibrée, comme souvent le travail de Jansons dans ce répertoire mais à la tonalité inquiétante, aux rythmes marqués, scandés par les percussions. La perfection des attaques, la clarté des cuivres, la subtilité des cordes, et l’extraordinaire précision des bois font le reste dans cette salle qui valorise sans jamais amplifier. Les dernières mesures qui s’éteignent progressivement, annonciatrices du suicide du héros, sont prodigieuses parce qu’elles marquent non une tension, mais une fin résignée, et le son s’efface et s’arrête par un silence pesant perceptible en salle.

Autre impression pour l’orchestre du concerto pour violon de Mendelssohn où la profondeur de la musique semblait être portée par le groupe, alors que le soliste semblait plus préoccupé par la virtuosité requise, qui est grande, mais qui ne peut à elle seul porter l’exécution. Bien sûr, la recherche du dialogue soliste/orchestre menée par Mariss Jansons aboutissait (dans le premier mouvement par exemple à l’attaque si directe) à des moments d’un ineffable équilibre et d’une sublime beauté. Mais Julian Rachlin semblait dans une entreprise démonstrative qu’on n’entendait pas dans l’orchestre : la partie soliste contient de nombreux mouvements virtuoses, notamment à l’aigu et suraigu, incroyables de finesse, et le soliste évidemment triomphe des redoutables difficultés, mais il pourrait justement exalter des moments plus suspendus, une plus grande poésie (on pense à ce que ferait une Isabelle Faust), mais ce violon-là manque de profondeur et semble au contraire voguer un peu superficiellement, au service de l’effet plutôt que du cœur.

Et le bis (Ysaïe) choisi, évidemment confirmait l’impression d’une démonstration : oui, Julian Rachlin est un virtuose, mais oserais-je dire…et après ? Il y avait donc un vrai espace entre un chef qu’on sait « humaniste » et sensible, expressif et profond, et un soliste plus à la surface des choses, moins soucieux de l’expression que de la stupéfaction. Dialogue du derme et du cœur. Je préfère le cœur.
Le poème symphonique « Les cloches » de Rachmaninov inspiré d’un texte d’Edgar Poe retrace les quatre âges de la vie presque sortis d’une énigme du Sphinx, l’enfance, la jeunesse, la guerre, la mort.
Rachmaninov après un début plus riant renvoyant aux âges de l’enfance, renvoyant au tintement dont il est question dans le poème de Poe, conduit une histoire qui ne retrace que les malheurs de la vie, dans une ambiance de plus en plus sombre qui marque la fin de la légèreté, de l’insouciance. Les cloches accompagnent cette évolution et c’est leur couleur même qui s’assombrit jusqu’au glas. La musique, qui ne m’a pas frappé, s’inspire évidemment à la fois de la musique poulaire russe, avec des accents moussorgskiens, mais aussi et surtout du maître coloriste qu’est Tchaïkovski, et force est de reconnaître ls stupéfiante beauté des sons et des couleurs, notamment au niveau des cuivres et des bois d’une incroyable richesse chromatique. Jansons défend cette musique avec son engagement habituel, son humanité structurelle, avec un chœur qui est à son sommet, mais le chœur du Bayerischer Rundfunk quitte-t-il les sommets ? Il sait s’exprimer avec force, mais aussi alléger dans les parties les plus lyriques, vraiment imposant par sa prodigieuse présence. Des trois solistes, le ténor Maxim Aksenov qui remplaçait Oleg Dolgov malade n’a pas réussi à s’imposer vraiment: la voix reste un peu blanche et noyée dans la masse (il était plus convaincant dans Khovantchina à Amsterdam la semaine précédente).

Au contraire, Tatiana Pavlovskaia, issue de la troupe du Marinski qu’on entend de loin en loin en Europe frappe par la précision du chant, l’étendue des moyens et le contrôle vocal, et la présence : la prestation est vraiment impressionnante, ainsi que celle d’Alexey Markov, lui aussi en troupe au Marinski, mais plus fréquent sur les scènes occidentales. L’autorité, la belle technique, la projection, l’émotion aussi caractérisent ce chant maîtrisé. La voix est jeune, sonore, le chant intelligent. A eux deux, ils marquent fortement l’aspect vocal de l’œuvre. Une exécution pareille évidemment marque fortement l’auditeur, même si les aspects strictement musicaux ne sont pas arrivés à me convaincre. « Les Cloches » est une œuvre intéressante certes, passionnante ? Cela reste à prouver, même dans une salle à l’acoustique incomparable, à la fois précise et chaleureuse qui contribue largement à la forte impression laissée par l’exécution. On est quand même heureux de découvrir ce poème symphonique qui plonge dans la tradition russe, et qui pourtant est inspiré d’un auteur britannique : une fois de plus l’art transcende les frontières et les genres.
Addendum : texte du poème d’Edgar Poe, traduit par Stéphane Mallarmé
LES CLOCHES
Entendez les traîneaux à cloches — cloches d’argent ! Quel monde d’amusement annonce leur mélodie ! Comme elle tinte, tinte, tinte, dans le glacial air de nuit ! tandis que les astres qui étincellent sur tout le ciel semblent cligner, avec cristalline délice, de l’œil : allant, elle, d’accord (d’accord, d’accord) en une sorte de rythme runique, avec la « tintinnabulisation » qui surgit si musicalement des cloches (des cloches, cloches, cloches, cloches, cloches, cloches), du cliquetis et du tintement des cloches.
Entendez les mûres cloches nuptiales, cloches d’or ! Quel monde de bonheur annonce leur harmonie ! à travers l’air de nuit embaumé, comme elles sonnent partout leur délice ! Hors des notes d’or fondues, toutes ensemble, quelle liquide chanson flotte pour la tourterelle, qui écoute tandis qu’elle couve de son amour la lune ! Oh ! des sonores cellules quel jaillissement d’euphonie sourd volumineusement ! qu’il s’enfle, qu’il demeure parmi le Futur ! qu’il dit le ravissement qui porte au branle et à la sonnerie des cloches (cloches, cloches — des cloches, cloches, cloches, cloches), au rythme et au carillon des cloches !
Entendez les bruyantes cloches d’alarme — cloches de bronze ! Quelle histoire de terreur dit maintenant leur turbulence ! Dans l’oreille saisie de la nuit comme elles crient leur effroi ! Trop terrifiées pour parler, elles peuvent seulement s’écrier hors de ton, dans une clameur d’appel à la merci du feu, dans une remontrance au feu sourd et frénétique bondissant plus haut (plus haut, plus haut), avec un désespéré désir ou une recherche résolue, maintenant, de maintenant siéger, ou jamais, aux côtés de la lune à la face pâle. Oh ! les cloches (cloches, cloches), quelle histoire dit leur terreur — de Désespoir ! Qu’elles frappent et choquent, et rugissent ! Quelle horreur elles versent sur le sein de l’air palpitant ! encore l’ouïe sait-elle, pleinement par le tintouin et le vacarme, comment tourbillonne et s’épanche le danger ; encore l’ouïe dit-elle, distinctement, dans le vacarme et la querelle, comment s’abat ou s’enfle le danger, à l’abattement ou à l’enflure dans la colère des cloches, dans la clameur et l’éclat des cloches !
Entendez le glas des cloches — cloches de fer ! Quel monde de pensée solennelle comporte leur monodie ! Dans le silence de la nuit que nous frémissons de l’effroi ! à la mélancolique menace de leur ton. Car chaque son qui flotte, hors la rouille en leur gorge — est un gémissement. Et le peuple — le peuple — ceux qui demeurent haut dans le clocher, tous seuls, qui sonnant (sonnant, sonnant) dans cette mélancolie voilée, sentent une gloire à ainsi rouler sur le cœur humain une pierre — ils ne sont ni homme ni femme — ils ne sont ni brute ni humain — ils sont des Goules : et leur roi, ce l’est, qui sonne ; et il roule (roule — roule), roule un Péan hors des cloches ! Et son sein content se gonfle de ce Péan des cloches ! et il danse, et il danse, et il hurle : allant d’accord (d’accord, d’accord) en une sorte de rythme runique, avec le tressaut des cloches — (des cloches, cloches, cloches) avec le sanglot des cloches ; allant d’accord (d’accord, d’accord) dans le glas (le glas, le glas) en un heureux rythme runique, avec le roulis des cloches — (des cloches, cloches, cloches) avec la sonnerie des cloches — (des cloches, cloches, cloches, cloches, cloches — cloches, cloches, cloches) — le geignement et le gémissement des cloches.
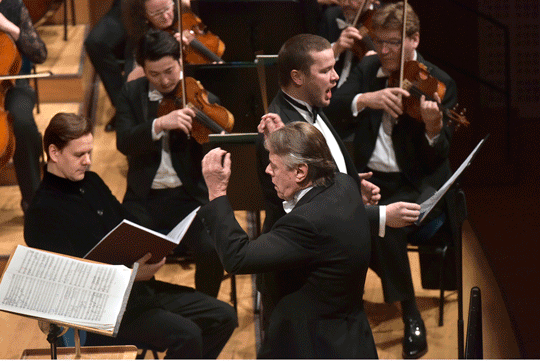
DIMANCHE 19 MARS
Chostakovitch : Symphonie n°7 en ut majeur op.60 « Leningrad »
On attendait beaucoup de ce concert d’abord parce qu’après avoir été une des références de la musique de Chostakovitch, une symphonie emblématique de son travail la « Leningrad » est aujourd’hui moins populaire que d’autres comme la 10ème , qu’on entend partout, voire la 15ème.
Une fois de plus, il faut souligner combien aujourd’hui Chostakovitch fait partie de la normalité des programmes de concerts, alors que dans la jeunesse, les débats autour de ce qu’on disait être ses « ambiguïtés » par rapport au régime soviétique dominaient la presse. La guerre froide imposait aussi dans la musique des discours idéologiques. Aujourd’hui, la guerre froide est loin (encore que…) et le musicien s’impose par rapport à l’homme face à l’histoire. Or le musicien Chostakovitch est une sorte de cinéaste du son, élaborant un récit fortement appuyé sur des références musicales antérieures, avec un travail très assumé de citations ou de variations sur des citations. Un peu comme le travail de certains cinéastes comme Woody Allen sur l’expressionnisme dans « Ombres et brouillard » ou Ridley Scott sur Fritz Lang dans « Blade Runner ». L’œuvre de Chostakovitch a en ce sens quelque chose de post-moderne avant la lettre. Ainsi de « Leningrad », référée explicitement à Ravel (Boléro) et à Lehar (La Veuve joyeuse) dans son fameux crescendo du 1er mouvement. L’œuvre échappe un peu au débat sur les relations avec le stalinisme à cause de la situation tragique de la ville qui est évoquée et qui en a fait pendant depuis longtemps une œuvre de référence du musicien, parce que justement elle dépassait la question idéologique. Si pendant la guerre, elle a été exécutée de nombreuses fois, en URSS comme en Occident, comme élément glorifiant la résistance russe et la sauvagerie nazie, le regard porté sur elle après la guerre a souffert des débats autour du stalinisme et des relations du musicien avec le totalitarisme. Plus récemment cependant, avec le débat sur la date de composition du 1er mouvement, des voix se sont élevées pour y voir une image de la montée de tous les totalitarismes et non pas seulement de l’invasion nazie. Si l’œuvre a été composée avant l’invasion allemande en 1941, on peut effectivement en discuter la signification.
Le travail de Mariss Jansons sur la « Leningrad » est une réussite impressionnante. On connaît sa familiarité avec l’univers de Chostakovitch, mais avec la ville de Leningrad aussi puisque Jansons y a étudié et travaillé, au temps où St Petersburg s’appelait encore Leningrad. Il y a une complicité évidente et personnelle entre le chef et cette œuvre.
La musique de Chostakovich a quelque chose d’une musique à programme, ou mieux, d’une musique qui serait récit, voire roman : on commence par une évocation lyrique de la paix, puis la violence s’insinue puis s’engouffre, détruisant un passé heureux, pour finir dans le triomphe de la victoire. L’impressionnant crescendo de la marche du premier mouvement, un des moments musicaux les plus forts de la soirée sinon le plus fort marque ce passage insidieux de la paix à la guerre, où l’on entend à peine les premières traces de la marche au loin (une allusion claire au Boléro de Ravel par l’utilisation des percussions qui accompagnent les pizzicati, puis des bois) derrière l’évocation initiale assez paisible (notamment à la flûte et au violon solo). Ces percussions peu à peu envahissent l’espace sonore en un pandémonium qui peut à peu s’éteint en un apaisement qui ironiquement, sarcastiquement même se termine par la réapparition de la petite musique ravélienne des percussions, comme si tout allait recommencer: Chostakovitch ne laisse pas l’illusion s’installer. Et l’auditeur sort frappé . C’est sans doute une manière de formuler aussi toute invasion totalitaire et pas seulement l’invasion militaire des troupes nazies. Cette symphonie nous enseigne combien la paix et la liberté sont fragiles, au-delà de tout discours. Ce qui frappe une fois de plus chez Jansons, c’est à la fois un son massif, mais clair, détaillé, coloré, c’est aussi l’absence totale de maniérisme, mais plutôt un discours direct, franc, net. L’exécution du premier mouvement impressionne tellement que le reste néanmoins apparaît un peu fade et peine à entrer en concurrence. Il y a chez Jansons une complicité extraordinaire avec l’orchestre qu’il laisse jouer, quelquefois esquissant à peine un geste, le laissant développer le son et y retrouver une grande force émotive, notamment dans l’adagio mahlérien, partout présent aux deuxième et troisième mouvement, où l’orchestre semble parler et exprimer la douleur et l’amertume. Mariss Jansons fait pleurer le son et c’est bouleversant, mais il laisse aussi s’exprimer toutes les ambiguïtés, notamment dans la danse presque macabre du deuxième mouvement où l’apparent apaisement presque joyeux se double d’un discours grinçant. Jansons jamais ne lâche l’expression de l’ambiguïté.
Dans le dernier mouvement avec son alternance de moments triomphants et d’autres plus gris ou plus sinistre, Jansons fait ressortir une probable ironie du compositeur, où le triomphe apparent n’efface pas ni la douleur du présent ni surtout celle du futur: le triomphe, par son urgence, par le son énorme qu’il développe, en devient inquiétant et rappelle presque la marche du premier mouvement, en jouant notamment sur les percussions et sur la manière dont les cordes jouent de l’archet: c’est un triomphe sans joie, lourd de sens qu’il nous évoque ici. Hitler ou Staline? Peste ou choléra? Voilà ce qu’on semble entendre dans cette musique prophétique, polysémique. Et c’est bien cette interrogation qu’on entend avec insistance, avec ces minutes finales presque extérieures qui rappellent le Zarathustra de Strauss. Mariss Jansons est l’un des phares de la direction d’orchestre, il a peu de concurrents sur ce répertoire qu’il vit de l’intérieur et qu’il connaît dans les méandres des moindres détails. Avec un orchestre complètement dédié, ce fut un de ces moments exceptionnels, voire uniques, qui restent gravés dans la mémoire, dans le coeur et dans la peau.
S’il y a dans ces deux jours une constante, c’est l’extraordinaire complicité en le chef et son orchestre, qui est actuellement l’un des meilleurs de la scène musicale mondiale, on le sent, à la manière détendue dont Mariss Jansons dirige, à son engagement aussi et à ses multiples sourires, auxquels répondent des musiciens visiblement heureux de jouer. Cette osmose est lisible, et elle rend les exécutions très personnelles, très « vécues » de l’intérieur, un peu comme naguère Abbado et le LFO. La musique est peut-être question de style, sans doute de technique mais surtout, dans le cas de la musique symphonique, une question de rencontre, une question sans doute purement humaine : les plus grands concerts naissent de cette rencontre là qui ressemble à un travail maître-disciples où au-delà de la partition, il y a adhésion. L’art est fait de l’assemblage de ces choses diverses, outils, instruments, techniques, discours, mais surtout humanité. C’est ce que Jansons diffuse, tout le temps, et surtout avec son orchestre, et c’est ce que nous avons là vécu, dans cette salle merveilleuse, avec ce public toujours chaleureux, dans la douceur d’un soir de printemps. [wpsr_facebook]

