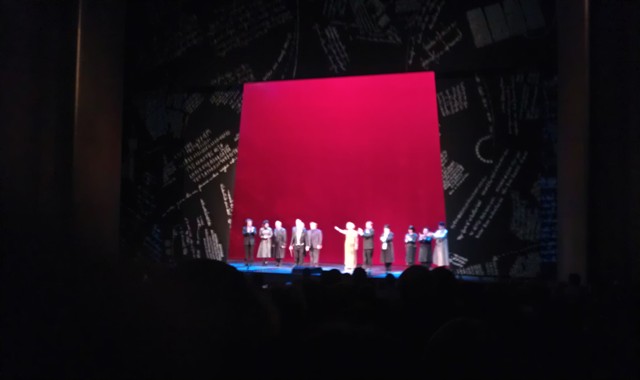Les dieux de l’Olympe (ou du Walhalla) volent, tuent, violent, séduisent, sont des menteurs, sont souvent de mauvaise foi, mais en même temps, quand ils donnent, c’est une pluie d’or qui tombe sur le monde (ou Danaé), c’est un Océan de beauté qu’ils dispensent. pas parfaits mais toujours grands, ce sont les Dieux.
Il en va (presque) de même pour Claudio Abbado, affectueusement appelé “Il Divino” par ses fans les plus proches ou Abbadio par les plus ironiques. Un jour il nous plonge dans la déception et la colère, et l’autre il nous enlève, il nous “rapte”, il nous emporte dans un tourbillon , dans un transport qui bouleverse une salle entière parce qu’il verse dans nos oreilles une pluie de bonheur. Et ainsi en fut-il hier soir à la Philharmonie, dans un programme étrange dont il a désormais le secret, un programme Schumann-Berg où ni Schumann ni Berg ne sonnaient comme d’habitude, où il s’est permis une de ses entourloupes favorites qui nous fait ouvrir un abîme sous nos pieds, l’abîme des possibles musicaux.
Claudio Abbado est un vieux chef désormais, mais s’il en a la liberté, il n’en a pas le style, il est tout sauf un patriarche. Sa carrière extraordinaire lui a fait tout diriger ou presque, les postes occupés ont été parmi les plus prestigieux (Scala, Vienne, Berlin sans compter Londres); et à 79 ans, il dirige Schumann comme un jeune homme le ferait, redécouvrant une partition retravaillée et relue. Abbado ne vit jamais sur ses acquis, il vit toujours sur la certitude qu’il y a encore à acquérir, qu’il y encore à apprendre, que la musique est un tonneau des Danaïdes.
Dès l’ouverture de Genoveva, on se dit qu’on n’a jamais entendu ce Schumann là, fluide, dégraissé, “moderne”, avec un orchestre qui adhère, qui répond, qui s’écoute, qui fait de la musique. Pas de violents contrastes, mais une distribution du son, une diffraction qui nous prépare à Berg, les deux morceaux suivants d’une assez longue première partie (1h). Il en résulte une certaine légèreté, oserais-je dire rossinienne: le chef rossinien par excellence qu’est Abbado (il y est encore incomparable, n’en déplaise aux critiques d’aujourd’hui qui souvent ne l’ont pas entendu à la scène). Les sons s’organisent en crescendos, se diffusent avec une clarté inouïe, pas un instrument n’échappe à nos oreilles, avec des cordes à se pâmer (les altos! les violons!). Quel moment…et ce n’est que le moment propédeutique, car dès que les Altenberg Lieder sont attaqués, l’introduction au premier Lied (“Schneesturm”) affiche cette diffraction cristalline, cette bombe à fragmentation sonore qui nous montre un orchestre fait de micros sons qui se diffusent à l’infini. Ces Lieder brefs, presque des Haikus musicaux (des textes de “Ansichtskarten”/de cartes postales), renferment toute la palette des sons (le troisième “An den Grenzen des All” commence et finit par la série dodécaphonique). La délicatesse, la précision, l’extraordinaire concentration de l’orchestre (aux dires d’amis, supérieure à la veille) et la voix “instrumentalisée” de Anne-Sofie von Otter, toujours merveilleuse de netteté et de précision dans ce type de répertoire, crée l’émotion par la retenue, par le formatage millimétré du son, avec une voix qui n’est pas grande, mais qui sait négocier tous les passages, qui sait se faire entendre, et l’attention d’Abbado à ne jamais la couvrir, à accompagner la voix (ah…le chef d’opéra qu’il est…) est palpable. Le dernier Lied “Hier ist Friede” est purement merveilleux de retenue, le moindre silence y est éloquent. Et il prépare si bien au concerto qui suit.
On commence d’ailleurs à comprendre les secrets de ce programme: Abbado cherche à relier les œuvres qui s’appuient ouvertement sur la musique de Bach. Il prépare un programme Bach pour décembre, et bonne partie des œuvres jouées ce soir se réfèrent par citations (Schumann) ou constructions (Berg) à la musique du Kantor de Leipzig.
C’est le cas de ce Concerto à la mémoire d’un ange, dédié à Manon, fille d’Alma Mahler et de Walter Gropius, qui est aussi un hommage à Gropius, l’architecte du hiératisme et de la géométrie. Références à un choral de Bach, à la Passion selon St Mathieu que Berg voulait avoir sous les yeux, aux Cantates, le Concerto à la mémoire d’un ange, en deux mouvements, est une construction référentielle! Isabelle Faust est incomparable de légèreté, de discrétion, de maîtrise du volume sonore, son approche lyrique est à elle seule un discours, l’approche du chef épouse avec une telle osmose celle de la soliste, qu’on a l’impression qu’elle est le prolongement de l’orchestre: il n’y a pas de dialogue soliste/orchestre, il y a unité “ténébreuse et profonde”, les sons ne se répondent pas, ils se prolongent les uns les autres, ils composent comme un chœur inouï. Oui, ce Berg est phénoménal et le deuxième mouvement, dont les dernières mesures sont à pleurer d’émotion, est un chef d’œuvre à lui seul. Quel moment!
En deuxième partie, la sombre et mélancolique Symphonie n°2 de Schumann. Mais alors qu’à Lucerne, le son projeté rendait la couleur particulièrement grise de l’œuvre de Schumann (appelée par Sinopoli, rappelons le “psychose compositive”), ici, l’orchestre diffuse une autre musique, une autre lumière. Il y a de l’énergie (scherzo), il y a de la couleur (final), il y a aussi de la mélancolie (extraordinaire adagio), mais il me semble y voir non de la dépression, mais un certain optimisme. On est plus dans l’ouverture au futur que dans l’autocompassion. Un son ouvert, un romantisme dépassé, qui court vers l’impressionnisme. On est au seuil de Baudelaire et de Rimbaud, du Rimbaud de “Aube”. Un son dégraissé, sans pathos aucun, un orchestre déconcertant à force d’être précis dans ses réponses à la moindre inflexion du maître (j’étais au block H, derrière l’orchestre, les yeux fixés sur les gestes et le visage extatique du Claudio Abbado). Il est incroyable de constater que si encore une moitié de l’orchestre connaît Abbado pour l’avoir fréquenté au quotidien, une autre moitié est jeune, totalement formée au quotidien à l’approche de Rattle, qui est tout le contraire de l’approche libertaire de Claudio. Claudio laisse les musiciens jouer, avec toute leur place, dans une liberté incroyable, et ne donne pas vraiment de directives…et cet orchestre qui le connaît finalement assez mal le suit comme fasciné, comme entraîné, comme captivé… Et les solistes de l’orchestre(Pahud! phénoménal!) s’en donnent à chœur joie.
S’étonnera-on de l’explosion finale du public, de ses rappels infinis, de cette immédiate standing ovation? Eh! oui, ce fut un don extraordinaire que nous a fait Claudio ce soir. Une révélation. Comment ne pas l’aimer?