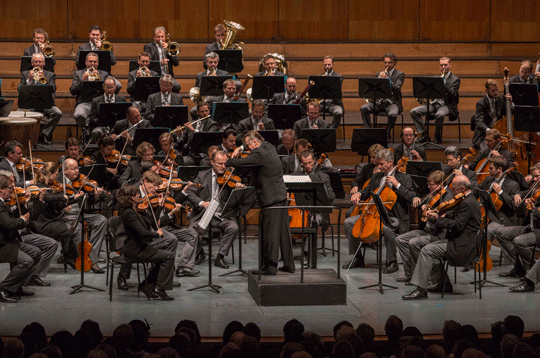Cet article est une adaptation-traduction de l’article paru le 21 août dernier dans Platea Magazine (Madrid) http://www.plateamagazine.com/criticas/1216-bernard-haitink-dirige-la-octava-de-bruckner-en-el-festival-de-lucerna
Ce n’est pas à un concert parmi tant d’autres du Festival de Salzbourg auquel nous avons assisté le 21 août dernier, un de ces concerts qui se consomment dans la masse de l’offre salzbourgeoise. Mariss Jansons ne se consomme pas, il se déguste. Tout simplement parce que ce jour-là, Mariss Jansons, Emanuel Ax et les Wiener Philharmoniker ont fait de la musique et rien d’autres.
Faire de la musique signifie «s’effacer» derrière la partition, sans se mettre en représentation, et interpréter l’œuvre dans un rapport simple et naturel, sans sensationnalisme, sans maniérismes, sans aucune autre vocation qu’exécuter de manière fluide et avec une joie profonde le concerto n° 22 Kv 482, en mi bémol majeur, le plus long écrit par Mozart.
Après avoir confié la partie solo dans les deux dernières occasions où ils ont interprété cette pièce à un chef qui était aussi un pianiste (Barenboim et Buchbinder), la collaboration traditionnelle entre soliste et chef a repris ses droits, ici avec Mariss Jansons et Emanuel Ax, pianiste américain d’origine polonaise, un artiste toujours au service de la musique, aux antipodes de la virtuosité narcissique. Le couple Ax / Jansons a travaillé ensemble à merveille; orchestre et soliste ont fait de la musique en tissant ensemble la partition par un jeu entrecroisé, à l’écoute l’un de l’autre, à disposition l’un de l’autre sans que le chef n’impose une direction mais bien plutôt offre un cadre musical dans lequel le travail du soliste est mis en relief. Que ce soit avec le volume, très retenu, que ce soit avec le jeu interne entre soliste et instrumentistes (avec des bois, la plupart du temps), il s’est agi de rendre la musique lisible et accessible avec une facilité et une simplicité incroyables.
Emanuel Ax ne donne pas l’impression d’exécuter une partition difficile, ne semble pas jouer pour prouver quelque chose de lui-même, il ne cherche pas à imposer quelque chose: il effleure le clavier avec aisance et légèreté, volant au-dessus des touches, avec des cadences parfois inédites et un rythme peut-être pas spectaculaire, mais qui jette une couleur paisible et souriante sur le concerto en question, écrit à un moment singulièrement heureux de la vie de Mozart, autour de 1785.
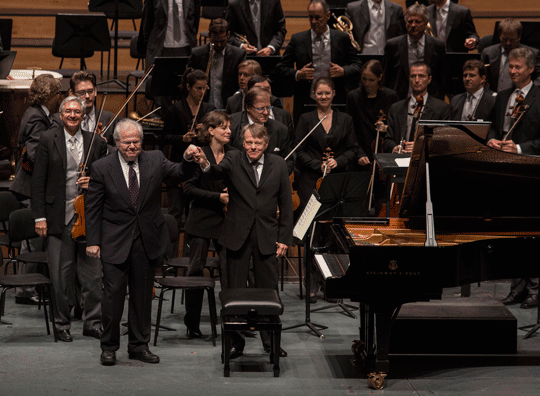
Je me suis intéressé, en particulier au système d’échos mis en place entre l’orchestre et le soliste, et particulièrement le jeu avec les bois (notamment la clarinette fabuleuse d’Ernst Ottensamer mais aussi le basson et la flûte dans le célèbre troisième mouvement, immortalisé par Milos Forman dans le film Amadeus). On est aussi frappé par la concentration d’Emanuel Ax qui dessine dans l’andante, le deuxième mouvement, si délicat, si intériorisé, un univers très personnel, un paysage à la fois sobre et d’une noblesse à couper le souffle. L’interprétation d’un Mozart si naturel, jamais terne ou ennuyeux, un Mozart purement agréable, mais toujours raffiné sans affectation, semblait d’une fraîcheur rare. Et Mariss Jansons, qui n’est pas si fréquent dans ce répertoire, montre également une grande capacité d’adaptation et un soin tout particulier au dialogue entre chef et soliste, avec une attention à l’autre qui est en quelque sorte aussi une leçon d’humanisme au sens illuministe du terme et une grande leçon d’humilité, ce qui nous fait regretter de ne pas écouter plus souvent son Mozart, si apaisé et si poétique.
Interprété de cette façon, avec un soin mutuel et dans la sécurité et la confiance musicale de l’un à l’autre, ce deuxième mouvement est devenu l’une de ces rares occasions où l’auditeur se sent invité à écouter d’une manière presque chambriste, quasi intimiste, bien que l’on soit assis dans la grande salle du Festspielhaus de Salzbourg. Un moment de musique pure qui pourrait s’étendre à l’infini.
S’il y a un lien entre Mozart et la deuxième partie du concert, la Symphonie n°6 en la majeur de Bruckner, c’est certainement le lien entre l’ adagio de la symphonie et l’andante du concerto : les clairs obscurs brucknériens sonnaient comme un écho de la force intérieure du deuxième mouvement de Mozart . Ces clairs obscurs s’appuient sur la fantastique phalange des Wiener Philharmoniker , un véritable corps vivant, avec sa respiration, ses cuivres en sourdine au son extraordinaire, et les attaques des cordes en un jeu splendide qui construit un espace au tempo légèrement tendu et pourtant très ouvert avec du souffle, mais sans emphase , comme si l’on en revenait à la pure nature de la musique.

C’est que le naturel perçu dans l’interprétation de Mozart se retrouve dans l’interprétation de la symphonie de Bruckner, évidemment avec une assise distincte. C’est « Die Kekste », la plus effrontée, comme disait Bruckner: ce qui unit les deux œuvres au-delà de la nature, est une impression d’ouverture et de luminosité. Jansons ne reste jamais monumental ou écrasant : sa lecture n’est pas brutale, elle ne montre aucune brusquerie, comme dans une chaîne infinie de sons qui sont liés les uns aux autres en se développant sans rupture. Cette impression de sérénité sans fin est déjà perçue au premier mouvement, avec ce léger dialogue entre les cordes, sur lesquelles s’enchaînent les cuivres majestueux mais pas écrasants, continuant en quelque sorte le flux de la parole: la légèreté est intimement liée à la force, avec des sons qui restent toujours clairs (peut-être en raison de la tonalité en la majeur) et lumineux. Il suffit d’écouter les phrases de la flûte et les échos des trompettes, comme si elles mimaient les bruits d’une nature presque Beethovénienne. On sait que la sixième a été considérée comme le suprême exemple du romantisme. La fin du premier mouvement, qui pourrait être lourdement affirmée, se conclut avec des cuivres certes marqués mais en même temps comme suspendus – dans un effet qui rappelle de la dernière note du premier acte de Tristan de Wagner : rien n’est ici lourd, mais d’une force presque aérienne.
Ce qui convainc dans le travail de Jansons avec l’orchestre est l’absence, non seulement d’accents trop marqués, trop « imposés », mais aussi de cette insistance lourde qui pourrait bientôt confiner au vulgaire: nous sommes à l’opposé du vulgaire, immergés dans le flot musical et seulement dans la force la musique. Jansons grâce à la luminosité du rendu et l’incroyable clarté du son nous invite à une visite de l’architecture interne de la composition. Que ce soit dans le Scherzo ou le Finale , nous sommes toujours au bord de quelque chose, sur ligne de crêtes : ce qui pourrait être trop lourd ou trop évanescent ne l’est jamais trop , grâce à une véritable science des équilibres et des volumes, et grâce enfin à une alternance entre des sons légers et d’autres plus affirmés, et donc à une suprême maîtrise du rythme et de la dynamique . Et grâce, bien sûr, à une lecture architectonique de l’œuvre qui en respecte les formes sans ajouter d’intentions parasites comme si la forme était en elle-même la substance .
Ce miracle de l’équilibre, qui est particulièrement visible dans le dernier mouvement, parvient à combiner une puissance rayonnante avec une intériorisation sereine.
Je suis rarement sorti aussi heureux et apaisé d’un concert: c’est le miracle d’artistes qui font de la musique sans simplement la reproduire en représentation, et le miracle d’un orchestre totalement au service d’une vision si simple et en même temps si complexe.[wpsr_facebook]