
C’était une inauguration très attendue du Lucerne Festival et bien des mahlériens avaient fait le déplacement. Claudio Abbado a associé pour longtemps Mahler et Lucerne Festival Orchestra.
Abbado disparu, le sort du Lucerne Festival Orchestra pouvait se poser, au moins sous sa forme d’orchestre « des amis ». En réalité, depuis plusieurs années et déjà du temps d’Abbado, la physionomie de l’orchestre était un peu changée, les membres des Berliner Philharmoniker avaient dû le quitter, les Capuçon, Natalia Gutman et d’autres en sont partis après la mort du chef tutélaire, comme Diemut Poppen (alto) et Alois Posch (contrebasse) partis, mais il reste du moins un certain nombre de piliers qui sont là depuis les origines, Reinhold Friedrich le trompette solo, Raymond Curfs le timbalier, Jacques Zoon le flûtiste et des membres venus un peu plus tardivement (Lucas Macias Navarro, Alessandro Carbonare, ou Alessio Allegrini) sont devenus rapidement des figures irremplaçables de l’orchestre.
Cette année, peu de changements, sinon quelques membres de l’orchestre de la Scala, et le départ regrettable de Sebastian Breuninger, 1er violon, un des membres historiques, formé par Abbado, qui est en même temps 1er violon du Gewandhaus de Leipzig. Compte tenu des rapports actuels de Riccardo Chailly et du Gewandhaus, il était difficilement envisageable qu’il demeurât.
Le très futé directeur du festival, Michael Haefliger, avait le choix entre deux options :
- Ou bien confier le LFO chaque année à un chef différent, de type « carte blanche à », jusqu’à ce que la disparition d’Abbado ait été suffisamment digérée et que le marché des chefs s’éclaircisse. Le LFO est une formation très particulière demande des chefs de tout premier niveau, mais cela aurait alimenté les discussions sur la suite, et fait des chefs invités des potentiels candidats à un poste de directeur musical prévu dans le futur.
- Ou bien nommer un directeur musical le plus vite possible, pour redonner à l’orchestre un futur , des perspectives et un programme. C’est l’option qui a été choisie.
Cette manière de « relancer » le LFO s’accompagne d’ailleurs d’autres ouvertures vers l’avenir : en même temps que le nouveau départ du LFO, Haefliger a remis dans le même temps sur le tapis la question de la salle modulable dont le projet est affiché dans l’entrée du KKL,
Nous avons déjà évoqué dans ce blog l’appel à Riccardo Chailly, un des rares chefs de stature internationale disponible pour assumer la charge, limitée par ailleurs, de directeur musical du Lucerne Festival Orchestra. En effet, elle occupe au maximum deux semaines en été et deux semaines en automne pour la tournée. Elle a donc l’avantage d’être très prestigieuse et en même temps peu mangeuse de temps.
Il apparaît que pour l’orchestre, un nouveau directeur musical est préférable. Il permet de clairement se positionner, et de voir l’avenir, en terme de programme, de répertoires et d’organisation. Il est clair qu’avec Riccardo Chailly, la question du répertoire est résolue : c’est un chef curieux de pièces rarement jouées, mais en même temps familier de Bruckner et Mahler, les compositeurs fétiches du LFO, et du premier XXème siècle. L’année prochaine par exemple Stravinski est à l’honneur (Œdipus Rex, le sacre du printemps), mais avec la cantate Edipo a Colono de Rossini composée autour de l’année 1816, très rarement jouée et qui rompt complètement avec le répertoire habituel de l’orchestre, ce qui en soi est plutôt intéressant.
Ainsi donc, Michael Haefliger a proposé comme inauguration de l’ère Chailly la Symphonie n°8 de Mahler « des Mille » . On se souvient que cette symphonie était programmée pour 2012, mais que trois mois avant, Claudio Abbado s’était replongé dans la partition et qu’il avait finalement renoncé à la diriger, ne « trouvant rien de nouveau à dire ». C’est une partition qu’il n’a dirigée qu’une fois, à reculons pour une série de concerts avec les Berlinois en 1994 et un enregistrement de Deutsche Grammophon. Le résultat fut que le cycle Mahler du LFO dirigé par Abbado en DVD est resté incomplet.
En proposant comme inauguration de l’ère Chailly la Symphonie n°8 de Mahler,
- d’une part Haefliger marquait la continuité : Mahler restait une référence pour l’orchestre et permettait la clôture du cycle commencé avec Abbado
- d ‘autre part il marquait aussi la différence et le changement, puisque le nouveau directeur musical se chargeait de l’exécution.
Enfin, une inauguration marquée par un tel monument, avec plusieurs centaines d’exécutants, et par une campagne médiatique assez bien faite, attirant la presse spécialisée du monde entier, était pour le Lucerne Festival Orchestra et le Lucerne Festival en général une pierre miliaire, celle du changement dans le continuité, comme on dit en politique.
C’était donc une inauguration très politique, où la question symbolique prenait le pas sur la question artistique. Le pari était de convaincre que le LFO restait ce qu’il avait été, et que le choix de Chailly était justifié. Pari tenu et sans aucun doute gagné.
On avait donc rendez-vous avec ce monument presque inexplicable et surabondant de la création mahlérienne, surabondant en chœurs : quatre chœurs , le Tölzer Knabenchor, référence mondiale en matière de chœur d’enfants, le chœur du Bayerischer Rundfunk, de la radio lettone, et l’Orfeón Donostiarra , dont la présence était d’autant plus symbolique que ce chœur avait participé à la Symphonie n°2 « Résurrection » dirigée par Claudio Abbado en 2003, lors de la première apparition du Lucerne Festival Orchestra et qu’il n’avait pas été invité depuis : 13 ans après, il revient pour le premier concert de la nouvelle « ère » du Lucerne Festival Orchestra. Un monument aussi surabondant en solistes, huit solistes, deux mezzos, trois sopranos, un ténor, un baryton, un baryton-basse.
L’œuvre, totalement chorale et vocale, avec peu de moments exclusivement symphoniques, est divisée en deux parties, la première fondée sur un texte en latin du haut moyen âge, le veni creator spiritus, attribuée à Raban Maur, un archevêque de Mayence qui vivait au 9ème siècle ; la seconde moitié est fondée sur le final du Faust de Goethe, en allemand et 1000 ans séparent donc les deux textes. Il y a entre les deux parties d’ailleurs de profondes différences. La première, tonitruante, avec des interventions des chœurs et des solistes peu différenciées et presque à la limite de la lisibilité, et la seconde, plus traditionnelle, plus assimilable à une cantate, avec des interventions solistes bien identifiables et presque dramaturgiquement organisées.
La disposition de Lucerne permettait, outre la distribution globale chœur-orchestre, d’isoler l’organiste, à la tribune duquel sont intervenus l’ensemble des cuivres supplémentaires, et Mater gloriosa (Anna Lucia Richter). Il s’agissait évidemment d’une mise en espace de l’œuvre où même l’éclairage pourpre donnait une allure monumentale et spectaculaire à l’ensemble.
J’avoue avoir été un peu écrasé par la première partie, pour laquelle me semble-t-il, la salle n’était pas spécialement adaptée ; trop petite peut-être pour de telles masses sonores à leur maximum, cuivres et orchestre déchainés qui finissait par saturer. On n’entendait plus vraiment les solistes systématiquement couverts ou noyés par la masse chorale, l’impression écrasante et à la limite de l’audible était sans doute en même temps voulue.
On a pu discuter l’inspiration de Mahler dans cette partie. Adorno disait lui-même quelque chose comme « Veni creator spiritus certes, mais si après il ne vient pas ? » marquant sa distance en quelque sorte. Mahler a voulu rendre compte d’une totalité, une totalité sonore et spirituelle : il y a une volonté évocatoire un peu aporétique, et donc peut-être un peu désespérée. Pour ma part, ce trop-plein sonne quelque part un peu vide et j’ai des difficultés à entrer dans l’œuvre par cette première partie qui écrase certes voire laisse un peu froid. L’inspiration mélodique elle-même n’est pas au niveau d’autres œuvres. Rendre compte de « l’Universum » par la transposition musicale d’une totalité impliquant voix, chœurs et instruments aboutit forcément à une difficulté. Réunir des centaines de participants fait spectacle, mais n’implique pas l’auditeur, et rend le morceau peu participatif.
Ce qui me touche, c’est peut-être plus le côté désespéré de cette quête de totalité, d’une quête qui conduit à chercher à rendre l’indicible ou l’irreprésentable, et en même temps le côté un peu naïf (la naïveté du converti récent ?) d’une entreprise titanesque qui finit par rater son objectif. Mahler, qui implique tellement son auditeur, qui l’invite tellement à pénétrer son univers, le laisse ici au seuil, ne lui permet pas d’entrer. Et Chailly rend compte de cette aporie en proposant volontairement une lecture totalement extérieure et spectaculaire, une sorte de pandemonium sonore d’où rien n’émerge sinon une sorte de perfection froide sous un déluge volumineux de sons qu’il est difficile de démêler. Peut-être aussi cette première partie, ainsi proposée, ne laisse aucune chance à la petitesse humaine face à l’irruption tempétueuse de l’appel au Créateur. Le point de vue global s’impose, fort, gigantesque, impossible à endiguer, flot sonore qui reflète la multiplicité des mondes(ou qui essaie de témoigner) . Il en va différemment dans la deuxième partie, qui commence d’abord par une pièce orchestrale plus recueillie qui rappelle, elle, le Mahler que nous connaissons et nous aimons, celui de symphonies précédentes, sixième ou quatrième et une sorte de « captatio benevolentiae » qui permet de rentrer cette fois de plain-pied dans l’œuvre. De l’impossibilité de distinguer qui est qui, qui chante quoi, et qui joue quoi, on commence à avoir un repère, qui est aussi repère littéraire. Le Faust de Goethe est elle aussi une œuvre monumentale inépuisée, inépuisable, où le langage en déluge de vers nous écrase. Le jeu sur le langage de Goethe est proprement musical, quelquefois symphonique, quelquefois chambriste : cela m’avait frappé lorsque j’avais vu il y a 16 ans le Faust intégral monté par Peter Stein à Hanovre: impossible de ne pas entrer dans ce tourbillon continu de paroles qui fait musique, dans ces musiques de vers qui étourdissent et en même temps hypnotisent. Goethéenne, c’est à dire prométhéenne, voilà ce qu’est cette symphonie.
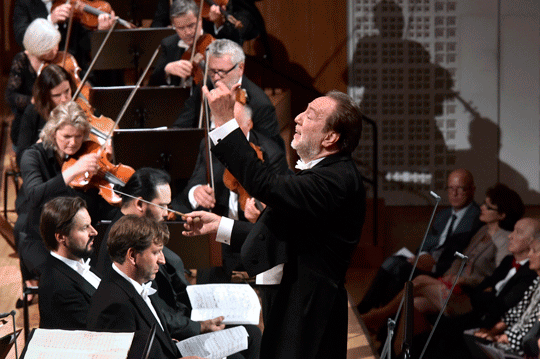
Ainsi, la dernière partie du texte de Goethe est une sorte d’Erlösung (de rédemption) par la musique et le texte, une ascension (sinon une assomption, tant le texte de Goethe est « aspirant »), en même temps une image de totalité où monde réel et monde poétique s’unissent et où le spectateur après environ 24h de théâtre, vit une sorte d’ataraxie. Cette partie ultime, mise en musique, s’efforce elle aussi d’ouvrir vers une totalité qui élève, et qui n’écrase plus : après le mouvement descendant de la première partie de la symphonie, où l’auditeur est cloué sur place par une tempête sonore qui tombe sur lui, le mouvement de la seconde est plutôt ascendant, la question de l’élévation est centrale, et ce jeu théâtral des interventions qui se renvoient l’une l’autre est cette fois-ci peut-être rendu par Mahler avec plus de cohérence ou plus d’inspiration. Il est clair que les voix qui se reprennent, que la forme traditionnelle de la cantate (le souvenir de Bach est ici présent), mais malgré tout la « cantate » de Mahler sonne pour moi plus profane que sacrée. Mahler est toujours profondément humain, pétri d’humain et c’est ce qui fait l’incroyable proximité de l’auditeur et de cette musique qui entre directement dans ses chairs.
Bien sûr, Le Lucerne Festival Orchestra fait merveille dans ces moments séraphiques (c’est ici le cas de le dire), où toute musique est suspendue dans un intermonde, elle respire et en même temps se fractionne ou se dématérialise, elle vit pleinement en nous et se dilue, elle est là et nous aspire et nous élève (singulier effet du dernier mouvement de la Troisième par exemple). On ne sait plus s’il faut admirer les cuivres impeccables de précision, les percussions menées par Raymond Curfs, les bois ahurissants (le hautbois d’Ivan Podyomov ! la flûte de Jacques Zoon !) et la chair des cordes (les altos et les violoncelles bouleversants). On reste interdit aussi par la précision des chœurs préparés et coordonnés par Howard Arman : c’est une performance d’avoir harmonisé l’ensemble gigantesque de toutes ces voix en un ensemble à la fois compact et différencié, sans compter les merveilleux Tölzer Knabenchor dont les interventions avec les femmes de l’Orfeón Donostiarra restera dans la mémoire, tant ces « anges » furent réellement, qu’on me pardonne ce truisme, « angéliques ».
C’est dans cette deuxième partie que les voix solistes se distinguent et pour certaines époustouflent : entendre Peter Mattei dans Pater Ecstaticus est une leçon : leçon de diction, d’émission, de projection, avec un timbre chaud, sans rien de démonstratif, avec un texte dit dans la simplicité de l’évidence. Sans jamais forcer, Peter Mattei a une présence inouïe, et la voix qui correspond exactement à l’œuvre. Une intervention inoubliable, d’un artiste à son sommet. Ecrasant de modestie, de naturel et de justesse.
Même remarque pour Sara Mingardo (Mulier samaritana) : sans jamais avoir une voix qui écrase par le volume, mais toujours bien placée, bien posée, Sara Mingardo impose le texte, par l’intelligence, par la diction et par la musicalité et par la suavité de son timbre.
J’ai toujours aimé dans ce type d’intervention aussi Mihoko Fujimura, qui a une attention marquée au texte et une rare intuition musicale : on se souvient dans cette même salle, d’un deuxième acte de Tristan avec Abbado en 2004 où elle fut une Brangäne irremplaçable. C’est une artiste jamais spectaculaire (ce qui gênait dans sa Kundry, dont les aigus redoutables dépassaient ses possibilités). Ici, elle impose aussi une présence dans Maria Aegyptiaca, notamment par les graves, encore abyssaux, même si elle m’est apparue un tantinet en retrait par rapport à d’autres prestations récentes.
Remplaçant au dernier moment Christine Goerke malade, Juliane Banse (Una poenitentium) a su relever le défi, d’abord avec une présence à l’aigu notable, des aigus très bien négociés, très contrôlés et en même temps très affirmés et une diction magnifique : elle a été très convaincante, très charnelle aussi, très humaine enfin.
Ricarda Merbeth (Magna Peccatrix) impose évidemment son volume et sa technique impeccable, et surtout ses aigus écrasants et imposants. J’aime moins son timbre que je trouve toujours un peu froid et son expressivité moins affirmée (c’est notable à l’opéra), mais elle se distingue ici comme la voix la plus marquée et la plus volumineuse. Belle prestation.
La jeune Anna Lucia Richter, installée sur le podium de l’organiste dominant la salle, lance de la hauteur ses quelques vers.
« Komm, hebe dich zu höhern Sphären,
Wenn er dich ahnet, folgt er nach. »
L’intervention est très brève mais demande une très grande virtuosité, un très fort contrôle de la voix et des aigus très assurés. La jeune chanteuse, déjà engagée l’an dernier dans la Quatrième a su relever le défi et son intervention est remarquable.
Du côté des voix masculines, nous avons souligné tout l’art de Peter Mattei. On doit tout aussi apprécier celui de Samuel Youn, baryton-basse au timbre très velouté qu’on a apprécié à Bayreuth plusieurs années durant dans le Hollandais de Fliegende Holländer, il montre ici une belle qualité d’émission et, comme Mattei, une intervention non démonstrative, assez retenue, et assez « hiératique », où la simplicité de l’expression domine. Joli moment.
Andreas Schager avait la partie de ténor, Dr Marianus, la plus longue. Il est resté, contrairement à ses dernières prestations, assez retenu et plutôt contrôlé. La partie n’est pas vraiment simple et exige tension et concentration. Il s’en sort avec les honneurs, sans faillir. On apprécie cette voix claire, lumineuse quand il le faut, et qui sait déployer aussi une certaine énergie : il réussit à être très présent et se sortir des pièges. C’est plutôt très positif.
Comme on le voit, le niveau d’ensemble des solistes était particulièrement élevé, ce qui est presque toujours le cas pour les voix invitées à Lucerne.
Riccardo Chailly gérait toute cette immense et complexe machine, gestes précis, énergiques, sans être trop démonstratifs. Très attentif à tout, et notamment aux solistes, il sait aussi retenir le volume de l’orchestre. L’œuvre ne distille pas (au moins pour mon goût) d’émotion à l’égal d’autres symphonies : il reste que Chailly en propose une interprétation plutôt contrôlée en deuxième partie et plutôt déchainée en première partie. On lui reproche quelquefois de laisser aller le volume et de diriger fort. La musique de la symphonie étant ce qu’elle est, c’est un reproche qu’on ne peut lui faire : il n’a pas besoin de pousser le volume. Mais il a fait preuve de très grande qualités de netteté et de précision, tout en veillant aussi à marquer les moments les plus lyriques et les plus suspendues : utilisant les qualités intrinsèques de l’orchestre et ses grandes capacités techniques, il a aussi fait comprendre que l’entente s’était fait jour entre les musiciens et lui. En ce second concert auquel j’ai assisté, que tous les spectateurs présents la veille ont considéré comme meilleur (musiciens et chefs plus détendus), il a parfaitement montré qu’il avait pris les rênes et que le pari était gagné, tant le succès a été grand. Longue vie à ce nouvel attelage. [wpsr_facebook]





