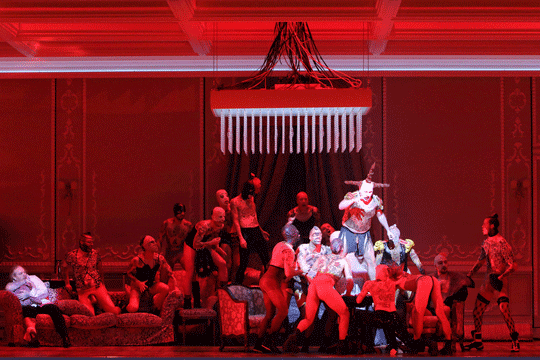
L’Ange de feu n’est pas l’un des opéras les plus joués de Prokofiev, si rare que même à Munich, il n’avait jamais été représenté : il entre au répertoire dans une mise en scène de Barrie Kosky et dirigé par Vladimir Jurowski. Disons immédiatement que c’est une entrée tonitruante et réussie puisque le théâtre désemplit pas : il y a avait sous le célèbre portique du Nationaltheater des dizaines de personnes arborant un « Suche Karte » que l’on ne voit qu’aux grandes occasions.
Composé entre 1919 et 1927, l’opéra fut créé en 1954 en version de concert à Paris, un an après la mort du compositeur, et un an après en version scénique à Venise : la violence et l’âpreté du sujet (d’après un roman de Valery Brioussov) qui doit beaucoup à l’école expressionniste, mais aussi au symbolisme, justifient sans doute ce retard, d’autant qu’en URSS comme en Occident, aussi bien dans les années 30 que dans les années 50, les temps ne sont plus aussi ouverts que dans les années 20. À cela s’ajoute des rôles principaux incroyablement tendus, toujours en scène où excès de tous ordres et violence occupent progressivement tout le terrain.
Même si l’histoire est assez simple, sa traduction scénique demande de la part du spectateur une grande concentration tant le réel et le fantasmé s’y confondent, s’y mélangent, pour ne plus former qu’un, et tant les niveaux de lecture demeurent complexes.
Dans une auberge au Moyen Âge, le chevalier Ruprecht rencontre Renata, une femme à la recherche d’un ancien amant, Heinrich, en qui elle voit l’Ange qui lui promit jadis le destin d’une sainte. Entre Ruprecht, qui est séduit par Renata, et Renata qui va utiliser tous les expédients possibles (y compris magie et sorcellerie) pour retrouver son ancien amant, se construit une relation forte, physique, traversée des désirs de l’un et des fantasmes de l’autre, et le couple finira par se réunir et affronter (plus que vivre) les délires et les fantasmes dont chacun par des voies diverses a rempli sa vie. Il y a là dedans de quoi alimenter les rêves les plus fous d’un metteur en scène ou des dizaines de divans de psychanalystes: c’est un opéra qui par son ambiance n’est pas sans rappeler le film « Les Diables » de Ken Russell (1971).
Personnellement, je n’ai vu qu’une seule production, à la Scala en 1994 dirigée par Riccardo Chailly dans une mise en scène de Giancarlo Cobelli, qui n’était pas inoubliable, bien que musicalement de très haut niveau (avec Galina Gorchakova et Sergei Leiferkus). Signalons au passage que la Scala est sans doute le théâtre occidental qui a le plus représenté l’œuvre de Prokofiev (3 productions dont une de Giorgio Strehler, et 4 séries de représentations entre 1956 et 1999).

Barrie Kosky a choisi de représenter l’opéra dans le décor (de Rebecca Ringst, qui travaille très souvent avec Calixto Bieito) moderne d’un hôtel de luxe, un décor fixe qui va progressivement se déglinguer et abandonner son bel ordonnancement pour devenir le champ clos de fantasmes de plus en plus délirants. Cela impose rigueur et travail serré sur les acteurs, et évidemment renvoie à la représentation d’un univers plus mental que réel, à la limite du supportable. Il construit son travail avec un sens du crescendo étonnant, le début étant lent, volontairement ennuyeux, voire un peu répétitif, avec des mouvements presque géométriques, des personnages éminemment raides, évoluant à petit pas d’abord vers ce que Rimbaud appellerait un dérèglement de tous les sens, mais un dérèglement qui serait très progressif, comme si on s’enfonçait lentement, chaque fois un peu plus dans la folie. La maîtrise des transformations de la scène, d’abord à peine perceptibles, puis de plus en plus nettes, l’évolution des éclairages, de plus en plus colorés (splendides éclairages de Joachim Klein) aident à ce crescendo (où à cette chute dans l’abime). La mécanique est d’autant plus rigoureuse que l’opéra se déroule sur 2h15 sans entracte, et l’impression sur le spectateur est ainsi de plus en plus étouffante et forte, si bien qu’on en sort littéralement sonné, voire secoué.
Tout commence donc très banalement, par l’entrée dans sa chambre d’un client d’hôtel, une chambre « boite », large, lambrissée, dans un Palace comme on devait les aimer ou les rêver dans les années 30.
Puis se succèdent les arrivées des employés, qui portant les valises, qui prenant les commandes, qui vérifiant que tout fonctionne parfaitement, avec des interventions répétitives et dérangeantes sans que la musique ne commence et dans le silence mécanique qu’on pourrait avoir au théâtre ou dans un film muet, une sorte de mécanique huilée et géométrique qui est exactement à l’opposé de tout ce qu’on va vivre les deux heures suivantes, qui fait rire ou glousser d’abord, et qui finit par agacer : on se demande quand la musique va commencer.
L’apparition de Renata est la bizarrerie initiale, qui va déclencher tout le reste. Le lit central s’avance seul au milieu du plateau, Ruprecht est assis au bout, jambes écartées, et la tête de Renata apparaît sortant du dessous, entre les jambes ouvertes de Ruprecht : un tableau sans ambiguité, préannonciateur du reste, mais en même temps presque « correct » puisque de cette position rien n’est exploité, même si bien vite Renata va s’imposer et imposer son rythme et ses rêves.

Et ainsi l’espace va se transformer, meubles écartés ou entassés, plafond qui se surélève, couleurs criardes des éclairages, et à chaque moment clé, lorsqu’on s’enfonce de plus en plus dans le monde fantasmatique, apparition d’un groupe de danseurs transgenre, de plus en plus érotisé, d’abord en robe de soirée années 50, puis peu à peu dénudés jusqu’à la nudité, ou l’exposé des intimités masculines comme on dit, y compris des chanteurs (Mephistophélès). Barrie Kosky dont le sens de l’humour n’est plus à démontrer a aussi travaillé sur le thème du tatouage, comme expression fantasmatique, profitant de ce qu’il avait sous la main Evguenyi Nikitin, à qui les tatouages ont joué un mauvais tout à Bayreuth.

Le personnage de Renata, excessif, passant de la passion la plus brûlante à la prostration, puis voulant se réfugier au couvent est une figure évidemment très connotée du désir féminin et des ravages du désir, et de la possession au sens catholique du terme (d’où mon allusion précédente au film de Ken Russell qui est une histoire de possession) et Ruprecht, bien qu’il entre dans le jeu de la passion et du désir (opportunément l’histoire de Faust est derrière, avec l’apparition de Faust et Méphistophélès très présents dans les dernières scènes) reste « sauvable », il y a là un traitement particulier de la femme, comme toujours pourrait-on arguer, dans l’espace clos d’un hôtel, une sorte de « huis clos » infernal (on n’est pas si loin de Sartre). L’espace même de l’hôtel, lieu de passage multiple, hommes d’affaires politiciens, aventuriers, qui voit des scènes meurtrières, des turpitudes, de sexe à gogo (Sofitel New York), est favorable à l’explosion de tous les fantasmes et de tous les excès.
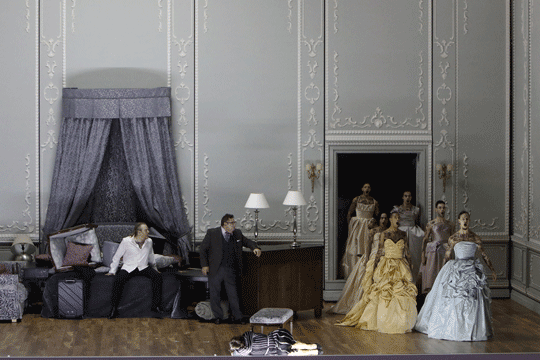
Et Barrie Kosky explore à la fois avec rigueur et précision tous les possibles de cet espace vite étouffant, où l’excès prend une valeur encore plus marquée, à la limite du supportable : ce mélange de l’hyperréaliste et de l’hyperfantasmé est un des caractères de ce travail qui est impressionnant dans la manière de mener les chanteurs à une vérité du jeu qui laisse rêveur : Evguneyi Nikitin à ce titre est impressionnant de violence, d’engagement : il étourdit tellement il est dans le rôle, ne quittant jamais la scène, toujours aux extrêmes. Vocalement les choses ne sont pas aussi définitives, la voix ne passe pas toujours le flot continu d’un orchestre omniprésent, et manque souvent de projection. Ce n’est pas la première fois que je note cela chez ce chanteur. Sa voix n’impressionne pas et ne marque pas. Mais ici, et c’est paradoxal, il n’a pas de besoin de chanter : il lui suffit d’être en scène et c’est étourdissant.

La soprano russe Svetlana Sozdateleva a été engagée suite à la défection d’Evelyn Herlitzius, une habituée des rôles tendus du répertoire russe (Lady Macbeth de Mzensk), elle se donne totalement vocalement et scéniquement, sans être exceptionnellement volumineuse, la voix est bien posée, bien projetée, et très homogène vient à bout de ce rôle impossible sans aucune faiblesse. Et son engagement scénique est étourdissant, c’est une chanteuse complètement dédiée, brûlante, une torche qui garde pourtant un brin de distance : c’est tout ce qui fait le prix de son travail. Voilà un nom à retenir, voilà une artiste tout à fait exceptionnelle, qui se donne comptant.
Dans cette œuvre sur le visible et le caché, sur la folie et la raison, sur les extrêmes bien/mal, enfer/salut, sur l’étourdissement et le vertige devant les prodiges de l’inconscient, Barrie Kosky ne fait jamais totalement exploser les choses et garde toujours une très grande maîtrise : l’espace clos y est pour beaucoup et oblige à être particulièrement attentif aux mouvements et concentré sur chaque geste et surtout sur chaque personnage.

Ce qui impressionne et en même temps dérange dans le travail général, c’est justementt cette plongée : plus qu’un travail extensif et explosif, on a un travail au contraire intensif et implosif, qui exploite toutes les possibilités en lumières, couleurs, variations sur le volume à l’intérieur d’un espace défini, une sorte de boite infernale où se concentrent les violences et les délires des hommes.
La dernière scène est à ce propos éloquente : dans le livret, Renata, après avoir porté au couvent les désordres de sa possession (prodigieuse scène de délire au couvent), est condamnée au bûcher par le Grand Inquisiteur, c’est bien le moins. Mais Kosky ramène au final le calme après la tempête, le couple Ruprecht/Renata se retrouve presque intouché, comme après une nuit juste un peu perturbée, disons agitée. Comme si tout n’avait été que délire d’un couple (presque) ordinaire. On sent bien toute l’exploitation psychanalytique et en même temps les espaces inexplorés des possibles érotiques : une sorte d’eros cosmique ou de cosmos érotique qui laisse le public totalement éberlué.

Si j’ai déjà évoqué les deux protagonistes, qui ne laissent jamais la scène et dont la performance est ahurissante, il faut souligner l’engagement de toute la distribution, et les figures qui s’imposent, au premier plan le magicien masculin/féminin Agrippa von Nettesheim (Kosky adore passer d’un genre à l’autre et surtout brouiller les pistes et la lecture d’un monde genré) : Vladimir Galouzine, qui nous a plus habitués aux grands rôles de ténor dramatique ou spinto (Otello, Hermann) y est étonnant, méconnaissable y compris vocalement. Quelle apparition ! Notons aussi la voyante d’Elena Manistina, au grave abyssal, et la supérieure de Okka von der Damerau, toujours étonnantes quels que soient les rôles qu’elle traverse, cette chanteuse, qu’on voit rarement dans des rôles importants, a une plasticité telle qu’elle marque dans tous les « petits » rôles qu’elle entreprend et à chaque fois, elle remporte un succès important.

On serait injuste de ne pas souligner encore une fois la qualité de la troupe de Munich avec ses artistes habituels, toujours excellents, Heike Grotzinger, Christian Rieger, Matthew Grills, Andrea Borghini, et cette fois-ci en particulier Kevin Conners qui chante un Méphisto exhibo avec un affront stupéfiant.
Sans la chorégraphie d’Otto Pichler et l’engagement du corps de ballet, expression directe des fantasmes des protagonistes, la mise en scène ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne : leur travail est impressionnant, danseurs et figurants sont presque des chanteurs muets tant ils semblent être une voix de l’ensemble.
Evidemment le chœur, notamment dans les parties finales (direction Stellario Fagone) montre comme il est lui aussi particulièrement plastique : tout cela montre combien les masses munichoises atteignent en ce moment un niveau inédit.
Mais tout cela ne serait rien sans la prestation totalement bluffante de l’orchestre. Sous la direction de Vladimir Jurowski, il brille de tous ses feux, dans cette partition polymorphe, qui elle aussi va aux extrêmes, violente, lyrique, brillante, assourdissante, mais jamais tonitruante. Jurowski fait un travail éblouissant, avec des cuivres sans scories, avec des cordes prodigieuses, avec des harpes phénoménales : une masse sonore tellement maîtrisée que tout s’entend, d’une luminosité cristalline et d’une présence imposante, dynamique, animée. Une des grandes prestations orchestrales de cette année, qui impose Jurowski dans les grands chefs de fosse de ce temps.
Avec un tel spectacle, d’un tel niveau, aussi prodigieux dans la fosse que sur la scène, comment nier que Munich aujourd’hui soit la scène de référence, il faut voir ce Prokofiev, il se joue aussi pendant le festival en juillet 2016, c’est à ne manquer sous aucun, mais vraiment aucun prétexte. [wpsr_facebook]

