
Un Otello de Verdi est toujours un événement. Parce que l’œuvre traîne derrière elle des chanteurs et des chefs légendaires. Sans l’un ou l’autre, il est difficile qu’un Otello réussisse, ce qui n’est pas le cas d’autres opéras de Verdi. La période actuelle est sans Otello : Antonenko ? oui il a la voix, mais inodore et sans saveur. Botha ? Oui, il a la voix, l’élégance, le timbre, mais scéniquement…Alagna ? oui, sans aucun doute l’aura, le charisme, mais peut-être pas le format vocal, notamment pour les esultate initiaux et pour la tension voulue par le rôle et donc à terme pour la préservation de sa voix. Alors le petit monde lyrique attend Jonas Kaufmann, et en attendant Kaufmann, les festivals tournent en rond.
Bien sûr, j’ai été bercé aux Otello de Jon Vickers et Placido Domingo, vus et revus sur scène, mais aussi un Carlo Cossutta, bien oublié qui ferait sans nul doute aujourd’hui les délices de tous les festivals, mais aussi de chefs : Solti, Kleiber, Abbado, et ceux là on ne les oublie jamais non plus.
Pour honorer le thème du Festival, Shakespeare et ses tout juste quatre siècles depuis sa disparition en 1616, on aurait pu envisager Falstaff, il y a les voix, il y a les metteurs en scène, mais Falstaff (déjà proposé 2 fois en 25 ans) ne remplirait peut-être pas la salle, parce qu’il n’a pas le parfum du spectaculaire. Macbeth ? il y a les voix pour, et là aussi les possibilités de metteurs en scène, mais pour Salzbourg, le choix de la Lady ferait peut-être problème. Il y avait aussi les Shakespeare non verdiens, comme le Lear de Reimann, mais Reimann aurait fait fuir le festivalier (vu l’effet Henze sur le public lors d’un des concerts), ou oser Das Liebesverbot, de Wagner, un titre que Thielemann aurait pu très largement porter, dans une production non coupée qui eût pu être la référence moderne. Mais à Pâques à Salzbourg, c’est de la grosse machine standard et distribuée au sommet qu’il faut.
Alors il a fallu se rabattre sur Otello, avec une distribution à 100% non italienne, et un chef réputé, mais dont l’univers reste germanique, malgré ses efforts pour casser l’image (Cavalleria/Pagliacci l’an dernier), et sans Kaufmann, qui a dû promettre à Pappano de prendre le rôle à Londres.

Et c’est l’échec, avec une distribution inattendue sur le papier, chacun des chanteurs étant dans son aire une référence. Dorothea Röschmann est une mozartienne accomplie et un modèle de style, José Cura a encore une voix, malgré de longues interruptions de carrière, et bien qu’il ait chanté le rôle il y a 20 ans dans la dernière production à Pâques de l’Otello d’Abbado (Ermanno Olmi, à oublier) lors d’une tournée des Berliner à Turin. Carlos Alvarez en Iago, l’un des grands stylistes et l’un des grands barytons de l’époque, mais désormais sur le crépuscule. Lodovico est Georg Zeppenfeld, bien sous dimensionné pour un tel artiste, et un jeune ténor très remarqué là où il passe, Benjamin Bernheim en Cassio.
La mise en scène a été confiée à une équipe française, Vincent Boussard pour la mise en scène, Vincent Lemaire pour les décors, et Christian Lacroix pour les costumes . Un travail qui n’a pas du tout emprunté le chemin du Regietheater, et ne travaille pas du tout sur la « Personenführung », le travail sur les personnages, mais sur les ambiances. Certaines critiques de la presse allemande ont vu dans la mise en scène un « style français », je m’inscris en faux contre ce genre de qualificatif, d’abord, parce qu’il n’y a pas de « style français » dans la mise en scène actuellement en France, il n’y a même pas de style d’ailleurs. Boussard signe un travail dans son genre plutôt élégant et réussi, bien que ce ne soit pas du tout le type de travail que je désire au théâtre. Dans ce lieu, on a vu Karajan (mais l’été et pas à Pâques), qui n’était pas vraiment un metteur en scène, mais qui ne voulait pas que ce qu’on voit puisse perturber la musique : son film à ce titre est édifiant (mais il avait Freni et Vickers…), Ermanno Olmi (avec Abbado ) s’est fourvoyé (mais il y avait Domingo, Raimondi et Frittoli) . L’Otello présenté cette année est la deuxième production depuis la fondation du Festival de Pâques, qui est plus harmonieuse, et plus esthétique, sinon esthétisante avec quelques moments vraiment réussis (notamment le premier acte, plutôt bien, voire très bien mené) et pour moi plus réussie qu’Olmi.
On a d’ailleurs peu de productions du chef d’œuvre de Verdi à Salzbourg depuis 1967 : l’été, ce fut Karajan en 1970-71-72, puis Abbado à Pâques 1996, et enfin Riccardo Muti l’été (production Stephen Langridge) en 2008 avec déjà Carlo Alvarez en Iago. A chaque fois, ce n’est pas la mise en scène qui fit briller la production.
Vincent Boussard se saisit de l’histoire et l’illustre, sans s’attarder trop sur la caractérisation des personnages, mais construisant, comme je l’ai dit, une ambiance, des images qui tentent d’expliquer ce qui se passe : pendant le duo, dans une sorte de boite isolée, avec un miroir (cet amour est-il réel ou un reflet) et un ciel uniformément étoilé (la nuit, protectrice des amants – voir Tristan), s’inscrit en vidéo un mouchoir voletant (l’avenir et la menace). L’image est belle, et aussi juste : la fonction dramaturgique du duo est d’être le seul moment de « pur amour » de l’œuvre puisque dès l’acte II la machine à détruire se met immédiatement en place. En soi, c’est un climax. Plus dure sera la chute.
Le premier acte est plutôt réussi, même si les chœurs sont désespérément face à l’orchestre, tous vêtus de noir, de ce noir sombre et nocturne, avec un immense voile poussé par le vent non dénué d’élégance par sa monumentalité, avec sa table sur laquelle évolue Cassio singulièrement mis en valeur dans une scène qui n’est pas toujours lisible et qui est ici très claire. La mise en valeur de Cassio sur cette immense table (qui est une seconde scène et qu’on retrouve au 3ème acte) avec sa coupe de vin (qui semble du jus de pamplemousse rose) sert la clarté dramaturgique du propos. Elle met en même temps en valeur le chant de Cassio (qui le mérite) et force le public à la concentration. Tout cela est bien fait, avec l’enchaînement sur le duo Otello/Desdemona, concentré sur le centre du dispositif, et comme hors du temps et hors la trame.

Boussard va utiliser en écho le même principe d’isolement « dans une boite » pour la scène du meurtre de Desdemona, qui deviendrait presque une pantomime, avec une Desdemona réelle et une Desdemona-image (personnifiée par sa robe) , au dessus de la porte, presque une image sainte, image de transfiguration.

On navigue entre le réel et le symbolique, notamment aussi à travers cet ange noir, le démon qui mourra avec Otello, et qui apparaît comme une immense bactérie à chaque moment clé de la descente aux enfers de la jalousie et de la destruction, un ange noir qui se prend lui même à ce jeu de la mort, puisque une de ses ailes prend feu au contact des bougies qui couvrent la table immense du 3ème acte et que parcourent les personnages, entre des rangées de bougies vacillantes, qui semblent aussi bien des cierges ou un espace mystérieux dans lequel il faut passer, en risquant et son corps et sa vie (jeu sur les voiles, fragilité du chemin, chute de bougies à terre, et embrasement de l’aile de l’ange). Tout cela est emblématique de fragilités et de mort.
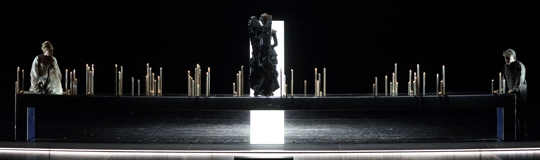
Boussard s’intéresse donc plus aux images, aux emblèmes, aux symboles, sans que l’imagerie ne soit jamais dérangeante, mais elle est à peu près le seul véritable intérêt d’un travail qui s’intéresse peu au jeu et aux interactions entre les personnages qui ne font guère que ce qu’on voit sur toutes les scènes. Il se contente d’illustrer l’histoire du mieux possible, avec de jolis éclairages de Guido Levi.

Les costumes de Christian Lacroix (co-réalisés avec Robert Schwaighofer) dont on aurait pu croire en lisant la presse (qui annonçait 2,5km de tissu) qu’il allait faire un « froufroutello » sont plutôt rigoureux, en autant de taches d’ambiances : noirs au premier acte, rouges au troisième à la scène de l’arrivée de l’envoyé du Doge, assez riches mais sans décorations ni chamarrures inutiles.
Certaines images sont réussies, certaines scènes, sans toujours avoir une vérité dramaturgique vraiment marquée, « se laissent voir », avec une tendance à un esthétisme un peu superficiel, mais certaines autres restent insuffisamment fouillées. C’est le cas de la grande scène finale du troisième acte (l’envoyé du doge), qui n’a pas vraiment ni vie ni tension, même si les excès d’Otello qui conduisent le chœur à se retourner, laissant le héros seul, en constituent le seul « moment » , mais pour le reste, il n’y pas grand chose.
Au total ce travail est illustratif, donne à voir plus qu’à penser, et ce qu’on voit est plutôt étudié, mais hélas, comme je l’ai écrit, je ne vois pas de mise en scène de cette œuvre qui ait jusqu’ici marqué (ou animé) les esprits, et j’en arrive à penser que celle de Terry Hands de l’opéra de Paris en 1976 reste encore l’une des plus réussies.
Mais une mise en scène seule ne fait pas une soirée, car elle est nourrie et se nourrit de l’urgence du plateau et de la fosse. S’il n’y a pas de lecture conjointe scène/fosse, la mise en scène s’éteint.
Or, la fosse est ici singulière.
Singulière parce qu’on entend un Otello très inhabituel. Le travail de Christian Thielemann ne peut laisser indifférent tant l’approche change complètement le paradigme.
Il ne s’agit pas de disserter sur l’italianità ou non de cet Otello. Car Carlos Kleiber qui fut sans doute le plus grand chef pour cette œuvre n’est pas italien, non plus que Furtwängler, qui en laissa aussi une très belle trace (avec Ramon Vinay et Dragica Martinis). C’est l’option du chef, très marquée, qui me paraît ne pas être cohérente avec ce que dit la composition.
En optant pour une clarté analytique qui fait entendre la moindre poussière de la partition la nettoie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus ni nerf, ni aspérité, ni pulsion, mais une boite vidée de toute substance et de toute vie, Thielemann dévitalise Otello. C’est magnifiquement exécuté par une Staatskapelle Dresden prodigieuse de netteté, merveilleusement propre, sans scorie aucune et qui laisse découvrir des phrases musicales, des détails qui nous avaient échappé depuis toujours et met en valeur sans aucun doute la richesse infinie de la partition de Verdi. Si vous voyez la Joconde au microscope, vous en verrez les moindres détails pigmentés, mais le tableau vous échappera et c’est ce qui se passe ici. Il y a dans la musique de Verdi et dans l’Otello notamment un travail sur les contrastes, sur les explosions suivies d’apaisements d’un lyrisme extrême qui mime sans cesse les écartèlements de l’âme perturbée d’Otello, il y a une chaleur, celle des nuits moites où se trament les drames qu’on n’entend ni ne ressent ici. Ainsi de l’explosion initiale, de cette entrée dans l’opéra in medias res qui doit être brutale, globale, surprenante (Kleiber ne laissait aucun répit entre le salut au public et faisait exploser déjà la première note, en se retournant vers l’orchestre) ici déjà on l’entend décomposée, déconstruite, ce qui tue l’effet voulu. Quelquefois, cela fonctionne très bien, notamment dans le crescendo qui conduit à la crise du premier acte autour de Cassio où tout le crescendo devient mimétique à la scène et à l’orchestre, comme si les instruments jouaient ce qui se trame en scène (les bassons, superbes !), quelquefois, et le plus souvent, cela fait perdre et la tension dramatique, et le fil musical, le legato et la pulsion.
Cet Otello n’halète pas, il a la netteté froide de ces tableaux de Bronzino ou de Pontormo sans jamais avoir le trait tremblant du Titien qui en ferait toute l’humanité. Il en résulte un certain ennui, du distant, du beau, triste sans être ardent. De cette histoire de passion ravageuse et mortifère, Thielemann fait une histoire de composants chimiques vus au microscope.
Et il n’est pas aidé par le plateau. Le chœur est très correct (Sächsischer Staatsopernchor Dresden, direction Jörn H. Andresen), mais pas exceptionnel, notamment au troisième acte où les aigus exigés restent timides et un peu tirés.
Après le forfait de Johan Botha, le Festival a fait appel pour Otello à José Cura, une vieille connaissance à la carrière interrompue puis reprise, qui a été une star filante à la fin des années 90. Une voix forte, une certaine intelligence, mais un raffinement qui se fait attendre. La voix est assez opaque, projette mal, et le timbre est singulièrement sourd. Le personnage existe malgré tout, et les derniers moments sont bienvenus. Malgré les défauts actuels de la voix, la prestation est loin d’être scandaleuse, et le chanteur se défend et défend assez bien le rôle. On n’est pas au niveau d’un Festival comme celui de Salzbourg Pâques, mais José Cura préserve la représentation, et on est loin du naufrage que certains prédisaient. Il y a de l’intelligence dans ce chant, il y a de l’émotion, même si ce n’est jamais bouleversant, et cela ne répond pas exactement aux exigences d’un rôle il est vrai redoutable. J’ai entendu Cura plusieurs fois dans Otello, je n’ai jamais vraiment aimé. Cette fois-ci, je n’ai pas vraiment détesté.
En 1996, Domingo masquait quelques insuffisances, des aigus savonnés, quelques instabilités, mais était impérial et bouleversant au quatrième acte, en phase avec l’orchestre comme rarement on a pu entendre sur une scène. Ici Cura arrive à moduler certains moments, mais en dépit des efforts réels, c’est un peu tard.

Carlos Alvarez a perdu une certaine suavité vocale, un timbre d’une douceur ineffable qui en faisait le prix dans des rôles comme Posa. Son timbre plutôt sombre convient à Jago, mais il il faut noircir à plaisir (ce qui faisait le prix d’un Raimondi, même en fin de carrière en 1996), sans être un histrion. Alvarez est très équilibré, est toujours un styliste et un vrai « diseur » du texte. En ce sens son Jago, sans être pleinement réussi (le credo manque de l’agressivité et des aigus qu’on attendrait) est assez bien défendu, notamment dans toutes les scènes avec Otello et dans les ensembles ; ses duos avec Otello ont une vérité singulière, l’ensemble du premier acte est bien mené, c’est encore un Jago très défendable sans être à son sommet d’il y a quelques années.
Au total, les deux protagonistes masculins sans être stupéfiants, s’en sortent, avec les honneurs, malgré les problèmes dus à des voix un peu fatiguées, mais aussi quelquefois à un orchestre qui ne les aide pas toujours (tempi, volume).

Le plus gros problème tient à Dorothea Röschmann, dont on se demande ce qu’elle vient faire dans cette galère. Cette chanteuse dont on apprécie les prestations mozartiennes, qui a du style, de l’élégance semble ici avoir perdu toute ligne de chant. L’air du saule ou l’ave Maria restent froids, comme des exercices de style très maniérés, sans une ligne naturelle et sans vibration aucune, complètement extérieurs. Mais ce qui frappe surtout, c’est que la chanteuse a dû travailler l’aigu pour l’élargir aux dépends des graves et même du centre, il en résulte des aigus surdimensionnés, sans legato, sans ligne, qui surgissent, surprennent, gênent, et cassent la mélodie. Vraiment, on est loin d’une Desdemona, Festival ou non. Une très grosse déception, d’autant que j’aime vraiment beaucoup cette artiste.
Dans les rôles de complément, notons que Georg Zeppenfeld (avec un chapeau claque…) n’est pas parfaitement à l’aise non plus dans Lodovico (mais il a si peu à chanter) et que l’Emilia de Christa Mayer se défend bien au quatrième acte, et le Rodrigo de Bror Magnus Tedenes et le Montano de Csaba Szegedi sont très honnêtement distribués.

Du point de vue du chant, on se souviendra seulement de Benjamin Bernheim dans Cassio, seul sur son immense table, mis en valeur dans son ivresse naissante, au chant impeccable. Cassio n’est pas toujours un personnage mis en relief, plutôt pâle dont la voix de ténor très lyrique doit faire pendant à celle dramatique d’Otello. Ici, les qualités apparaissent immédiatement, ainsi que la personnalité scénique, le style, la diction et la projection sans défauts. La pure beauté du chant, ce soir, c’est Cassio qui nous l’a offerte. Retenez donc ce ténor, qui mérite une belle carrière.
Ainsi donc ce fut une soirée plutôt contrastée, un Otello largement inaccompli, victime d’annulations (Johan Botha, Dmitri Hvorostovsky) ou d’erreurs de casting (Dorothea Röschmann), dont le meilleur du plateau est le Cassio de Benjamin Bernheim. Le bilan est maigre, malgré la valeur des uns et des autres, et avec un orchestre de grande qualité conduit vers une interprétation qui est loin de me convaincre. La mise en scène offre un cadre relativement élégant mais insuffisamment fort pour faire pencher la balance. Attendons l’Otello du futur…[wpsr_facebook]

