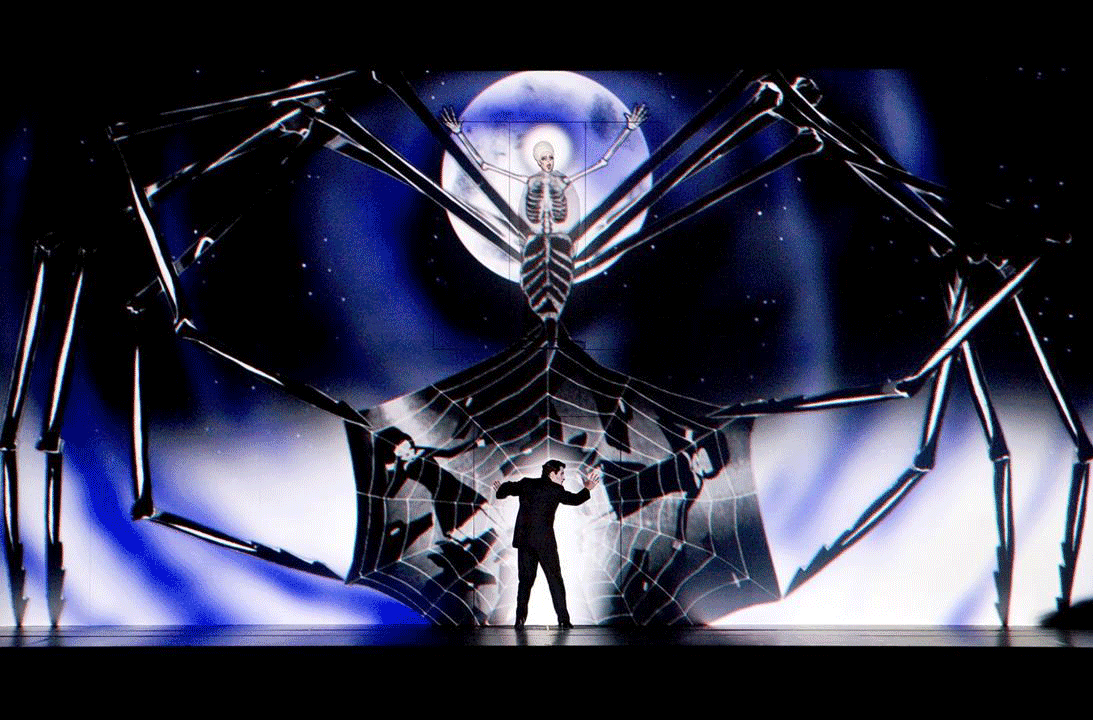
Inutile de revenir sur la qualité des spectacles présentés à la Komische Oper et à l’exigence de de son animateur, le metteur en scène Barrie Kosky, de mises en scène de haut niveau. Il en signe lui-même beaucoup, mais celles qu’il confie à d’autres sont aussi de grands moments de théâtre, un exemple parmi d’autres, l’Ange de feu qu’on vient de voir à Lyon, de Benedict Andrews.
Pour Die Zauberflöte, le défi est double. D’une part, c’est une œuvre symbolique de l’opéra-comique, un Singspiel populaire que toute l’Allemagne fait voir à ses jeunes générations au moment de Noël, et donc pleinement part du répertoire traditionnel de la Komische Oper, d’autre part, c’est une œuvre qui en l’espèce doit plaire à tous. Il faut conjuguer le monde enfantin et un peu merveilleux et la grande tradition de l’opéra-comique, tout en restant fidèle à Mozart, mais aussi aux attentes des familles qui viennent en masse.
Or l’expérience montre que Zauberflöte, comme Fidelio ne sont pas des œuvres faciles à monter. Nombre d’immenses figures de la mise en scène s’y sont frottées et y sont tombés à commencer par Giorgio Strehler à Salzbourg, mais aussi tant d’autres. On se souvient de la production de Roberto de Simone à la Scala dirigée par Riccardo Muti. Une marche funèbre.
La voie d’une rare justesse choisie par Barrie Kosky, porté par goût vers les œuvres de ce type, qui est un grand metteur en scène d’opérette, qui adore le Music-Hall et qui sait parfaitement colorer une mise en scène et s’adresser à un public très divers a été celle de s’associer à « 1927 » de Suzanne Andrade et Paul Barritt, qui travaillent sur des spectacles aux frontières du théâtre de l’animation, du film, et qui sont passionnés par l’univers du muet : 1927 est l’année du premier film sonore.
Kosky explique dans le programme de salle que ce travail collectif sur Zauberflöte a permis à Andrade et Barritt d’entrer dans l’univers de l’opéra, grâce à l’expérience de Barrie Kosky qui a mis les équipes de la Komische Oper à disposition. Ce spectacle est donc la conjugaison d’expériences très diversifiées et de mondes variés.
Le résultat, qui remonte à 2012, est simple : le spectacle repris régulièrement affiche complet à chaque reprise, d’autres théâtres ont voulu le louer : c’est le cas du Liceu de Barcelone et du Teatro Real de Madrid, et ce sera le cas de l’Opéra-Comique de Paris la saison prochaine, qui va y afficher bien des membres de la troupe de la Komische Oper.
Le principe de la mise en scène en est assez simple : il s’agit de faire de Zauberflöte un spectacle sur la magie des images, en jouant sur la relation animation/théâtre, et en faisant de chaque personnage un prolongement des images animées, en leur donnant une allure années 20, et notamment des films des années 20. Papageno ressemble à Buster Keaton, Monostatos à Nosferatu, et Pamina a un faux air de Louise Brooks dans la Lulu de Pabst.
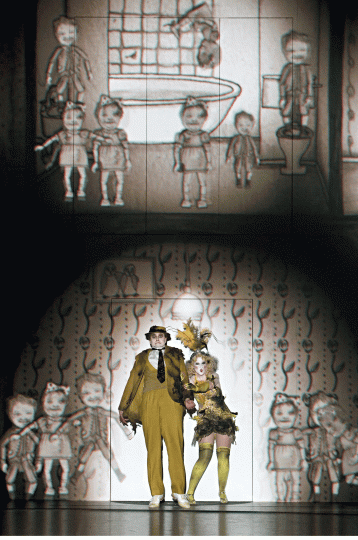
En même temps, la mise en scène utilise les techniques du film muet pour résoudre la question des dialogues, toujours épineuse : au lieu des dialogues parlés, puisque nous sommes dans un film muet, on va afficher comme dans le muet, des cartons de commentaires insérés entre les scènes, qui vont être mimés par les chanteurs, cartons évidemment plein d’humour, quelquefois accompagnés d’images désopilantes. Ainsi évidemment, tout le début cueille le public par surprise, la chasse au dragon, la situation de Tamino, dans l’estomac du monstre, les simagrées des trois dames, l’impossibilité (bienvenue dans un film muet) de parler pour Papageno. Il en résulte aussi des scènes impressionnantes par l’effet qu’elles produisent, dont l’apparition de la Reine de la nuit en araignée géante, ou les animaux sauvages (ici des cerbères) autour de Monostatos calmés par le Glockenspiel et transformés alors en danseuses de cabaret, Papageno au milieu des éléphants roses installés dans des verres qui lui crachent du liquide, Pamina agressée par les cerbères de Monostatos.
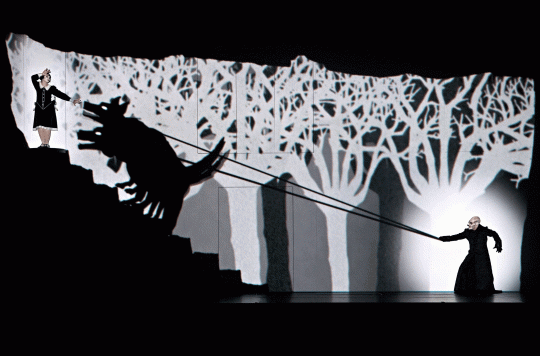
Beaucoup plus facile aussi d’imaginer au deuxième acte les épreuves de l’eau, du feu, car l’imagination est au pouvoir. Bref, les 3h30 de spectacle durent 5 minutes, et le travail scénique qui réclame un rythme, un tempo, une exactitude de suivi minutée est essentiellement confié à la projection vidéo et aux chanteurs, apparaissant et disparaissant du mur écran qui barre la scène.
Un spectacle au principe simple, à l’exécution délicate, qui ne souffre aucun décalage ni retard, qui demande aux acteurs chanteurs non tant du jeu, mais une parfaite synchronisation des mouvements par rapport à l’écran. Le résultat : la magie d’un bout à l’autre et à n’en pas douter la plus « juste » Zauberflöte vue sur une scène depuis longtemps. C’est le type même de spectacle pour tous les âges, de 8 à 80 ans disait Barrie Kosky, de 7 à 77 ans dirons-nous, en bons disciples de Tintin.
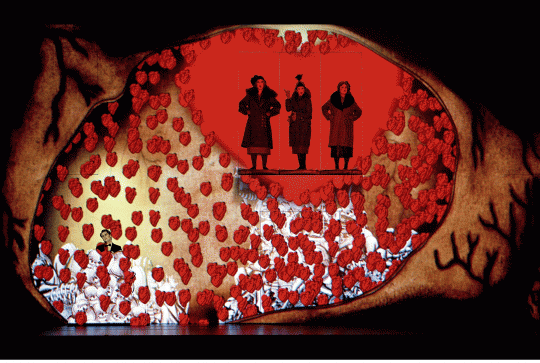
Donc un conseil au lecteur qui chercherait à initier les chères têtes blondes à l’opéra : réservez très vite à l’opéra-comique l’an prochain pour toute la famille : vous ne le regretterez pas.
Musicalement, comme souvent à la Komische Oper, une distribution homogène avec quelques perles plus ou moins baroques et plus ou moins précieuses. On est un peu déçu par le Sarastro de Thorsten Grümbel, qui chante aussi le Sprecher, la voix ne projette pas, les graves ne sont pas vraiment sonores, c’est un Sarastro un peu pâle, sans grand relief, et qui ne réussit pas à s’affirmer. Le Tamino d’Adrian Stooper, le ténor australien, est sympathique, bien en place, correct sans être vraiment notable, mais élégant. Pour tous les autres c’est un sans-fautes : le Papageno de Dominik Köninger, Vogelfänger accompagné de son chat désopilant Vogelfänger lui aussi…est vivant, leste, très expressif et physiquement et dans son chant, c’est une prestation vraiment réussie, tout comme celle, plus brève, mais brillante de la jeune Papagena de Talya Lieberman, qui appartient au studio de la Komische Oper. Le Monostatos de Peter Renz, vieille connaissance de la maison, est lui aussi expressif à souhait et compose un personnage tragi-comique d’une rare authenticité, noblesse et jolis sons de la part des « Gehärnischter Männer » Christoph Späth et Daniil Chesnokov : étant issus tous trois du Tölzer Knabenchor, die drei Knaben sont évidemment ce qu’on peut trouver de mieux en matière de justesse et de fraîcheur (Daniel Henze, Laurenz Ströbl, Peter List). J’ai particulièrement apprécié la Reine de la nuit de la jeune soprano grecque Danae Kontora. Voix sûre, sonore, avec tous les aigus qu’il faut, même dans le registre le plus haut, et des piqués de Der Hölle Rache… au second acte très précis et sans bavure aucune, cela compose au total une Reine de la Nuit de très bon niveau qui ne mérite qu’éloges.
Enfin l’américaine Nicole Chevalier est Pamina : poésie, justesse, contrôle sur la voix, engagement dans l’interprétation, émotion aussi, voilà un ensemble qui fait une Pamina elle aussi vraiment intéressante : les deux femmes dominent une distribution par ailleurs globalement très respectable, comme on l’aura compris.
Très respectable à excellent le chœur de la Komische Oper dirigé par David Cavelius qu’on entend sans le voir beaucoup, mise en scène oblige, et l’orchestre fait preuve d’une ductilité et d’une présence notables. Dirigé par le GMD Henrik Nánási, il montre une belle énergie, un sens des contrastes, une certaine subtilité, voire du réel raffinement à certains moments (Ach ich fühl’s…). Mais sa principale qualité, c’est la dynamique et la limpidité qui confirment le bon travail effectué par le chef sur sa formation. On ne peut que regretter son départ en fin de saison, d’autant que sur cette production, que Nánási a créée en 2012, il a fait fait preuve d’une sens du rythme, d’une précision métronomique pour être en phase avec le rythme de la vidéo. Joli travail d’artisanat d’art.
Le résultat: il faudra courir à l’Opéra-Comique, à Paris, ou faire le voyage de Berlin : il est toujours préférable de voir une production chez elle, pour la salle où elle est née. Ou faire les deux, c’est le genre de spectacle pour lequel on peut dire : plutôt deux fois qu’une.[wpsr_facebook]

