
Il y a six ans Nicolas Joel en 2009 avait symboliquement ouvert son mandat par Mireille de Gounod qu’il avait lui même mise en scène, production tellement réussie qu’elle ne fut jamais reprise.
En affichant Moses und Aron de Schönberg mis en scène de Romeo Castellucci pour sa première nouvelle production, Stéphane Lissner tout aussi symboliquement annonce la couleur : c’est bien d’abord un message en quelque sorte politique avant qu’artistique, une note d’intention que Lissner adresse au public parisien. Qui s’en plaindra ? Le succès remporté par le spectacle montre quelle était l’attente du public après les années précédentes plutôt grises et sans grand intérêt.
Il faudrait sans doute s’interroger sur les raisons de ce succès. Schönberg ? J’en doute, ou alors on nous a changé le public d’opéra, dont certains considèrent que Wozzeck (1925) est inaudible. Je pense plutôt que la présence de Romeo Castellucci qui traîne une odeur sulfureuse a stimulé la curiosité. C’est toujours le même phénomène qui frappe les metteurs en scène « novateurs » : donnez-leur à travailler Schönberg et c’est un triomphe, mais donnez leur Madama Butterfly et ce sera la bronca. Castellucci dans Schönberg, aux yeux d’un certain public, cela ne dérange pas ; c’est même très cohérent.
J’ai lu je ne sais où que Moses und Aron était une pièce « contemporaine ». Elle a 82 ans…et elle a été créée il y 61 ans. Le contemporain est assez élastique, mais c’est sans doute la modernité de Schönberg qui est éternelle.
L’attente du travail de Romeo Castellucci, les nouvelles distillées habilement lors des répétitions, et notamment le fameux taureau charolais comme Veau d’or, les premières images : tout a été fait pour susciter la curiosité, et même la très récente protestation au nom du bien-être animal contre l’utilisation du taureau contribue à la réussite de la communication autour du spectacle, avec pour résultat une relative déception qu’on lit dans les compte rendus critiques sur la production. Voilà un travail apparemment classique dans son propos : pas de vidéo en direct d’une chambre d’hôpital (comme dans Orfeo), pas de carmélites (comme dans Œdipe Roi que les parisiens vont voir fin novembre). Paris, depuis le XVIIIème siècle n’aime rien tant à l’opéra que la nouveauté et le frisson, et donc ce spectacle qui n’offre apparemment que Moïse, Aaron, et le Sinaï, tout simplement (C’est à dire le texte même, j’allais dire le Verbe même) a pu décevoir les plus avides.
Écrivant ce compte rendu après la fête, c’est à dire à la fin de la série de représentations, alors que j’ai vu le spectacle à la Première, j’ai voulu en profiter pour écrire avec le recul sur ce qui me restait, après trois semaines, de la production. Quand cendres, poussières et paillettes retombent, que reste-t-il du spectacle ?
Il reste l’impression d’un grand spectacle et l’écho répété d’un très grand succès. La fortune actuelle de Romeo Castellucci qu’on semble découvrir, est assez singulière d’ailleurs, dans la mesure où ses spectacles ont parcouru l’Europe depuis la fin des années 90. Romeo Castellucci, ce sont des ambiances, c’est une volonté d’impliquer émotionnellement le spectateur par un théâtre souvent bien proche du théâtre de la cruauté d’Artaud dont Castellucci est un évident lecteur. Son Haensel et Gretel, qui reste pour moi un de ses plus grands spectacles, transformait le conte pour enfants en un cauchemar dont les enfants sortaient en larmes…

On retrouve chez Romeo Castellucci la volonté de construire des images puissantes, qui vont marquer le spectateur, des images esthétisantes, des lumières étranges aussi qui illustrent l’italianità du metteur en scène, à commencer par cette toute première partie dans un brouillard blanc, avec beaucoup de nuances de blanc, un blanc laiteux, qui éloigne, qui sépare, qui annihile les formes et devient évocatoire, un blanc de paradis (très souvent les représentations « publicitaires » du paradis sont blanches, avec nuages ), un blanc suggestif qui suggère la protection divine qui accompagne le peuple juif. Le blanc emblématique de l’innocence première.

Le mouvement parabolique de cette production, c’est le passage progressif du blanc au noir, c’est la tache noire qui va se multiplier : noir le liquide que certains pensent pétrole, d’autres encre. Noire la couleur de l’idole centrale qui frappe, noire l’eau de la piscine probatique. Le spectacle passe du blanc au noir, un spectacle qui passe du contact avec un Dieu irreprésentable à un monde qui, n’arrivant pas à se le représenter, préfère retourner à ses idoles ou les créer, c’est à dire rester monde et refuser Dieu. La question de la représentation est au centre de polémiques religieuses et civiles infinies dans le monde d’hier (les guerres iconoclastes) et celui d’aujourd’hui (inutile de faire un dessin…).
L’image blanchâtre à peine esquissée du taureau en arrière plan traduit bien visuellement la question. Entre un Dieu omniprésent et invisible, et un Dieu hic et nunc à adorer, le peuple choisit l’ici et maintenant.
La question posée par le Moses und Aron de Schönberg est bien une question presque eschatologique et la traduire à l’opéra est une opération marquée du sceau de l’impossible : où bien vous racontez l’histoire comme une aventure cinématographique, où bien vous procédez par images, par épisodes, par stations, par vignettes où peu à peu le Livre se révèle. L’histoire a été racontée au cinéma (« Les Dix Commandements ») par le cinéma hollywoodien qui faisait de l’aventure biblique une succession d’images fortes, l’enfant que j’étais a été marqué par la vision de l’ouverture de la mer rouge, ou la succession des plaies d’Egypte, ou même le Buisson ardent, puisque le film de Cecil B.de Mille montre tout. Et plusieurs années après, jusqu’au seuil de l’adolescence, j’ai été poursuivi par l’image d’un Sinaï mystérieux et menaçant : le Dieu d’Hollywood n’est pas très rassurant.
On peut choisir l’aplatissement de l’opéra belcantiste à la Rossini, qui utilise l’ouverture de la Mer Rouge comme la Tempête suprême (un motif qu’il affectionne dans sa musique, héritage des tempêtes baroques), et qui raconte une histoire parallèle à l’histoire biblique (j’adore Moïse et Pharaon, un des premiers « grands opéras », mais pas pour son utilisation de la Bible).
Schönberg, à qui l’on doit à l’opéra des formes plutôt réduites (Von heute auf morgen par exemple) se confronte là à une forme immense, qui illustre son retour au judaïsme fondateur, et qui utilise l’opéra non comme spectacle, mais comme message : Moses und Aron est, après Parsifal, un autre Bühnenweih(fest)spiel.
Peter Stein, à Amsterdam et Salzbourg en avait fait un opéra spectaculaire, lumières aveuglantes, orgie monumentale où le chœur se mettait nu (impressionnant chœur d’Amsterdam) une sorte de fête expressionniste peut-être plus marquée par les années 20 que par le message biblique lui-même, et la direction acérée, glaciale et vigoureuse de Pierre Boulez l’accompagnait. Un des spectacles les plus marquants des trente dernières années, qui a reproposé Moses und Aron sous les projecteurs (et Dieu sait qu’il y en avait dans le spectacle). Mais un spectacle qui jouait sur l’ambiguïté d’une œuvre écrite au moment de la montée du nazisme comme parole politique déviante, qui rivivifiait en quelque sorte l’adoration des idoles païennes .

Castellucci revient au texte, et pour tout dire, au Verbe et à sa transmission, il va proposer une expression du Divin dans sa production et sa réception et dans les rapports production-réception, qui est au fond tout le problème de l’œuvre : comment transmettre l’idée de Dieu, avec à la fois une grande fidélité à l’esprit de l’œuvre, mais aussi à l’Esprit
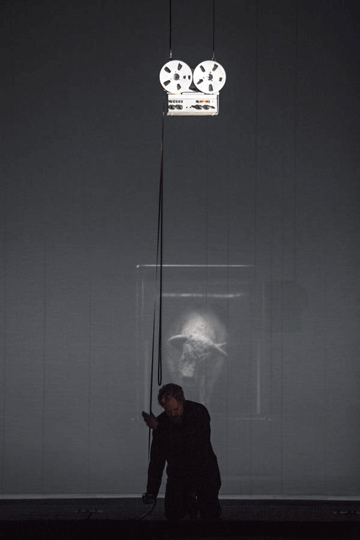
au sens fort du terme, avec aussi des visions hyperréalistes non dénuées d’ironie ni de distance comme cette première image d’un magnétophone vieux style, d’une blancheur immaculée qui représente la voix non représentable de Dieu et dont les bandes magnétiques vont être un des motifs récurrents de la production, d’abord entourant le bras de Moïse, ensuite composants de la figure de l’idole noire adorée du peuple.
Autre motif récurrent, le totem blanc qui figure le « bâton d’airain » de Moïse, que Castellucci a déjà utilisé je crois dans un autre spectacle Go down Moses présenté au théâtre de la Ville en 2014. Un motif polysémique, comme il y en a beaucoup dans les travaux de Castellucci, dont le sens peut être reçu de manière diverse sans perdre de sa puissance, ou même ne pas être compris, comme souvent peut l’être tout signe, notamment les signes du Divin (voir la question delphique des oracles).

Ainsi de ce bâton d’airain totémique, on extrait un liquide noir (pétrole ? encre ?), en tous cas symbole de souillure qui va envahir peu à peu la scène et les personnes. Bâton qui symbolise Moïse ou Serpent maléfique : il ne peut y avoir de Loi que s’il y a souillure : la loi naît de la déviance. Et ironiquement quand ce bâton apparaît apparaissent aussi les mots « Grand anaconda » en surimpression. Les Dix Commandements sont une réponse au comportement des hommes, car si les hommes se comportaient sans souillure, ils n’en auraient pas besoin. Cette souillure noire peut être pétrole, tant ce totem semble une mécanique qui fait penser à un trépan, à une mécanique d’extraction du pétrole vu alors comme perversion, comme sang noir des Enfers (on serait proche de Castorf dans son Ring), comme substitut brutal et sans séduction de l’Or dont parle la partition mais aussi peut-être vue aussi comme encre, l’encre des écritures, mais en tous cas un liquide qui en étant nettoyé fait surgir le verbe, inscrit au sol dans les traces laissées après le nettoyage.
De même la piscine, le passage par l’eau est à la fois figure métaphorique du passage de la mer rouge, et bien entendu piscine probatique, de l’eau purificatrice, comme elle exista aux portes de Jérusalem et figurée dans la peinture (voir San Rocco à Venise et Tintoretto), une piscine probatique dans laquelle on plonge aussi un élément rouge (vivant ?) du totem et donc dans lequel on purifie hommes et choses, mais aussi une piscine probatique dont l’eau semble noircie.
La question du sens, la question de la transmission, la question aussi de l’ambiguïté ou de l’ambivalence sont des éléments qui font parti du message . La question de la parole étant posée par Moïse lui même dès les premières répliques « Meine Zunge ist ungelenk, ich kann denken, aber nicht reden », c’est autour du Verbe que Castellucci construit son travail, des mots apparaissent en surimpression et défilent à toute vitesse, comme les chiffres qui vont jusqu’à 40, 40 jours, et 40 nuits de Moïse sur le Sinaï : la Bible est pleine de séjours de 40 jours, dans l’ancien et le nouveau Testament (40 jours entre la résurrection et l’ascension de Jésus par exemple), c’est à dire que Castellucci fait défiler des mots et des chiffres qui sont des signes « dé-chiffrables » .
Ainsi, ce travail colle-t-il aux intentions de Schönberg revenu au Judaïsme et désireux d’écrire un opéra (dont il assume, comme Wagner, parole et musique) où la parole sous toutes ses formes sera centrale, parce que la parole est ici Acte, la parole comme outil, comme effet, comme signe inintelligible, et comme action. Une parole qui dans la mise en scène de Castellucci est partout, et défile en surimpression. Schönberg compose ce qu’on pourrait appeler un « Bühnenweihspiel » un jeu scénique sacré, qui n’a rien d’un opéra au sens traditionnel, mais rien non plus d’un oratorio, qui ressemblerait plutôt à un Mystère au sens médiéval du terme. On entend la parole chantée, parlée ou psalmodiée, la parole écrite, la parole enregistrée (les bandes magnétiques) : les voix (oui, avec x) du Seigneur sont impénétrables et Moïse, son prophète (celui qui annonce la parole divine), celui dont le métier est d’annoncer, ne sait pas parler. La situation tragique de Moïse est celle d’un humain dont la charge est d’annoncer la Parole, mais incapable de la prononcer et donc d’une impossibilité de transmettre la voix du Divin sinon par un intermédiaire, une sorte d’exégète dont la fonction, de facto, atténue la Parole
D’où la question d’Aron, celui qui sait parler, mais qui ne communique pas avec l’Eternel, celui qui tient le fil de la relation aux hommes, et donc au relatif, et donc à ceux qui doivent obéir à la Loi parce qu’il l’ont sans doute déjà enfreinte. Aron parle, et mais n’est pas le « prophète », et sa parole est non plus prophétique, mais politique et comme toute parole politique, contingente. D’où à la fois la différence de vocalité (Moïse est baryton basse) et Aron et ténor, ténor comme « ténu », comme fragile (je fais moi aussi des jeux sur les mots) et qui permet, pour « tenir » le peuple, par le retour au paganisme et par le Veau d’or. Peter Stein avait insisté sur l’orgie, et sur un côté très terrestre, mais Castellucci l’évoque sans insister (quelques nus) préférant sanctuariser un corps féminin présenté aux pieds du Veau d’Or/taureau :

le tableau est saisissant de ce frèle corps féminin étendu aux pieds de l’énorme taureau . Le choix du taureau ne peut être gratuit. Il y a là allusion imagée aux sacrifices humains, aux jeux du cirque à Rome, au Moloch de Salammbô, c’est à dire tous les rites qui massacrent le vivant pour l’Idole, et les extrêmes de l’idolâtrie et les extrêmes de la monstruosité. C’est tout ce que l’Éternel refuse, dès le premier Commandement : « Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, pour leur rendre un culte… ».
Mais Castellucci ne rend rien évident et tout évocatoire, tout simplement parce que la Parole est une et ses effets multiples et ses interprétations aussi multiples que les individus singuliers qui l’entendent : ainsi l’espace est-il en permanence ritualisé et géométrique où se meuvent les personnages, ainsi de la disposition du chœur, du parcours même du Taureau, des servants vêtus de combinaisons stériles pour éviter de manier l’impur, qui pourtant est parmi nous et en nous, toujours : il n’y a de pur que par rapport à l’impur, et dans un monde où il n’y aurait que le Bien, le Bien n’existerait pas car le Bien n’existe que par rapport au Mal. D’où les visions à peine esquissées ou devinées du début du spectacle d’un monde uniforme qui ne prend forme que lorsque le noir (la souillure, le Mal) apparaît. Même si apparaît à la fin un Sinaï couvert pendant l’essentiel du spectacle sous un drap candide, un Sinaï évoqué, débarrassé de son drap et devenu montagne, devient un Sinaï concret qu’on gravit, désormais à plusieurs, comme pour se relier à Dieu, après la perdition du veau d’Or, symbole d’un après que Moïse ne connaîtra pas, et comme si enfin on allait vers le très concret, qui est lui aussi un leurre.
Toute cette complexité est présente dans un spectacle où le parcours efface résolument tout « scandale » ou toute image qui focaliserait le spectateur sur la mise en scène et non sur ce le contenu qui est dit, suggéré, évoqué : Castellucci semble lui-même s’effacer devant une sorte d’illustration de l’impossible à illustrer, figurer ou dire. C’est un grand rituel illustratif et lustral, qui prend sens dans l’entreprise même de Schönberg. Après avoir mis en scène Parsifal, Castellucci approche de nouveau le sacré par l’évocation d’une Parole protéiforme et lointaine qui est la parole de Dieu vue par Schönberg, dans une démarche qui veut marquer les frontières de l’impossible : ce n’est pas un hasard si certains ont vu dans le Totem mécanique représentant le serpent d’Airain, une allusion à Kubrick et à 2001, Odyssée de l’Espace. Comme dans Parsifal, comme chez Kubrick, la Quête est le seul acte possible.
Boulez avec Stein proposait un Moses und Aron acéré, un peu comme Solti à l’opéra en 1973 (dans une mise en scène oubliable), Jordan avec Castellucci propose un Moses und Aron plus contemplatif, plus sage, aussi géométrique en scène qu’en fosse. Jordan a fait un travail avec l’orchestre remarquable, d’une clarté notable, d’une rigueur exemplaire ; Son approche, qui pour certains a manqué d’un peu de vie, met en valeur chaque moment, sculpte chaque parole. Plus encore, Jordan, qui n’est pas un de mes chefs de prédilection arrive ici à relier tout ce que la musique du XXème doit au baroque, voire à la musique de la Renaissance (Boulez est passionné de Gesualdo), mais il fait aussi entendre aussi ce que cette musique peut avoir de viennois, au sens post-romantique du terme, la musique de Schönberg, n’est pas une musique en représentation, c’est une musique intellectuelle, composée, sur-composée, qui oblige à la concentration et à une écoute diffractée : l’approche de Jordan facilite ce travail car elle n’est pas théâtrale, elle est tout sauf en représentation, elle se replie, elle se soustrait elle oblige à entrer dans les méandres de la composition. En ce sens Philippe Jordan réalise pour mon goût la plus convaincante de ses approches.
Saluons aussi le travail du chœur : José Luis Basso qui vient du Liceo de Barcelone, a travaillé ici d’une manière exemplaire, le chœur de l’Opéra qui est un chœur en soi de grande qualité, a travaillé sur le phrasé, sur la diction, sur l’expression même d’une manière éblouissante.
Ce qui doit marquer une production qui affirme une orientation et se veut l’image d’une saison ou d’une nouvelle période, c’est que toutes les masses artistiques du théâtre sont au rendez-vous : ici, techniciens chœur et orchestre montrent que devant un tel défi, ils sont tous au rendez-vous (saluons les éclairages fabuleux de Castellucci, mais aussi les techniciens lumière de l’opéra). Les solistes et pas seulement les deux rôles principaux, même s’ils sont tous épisodiques, dans une telle entreprise, doivent être impeccables car dans un opéra sur la parole et le mot, ils doivent tous être irréprochables : le niveau d’un théâtre ou d ‘une représentation se voit aux petits rôles, et pas aux grands, car s’il est facile de distribuer les grands rôles, il est bien plus difficile de distribuer les rôles plus réduits, qui font pourtant la couleur de l’ensemble. Et là ils sont parfaits, Catherine Wyn-Rogers qui prête son beau mezzo sonore à la malade, Julie Davies toute jeune soprano émoulue des formations américaines, Christopher Purves, magnifique baryton qui écume les scènes dans Britten, mais aussi Nicky Spence, le tout jeune Michael Pflumm ou Ralf Lukas, qu’on voit souvent dans les représentations wagnériennes (Melot). Beaucoup sont anglo-saxons, qui en général sont formés à la diction d’une manière rigoureuse et on reste frappé par le sens du mot de chacun.
Si John Graham-Hall est un ténor qui m’a il y a quelques années vraiment séduit dans Peter Grimes, la voix semble fatiguée, et un peu voilée, si bien qu’elle semble dans Aron à la fois en harmonie avec celle de Moses et en même temps ne pas assez tranchée. Dans Aron, il faut une voix très saine, et très différenciée de Moses (Avec Boulez, c’était Chris Merritt), je verrais là dedans pourquoi pas un Vogt ou un Hymel, des voix qui séduisent, des voix suffisamment « ailleurs » pour faire la différence, pour emporter le peuple, pour jouer avec la subtilité du texte et ses insinuations. Graham Hall est un beau ténor, à la diction impeccable et à la belle présence, mais dans un rôle où la parole est maîtresse, il semble un peu trop gris.
Thomas Johannes Mayer en revanche est Moïse : il a dans Moïse la qualité de son Wanderer, une sorte de voix puissante mais un peu mate, un peu voilée, un peu fatiguée dont il joue avec génie. C’est un chanteur intelligent, un diseur de texte extraordinaire (son monologue de Wotan au deuxième acte de Walkyrie est impressionnant) , il est ici vraiment la voix qu’il faut, présente, puissante et en même temps pas spectaculaire, mais habitée par le texte, profonde, qui donne à chaque parole un poids et un sens. Un chanteur germanique de très grande tradition et de haute école. On ne voit pas qui actuellement pourrait lui disputer la palme aujourd’hui dans un rôle à la difficulté multiple qui exige en plus une très grande présence scénique. Anthologique.
Il reste à souhaiter que ce spectacle devienne un classique parisien et non un feu d’artifice unique, qu’on puisse aller s’y retremper régulièrement, il serait délétère de ne pas le reprendre assez régulièrement. Le spectacle est repris en mai prochain à Madrid dans une salle moins vaste, avec un autre chef (Lothar Koenigs), et un autre Moses (Albert Dohmen). Il serait intéressant de voir ce que devient ce vaste espace abstrait avec un rapport scène salle différent et une acoustique plus claire que celle de Bastille, très claire elle aussi, mais lointaine, qui allait d’ailleurs bien avec cette mise en scène ritualisée et abstraite, une acoustique qui fait distance. Dans un théâtre où la proximité est plus forte, il conviendrait de revoir ce travail. Mais au moins, à Madrid, pas de souci pour trouver le taureau.[wpsr_facebook]

