
On peut voir Les Huguenots en France, en Belgique, en Italie quelquefois, en Allemagne cette fois, mais pas à Paris. L’Opéra de Paris, où l’œuvre a été créée, qui en a historiquement fait l’un des opéras les plus représentés avant la deuxième guerre mondiale, ne l’a pas repris depuis des lustres. Ses directeurs avisés lui préfèrent Tosca (une grande originalité, avec une distribution et un chef d’envergure pour le moins discutable) ou un Barbier de Séville : les deux pouvaient attendre, Tosca écumait depuis 20 ans la scène de Bastille dans la production Schröter, et le Barbier de Séville depuis douze ans dans celle de Coline Serreau, des reprises avec bonne distribution pouvaient faire l’affaire et permettaient avec les économies, de monter ce pilier du répertoire français. Mais sur les bords de Seine, Meyerbeer n’est sans doute pas assez in, et surtout, il n’est pas susceptible de racoler un public endormi ou en décomposition culturelle. Depuis 1980, une seule production de Meyerbeer, Robert le Diable, qui d’ailleurs a marqué, due au seul qui ait vraiment réfléchi à l’âme et à l’histoire de cette maison, Massimo Bogianckino. En regardant Mémopéra, la mémoire partielle de l’Opéra de Paris qui commence à 1980…, on voit à Meyerbeer compositeur de nationalité allemande, manière subtile d’éviter de souligner que ce compositeur de nationalité allemande a régné sur Paris, a fait la gloire de l’Opéra de Paris et a créé un genre typiquement parisien (Paris à qui rien de Grand n’est étranger) le Grand-Opéra.
Plusieurs raisons m’ont poussé à aller à Nuremberg. D’abord et avant tout la curiosité de voir une production de Tobias Kratzer, qui fera Tannhäuser à Bayreuth en 2019 et qui l’a déjà mis en scène à Brême, ensuite voir le Staatstheater Nürnberg, dirigé depuis plusieurs années par Peter Theiler, un Intendant francophone et francophile, qui s’est lancé dans le Grand Opéra français, – il a déjà proposé Guillaume Tell de Rossini et Dom Sébastien roi du Portugal de Donizetti – et qui a propulsé Nuremberg parmi les scènes allemandes les plus intéressantes. Mais il ne s’intéresse pas seulement au Grand Opéra puisqu’en alternance avec Les Huguenots, il propose Turandot dans une nouvelle production signée Calixto Bieito.
On le sait, Les Huguenots est une œuvre très exigeante en voix, demandant au moins deux sopranos de toute premier niveau (Arroyo Sutherland par exemple dans le disque de Bonynge) et surtout un ténor impossible pour Raoul de Nangis, comme jadis Nicolaï Gedda, ou aujourd’hui John Osborn qui le fit à Bruxelles dans la production d’Olivier Py. Réussir à monter cet opéra dans un théâtre de répertoire avec une troupe pas forcément adaptée a priori et seulement quelques chanteurs invités est une gageure.
Car Les Huguenots qui fut un succès universel jusqu’à l’orée des années soixante, n’a rien de cette œuvre boursouflée, longue et ennuyeuse qu’on dit aujourd’hui. Dans une veine exploitée par la littérature et le théâtre de l’époque (Henri III et Charles IX y sont très à la mode et dix ans après Les Huguenots, Dumas fera paraître La Reine Margot) elle est un condensé de l’habileté de Meyerbeer à mélanger les styles, à utiliser les procédés baroques (solo avec viole d’amour) et les références du passé, à puiser dans les chœurs monumentaux (merci Guillaume Tell), dans la musique de ballet, et à faire un bilan concret de l’histoire du chant : on y trouve toutes les voix, du ténor à la voix d’Arnold du Guillaume Tell au page qui va rappeler Cherubino, le grand soprano lyrique, le soprano colorature, et une variation de basses et de barytons basses. Meyerbeer plonge dans l’histoire de la musique au XVIIIème, puise dans Bach, Gluck, Mozart, mais aussi Rossini et Spontini, son génie consiste à produire une musique toujours accessible, jamais ennuyeuse, vive, impressionnante. Le succès planétaire n’est pas un hasard .
Ce n’est pas un hasard non plus si cette œuvre de 1836 va être un creuset inépuisable d’emprunts : Wagner y trouvera le Nachtwächter des Meistersinger, et le génie du charivari final du 2ème acte des mêmes Meistersinger peut être interprété comme un renversement génial d’une Saint Barthélémy entendue chez Meyerbeer, il y trouvera aussi quelques traits futurs de Parsifal et notamment la bénédiction de Gurnemanz dans l’Enchantement du Vendredi Saint trouve son origine dans celle de Marcel bénissant Raoul et Valentine au cinquième acte. Verdi quant à lui y puisera son Rataplan de la Forza del Destino et s’en souviendra dans certains chœurs, notamment d’Ernani et sans doute dans le personnage d’Oscar de Ballo in maschera inspiré d’Urbain.
En somme, il n’y a aucune raison de mépriser cette musique : au contraire, il y a toutes les raisons de la représenter, avis à l’Opéra de Paris qui l’a représenté 1126 fois (seul le Faust de Gounod le dépasse en nombre) et qui semble l’avoir oublié, d’autant que l’opéra est distribuable aujourd’hui , on a toutes les voix pour ça..
En ce vendredi 24 octobre, la salle du Staatstheater Nürnberg (bâtiment du début du siècle à la vague architecture de cathédrale civile), un théâtre financé par l’Etat libre de Bavière et par la ville de Nuremberg, avec 550 employés, 650 représentations annuelles (théâtre, opéra, ballet), deux scènes, et 270000 spectateurs (pour une ville d’un demi-million d’habitants) est quasiment pleine.
Et la représentation de Nuremberg, proposée en collaboration avec le Palazetto Bru Zane, Centre de musique romantique française, confirme le succès de presse et de public que les premières représentations ont remporté la saison dernière.

Tobias Kratzer travaille dans un espace unique conçu par le décorateur Rainer Sellmaier (également auteur des costumes), l’atelier d’un peintre qui malicieusement ressemble à celui de La Bohème avec un poêle et une grande verrière ouverte sur les toits de Paris, un peintre d’aujourd’hui en proie comme le Marcello de Puccini à une crise d’inspiration. Travaillant sur un grand format représentant Abel et Caïn, dans le plus pur style néoclassique, il renonce et renvoie ses modèles. Lorsque ses amis envahissent son atelier il va faire voguer son imagination dans la même veine fratricide et va investir le thème des guerres de religion en essayant d’abord de travailler sur la paix et l’entente entre catholiques et protestants dans la figuration d’un repas commun: à partir de ce moment, la mise en scène fait des allers et retours entre les affres du peintre, ses efforts pour créer des scènes monumentales à la Rubens et l’histoire des Huguenots. Mais l’Histoire ne réussit pas toujours à rentrer dans un tableau…

Les personnages deviennent réalité, sortent des tableaux, y compris par la fantasmagorie (les Gargouilles de Notre Dame envahissent la scène pour punir les Huguenots) et le peintre lui-même est tantôt le peintre, tantôt Nevers, le catholique qui refuse la guerre et qui cherche la réconciliation. Il est fiancé à Valentine, fille du comte de Saint Bris, un ultra catholique. Elle lui demande de rompre ses fiançailles, ce qu’il’accepte avec douleur et résignation mais avec une grande noblesse d’âme, parce qu’elle est amoureuse du protestant Raoul de Nangis et que la reine Marguerite de Valois compte en faire un mariage de réconciliation entre protestants et catholiques (ainsi commence d’ailleurs la Reine Margot, qu’on force à épouser Henri de Navarre en signe de paix).
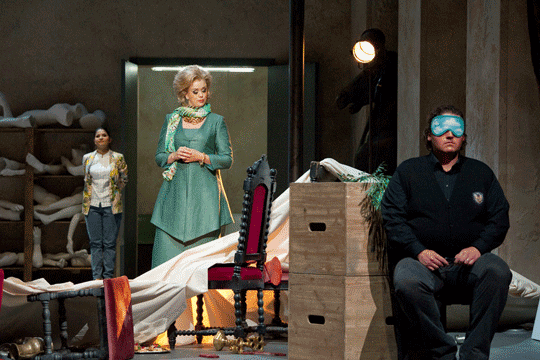
Marguerite de Valois elle même est à la fois la reine dans le rêve du peintre, et son mécène-collectionneuse dans la réalité moderne, vêtue comme une first Lady américaine à la Nancy Reagan ou comme une riche collectionneuse coureuse de galeries.
La question sous-jacente, qui sous tend le travail de Kratzer est « peut-on figurer la guerre ? » . Le peintre ne cesse de voir son effort pour représenter une possible réconciliation contrecarré par ses propres personnages pris dans l’écheveau des événements historiques. Il y a de très beaux moments, très réussis notamment lorsque le peintre en habits d’aujourd’hui essaie de faire tomber la tension mais se trouve dépassé par la violence des foules. Ainsi Kratzer pose-t-il la question : tout est-il figurable par l’art ? mais en même temps il pose la question très actuelle des engrenages de la violence, et notamment de la violence religieuse, des conflits individuels, des luttes inexpiables de clans (que Shakespeare avait déjà traité dans Roméo et Juliette) marqués ici par les catholiques en rouge et les protestants en noir, et Tobias Kratzer joue de manière assez virtuose sur ces va- et-vient, sur les références historiques et littéraires

(entrée de Marguerite de Valois sur son cheval), sur la violence religieuse et l’intolérance, mais aussi sur la crise artistique, sur le conformisme artistique bloqué devant l’hyperviolence et contraint à la fuite en avant. Dans un ordre différent, c’est une thématique voisine de ce qu’avait créé Katharina Wagner pour les Meistersinger à Bayreuth, ou, de manière plus pâle, Carsen dans le Tannhäuser de Bastille.
Ce qui est passionnant, c’est que ce travail est sans doute une mise en abyme de son propre travail de metteur en scène et de sa recherche pour représenter Les Huguenots. Pendant trois heures trente minutes (45 minutes de coupures qui ne nuisent pas du tout au flux musical et à l’action, contrairement au Rienzi de Berlin déchiqueté malgré la belle mise en scène de Philip Stolzl) Kratzer essaie de répondre à cette simple question: peut-on représenter Les Huguenots aujourd’hui ? Au travers de ce peintre, il évoque ses propres hésitations de metteur en scène, sa propre approche, ses propres va et vient et au fond nous parle de théâtre et de représentation théâtrale, de réalité et illusion, d’être et d’apparence : et l’illusion théâtrale fonctionne, puisque peu à peu l’histoire envahit l’atelier, et qu’il n’y presque plus d’art ou de peinture mais la réalité du récit qui prend corps, dans la représentation qui devient alors réalité .

À la fin Nevers meurt, tué par les catholiques, et il semble n’y avoir plus de peintre ni de peinture: l’art est mort, comme à l’acte III du Parsifal bayreuthien de Schlingensief, tué par le mal absolu de la violence. Le peintre est mort, ayant tout détruit dans son atelier, dévoré par ses modèles, victime du massacre des protestants et du massacre de tout art. Désespéré par le manque d’inspiration, par l’impossibilité de créer un choc esthétique qui puisse rendre une guerre, le peintre a tout jeté, tout détruit y compris les membres disloqués de sculptures entreposés au fond de l’atelier et qui ne sont pas loin de rappeler massacres et corps mutilés, et il a tout recouvert d’une toile de plastique transparent dans laquelle on se prend les pieds, dans laquelle on risque à tout moment de tomber et sur laquelle gisent les quelques objets restant, seaux ou pinceaux. Il jette alors sur cette toile qui ressemble à de l’eau ruisselante, des seaux de peinture rouge: on pense alors à Agrippa d’Aubigné évoquant la Seine rougie du sang des morts de la Saint Barthélémy dans Les Tragiques.
Lorsqu’il se relèvera au final, revenu à la réalité, lorsqu’Urbain annonce l’arrivée de Marguerite, c’est la mécène stupéfaite qui apparaît et le peintre qui lui brandit le seul tableau possible : une toile blanche recouverte d’une immense tache de peinture couleur de sang : l’artiste ne pouvait pas figurer le massacre, infigurable, et c’est l’abstraction qui s’impose: du même coup il a trouvé l’inspiration, il s’est renouvelé, il a trouvé son style, plus de conformisme, plus de figuratif, plus de grands formats compassés, mais un art nouveau, né – et c’est ambigu- de la violence du monde . Le peintre a fait son Guernica.
Kratzer a soigné tout particulièrement les mouvements et la direction d’acteurs : le peintre est Nevers (Martin Berner), particulièrement engagé et émouvant, sacrifiant d’un côté sa fiancée et la laissant à Raoul, s’engageant à ses côtés au nom de son honneur et au nom de la paix ; mais il est aussi d’un autre côté un peintre envahi de montées d’images impossibles à représenter, le sujet lui échappant à chaque fois par son indicible violence. La Valentine de Hrachuhí Bassénz est aussi très engagée, ainsi que le Marcel de Jochen Kupfer. Les qualités d’acteur de Uwe Stickert en Raoul sont moins évidentes que sa voix. Ainsi la mise en scène apparaît très élaborée au niveau du concept, tissant des éléments très divers entre eux, avec par ailleurs une vraie cohérence: le passage du « réel » au « figuré » s’effectue de manière toujours fluide, avec de très beaux moments, très bien construits, entrée de Marguerite sur son cheval, invasion des Gargouilles, mais aussi la mort de Marcel, Valentine et Raoul se tenant presque triomphalement par la main. Tout cela montre un travail maîtrisé, remarquablement calibré, sur art et histoire, art contre histoire, art dans l’histoire et sur le rôle de l’artiste dans le monde.

Ce travail d’un indiscutable intérêt s’accompagne d’une réalisation musicale de niveau très enviable.
L’orchestre (la Staatsphilharmonie Nürnberg) a montré une certaine affinité avec ce répertoire, même si le rendu sonore m’est apparu manquant un peu de corps au départ. Le chef (Premier Kapellmeister du Staatstheater) Guido Johannes Rumstadt a su éviter de diriger trop fort (c’est la tentation pour ce type d’œuvre monumentale, notamment dans une salle de dimensions moyennes) et a trouvé un équilibre entre une interprétation trop rossinienne (trop italienne si l’on veut) ou un travail qui tirerait vers Wagner. La partition très ardue au niveau instrumental (le chef Habeneck avait beaucoup bataillé avec Meyerbeer, trouvant la partition impossible) réserve de nombreuses parties fort exposées aux différents pupitres notamment aux bois (clarinette basse utilisée ici pour la première fois, mais aussi basson ou cor anglais) dans lesquelles les membres de l’orchestre se sortent avec tous les honneurs, notamment quand ils accompagnent la basse Jochen Kupfer dans Marcel. C’est que la musique de Meyerbeer prend quelque chose à tous les compositeurs en vogue à l’époque, notamment les italiens (nous avons évoqué Spontini et Rossini) et plonge aussi dans le passé dont elle utilise les formes. La musique chorale évoque quelquefois les chorals de Bach et en tous cas reprend des pièces religieuses, dont le fameux choral de Luther Seigneur rempart et seul soutien (Eine feste Burg ist unser Gott ) un des leitmotiv de l’œuvre, certains autres moments renvoient à Mozart (Don Giovanni). On comprend l’immense succès de Meyerbeer, avec cette habileté à tisser différentes influences entre elles, à construire une sorte de mélange qui n’est jamais du plagiat, mais qui rappelle toujours quelque moment musical connu ou enfoui dans la mémoire. Homme de culture, saisissant parfaitement les tendances du jour, Meyerbeer sentait intuitivement les demandes du public. En très habile faiseur et mais aussi en inventeur de formes nouvelles ou de magnifiques mélodies, notamment pour Raoul (Tu l’as dit…tu m’aimes…au 4ème acte) ou Marguerite (O beau pays de la Touraine), il connaissait les recettes du succès. Et bien des trouvailles de Meyerbeer ont tellement été réutilisées depuis qu’elles passent aujourd’hui pour des banalités.

Dans ce maelström d’influences et de styles, l’interprétation proposée ici reste équilibrée, et même souvent raffinée ; elle défend l’œuvre d’une manière plus qu’honorable, avec un chœur qui prend sa part de la réussite d’un projet qui pouvait au départ paraître hasardeux, vu les dimensions de la salle et de la quantité de masses à réunir. Et il prend une part non indifférente, avec la couleur bel cantiste exigée, mais aussi la vaillance et l’éclat, notamment dans ces splendides ensembles à trois voix du second acte où se mélangent en fait trois chœurs différents. La mise en scène, au total relativement intimiste, au moins confinée dans un seul espace aide d’ailleurs à contenir les effets de masse, sans amenuiser les effets musicaux particulièrement efficaces.
Vocalement, on a dit la difficulté à réunir un plateau dit « à sept étoiles », tant chaque rôle contient des difficultés propres et doit être interprété par des chanteurs de grand niveau. À titre d’exemple, la dernière reprise à la Scala en 1962 réunissait Joan Sutherland, Giulietta Simionato, Fiorenza Cossotto, Giorgio Tozzi, Nicolai Ghiaurov, Franco Corelli et Wladimiro Ganzarolli…
Trois voix féminines se partagent le plateau, la reine Marguerite de Valois, qui n’a pas le plus long rôle, mais sans doute le plus noble, puisqu’elle œuvre pour la réconciliation des catholiques et des protestants et qui chante l’un des airs les plus fameux parmi ces airs impossibles du répertoire romantique, lié pour toujours à Joan Sutherland Ô beau pays de la Touraine : c’est ici Leah Gordon, qui joue à la fois la reine et la mécène du peintre (ou une collectionneuse avisée)dans la mise en scène, très beau personnage à l’américaine, au physique et à la coiffure des années 60, une Peggy Guggenheim qui serait dessinée par Warlikowski.
Par le contrôle vocal, la diction très soignée, le sens des notes filées et d’une voix qu’elle sait alléger au maximum, et surtout par une élégance rare, elle réussit à donner de cet air particulièrement ardu une interprétation de premier ordre qui n’égale peut-être pas la Stupenda mais qui s’en rapproche fortement .

Pour le rôle de Valentine créé par Cornelie Falcon, une voix au timbre sombre intermédiaire entre la soprano et le mezzo, la liste des chanteuses qui l’ont abordé va de Martina Arroyo, lirico spinto à Giulietta Simionato, mezzosoprano. Valentine, c’est ici la jeune soprano arménienne Hrachuhí Bassénz, dans un rôle qui se déploie surtout dans les quatrième et cinquième actes, les plus dramatiques. Hrachuhí Bassénz est un soprano lyrique dont le répertoire va de la Reine de la nuit à Elvira des Puritani en passant par La Bohème. Elle a tout d’une grande ou d’une future grande. Voix ronde et charnue, bel appui sur le souffle, aigus larges et sonores, avec une étendue de deux octaves, contrôle vocal, diction, et tenue impeccable et belle présence qui s’imposent en scène: elle remporte un triomphe mérité, c’est un nom qui fera pour sûr du chemin.
Urbain, c’est la jeune mezzo slovaque Judita Nagyová qui vient de passer de la troupe de Nuremberg à celle de Francfort : une voix puissante, très présente, aux couleurs sombres.
Nevers est interprété par Martin Berner, un baryton au timbre chaud et à la voix sonore, mais qui enthousiasme surtout par la présence scénique et le personnage double qu’il interprète, tantôt Nevers, tantôt le peintre, avec une sensibilité, une jeunesse et un naturel confondants.
Marcel, chanté en juin dernier par une basse, l’est cette saison par un baryton basse, Jochen Kupfer, doué d’un timbre fort séduisant et d’un volume sonore notable, même si la voix demanderait peut-être pour Marcel plus de profondeur. Il reste que la prestation est très honorable et que le français, ici encore est bien dominé.
Belle prestation également de la basse bulgare NicolaI Karnolski dans Saint Bris.
Raoul est le ténor Uwe Strickert, qui n’appartient pas à la troupe.
On connaît la difficulté du rôle, similaire à Arnold de Guillaume Tell ou sinon plus difficile encore: il exige à la fois vaillance et lyrisme, douceur et énergie et d’incroyables aigus, lancés, murmurés, susurrés : seul à mon avis Nicolai Gedda a su en rendre toutes les facettes. Certes, Stricker n’a pas la morbidezza d’un Gedda, il n’a pas aussi la voix aussi ductile. Mais il a une impeccable diction, sans doute la plus limpide de tout le plateau, un timbre clair et sonore, et il a toutes les notes, même s’il ne les tient pas au-delà de l’imaginable comme son illustre prédécesseur. Sans être incomparable, sans être non plus un acteur exceptionnel, il est un Raoul très crédible, pleinement à sa place, vocalement sans scorie aucune, ce qui vu le rôle est tout à fait remarquable.
Les rôles de complément sont tenus très dignement et l’ensemble de la représentation défend cette partition comme rarement on a pu l’entendre récemment.
Et pourtant, c’est dans un théâtre de répertoire, à l’occasion d’une représentation de répertoire donnée par la troupe qu’on peut voir ce spectacle peu ordinaire. Cela ajoute évidemment à ma conviction que seule cette forme d’organisation peut à la fois défendre l’art lyrique et le diffuser. Car c’est une organisation qui garantit une présence sur le territoire et une diffusion capillaire ainsi qu’une qualité soutenue, notamment dans les grandes villes, et qui garantit une vraie cohérence artistique par le travail de troupe au quotidien.
Par chance, ce spectacle est coproduit par l’Opéra de Nice, et le public français aura donc la possibilité de le voir dans le théâtre qui fut jadis un temple du beau chant. Espérons que ces représentations seront programmées bientôt. Et espérons surtout que Les Huguenots reprendront le chemin de Paris qui en fit la gloire et qui paraît scandaleusement l’avoir oublié.
En tous cas, pour l’instant, c’est à Nuremberg qu’il faut aller jusqu’au 15 novembre pour écouter cette représentation vraiment digne de Maîtres Chanteurs…[wpsr_facebook]

