
Après un Festival difficilement oubliable, la programmation « ordinaire » reprend à l’Opéra de Lyon, qui vient de recevoir l’Opera Award de la meilleure maison d’Opéra de l’année (au monde), un prix parfaitement mérité qui avait déjà été frôlé auparavant. Nous y reviendrons.
Cette production d’Alceste est d’abord une production des fidélités : elle voit le retour d’Alex Ollé de la Fura dels Baus à la mise en scène (sa dernière mise en scène était celle du Fliegende Holländer l’automne 2014 qu’on vient de revoir à Madrid et à Lille) et de Stefano Montanari sur le podium, qui prend la direction de la nouvelle formation baroque de l’Opéra de Lyon, I Bollenti Spiriti (sur le modèle de La Scintilla, la formation baroque de l’opéra de Zurich) promesse d’un opéra baroque par an avec un orchestre sur instruments anciens. Un degré de plus dans l’approfondissement d’une politique qui mise sur la qualité et la singularité. Dans une France lyrique où le répertoire baroque est l’un des mieux servi en Europe, cette initiative significative est à saluer.
Alex Ollé, qui dirige avec Carlus Pedrissa le collectif La Fura dels Baus, est le plus « sage » des deux. Mais cette fois-ci son option scénique est radicale. Il pose la question du sens de l’œuvre aujourd’hui, débarrassée de son aura mythologique et transforme la tragédie lyrique en une sorte de drame bourgeois (costumes de Josep Abril) d’aujourd’hui dans un manoir lambrissé. Aux motivations mythologiques de haute tenue, il substitue une chaîne de causalité toute humaine : les suites d’un accident de voiture où l’épouse se sent coupable devant le mari dans le coma. Ainsi le spectacle commence-t-il par une vidéo où le couple par en vacances : bagages chargés par le majordome, puis la BMW (immatriculée en Espagne) part, mais une discussion du couple vise à l’aigre et à une franche engueulade, au moment d’allumer l’autoradio, la musique part dans la fosse, et la voiture se retourne.
Le rideau se lève alors sur une vaste salle où une chambre stérile abrite Admète dans le coma, pendant que la famille semble attendre l’issue fatale.
La vidéo n’a pas d’autre usage, peut-être agaçant, que d’imposer la vision pragmatique de l’explication des causes de la situation, qu’elle inscrit dans un modernisme un peu caricatural. Imaginer une causalité aussi banale par rapport au mythe originel sur lequel s’appuie la tragédie lyrique de Gluck, mais aussi par rapport au genre de la tragédie lyrique détermine aussi des choix scéniques qui atténuent peut-être sa force, ainsi par exemple de la disparition du chœur, placé en fosse, et réapparaissant sur scène d’une manière fantomatique (ou fantasmatique) dans la deuxième partie.
Il y a en effet dans cette mise en scène une notable différence entre la première partie (actes I et II), qui se passe dans la salle de réception d’un riche manoir, et qui s’achève par le suicide d’Alceste qui se défenestre, et la seconde (acte III), qui semble être la copie de la première, mais au lieu d ‘Admète, c’est Alceste qui gît sur le lit de la chambre stérile et qui va fantasmer sa guérison et une fin heureuse.
Alex Ollé, en « laïcisant » le mythe cherche des motivations, et celle qui fait du sentiment de culpabilité d’Alceste le moteur de sa décision enlève tout héroïsme « gratuit » à son geste. Chez Gluck, et dans le mythe, la grandeur héroïque du personnage vient de son amour, seul moteur qui la fait agir et du même coup elle meurt pour laisser son mari vivre, simplement. Dans la version d’Ollé, elle se suicide pour réparer, pour effacer sa culpabilité et le remords. On passe du mythologique au psychologique, même si le livret résiste : il reste les exigences de l’oracle, le sacrifice annoncé d’Alceste à son mari, éléments que la transformation en drame familial ne réussit pas à effacer. Dans le monde sans dieu(x)des hommes, Alceste n’a plus comme solution que le suicide.

Certes, l’une des scènes les plus réussies de la soirée est la prière à Apollon, vue comme une scène de spiritisme éclairée à la flamme avec le Grand Prêtre impressionnant d’Alexandre Duhamel, le plus convaincant de la représentation où Karine Deshayes souffrante a dû laisser la place à Heather Newhouse pour la moitié de l’opéra.
Il y a toujours risque à déranger un livret, même s’il y a des transpositions qui font sens, parce qu’elles en éclairent les possibles. En revanche, je ne trouve pas de justification puissante à cette opération. Alex Ollé affirme qu’il faut rendre crédible les « mécanismes psychologiques » des personnages dans l’interview insérée dans le programme. Mais la mythologie est à l’opposé de tout mécanisme psychologique et le personnage mythique n’a pas la psychologie d’un mortel, puisque le mythe est au contraire ce qui peut sous tendre et expliquer la psychologie: Œdipe en est un clair exemple. En disant « complexe d’Œdipe » Freud s’appuie sur un mythe pour éclairer les méandres d’une psychè anonyme.
Au-delà, je ne partage pas la vue d’Alex Ollé dans son effort à donner une psychologie à des personnages qui dans le mythe se définissent par des actes qui vont faire école ou modèle, mais sur lesquels toute explication quelle qu’elle soit en diminue la portée.
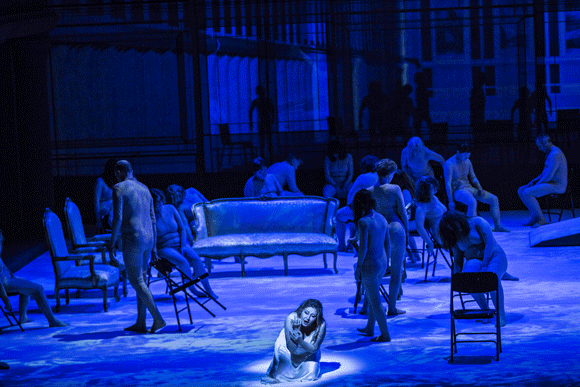
C’est d’autant plus clair qu’Ollé dans sa deuxième partie revient au mythe, revient aux visions, revient à l’irrationnel, avec des éclairages somptueux (Marco Filibeck), avec des vidéos très bien faites (Franc Aleu), avec des chœurs cette fois présents en scène, qui évoquent les délires d’Alceste, dont le visage sous masque à oxygène apparaît en surimpression. Ainsi retourne-t-on aussi au film qui raconte la fin heureuse, la famille réunie, mais qui se délite aussitôt sous nos yeux, alors que la musique reprend l’ouverture de l’opéra et qu’on voit le cercueil d’Alceste décédée. Il est d’ailleurs notable que les scènes esthétiquement les plus réussies sont celles où l’irrationnel est évoqué.
Peut-être aussi Ollé considère-t-il qu’à Karine Deshayes convient un personnage de « mère bourgeoise » qu’à celle d’héroïne mythologique.

Notons enfin des jeux subtils sur le décor imposant (d’Alfons Flores) entre la Cène de Léonard représentée au mur, et ce repas familial où Admète fête sa guérison pendant qu’Alceste essaie de dissimuler le choix qu’elle a fait de périr. Par ce dialogue entre scène de repas et image de la Cène, bien sûr Ollé nous invite à assimiler le sacrifice d’Alceste à une décision christique, se sacrifier pour sauver le prochain ; le sacrifice de l’un pour l’amour de l’humanité et de l’autre pour l’amour de son mari ainsi mis en dialogue soulignent l’universelle grandeur des sacrifices, tandis que la réponse un peu larmoyante et maladroite d’Admète le range immédiatement hors des grandes âmes et presque hors du jeu, désormais entre Alceste et elle-même.
Au service de ce travail et très clair à défaut d’être convaincant, très didactique, une distribution de classe, et de bon niveau, sans jamais atteindre au sublime.
Karine Deshayes, souffrante, a été remplacée le 8 mai par Heather Newhouse pendant l’essentiel de la première partie, qui chantait en scène côté jardin pendant que Karine Deshayes mimait le rôle. Solution hybride désormais traditionnelle, depuis qu’un certain Patrice Chéreau l’inaugura à Bayreuth en 1977 dans Siegfried.
Heather Newhouse, voix claire, assez précise, avec un petit défaut de diction, sauve la représentation, la voix ne réussit pas toujours à s’imposer, manque un peu de corps pour un rôle qui exige une assise vocale large mais la représentation garde incontestablement sa tenue musicale et l’ensemble de sa prestation est honorable. Quand Karine Deshayes prend le relais à partir de son air du 2ème acte « Dérobez-moi vos pleurs, cessez de m’attendrir », la représentation se cristallise : la voix a du corps, de la chair, avec une belle diction. Les aigus passent peut-être mieux que certains graves. Le personnage ne s’incarne pas en une héroïne mythique, mais en une femme d’incontestable dignité. Certains seront peut-être déçus, mais l’Alceste de Karine Deshayes est en ce sens exactement le personnage voulu par la mise en scène, démythifiée, et profondément humaine.
Julien Behr en Admète est doué d’une grande élégance de chant qui sait travailler les nuances, d’une voix suave, lyrique, d’un timbre très séduisant, d’une très belle diction, mais qui manque un peu du volume nécessaire surtout à l’aigu, un peu serré, et du coup le personnage d’Admète perd en corps. Mais là encore, cela sert d’une certaine manière le propos scénique. On l’a dit, Admète est l’un de ces personnages mythiques qui pâlissent à l’ombre des héroïnes qu’ils côtoient.
Grandiose en revanche le Grand Prêtre d’Alexandre Duhamel, une voix qui a du corps, de la puissance, un aigu triomphant et une belle présence. C’est lui dont la prestation vocale domine la représentation. On savait qu’il était un bel espoir du chant français, on en a la confirmation.

Les autres ne déméritent pas, à commencer par le Coryphée de Maki Nakamishi, membre du chœur de l’Opéra au chant très contrôlé, et très appliqué et en même temps très présent, Tomislav Lavoie en Apollon (et en héraut), voix sonore et beau timbre de basse, Florian Cafiero, en Evandre à la jolie voix claire, stylée et bien contrôlée de ténor.
Hercule est Thibault de Damas, baryton issu du studio de l’Opéra de Lyon (dont il était membre jusqu’à 2016). La mise en scène lui donne une allure un peu chaloupée, dégingandée, qui est souvent le sort d’Hercule dans cet opéra, comme un Superman qui passe par là. Rien de Superman ici, mais celui d’un ami de la famille un peu à part pour ne pas dire particulier en version christique-cheap (un écho humain au tableau de la Cène qui domine le salon ?). La diction est assez claire et le volume vocal lui donne une présence certaine, mais avec un problème de style dont on se demande s’il est intrinsèque ou dû aux exigences d’une mise en scène qui veut désacraliser les présences mythologiques.
Le chœur (direction Philip White) dont on a déploré la présence en fosse pendant la première partie alors que son rôle est essentiel, est vraiment remarquable ; d’ailleurs, les artistes du chœur qui ont des rôles de complément s’en sortent avec les honneurs, on a cité plus haut Maki Nakamishi, on pourrait citer Paolo Stupenengo en oracle.

Enfin Stefano Montanari est peut-être à la tête de la formation « I bollenti Spiriti », la nouvelle formation baroque de l’opéra de Lyon, le plus convaincant, avec son énergie coutumière, l’incontestable style qu’il imprime, et qui convient si bien à l’acoustique de la salle, avec un orchestre vigoureux, et qui malgré quelques approximations (dans les cuivres) emporte l’adhésion par sa présence, son sens dramatique dans une œuvre à la dramaturgie en devenir, et laisse bien augurer des productions futures.
Après les fastes du Festival, cette production reste de belle tenue, même avec un parti pris qui ne m’a pas convaincu – mais Gluck est très difficile à mettre en scène aujourd’hui (malgré le magnifique Orphée et Eurydice de David Marton dans cette salle). Sa distribution entièrement française et le chœur s’en sortent avec tous les honneurs mais c’est l’orchestre « naissant » qui a vraiment imprimé à l’ensemble sa (et ses) couleurs.
La vitalité de l’Opéra de Lyon et l’inventivité de son directeur, la qualité de l’ensemble des personnels lui ont valu l’Opera Award de Meilleur opéra de l’année (au monde) : c’est amplement mérité, et montre l’excellence et l’engagement des équipes. On espère d’autant plus que les remous actuels relayés par la presse ne soient que passagers, car arriver à une telle régularité dans l’excellence demande évidemment les efforts de tous, mais exige aussi une cohésion absolue. Onore onere disent les italiens.[wpsr_facebook]

