
L’Opéra National du Rhin vient de traverser une période difficile avec la maladie et la disparition de sa directrice Eva Kleinitz, véritable traumatisme pour une maison où elle avait très vite su s’imposer par sa compétence et son charisme. En charge depuis 2017, elle avait en très peu de temps donné une couleur nouvelle à cette institution, l’un des tout premiers opéras en France par le prestige et surtout la qualité constante.
Cette couleur était celle de l’ouverture vers l’extérieur avec le Festival ArsMondo, mais aussi l’appel à des artistes jeunes, souvent peu connus, mais toujours dignes d’intérêt, et notamment à des metteurs en scène de la toute nouvelle génération. Sa longue expérience à Stuttgart, l’une des maisons les plus inventives outre-Rhin lui avait permis de gagner la confiance et l’estime de toute la profession. Enlevée à 47 ans au monde, elle a laissé un théâtre orphelin de son sourire, de son ouverture, de sa capacité à fédérer. Grâce à Bertrand Rossi, aujourd’hui directeur de l’Opéra de Nice, qui a assuré l’intérim, la continuité productive a été assurée, et il a su pendant la période très difficile traversée maintenir la cohésion de la maison et garantir que « the show must go on ».
Cette triste parenthèse est close avec la nomination à la tête de l’institution d’Alain Perroux, en charge depuis janvier 2020, bien connu du monde de l’Opéra, de Genève à Aix-en-Provence, un des meilleurs connaisseurs du monde lyrique d’aujourd’hui qu’on croise souvent dans les théâtres d’Europe à l’affût de nouveaux profils ou de spectacles notables.
Lui aussi, à peine nommé, prend les rênes de la maison et doit gérer les conséquences du confinement, et de la fermeture des institutions culturelles à cause de l’épidémie de Covid-19.
Et on le sait, les conditions de réouverture des salles restent brumeuses, même si en théorie théâtres et cinémas pourront rouvrir en ce mois de juin.
Déjà le MET de New York a fait glisser son ouverture de saison au 31 décembre 2020, et Lyon a déplacé sa première production (Le Coq d’Or) de septembre 2020 à mai 2021. L’Opéra de Paris verra son premier trimestre bouleversé et la production du Ring sans doute reportée, d’autres théâtres attendent prudemment avant d’annoncer la couleur.
Dans ces conditions plutôt incertaines, les annonces de saison ont au moins la valeur apotropaïque de faire reculer le mauvais sort et d’annoncer qu’on est prêt pour un futur. Mais les maisons, les artistes, les techniciens et employés restent bien seuls face à cette adversité.
La saison 2020-2021 a encore été préparée par Eva Kleinitz et Bertrand Rossi, et Alain Perroux prépare 2021-2022 qu’on espère « normale » – l’appel à la simple normalité en ces temps troublés constitue en fait le plus grand des espoirs.
L’espoir ici est déjà que 2020-2021 se déroule sans accrocs, ce qui est loin d’être acquis, il est réconfortant quand même d’afficher la saison « telle qu’elle devrait être ».
Par sa situation, l’Opéra National du Rhin situé dans une cité internationale siège du parlement européen, est assez proche de salles allemandes prestigieuses : Karlsruhe, Baden-Baden, Fribourg, voire Bâle en Suisse, un théâtre très particulier et très moderniste, proche de Mulhouse où se donnent aussi des représentations de l’Opéra du Rhin.
Face à cette concurrence diversifiée (Karlsruhe est un théâtre de troupe, tout comme Fribourg, et Baden-Baden est une scène de Festival qui accueille les plus célèbres artistes du moment), Strasbourg doit être différent : théâtre de stagione à la française, mais répertoire diversifié pour attirer un public international dans des esthétiques elles aussi diversifiées, dans une salle à la capacité relativement limitée (1100 places, comme Lyon), avec l’obligation de se partager entre Strasbourg Colmar (pour quelques soirées) et Mulhouse (où les représentations sont données à La Filature), et avec des productions qui doivent s’adapter aux autres salles. Bref, des obligations techniques, géographiques, logistiques qui complexifient la situation.
—
Le motto mis en valeur sur la couverture du programme annuel est « Il entend les pensées des passants. » didascalie correspondant au Ballet “Les ailes du désir” présenté dans la saison.
En réalité, comme l’écrit Alain Perroux, la thématique développée dans la saison pose la question de l’amour, dans ses aspects asymétriques : amour non correspondu, trahison, magie, tout ce qui fait de la relation amoureuse un espace de dangers, de risques, de déceptions, de drames.
Du point de vue lyrique, 7 productions, alternant des titres du grand répertoire et d’autres moins fréquents ou contemporains
- Solveig (L’attente)
- Samson et Dalila
- Hänsel und Gretel
- La Mort à Venise
- Hémon
- Alcina
- Madama ButterflyOpéras jeune public :
- Gretel und Hänsel
- Cenerentolina
Opéras
Septembre 2020
Comme toujours, Strasbourg ouvre sa saison par une création en général intégrée dans le Festival Musica, cette fois-ci c’est un titre lié au Peer Gynt d’Henrik Ibsen qui fait l’objet d’un Focus à La Filature, scène nationale de Mulhouse.
Henrik Ibsen/Karl Ove Knausgård, Edvard Grieg,
Solveig (L’attente) (4 repr.) MeS : Calixto Bieito, Dir : Eivind Gullberg Jensen, Conception vidéo, Sarah Derendinger, avec Mari Eriksmoen .
Coproduction Bergen International Festival, Tivoli Copenhagen, Teatro Arriago de Bilbao, Vilnius Festival, Gothenburg Symphony Orchestra, Iceland Symphony Orchestra
Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Nouvelle version de la pièce d’Ibsen (1867) sur la musique d’Edvard Grieg, vue non plus du point de vue de Peer Gynt, mais de Solveig, la jeune femme abandonnée par le héros. L’histoire réécrite par le romancier norvégien Karl Ove Knausgård reste accompagnée de la musique de Grieg. Une expérience passionnante, sur les croisements de regard, sur la question du point de vue, sur l’abandon.
Octobre – Novembre 2020
Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila (5 repr. Strasbourg/2 repr. Mulhouse), MeS : Marie-Eve Signeyrole Dir : Ariane Matiakh avec Massimo Giordano, Katarina Bradić, Jean-Sébastien Bou, Patrick Bolleyre
Orchestre Symphonique de Mulhouse.
Retour d’un classique du répertoire, créé à Weimar en 1877, dans une mise en scène de Marie-Eve Signeyrole, réalisatrice, vidéaste, à laquelle le monde lyrique s’intéresse de plus en plus (elle a notamment signé un Onéguine remarqué à Montpellier et Rouen). C’est Ariane Mathiak, cheffe française qui travaille souvent en Allemagne et en Scandinavie qui va diriger et le rôle de Samson est tenu par Massimo Giordano, qui a beaucoup chanté à Stuttgart et à Lyon (encore très récemment Mario de Tosca), tandis que Dalila sera Katarina Bradić, mezzo solide qui chante un peu partout en Europe. Le Grand-Prêtre sera cahnté par l’excellent Jean-Sébastien Bou. Ne pas manquer ce rendez-vous.
Décembre 2020/Janvier 2021
Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel (6 repr. Strasbourg/2 repr.Mulhouse) MeS : Pierre Emmanuel Rousseau Dir : Marko Letonja avec Anaïk Morel et Lenneke Ruiten, Markus Marquardt, Irmgard Vilsmaier etc…
Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
Œuvre « obligée » pour Noël en territoire germanophone, avec Die Zauberflöte, Strasbourg l’affiche pour les fêtes (manière d’attirer aussi un public allemand en visite au marché de Noël qui s’étend entre autres devant le théâtre sur la place Broglie) avec en complément une version opéra pour enfants (en décembre à Strasbourg et janvier à Colmar et Mulhouse, voir ci-dessous), c’est presque un focus pour la période des fêtes.
L’Orchestre est dirigé par le directeur musical de l’OPS Marko Letonja et la distribution est dominée par l’excellente Anaïk Morel (Hänsel) qu’on voit désormais un peu partout et la Gretel (Lenneke Ruiten) (dont Wanderer a récemment parlé à propos du Lucio Silla bruxellois), autant dire deux garanties de très bon niveau.
Si vous n’avez jamais vu l’opéra de Humperdinck, c’est l’occasion d’un joli week-end à Strasbourg car le niveau musical s’annonce prometteur.
Février-Mars 2021
Benjamin Britten, La Mort à Venise (5 repr. Strasbourg/2 repr.Mulhouse) MeS : Jean-Philippe Clarac et Oliver Delœuil Dir : Jacques Lacombe avec Toby Spênce, Scott Hendricks
Orchestre Symphonique de Mulhouse
La dernière œuvre de Britten, appuyée sur la nouvelle de Thomas Mann (1912), créé en 1973, deux ans après la sortie du film célébrissime de Luchino Visconti (1971). Aschenbach sera Toby Spence, l’un des ténors les plus raffinés de la scène lyrique et l’un des meilleurs spécialistes de Britten aujourd’hui. Face à lui l’excellent Scott Hendricks au répertoire diversifié, remarquable dans Ruprecht de L’Ange de Feu (notamment à Aix) dont on a vu assez récemment le Prus dans l’Affaire Makropoulos à Zurich : chanteur intelligent, habile à colorer la voix et à l’adapter parfaitement à différents personnages (il en joue sept dans La Mort à Venise).
La mise en scène est assurée par Jean-Philippe Clarac et Oliver Delœuil, créateurs d’univers scéniques qui fascinent et qui ont déjà séduit de nombreux théâtres, ils travaillent pour la première fois à Strasbourg, sur une œuvre qui se prête parfaitement à une profusion d’images et la direction musicale est confiée au directeur musical du Symphonique de Mulhouse Jacques Lacombe, qui a fait une bonne partie de sa carrière outre Atlantique et en Allemagne .
La rareté de l’œuvre, les protagonistes scéniques et musicaux et la mise en scène devraient faire de cette production un Must.
Mars-Avril 2021
Zad Moultaka, Hémon (4 repr. Strasbourg/2 repr.Mulhouse) MeS : Zad Moultaka & Gilles Rico, Dir : Bassem Akiki avec Raffaele Pe, Tassis Christoyannis, Judith Fa, Béatrice Uria-Monzon
Dans le cadre d’ArsMondo (Liban)
Orchestre Philharmonique de Strasbourg
Création mondiale
Une création mondiale dans le cadre de ArsMondo/Liban, autour de Hémon, le fiancé d’Antigone, personnage secondaire qui dans la légende se suicide. Construire une œuvre autour de lui est donc en soi une originalité. Le compositeur et plasticien libanais Zad Moutalka et le librettiste Paul Audi proposent une voie nouvelle et fragile pour le mythe célébrissime où se heurtent raison morale et raison d’Etat. Les déchirures libanaises en toile de fond de cette manière de revisiter le mythe devraient ouvrir vers un travail passionnant où le compositeur est en même temps metteur en scène (avec Gilles Nico) , direction par le jeune chef libano-polonais Bassem Akiki, et distribution de haut niveau avec le Hémon du contreténor Raffaele Pe et le Créon du baryton Tassis Christoyannis, l’Antigone de Judith fa et l’Eurydice de Béatrice Uria-Monzon. Nouveaux profils, nouvelle musique venu d’un pays merveilleux mais particulièrement blessé et exsangue dont l’Opéra n’est pas le genre privilégié a priori : stimulation pour public curieux. On peut renaître par la culture.
Mai-Juin 2021
Georg Friedrich Händel, Alcina (5 repr. Strasbourg/1 repr. Colmar/2 repr.Mulhouse), MeS Serena Sinigalia, Dir : Christopher Moulds avec Ana Durlovski, Hélène Guilmette, Diana Haller, Marina Viotti etc…
Orchestre Symphonique de Mulhouse
Coproduction Opéra National de Lorraine et Opéra de Dijon
Pour la fin de saison, la programmation se « range »…En programmant l’Alcina de Händel, pas de grand risque, le titre devenant un des must de l’opéra baroque aujourd’hui. On aurait pu espérer de Strasbourg un titre un peu plus rare, mais il est vrai que les lois de la coproduction doivent composer avec les désirs des autres structures. Cette nième Alcina est confiée à la baguette experte de Christopher Moulds, l’un des chefs qu’on voit désormais fréquemment dans les fosses baroques et à la mise en scène de Serena Sinigaglia, l’un des noms qui montent en Italie aujourd’hui, qui travaille de manière astucieuse quelquefois et toujours classique. On ne devrait pas être trop décoiffé…
Dans la distribution, Ana Durlovski, récente Marguerite de Valois des Huguenots genevois, solide soprano, et Hélène Guilmette, Morgane, ainsi que la très bonne Marina Viotti dans Bradamante…
Juin-Juillet 2021
Giacomo Puccini, Madame Butterfly (5 repr. Strasbourg/2 repr.Mulhouse), MeS Mariano Pensotti, Dir : Giuliano Carella avec Brigitta Kele, Leonardo Capalbo, Tassis Christoyannis, Marie Karall etc…
Orchestre Philharmonique de Strasbourg
La production est confiée à la baguette consommée de Giuliano Carella, une garantie de sécurité autoroutière et à la mise en scène de l’argentin Mariano Pensotti , qui est l’un des metteurs en scène les plus reconnus d’Amérique latine, notamment pour des productions des années allant de 2011 à 2016. Il présenta un spectacle à Avignon 2015. L’excellent Leonardo Capalbo en Pinkerton fera face à la Butterfly de Brigitta Kele, un soprano de bonne facture.
Opéras pour enfants
A priori je me méfie des opéras jeune-public, les seuls qui m’aient convaincu étant les Wagner très réussis réalisés à Bayreuth et qui mériteraient d’être exportés.
Mais ici, les titres sont des adaptations de titres du répertoire d’opéra (et non des œuvres originales inventées pour jeune public) et méritent l’intérêt, car la priorité est d’introduire introduire les très jeunes au répertoire. Il y a trop de chose médiocres sur le marché.
Décembre 2020/Janvier 2021
Engelbert Humperdinck, Gretel et Hänsel (3 repr. à Strasbourg, 1 repr. à Colmar, 2 repr. à Mulhouse) MeS Jean-Philippe Delavault, Dir : Vincent Monteil avec des artistes de l’Opéra Studio.
On peut se demander pourquoi une adaptation « jeune public » d’Hänsel und Gretel, un titre qui lorsqu’il est proposé, attire les familles et beaucoup d’enfants (encore récemment à la Scala). C’est sans doute à la fois une manière de faire chanter les jeunes du studio, mais aussi la Maîtrise du Conservatoire de Strasbourg et l’Ensemble Orchestral de l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg tout en proposant une production de jeunes sans trop de risque. C’est enfin créer des petits formats permettant des représentations scolaires d’une durée plus conforme aux capacités d’attention des jeunes. Compréhensible, mais un peu regrettable.
Le chef Vincent Monteil qui dirigera la production est directeur musical de l’Opéra-Studio.
Tout de même, ne serait-il pas plus hardi de confronter les jeunes artistes en formation à un titre du répertoire comme on le fait souvent ailleurs (encore début février à Berlin avec Suor Angelica de Puccini, il est vrai avec Kirill Petrenko) et leur réserver une production de la saison ? Il serait sans doute plus formateur de confronter des jeunes artistes et musiciens aux conditions réelles de la représentation du grand répertoire et au public “ordinaire” de l’opéra.
Avril-Mai 2021
Gioachino Rossini, Cenerentolina (3 repr. Mulhouse/2 repr. Colmar/4 repr. Strasbourg) MeS Sandra Pocceschi et Giacomo Strada avec des artistes de l’Opéra Studio.
Production du Grand Théâtre de Genève
Délicieux spectacle très agile parfaitement adapté à tourner dans d’autres villes et dans des salles à effectif réduit. Il me semble qu’Alain Perroux aura peut-être à créer un petit Opéra itinérant avec des travaux de ce type, nécessitant une logistique légère et permettant d’aller à la rencontre du public dit éloigné avec de la qualité.
Récitals
Un vrai programme de récitals, avec des noms enviables, des programmes variés, et les dimensions de la salle conviennent parfaitement à cette forme intime qui est en train d’être un peu négligée en France.
C’est un programme bien articulé, qui excite l’intérêt avec six chanteurs très différents, et tous excellents dans leur ordre.
- Pavol Breslik est l’un des ténors les plus aimés du public, d’une rare intelligence des textes; il propose un programme typiquement austro-hongrois avec des auteurs tchèques (Dvořák), slovaque (Schneider–Trnavský), autrichien (Schubert) et hongrois (Liszt).
- Eva Maria-Westbroek reste, malgré quelques passages à vide, l’un des sopranos dramatiques de référence aujourd’hui, dans un programme très ibérisant.
- Karine Deshayes, accompagnée du pianiste Philippe Cassard qu’on ne présente plus et du clarinettiste Philippe Berrod, première clarinette solo de l’Orchestre de Paris (mais pas que, c’est un des clarinettistes les plus demandés au monde) propose un programme franco-allemand qui promet d’être passionnant.
- Joyce El-Khoury apportera le Liban à Strasbourg dans une soirée qui excite la curiosité, par son originalité et sa variété.
- Matthias Goerne, l’un des grands spécialistes mondiaux du Lied, propose un voyage de Wolf à Strauss en passant par Wagner.
- Enfin Mark Padmore, le ténor des Passions de Bach, mais aussi de George Benjamin, ou de Britten ou du Winterreise de Schubert, proposera un programme Schubert Schumann pour lequel il sera accompagné par rien moins que Till Fellner.
Avec un tel programme, le public alsacien (et pas seulement) devrait se précipiter.
21 octobre 2020
Pavol Breslik, ténor
Piano, Amir Katz
Antonín Dvořák
Franz Schubert
Franz Liszt
Mikuláš Schneider–Trnavský
15 janvier 2021
Eva-Maria Westbroek, soprano
Piano, Julius Drake
Samuel Barber
Kurt Weill
Joaquin Turina
Jesús Guridi
Carlos Guastavino
17 février 2021
Karine Deshayes, mezzosoprano
Piano, Philippe Cassard
Clarinette, Philippe Berrod
Ludwig Spohr
Franz Schubert
Maurice Ravel
Henri Duparc
26 mars 2021
Joyce El-Khoury, soprano
Piano, Serouj Kradjian
Voyage musical en terre libanaise dans le cadre d’ArsMondo (Liban)
28 mai 2021
Matthias Goerne, baryton
Piano, Alexander Schmalcz
Hugo Wolf
Hans Pfitzner
Richard Wagner
Richard Strauss
23 juin 2021
Mark Padmore, ténor
Piano, Till Fellner
Robert Schumann
Franz Schubert
Il reste à espérer que la saison puisse se dérouler sous les auspices qui permettent à cette excellente maison d’opéra de retrouver un regard assuré vers l’avenir. Nous souhaitons bonne chance à Alain Perroux.



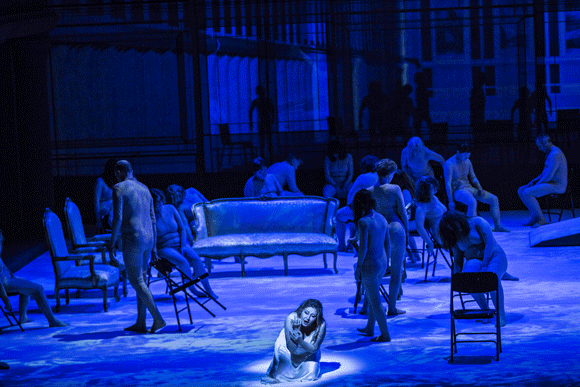




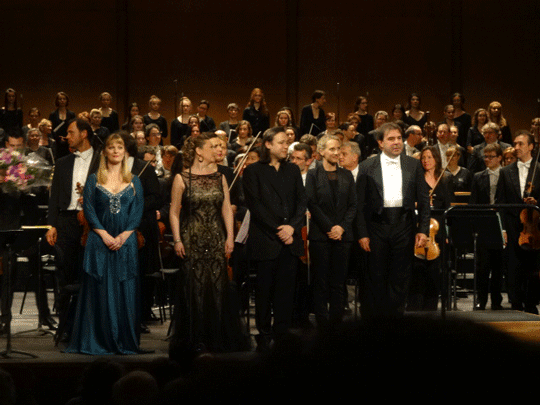
 © Michel Cavalca, Photos du site de l’opéra de Lyon
© Michel Cavalca, Photos du site de l’opéra de Lyon © Michel Cavalca,
© Michel Cavalca, © Michel Cavalca,
© Michel Cavalca, © Michel Cavalca,
© Michel Cavalca,