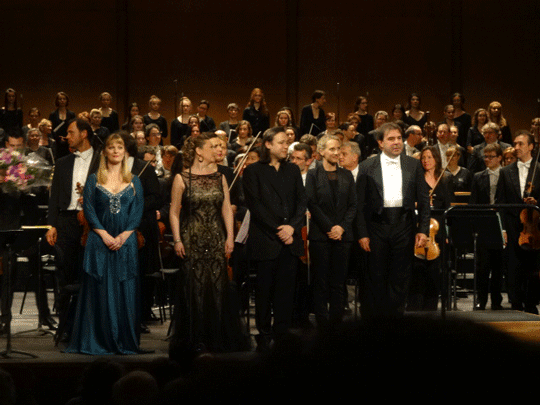
Cycle Shakespeare avec l’Orchestre National de France
Franz Liszt Hamlet op.10
Richard Strauss Macbeth op.23
Felix Mendelssohn Le Songe d’une nuit d’été op.21/op.61
L’Orchestre National de France s’est mis sous le signe de Shakespeare puisque ce cycle se conclura par les représentations de Macbeth de Verdi au TCE.
Cette soirée marquait un retour à la normale après le mois troublé de Radio France et les concerts annulés « pour cause de Vigipirate » . Ce qu’il faut espérer, en restant dans la veine shakespearienne, c’est que tout ce mouvement ne se termine pas en « Much ado about nothing » ni en « The Comedy of Errors », mais bien plutôt en « All’s Well that Ends Well » .
Et ce programme shakespearien proposait deux œuvres peu jouées, Hamlet est pour un Liszt déjà mûr son quatrième poème symphonique, mais Macbeth est le premier pour Strauss qui a connu moindre fortune que le quasi contemporain Don Juan. Quant au Songe d’une nuit d’été, l’ouverture (op.21) est composée par un Mendelssohn de 17 ans (et créée à Szczecin un an plus tard), même s’il la complète à la demande du Roi de Prusse 17 ans plus tard (il n’a encore que 34 ans) pour une création au Neues Schloss de Potsdam.
La redécouverte des drames de Shakespeare dans la deuxième partie du XVIIIème et au début du XIXème est suivie d’un tel engouement qu’il serait sans doute fastidieux d’établir une liste des œuvres musicales qu’elles ont inspirées, à l’opéra ou au concert pendant le 19ème siècle et les œuvres adaptées de Shakespeare le sont souvent avec bonheur, ce qui nous vaut à la fois des opéras et des pièces symphoniques qui sont chacun des chefs d’œuvre. On a vu récemment avec Le Cid que ce n’est pas toujours le cas d’autres auteurs.
C’est donc un programme à la fois intelligent et stimulant qui était proposé ici, et que l’on peut encore voir en streaming sur concert.arte.tv et francemusique.tv.
Stimulant parce que, si Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn est fréquent dans les programme, il l’est moins dans sa version mixte texte et musique, et que les deux autres poèmes symphoniques restent de très grandes raretés.
La première partie constitue pour moi une surprise. Et notamment l’Hamlet de Liszt. Je n’avais jamais entendu cette pièce d’une quinzaine de minutes et même si on sait l’intérêt que portait Liszt aux formes de musique nouvelle (il fera de Weimar un des ferments de la diffusion de la nouvelle musique en Europe), on est surpris à l’audition de découvrir une œuvre qui projette entièrement vers l’avenir, qui va vers Mahler ou vers le premier XXème siècle, tant par la couleur et par certains aspects techniques que par la construction ou même la brièveté. C’est un défi que de concentrer en quinze minutes une pièce de plusieurs heures à la dramaturgie complexe. Liszt en fait une sorte de parabole, élaborant avec une certaine clarté un parcours qui reprend de manière très claire les nœuds dramaturgiques, en séparant chaque moment par de longs silence, par des ruptures de ton, de style, de rythme. Cette approche est très moderne au sens où elle ne raconte pas une histoire qui avancerait comme un récit mais au sens où elle montre une structure, presque cyclique ou circulaire et où elle devient exposition et non parcours.
Il faut saluer ici la performance des musiciens du National, très en forme, très concentrés, avec des cordes qui ont l’essentiel des initiatives dans cette pièce qui joue souvent sur les différents pupitres de cordes, et l’oeuvre convient parfaitement à Daniele Gatti par son regard vers le premier XXème siècle qu’il affectionne. Si ce poème est répété à Weimar en public en 1858, il est créé en 1876, à une époque où tout bascule, Mahler n’a que 16 ans, il écrira quatre ans plus tard Das klagende Lied, son premier opus, Tchaïkovski arrive à maturité et assiste cette année là au Ring de Wagner dans le théâtre tout neuf de Bayreuth. Je cite volontairement Wagner, Tchaïkovski et Mahler parce que certains moments de cet Hamlet m’ont évoqué des phrases mahlériennes, et parce que la toute fin m’évoque le Tchaïkovski noir de la pathétique (il a d’ailleurs écrit lui aussi un Hamlet…), quant à Wagner et Liszt…
Gatti dirige cette musique comme de la musique de l’avenir accentuant volontairement les ruptures, avec de longs silences, refusant tout pathos et tout sentimentalisme, créant ainsi une tension en laissant la musique dans toute sa crudité, tension palpable dans les premières mesures du dialogue bois et cordes. Même dans les moments plus vifs, il évite l’éclat gratuit pour accentuer ensuite la concentration, avec des répétitions de motifs (Liszt voulait montrer comment les ressorts psychologiques jouaient sur les ressorts dramaturgiques), avec des moments vraiment réussis comme le dialogue entre violon solo et flûte, tout de retenue et de raffinement ou les accords entrecoupés de silence, des phrases comme tronquées, ou suspendues, et un final qui me renvoie au Tchaîkovski de la Pathétique, au Mahler de la 6ème voire à quelque chose de Parsifal. Daniele Gatti exalte ces aspects en essayant de construire des ponts, qui projettent et relient cette musique surprenant avec tout le post romantisme, voire le début du XXème siècle. Surprenant et stimulant, en tout cas passionnant.
Du coup, le Macbeth de Richard Strauss apparaît presque en retrait, même s’il est écrit une trentaine d ‘années après, et en tous cas, peut-être plus riche en technique d’orchestration, mais plus pauvre en inspiration. Macbeth, un des drames les plus noirs de Shakespeare, n’a pas ici cette noirceur, du moins au départ. Au contraire, là où chez Liszt il n’y avait aucun éclat, aucun brillant, ici, malgré le sujet, Strauss privilégie un certain brillant. Ce n’est pas pour moi un des chefs d’œuvre de Strauss que ce Macbeth, premier poème symphonique d’un jeune compositeur de 22 ans qui s’essaie à la musique à programme. Ce Macbeth sera revu dans les années suivantes, entre autres sur les conseils de Hans von Bülow, prédécesseur de Richard Strauss à Meiningen (un de ces théâtres de grande histoire que tout mélomane se doit d’avoir visité) et ce n’est qu’en octobre 1890 que l’œuvre sera créée et subira encore des modifications dans l’instrumentation jusqu’à sa création dans sa forme définitive en 1892 à Berlin. Alors que la pièce précédente de Liszt m’a séduit par sa brièveté, sa concentration, sa tentative de créer une ambiance sombre et ses ruptures de rythme et de continuité, même si elle n’a pas semblé accrocher le public, celle de Strauss m’est apparue moins riche dans les trouvailles mélodiques et dans la construction, même si sans doute plus susceptible de faire briller l’orchestre et d ‘avoir prise sur le public.
Certes elle possède cette fluidité et cette linéarité que le Liszt ne possède pas, sans doute tout à fait volontairement d’ailleurs. Les thèmes de Macbeth et de son épouse, sont exposés de manière brillante, utilisant l’ensemble de l’orchestre et sollicitant particulièrement les bois et les cuivres. Daniele Gatti réussit à faire sonner l’orchestre de manière à en exalter les qualités : on a tellement entendu ces derniers temps qu’ils étaient pas assez ceci, pas assez cela et donc qu’il fallait les faire fondre, que l’on est ravi qu’ils montrent avec orgueil ce qu’ils sont et ce qu’ils sont capables de faire ; Gatti, toujours très exigeant avec les formations qu’il dirige, les pousse et amène les cordes à démontrer de spectaculaires qualités de dynamique avec un son plutôt charnu soutenu notamment par de très belles contrebasses. Il en résulte une lecture miroitante, raffinée qui révèle les qualités de la construction du tissu orchestral, pour une partition qui me paraît ne pas réussir néanmoins à dessiner une ambiance qui corresponde vraiment à ce que je sens du drame shakespearien, en faisant plus une aventure épique là où je vois un drame plus intérieur. Mais Gatti s’empare de cette rutilance avec une profondeur qu’on n’imaginait pas dans cette musique un peu démonstrative, il y a notamment dans la dernière partie une générosité, un lyrisme, une puissance émotive que le chef réussit à transmettre grâce à un orchestre qui répond merveilleusement aux sollicitations : malgré la puissance orchestrale, rien de lourd ici, ni de brutal : les interventions du hautbois et des flûtes, puis de la clarinette, particulièrement tendues dans la dernière partie ont été particulièrement réussies, ainsi que celles du cor. Ce qui séduit, c’est à la fois la clarté du rendu de l’orchestre, particulièrement exposé et très en forme, et la volonté du chef de ne pas mettre de distance dans cette musique, de marquer le pathos et la fougue que Strauss a voulu y mettre, aussi bien dans les très nombreux moments tendus, que dans ceux plus rares, de retenue. Certaines passages évoquent aussi des œuvres postérieures (on reconnaît des moments proches de certaines phrases d’Elektra). Gatti travaille à la fois à rendre lisible cette partition grâce à la clarté de la lecture, mais aussi à en exalter les aspects dramatiques et les contrastes, par une constante tension, comme dans les dernières mesures où on lit à la fois un extraordinaire lyrisme où il laisse aller l’orchestre, et mais aussi (enfin!) le drame et l’obscurité . Une interprétation qui montre combien ce répertoire lui est proche.
Le choix de Mendelssohn, et du Sommernachttraum op.21 et op.61 en seconde partie est un choix presque antagoniste, on passe de la noirceur du drame à la comédie fantastique, à la « musique de fées ». D’ailleurs le programme de salle rappelle que Strauss recommandait de diriger Elektra ou Salomé comme du Mendelssohn . Voilà donc Mendelssohn, dans l’une des pièces assez populaires de son œuvre, l’ouverture (op.21) et les musiques de scène (op.61) du Songe d’une Nuit d’été.
Souvent donné en version strictement musicale (c’était ainsi la dernière fois où je l’ai entendue, à Berlin avec Abbado en mai 2013, lors de son dernier concert avec les Berliner Philharmoniker), c’est cette fois en version mêlant texte et musique que l’œuvre est présentée, et c’est une initiative heureuse car relativement rare.
Stéphane Braunschweig s’essayait pour l’occasion pour la première fois à l’art du récitant. Même si la prestation est honorable, on sent bien que ce n’est pas là son métier et quelquefois on eût préféré simplement entendre la musique qui paraissait interrompue quelquefois inutilement. Dans ce texte j’eus bien imaginé en revanche un Roberto Benigni par exemple.
Par rapport à Strauss, la masse orchestrale a été réduite, et l’approche de Mendelssohn est évidemment plus légère, plus aérienne, plus évanescente (Abbado en faisait un léger fil sonore d’une rare fluidité, presque « extatique »). Ici, Gatti alterne cette légèreté diaphane et une vraie présence de l’orchestre, qui n’est pas contradictoire, la pièce elle même de Shakespeare alterne une poésie totalement éthérée et des moments plus terriens, autour de personnages plus vulgaires, et la musique rend cette alternance terre-ciel.
J’ai beaucoup aimé l’ouverture, avec ses phrases que Wagner empruntera pour le troisième acte de Tannhäuser, et sa légèreté initiale, et sa dynamique, mais aussi une belle expressivité à l’orchestre (dialogue magnifique entre cordes et bois). Il n’est pas le seul d ‘ailleurs et l’intervention du soprano notamment la phrase « Newts and blind-worms… » rappelle singulièrement le Humperdinck de Hänsel und Gretel (1893, première dirigée par Richard Strauss…)
Les musiques de scène ont permis donc d’entendre le joli soprano de Lucy Crowe, belle ligne de chant, et aigus solides, mais était-il nécessaire, sinon pour faire l’affiche d’appeler Karine Deshayes pour la partie de mezzo où elle fut évidemment excellente, sans toutefois avoir vraiment l’occasion de déployer toutes ses qualités. elles étaient toutes deux en tous cas meilleures, bien meilleures même que Stella Doufexis et Deborah York à Berlin…
C’était l’occasion de retrouver aussi chœur et maîtrise de Radio France et l’Orchestre National en pleine forme, c’est à dire une partie des forces qu’on va probablement confier à la chirurgie (bien peu réparatrice) dans les prochains mois. Après en avoir lu et entendu tant dans les dernières semaines, non seulement on était heureux de retrouver l’orchestre dans une telle forme, mais on finissait pas se demander ce qu’on peut reprocher à un orchestre qui a donné une telle preuve d’excellence et d’engagement. L’orchestre dans sa globalité a magnifiquement répondu aux sollicitations du chef, offrant une prestation de très haut niveau.
Dans les musiques de scène, le scherzo initial a permis d’en vérifier à la fois la virtuosité et la dynamique qu’on apprécie encore plus à la réécoute (puisque le concert est disponible en ligne) qui permet peut-être plus de concentration. Rythmes marqués, fluidité, cordes splendides, flûte aérienne (les esprits…), un orchestre et un Gatti des grands soirs.
Je rappelais plus haut l’Abbado berlinois d’il y a quelques années : il me paraît clair que la version sans texte permet de travailler sur une cohérence musicale d’ensemble et des systèmes de références internes que la version avec texte ne permet pas de la même manière de repérer. La présence du texte oblige à une interprétation qui tienne directement compte des paroles et permet d’en marquer plus ce que j’appellerais la « mise en drame » par la tension de la liaison texte-musique. Cela donne en même temps un sens plus clair à la musique pour l’auditeur qui peut du même coup mieux lire l’interprétation.
L’intermezzo qui suit le mélodrame (..ou bien trouver la mort) est pour moi l’un des moments les plus intéressants, et les plus intelligents : il y a à la fois la fluidité, et une certaine légèreté, mais aussi une couleur plus sombre et plus grave, par une accentuation des aspects plus tendus ou dramatiques : sans le texte qui le précède, nous n’eussions peut-être pas vu aussi clairement cette tension.
C’est exactement la même impression qui domine le nocturne, l’un des moments les plus émouvants de la soirée, avec un solo de cor exceptionnel d’Hervé Joulain. Ce solo m’a vraiment enthousiasmé, mais l’ensemble a été dirigé de manière très sensible par Daniele Gatti qui en a fait un de ces moments suspendus où l’orchestre (cordes superbes, et flûtes !) a été complètement engagé pour dessiner une véritable ambiance, très retenue avec juste ce qu’il faut de pathos comme le montrent les dernières mesures avec le jeu des pizzicati. Un vrai moment d’émotion romantique. Un véritable Hymne à la nuit. C’est aussi là où Braunschweig a été le plus juste et le plus émouvant.
En somme, plus la pièce se déroulait et plus le tissu texte et musique devenait cohérent et parlant, et après la marche nuptiale si attendue, et proposée avec juste ce qu’il faut de pompe, et beaucoup d’élégance dans les parties plus fluides, les derniers moments ont été vraiment très réussis, pleins de délicatesse et d’émotion, dont une Bergamasque sans aucune lourdeur, très symphonique et dansante, et aussi plus détendus de la part du récitant qui avait pris ses marques et réussissait à dire le texte avec cette douce ironie qu’il réclame et qui lui avait un peu fait défaut au début. Voilà qui a montré, sur l’ensemble du concert, la belle qualité de l’orchestre et l’excellence de l’initiative de ce programme Shakespeare.
Car entendre un tel programme aussi inattendu, dirigé avec une telle intelligence et exécuté de manière aussi somptueuse par un orchestre qu’on a menacé et humilié est la meilleure des réponses. On ne peut que regretter qu’il ne soit donné qu’une fois.
Très beau succès mérité pour tous, et en particulier pour l’orchestre.
[wpsr_facebook]
