
Aussi étonnant que cela puisse paraître, Zubin Mehta n’a jamais dirigé Un ballo in maschera au théâtre. C’est aussi pour lui une première (même s’il l’a fait au concert) et pour cette première, il dispose d’une distribution de grand niveau, très attendue, avec Piotr Beczala dans Riccardo (qui l’a chanté au MET avec Levine) et Anja Harteros en Amelia, dont c’est la prise de rôle.
J’ai souligné ailleurs la difficulté de cet opéra, musicale et dramaturgique, j’ai même écrit un petit texte « L’impossible Ballo in maschera » à qui je renvoie le lecteur curieux.
Impossible, oui, parce que l’œuvre est charnière, entre les « grandes œuvres », Macbeth, Don Carlos, Aida et les œuvres de jeunesse ou « populaires ». Et de fait, Verdi n’abandonne pas le Grand Opéra, mais n’emprunte pas résolument la route de l’innovation : il suit une voie médiane et mouvante. Mouvante pour les chanteurs…Le rôle de Riccardo par exemple, s’alourdit de plus en plus : plus léger au départ (on est proche du Duc de Rigoletto), il s’alourdit à la fin pour se rapprocher de Radamès. Une vocalité qui peut déstabiliser certains ténors et qui ne leur facilite pas la tâche. Amelia est résolument un lirico spinto ; aujourd’hui la seule qui le chante sur les scènes avec succès et justesse est Sondra Radvanovsky, sans doute la plus solide « verdienne » du jour. Pour une Sondra Radvanovsky, combien de naufrages, y compris dans l’histoire de l’opéra : même la grande Leonie Rysanek y a succombé proposant un air du 2ème acte « Ecco l’orrido campo » des plus faux et des plus maltraités que je connaisse. L’un des plus grands « tonfo » de ma carrière fut un soir de Scala avec Gavazzeni au pupitre, et sur scène Luciano Pavarotti, Leo Nucci et une certaine Maria Parazzini qui remplaçait la soprano initialement prévue, qui se termina sur scène comme dans la salle, dans le sang, avec ces réactions si typiques du public scaligère à qui on ne la fait pas. Le trio de l’acte II fut un naufrage, trois chèvres bêlantes au moment de
« Odi tu come fremono cupi
per quest’aure gli accenti di morte? »
qui est proprement infernal à réussir. Tout dépend du tempo, de l’émission, notamment des notes d’Amelia qui sont souvent criées. Et ce moment-là est un test.

Il y a dans Un Ballo in maschera les ingrédients vocaux du grand opéra : un baryton (à la couleur proche de Simon Boccanegra), un ténor au spectre large, commençant belcantiste et finissant spinto, un soprano aux graves sonores et aux aigus infernaux, un soprano colorature (Oscar) essentiel pour l’équilibre vocal des ensembles pris à la tradition française. Ceux qui pensent voir un Oscar un personnage secondaire se trompent lourdement, c’est un personnage musicalement essentiel, et dans le drame c’est lui qui finit par désigner le comte à Renato, et puis Ulrica, contralto, à la présence limitée à l’acte I, mais qui a un énorme poids vocal, très rarement réussi, et quelques personnages secondaires fugaces et bien présents (Silvano le soldat, une basse jeune) .
Opéra paradoxal, souvent sur les scènes et rarement convaincant.
La Bayerische Staatsoper a soigné l’aspect musical : dans la fosse, l’ex-directeur musical, Zubin Mehta, revenant diriger à Munich un opéra qu’il n’a jamais dirigé à la scène, et sur la scène, Anja Harteros, la super vedette, Piotr Beczala, l’autre ténor qu’on essaie de promouvoir face à Kaufmann. Simon Keenlyside était prévu en Renato, mais il a déclaré forfait et c’est le baryton roumain George Petean qui le remplace (il n’est pas sûr qu’on y perde vocalement), la jeune Sofia Fomina en Oscar et la mezzo maison valeureuse Okka von der Damerau en Ulrica.
Pour l’avoir souvent entendu, je n’arrive jamais à « qualifier » Zubin Mehta : il a de mauvais soirs, ceux pour lesquels il est routinier, où il semble s’ennuyer, d’autres au contraire extraordinaires, tel Brucker à Salzbourg, tel Meistersinger à Florence, tel Ring à Valence : cet éclectique qui dans sa carrière a fait aussi bien les « Trois ténors » que des Wagner somptueux, privilégie le répertoire post-romantique, mais n’est pas un idéologue musical, bien plutôt un pragmatique. Ses Puccini sont en général notables : c’est un grand technicien de l’orchestre, c’est moins un « sensible », mais c’est sans conteste un grand chef, même s’il n’a pas vraiment ouvert de voies nouvelles à l’audition ou à l’histoire de l’interprétation musicales. Il y a des chefs qu’on reconnaît presque immédiatement à l’audition, ce n’est pas son cas.
Son retour à Munich, pour diriger un opéra aussi important pour la première fois à 80 ans est un événement considérable sur le plan musical, tant le chef indien a marqué pour ses enregistrements d’opéras italiens. De Verdi, il a laissé Trovatore, Traviata, Otello au disque.
À la tête de ce qui fut son orchestre et qui est sans doute l’un des orchestres de fosse les meilleurs (sinon le meilleur) en Europe, il propose un travail d’une grande précision, soignant à la fois la couleur et un son plein, rond, sur un tempo qui n’est pas rapide (certains chanteurs en souffrent un peu…) mais très rythmé, plein de relief, avec des contrastes de volume, mais sans jamais couvrir le plateau et accompagnant les chanteurs avec beaucoup d’attention. Le prélude est vraiment un modèle, laissant les instruments initiaux colorer l’ambiance, donnant une touche poétique et suspendue. L’entrée d’Ulrica est un des grands moments de la soirée, sombre, funèbre, concentrée. Ce sont peut-être les deuxième et troisième actes, plus dramatiques , qui me semblent les plus réussis, avec une capacité à isoler des phrases musicales, des bois et des violoncelles notamment, qui laissent rêveurs. Ce qui frappe dans cette interprétation, c’est le soin de certains détails qui nous montrent le travail de Verdi, les phrases révélées qui donnent une couleur particulière, et plus généralement, la poésie qui émane de l’œuvre .
Levine l’an dernier à New York avait une irrésistible pulsion, il y a ici quelque chose d’éthéré, quelque chose d’une épaisseur de discours, quelque chose de sérieux qui frappe. J’ai vraiment été fasciné par l’approche, par la clarté, par le raffinement de certains moments qui m’ont profondément touché.
Il est aidé par une équipe et un chœur (dirigé par Sören Eckhoff) vraiment exceptionnels, qui m’a frappé la veille dans Fliegende Holländer, mais qui impressionne dans Un Ballo in maschera où son rôle est très important voire spectaculaire. De plus, la mise en scène impose aux groupes et aux ensembles une géométrie et une mise en place très réussie et complexe, qui tient de la composition ou de la chorégraphie qui a presque à voir avec le musical (on l’avait de manière encore plus outrée à New York l’an dernier, notamment au premier acte dans la mise en scène de David Alden). C’est en tous cas pour le chœur une vraie performance.
Avec le trio Keenlyside, Harteros, Beczala, on pouvait s’attendre à un plateau brillant ; Keenlyside a été forfait et remplacé par George Petean, un des barytons montants de la scène lyrique internationale, mais les deux autres étaient bien là et ce fut pour le chant une de ces soirées qui donne satisfaction.
J’ai insisté sur le difficile défi que constitue Un ballo in maschera, opéra hybride spectaculaire et intimiste, historique, mais aussi quelque part fantasmagorique, avec des souvenirs de Grand Opéra (Oscar en est l’une des traces), mais aussi l’annonce d’un autre Verdi. Les « opéras de transition » ne sont jamais faciles, et comme je l’ai écrit j’ai rarement entendu ce Verdi-là de manière satisfaisante.
Ce soir fait quand même mentir la tradition, ce fut un Ballo in maschera de très grande tenue. D’abord parce que, comme souvent dans les maisons sérieuses, les petits rôles sont très bien tenus : le Silvano d’Andrea Borghini frappe par son naturel et sa présence, ainsi que pour sa voie engagée et très juste, c’est un jeune baryton-basse à suivre. Les deux conjurés Samuel et Tom ont remporté un bon succès malgré la surface réduite des rôles, surtout la basse Anatoli Sivko dans Samuel : on va vite entendre parler de cette basse sonore et au si beau timbre.

George Petean est un baryton très précis, manquant peut-être de relief scénique et de « pathos » dans la voix, qui n’a pas le brillant d’un Tézier (le Cappuccilli d’aujourd’hui) qui là-dedans fait merveille. Mais il sait conduire et contrôler la voix, il sait aussi bien projeter, il sait surtout colorer et ses interventions sont notables, et surtout son air de l’acte III « Alzati là tuo figlio » chanté sans histrionismes démonstratifs, mais avec une vraie tension. La voix sait se noircir, et surtout moduler avec une belle technique : il sait ce qu’il chante, et le chante parfaitement. Il rappelle par le timbre et certaines couleurs Renato Bruson dont il a l’intériorité et l’intuition. Il est vraiment un Renato intéressant, même si scéniquement il n’a pas la présence d’autres chanteurs, il reste qu’il impose une vraie voix, très présente, très juste dans le contexte. Très belle prestation.
Piotr Beczala est un cas plus difficile. La voix est parfaitement dominée, la technique est là, les aigus sollicités sortent, le timbre est clair. Donc a priori il n’y a rien à redire : et pourtant pour moi, il n’est pas un Riccardo, et ce pour plusieurs raisons. D’abord le premier acte n’est pas pour lui, trop brillant pour une voix qu’il n’arrive pas à alléger, il n’est pas vraiment le duc de Mantoue (bien que le rôle soit à son répertoire). C’est bien meilleur à la fin et correspond mieux à son état actuel de futur Lohengrin. Ensuite, il n’arrive pas à faire vraiment sentir le personnage. Il chante et ne fait que chanter. D’une star du chant on attend évidemment bien plus. Il chante tout plus ou moins de la même façon, sans vraiment colorer, sans engagement vocal vibrant. On reste dans la performance sans jamais entrer dans le rôle. Il avait été sifflé lourdement à la Scala pour son Alfredo qui pourtant sans être anthologique me semblait plus réussi.
Entendons-nous, c’est un chanteur de qualité, qui a « ses papiers en règle » comme ténor et même ténor de premier plan, et son dernier air « Ma se m’è forza perderti » a l’intensité et la force émotive voulue, avec une diction vraiment remarquable : c’est sans doute le sommet de sa soirée, le seul où l’on entende Riccardo sortir, vivre et sentir totalement . Mais pour le reste, je ne l’entend pas vivre, mais seulement (très bien) chanter. Il faut une tout autre couleur et un tout autre engagement pour Riccardo et plus généralement pour Verdi. La voix manque de souplesse et de ductilité et l’engagement interprétatif reste assez distancié : l’artiste est sérieux voire très solide sans nul doute, mais il manque bien du soleil pour Riccardo.
Sofia Fomina, une jeune chanteuse russe, était Oscar. Ceux qui pensent qu’Oscar est un personnage secondaire se trompent lourdement : le travesti est fréquent dans le Grand Opéra, qu’on rencontre dans Huguenots, dans Guillaume Tell, dans Don Carlos, et qui apparaît ici comme peut-être dramaturgiquement secondaire (encore que son rôle soit essentiel à la dernière scène), mais musicalement essentiel, notamment dans les ensembles du premier acte, et aussi dans le rythme qu’il impose aussi bien aux scènes initiales qu’à la scène finale. Il faut vraiment une vraie voix et un vrai personnage. Pas de Ballo in maschera sans un Oscar excellent, une chanteuse médiocre fait tomber immédiatement le premier et le dernier acte, tant par la couleur que le rythme voulu par Verdi. Sofia Fomina qui doit donner l’essentiel au premier acte, est un Oscar frais à souhait, virevoltant ; la voix semble moins assurée dans les premières mesures mais prend de l’assise et de la chaleur, et elle est de plus en plus juste : pendant le bal, elle s’affirme aussi scéniquement, où elle retire brutalement sa perruque, laissant apparaître de longs cheveux blonds illustrant la théorie du double que le metteur en scène Johannes Erath essaie d’imposer, comme si elle était non le page mais une femme sans doute amoureuse de Riccardo ; sa dernière scène plutôt dramatique est vraiment passionnante et elle se sort du rôle avec tous les honneurs.

Okka von der Damerau est Ulrica, dans cette mise en scène une sorte de Muse du destin, ou de la mort qui apparaît périodiquement en scène aux moments clefs, même si elle ne chante que pendant le premier acte. Sans être d’un volume extraordinaire, la voix est très homogène, passant du grave à l’aigu sans vraie difficulté. Les graves sont d’ailleurs somptueux même si les aigus mériteraient plus de projection. C’était sa première Ulrica, et dans le contexte de son théâtre, elle fait honneur à la troupe dont elle est l’un des éléments essentiels.
C’était aussi une prise de rôle pour Anja Harteros .
Impossible de lui contester le primat de la soirée ? Bien sûr, quelques menues hésitations dans le trio avec Ulrica et Riccardo (caché), notamment une ou deux attaques hésitantes, mais le reste ! Dans un rôle très difficile, l’un des plus difficiles du répertoire, alors qu’il apparaît à première vue plus praticable et plus aisé.

Le deuxième acte est hypertendu, avec des aigus impossibles, une ligne de chant à maintenir et des ensembles incroyablement difficiles, à commencer par le trio « Odi tu come fremono cupi
per quest’aure gli accenti di morte? » où ses aigus sont si dardés qu’ils peuvent devenir des cris de bête aux abois. Ici Mehta a l’intelligence d’un tempo très juste, moins serré qu’à l’accoutumé, et qui permet à Harteros de faire les notes justes, et bien placées (c’est en tous cas pour ma part une des premières fois que je l’entends ce satané trio ainsi chanté!
La voix a sûrement moins de pâte que celle de Sondra Radvanovski, sans doute un peu plus à l’aise, mais quel engagement, quels aigus, quelle présence et quelle émotion. Où est la chanteuse froide que certains entendent ? Il y a là une flamme, une présence, une urgence qui en fait l’incontestable triomphatrice de la soirée et une Amelia exceptionnelle, exceptionnelle, parce qu’aussi très personnelle, presque crucifiée, une passion grecque en somme.

On est musicalement face à une vraie réussite en termes de cohésion et de couleur, malgré mes maigres réserves çà et là : le plateau est composé de main de maître (on reconnaît la patte de Pål Moe, le directeur des distributions), et Mehta signe là une vraie et grande interprétation parce que pour une œuvre jamais dirigée, il voulait marquer son retour à Munich. Et c’est réussi.
J’ai laissé pour la fin la mise en scène de Johannes Erath, qui a travaillé avec l’équipe habituelle de Stefan Herheim (Heike Scheele pour les décors et Gesine Völlm pour les costumes.
Johannes Erath est un metteur en scène de nouvelle génération qui travaille pour la première fois à Munich, au parcours étonnant puisqu’il a été violoniste, de très haut niveau, élève de Rainer Küchl, le Konzertmeister des Wiener Philharmoniker, et membre de l’Orchestre de la Volksoper de Vienne. Mais il a viré à la mise en scène en étant assistant de Willy Decker et Peter Konwitschny entre autres, il a travaillé notamment à Hambourg, Dresde et Francfort. On lui doit paraît-il un Lohengrin de très belle facture à Graz.

Il propose une vision complexe de cet opéra qui ne l’est pas moins, un travail presque emblématique du Regietheater par la méthodologie et par le soin mis à décortiquer le texte du livret d’Antonio Somma qui à mon avis n’en mérite pas tant. Dès la première phrase « Posa in pace » il fait le rapport avec l’expression « requiescat in pace» et l’atmosphère de Requiem qui préside au réveil du comte, et ainsi propose une vision marquée par la mort, qui rôde, qui s’annonce, le chœur initial étant fait des courtisans, mais aussi et déjà, des conjurés, une mort qui n’est jamais loin et qui conduit la dramaturgie jusqu’à l’assassinat final avec ses nombreux jeux sur le pistolet, avec les double-cadavre de Riccardo. Un meurtre précédé d’ailleurs des désirs de meurtre d’Amelia sur son mari Renato, qu’elle envisage d’étouffer dans son lit, pendant qu’il dort, sorte d’Otello féminin dans une pantomime qui illustre l’introduction au deuxième acte, assez réussie et qui montre la déchirure et des doutes de l’héroïne.
Johannes Erath n’illustre pas le livret, mais s’intéresse aux implicites et aux situations des individus, le drame se noue et se dénoue dans une sorte de ménage à trois et d’intimité dont le lit, central est le protagoniste et le symbole : Riccardo porte pendant toute la représentation (sauf la dernière scène) une robe de chambre décorée des vagues de la mer d’Hokusaï (allusion à son habit de pêcheur pour aller voir Ulrica et à l’air qu’il chante devant elle) tandis que Renato au deuxième acte qui dort dans le lit, constate l’absence d’Amelia et enfile lui aussi une robe de chambre qu’il va bientôt échanger avec Riccardo (pour échapper aux conjurés). Tout se passe dans, sur et autour du lit. Et d’ailleurs, la première image pendant le prélude, est le lit où Riccardo rêve et la vision séductrice d’Ulrica (= la Mort, le Destin) vue de dos à travers le tulle d’un immense rideau qui clos l’espace scénique circulaire. Un espace circulaire comme l’orchestra des tragédies, autour duquel court un immense escalier hélicoïdal bi face, car cet espace est double et symétrique.

À la verticale du lit, un autre lit au plafond, symétrique, qui nous indique le futur, au premier acte Amelia dormante, au deuxième et troisième acte, un corps ensanglanté qu’on suppose sans grand risque d’erreur être celui de Riccardo. Cette intimité, elle est montrée de manière assez convaincante au deuxième acte où Amelia dissimulée dans les plis de tulle du rideau, chante avec « ses » deux hommes, tous deux en robe de chambre sur fond de lit défait. Drame intérieur, espace psychologique, amplifié par un fonctionnement du chœur tout à fait séparé des protagonistes, comme un chœur antique qui commenterait sans entrer dans la matérialité de l’action. Un chœur qui en quelque sorte n’existerait que comme décor de l’action sans y participer, un chœur dont les ombres géantes sont projetées dans une ambiance profondément marquées par l’expressionnisme et par le cinéma des années 20 : on pourrait, avec les costumes et le décor gris et monumental, confondre avec une quelconque Lulu mâtinée de comédie musicale avec une sorte de Marlène Dietrich. Brecht, Ange bleu et Lulu tout en un…pour un ballo in maschera ! Il y a de quoi faire attraper une syncope à un public italien…
Dans cette ambiance, ce qui fascine Erath, ce sont les êtres et les ombres, les êtres et leur reflet, les êtres et ce qu’ils cachent. Je le répète, il fait un travail rigoureux et aiguisé, glacial comme une lame de poignard, qui ne laisse aucune liberté au livret de Somma, et travaille sur une lecture-interprétation systématique, où les personnages évoluent dans un univers presque mental dont Ulrica gère la mécanique : à la fin, le corps de Riccardo gît au pied du lit, mais Riccardo (Beczala) grimpe l’escalier monumental en chantant à pleine voix ses dernières paroles pour rejoindre Ulrica: il expire dans la vie mais est déjà au Ciel….


Erath est en effet fasciné dans cette œuvre par les jeux de double, le ying et le yang, jeu avec les marionnettes qui sont soit enfant, soit double de Riccardo, couleur noir/blanc, courtisans/conjurés, Riccardo modèle de « bon » gouvernement dans son public et trahissant son meilleur ami par l’amour qu’il porte à l’épouse, Renato ami dédié, voire presque amoureux de ce Riccardo, avec cet amour transmué en haine assassine au deuxième acte, et pourtant Renato double de Riccardo avec chacun la robe de chambre de l’autre, annonçant évidemment le bal masqué. Amelia aimante et soumise, le jour, presque meurtrière et amoureuse la nuit,

Oscar jeune homme et jeune femme à la fin, monde réel et monde renversé dans un espace caléidoscopique, bal masqué où l’on ne sait qui est qui, et même Ulrica, belle femme blonde et altière, alors que le livret dit qu’elle est noire « Ulrica, dell’immondo sangue dei negri » mais vêtue de noir, comme une princesse des ténèbres qui n’a rien à voir avec l’effrayante femme qu’on annonce. Tout cela propose une vision inquiétante et trouble, où nous est lue la duplicité du monde et des hommes, l’impossible construction de soi, l’impossibilité d’aimer et de rester fidèle à soi avec chez chacun une face cachée.
Ce travail d’un grand sérieux évidemment confirme le côté roman noir de cette œuvre pessimiste, où les personnages tous positifs finissent dans la tragédie et le sang : le final en rédemption d’un Riccardo qui pardonne, déjà presqu’au Ciel vers lequel il monte, mais aussi l’ambiance très liée au cinéma muet en noir et blanc, aux années trente, c’est à dire un monde à la veille d‘un gouffre, indique évidemment un monde à la Brecht, tributaire d’ambiances expressionnistes, avec ces visages blafards notamment celui de Renato, presque impersonnel et glaçant, qui jette un doute dès l’abord sur ses sentiments envers Riccardo.
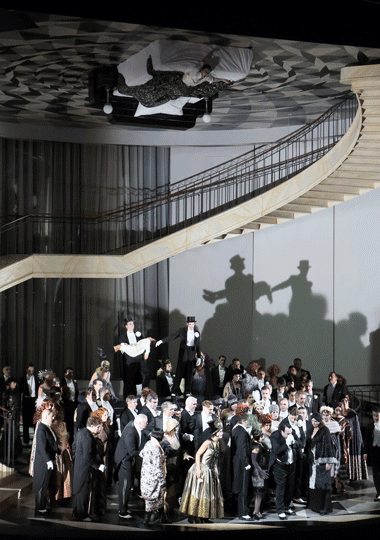
En fallait-il tant pour Un ballo in maschera ? Tout le côté brillant et spectaculaire est évacué : on est aux antipodes de Zeffirelli ou John Schlesinger, qui ont signé des mises en scène où tout le monde attendait la dernière scène ; Vérone aime cet opéra, seulement à cause de ce bal final, si spectaculaire qui attire les applaudissements . Rien de cela ici, aucune concession et une ligne assombrie et mortifère, qui lâche le livret dans son déroulé et qui essaie de plonger dans les détails du texte et d’analyser, voire extrapoler. Un seul exemple : s’appuyant sur le texte où Renato donne aux conjurés son fils en otage pour dire sa détermination à assassiner Riccardo, une des images du Bal masqué est la vision des conjurés en arrière plan avec un enfant dans les bras, comme pour contraindre Renato au meurtre.
Je trouve que ce travail très respectable en soi, avec des mouvements très bien réglés (splendide la manière de gérer les mouvements du chœur) très applaudi à la Première demeure trop suspendue à une lecture trop dramaturgique du livret. Peut-être attend-on aujourd’hui autre chose ? Je vois ce travail parfaitement cohérent avec les années 80, moins avec les années 2000. Tout fonctionne, mais c’est peut-être trop ? Peut-être trop pour un livret qui n’a pas les beautés d’autres livrets de Verdi (et qui a été l’objet de nombreuses hésitations : conflits entre Verdi et Somma, gestion de la censure) . Fallait-il donc tant de profondeur ? Les personnages ont-ils cette insondable part d’ombre ? A little bit too much…
Il reste qu’une fois encore, l’ensemble de la soirée est une vraie soirée d’opéra, un vrai moment. Et j’en suis sorti heureux, heureux pour une musique qui m’a frappé par l’émotion qu’elle diffuse, et aussi heureux malgré tout d’une production qui ose un Verdi au total épuré et rigoureux, peut-être trop, mais qui s’offre à la discussion, et à la réflexion, sans m’avoir totalement convaincu mais qui au moins fait théâtre.
_____
Ce spectacle sera retransmis par Staatsoper TV (et sur ARTE) (https://www.staatsoper.de/tv.html?no_cache=1) le 18 mars et restera en ligne une semaine. Ne le manquez pas.
[wpsr_facebook]

