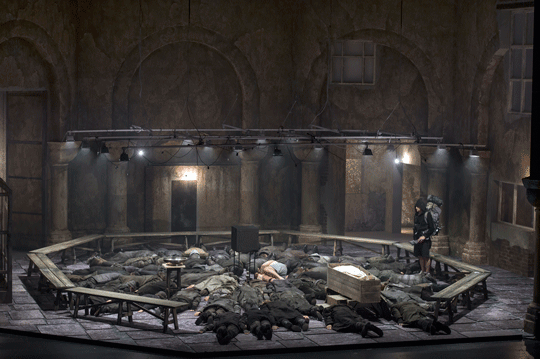ADIEU À KUNDRY
Quand une gloire du chant fait ses adieux à un rôle, le public vient pour honorer l’artiste et le/la remercier. D’une certaine manière, peu importe l’entourage et la distribution et peu importe la prestation et l’état réel de la voix, tout sera pardonné.
Il n’en fut pas ainsi, dans le cas de Waltraud Meier , Kundry dans le Parsifal mis en scène par Dimitri Tcherniakov et dirigé par Daniel Barenboim qu’elle interprétait pour la dernière fois ce lundi 28 mars à la Staatsoper de Berlin : l’écrin pour ses adieux fut le plus glorieux qui soit, avec une distribution chavirante, un orchestre exceptionnel et un chef inspiré. C’est donc un merveilleux Parsifal qu’il nous été donné d’entendre, un de ceux à emporter sur l’île déserte.
C’est pourquoi toutes affaires cessantes (j’ai encore quelques textes en retard), je voulais écrire sur ce Parsifal et sur Waltraud Meier. Fort opportunément Daniel Barenboim a rappelé qu’elle débuta Kundry en 1983 sous la direction de James Levine au Festival de Bayreuth, j’ai eu la chance de l’y entendre et de suivre sa carrière depuis. C’est dire l’émotion qui pouvait me saisir. Mais plus encore, c’est l’exécution musicale dans son ensemble qui m’a enthousiasmé, et la confirmation de la qualité du travail de Tcherniakov, dont la « Personenführung », le travail sur les personnages est incroyable de précision et de justesse. De mise en scène il sera peu question, parce que je l’ai évoquée par le menu dans mon compte rendu de l’édition 2015 , mais Tcherniakov a adapté son travail au personnage porté par Waltraud Meier : alors qu’il avait travaillé avec Anja Kampe sur la jeunesse et la « parenté » Parsifal/Kundry, chacun portant son doudou à la fin (petit cheval ou poupée) et sur une certaine violence érotique, il va travailler avec Waltraud Meier (dont le costume est plus « sage ») sur la femme, une sorte de mère pour les filles fleurs, mais bafouée, blessée, sacrifiée, isolée : elle ne s’adresse pas à Parsifal qui étendu à terre après le baiser, ne veut rien entendre, mais elle monologue sur elle-même. C’est prodigieux de vérité et de douleur. Il travaille sur une Kundry plus maternelle, plus mûre qui voit en Parsifal son Erlöser, son rédempteur, son sauveur, dans une relation d’individu à individu qui frappe par son intensité (les échanges de regards sont littéralement déchirants) : c’est le désespoir qui gouverne plus que la magie d’un Klingsor devenu un « pervers pépère » gotlibien. Il en résulte pour le spectateur une expérience humaine intense et bouleversante, loin des simagrées pseudo-religieuses dont on affuble Parsifal. Oui, il s’agit d’un Festival scénique sacré, mais le sacré est ici l’humain, dans sa crudité et sa douleur, un humain qui se lit dans tous les personnages, Amfortas dont la souffrance est donnée à voir d’une manière presque impudique, Gurnemanz qui remâche l’histoire du Graal et qui devient une sorte d’intransigeant gardien du temple si violent qu’il poignardait l’an dernier Kundry à la fin ; c’est moins clair cette année vu les mouvements (ou la place que j’occupais), en tous cas, la mort de Kundry est moins « démonstrative », même s’il y participe.
Que Parsifal ne soit « que » le rédempteur qui passe et s’en va portant le cadavre de Kundry, laissant le Graal à son destin montre en même temps combien l’histoire de la « secte » du Graal intéresse peu Tcherniakov ; le destin de Parsifal est l’errance, qu’il soit jeune (au début) en bermuda et capuche ou adulte (à la fin) en veste de cuir et treillis : Parsifal comme roman d’apprentissage.

Une aventure humaine qui est une aventure théâtrale et musicale, dans laquelle nous sommes emportés comme par un tourbillon, d’abord grâce à Daniel Barenboim. Le chef est inspiré et porté sans doute par ce moment particulier qui sanctionne des années de travail fidèle avec Waltraud Meier depuis 1987 ; une collaboration artistique qui passe notamment par Parsifal, Tristan mais aussi Wozzeck ou Walküre (on oublie quelquefois quelle Sieglinde Waltraud Meier a été). C’est bien le sens que Daniel Barenboim a donné à ses quelques mots prononcés à la fin de la représentation soulignant les éminentes qualités de Waltraud Meier, puissance, beauté de la voix, intensité et surtout ce poids particulier donné aux paroles, à chaque mot, faisant sonner à chaque fois le sens juste. Il y a eu de très grandes Kundry, mais tous les spectateurs des années 80 en l’entendant savaient qu’une page de l’interprétation wagnérienne s’écrivait et se sanctionnait C’est ce qui stupéfie dans ce Parsifal et qui est largement partagé par tout le plateau : on comprend chaque parole projetée clairement, avec l’expressivité qui convient, on est pris par l’engagement de chacun et sa justesse dans le jeu. Pour Waltraud Meier, on est loin de la tigresse des premières années : elle fait sonner une étrange nostalgie, on y entend une femme dévastée, presque une mère, protectrice de ce Parsifal qui à l’acte I et au début de l’acte II est un chien fou. Chaque parole est sculptée, chaque inflexion est donnée comme dans un grand Lied somptueux. Ce qui frappe encore, c’est la puissance expressive de la voix, et surtout la puissance tout court. Aucun outrage des ans (avec certes deux petits moments de justesse approximative dans les aigus, mais c’est un microdétail quand on pense à ceux de Rysanek à Bayreuth en 1982) et une fraicheur telle qu’on se demande bien pourquoi elle abandonne le rôle, sinon pour affirmer ainsi qu’il vaut mieux renoncer à un rôle en pleine gloire que sur de vagues échos de ce qui fut et qui n’est plus.
Je voudrais dire quelle émotion est la mienne, en ce dernier jour, car elle me bouleversa souvent, mais surtout au plus profond, un soir berlinois, à la Philharmonie, en avril 2002, lorsqu’elle interprétait les Rückert Lieder pour une autre dernière fois, le dernier concert d’Abbado à Berlin comme directeur musical des Berliner Philharmoniker. Ich bin der Welt abhanden gekommen fut un de ces moments définitifs, où il se passait tant de choses entre le chef et l’interprète, sur fond du cor anglais déchirant de Dominik Wollenweber, qu’immédiatement ce soir c’est ce souvenir-là qui m’est remonté. Me disant qu’en face de moi j’avais l’une des chanteuses non seulement des plus intelligentes de la scène d’aujourd’hui, mais aussi des plus sensibles et des plus vraies.
C’est quand l’art laisse voir l’humain dans toute sa beauté qu’il devient sublime. Waltraud Meier est pour moi plus irremplaçable dans Kundry que dans Isolde, sans doute parce que je l’ai entendue depuis ses tout débuts, une Kundry déjà mûre et encore verte, et ce soir dans une Kundry pas encore mûre, mais accomplie. Une vie d’artiste. Car les adieux, c’est toujours un peu la fin qui s’annonce, et là, il y avait tant de vie, de vibration, de sensibilité, de vérité, qu’on était loin, très loin d’une quelconque fin.
Daniel Barenboim a dirigé son orchestre avec sa vibration dramatique habituelle ; on sentait l’orchestre tendu et appliqué, nombre de musiciens restaient en fosse pendant les entractes, signes de volonté de s’entraîner jusqu’à la dernière minute.
Il y a d’abord dans ce travail une profondeur qui frappe, avec le tempo juste, peut-être un poil rapide à la fin, avec un volume important, d’autant plus dans cette petite salle, peut-être un poil fort néanmoins. Mais l’ensemble est tellement intense, l’interprétation colle tellement à la scène et à la violence rentrée qu’elle nous impose qu’il y a des moments où cela a un effet physique sur le spectateur : la chaleur et la fièvre montent, les poings se ferment, quelques perles de sueur apparaissent sur le front.
Ce qui est extraordinaire avec Barenboim (ou quelquefois problématique), c’est qu’il est toujours inattendu ; comme souvent les très grands, il change tel ou tel détail, tel ou tel tempo d’une soirée à l’autre ; plusieurs amis ont souligné la différence de volume ce soir, plus marqué, où pourtant et malgré tout on l’entendait encore chantonner et indiquer par des sons telle inflexion, tel appui, signe de sa concentration extrême. Et comme souvent aussi avec les très grands, l’orchestre était ce soir tout à lui, sans une scorie, avec des cordes prodigieuses, des cuivres sombres, car ce soir, l’approche était sombre, celle du monde pessimiste et désespéré voulu aussi par Tcherniakov. Comme enfin avec les très grands, Barenboim dirige une œuvre, un plateau et une mise en scène dont il tient évidemment le plus grand compte. Ce travail a le rythme du plateau, la noirceur du plateau, son ironie aussi (deuxième acte) notamment dans la scène des filles fleurs, terrible parce que sans magie, mais magique parce que terrible, la fascination du mal, une sorte d’enchantement nadirien dont la version solaire nous sera donnée au troisième acte. Haletant. Engagé. Grandiose.
Grandiose également le chœur qui dans cette mise en scène fait un tout autre effet que lors des Parsifal-messes scéniques où il apparaît quelquefois. Il y a là une vie singulière, une énergie du désespoir notable et particulière (Direction Martin Wright) et une vraie présence, puissante et impressionnante.
Il est vrai aussi que Barenboim avait sous la main le plus beau des plateaux possibles. D’abord comme souvent des petits rôles très bien tenus, à la diction merveilleusement claire, à l’engagement scénique notable. Ainsi citera-t-on les Gralsritter Paul O’Neill et Dominic Barberi, les Knappen Sonia Grand, Natalia Skrycka (qui chante aussi la voix du ciel et une des filles fleurs), Florian Hoffmann et Roman Paier. Mais aussi les filles fleurs : on a toujours un chœur des filles fleurs alternant entre la joie explosive et la séduction à l’orientale (ou à la mode de Ravello vu l’inspiration du jardin des Blumenmädchen). Ici la mise en scène est loin de la séduction orientale et le chœur des filles fleurs, à peine strident, rend l’image d’un chœur de petites/jeunes filles avec des voix qui ne seraient pas « faites ». Même les filles fleurs sonnent différemment mais si justes et si cohérentes avec la mise en scène.
Enfin Matthias Hölle, en Titurel (il l’était déjà lors du premier Parsifal de Barenboim à Bayreuth en 1987, avec Waltraud…) sculptural dans son manteau de cuir de triste référence, rappelle quelle basse il fut, et qu’on admira tant sur la scène de Bayreuth.
Tómas Tómasson en Klingsor, comme l’an dernier, rattrape les années de Klingsor médiocres dont les théâtres nous ont gratifiés, en armure de Matrix ou en équipage SM. Bien sûr Tcherniakov prend le spectateur à revers en imposant un « caractère », plein de tics, remettant en place son horrible mèche rebelle derrière des lunettes de pervers. ; Tómas Tómasson marche et insupporte, il regarde et insupporte, il caresse des petites filles et insupporte. Un repoussoir.
Et le chant est impeccable, puissant avec cette légère ironie dans le ton, cette légère nasalisation, loin des voix noircies et sans intérêt. Le rôle est tout dans la première scène : et il faut l’attendre à Furchbare Not, le moment qui évoque la castration. Tómas Tómasson est étonnant, à la fois repoussoir et pathétique, il y a les deux dans cette manière de chanter. Du grand art .
René Pape en Gurnemanz, même un peu fatigué (au début, les graves étaient légèrement opaques) est toujours un moment d’exception. Des aigus d’une insondable profondeur et d’un rare éclat, un texte dit avec une clarté et un souci des inflexions phénoménal, une présence bourrue et blessée qui en ferait presque un personnage mystérieux de roman médiéval, un engagement féroce qui peut aller jusqu’au meurtre sous des dehors finalement anodins. Cette complexité du personnage, René Pape nous l’impose, quand nous voyons trop souvent des Gurnemanz sculpturaux et statufiés. Nous avons là une humanité déchirante, que Tcherniakov ne cesse d’imposer, notamment au troisième acte lorsqu’il rêve devant la diapo du temple…être et avoir été.
Wolfgang Koch en Amfortas, a une présence scénique crue, impudique, même un peu gênante pour le spectateur : il impose sa blessure, la négligence de son port et de sa tenue, comme une sorte d’être incurable qui nous imposerait un physique aux limites du supportable. On n’a vraiment pas envie de le voir, en boxer et marcel sanguinolant. Et face à ce corps en putréfaction, par contraste, une voix d’une noblesse unique, une expression d’une intensité rare, un timbre velouté. Qu’il soit Wotan, Sachs ou Amfortas, Koch s’impose comme l’un des plus grands wagnériens d’aujourd’hui, d’une modestie palpable tant la présence en scène s’impose par le dire, par un minimum de gestes signifiants sans en faire des tonnes. Rien de trop, juste ce qu’il faut pour toucher, sans jamais exagérer dans le démonstratif, sans jamais être pathétique. Quel artiste !

Et puis, il y a Andreas Schager. Un Parsifal en tous points exceptionnel.
Il faut l’entendre dire, prononcer, moduler chanter « Erlöse.. » à l’acte II. C’est vraiment une performance qui ferait presque oublier Kaufmann, bien que le style soit tellement différent, et le personnage à l’opposé. D’abord, Schager a un timbre de ténor, l’éclat d’un ténor, et une voix d’une puissance si marquée qu’on craint qu’elle ne s’use prématurément tant il chante fort (déjà dans Tannhäuser à Gand…). C’est très fort, mais c’est si juste et si intelligent qu’on lui pardonne. Le chien fou du premier acte, avec ses excès qu’on entend dans une voix éclatante, forte et fière de soi, et qui va ensuite éclater dans la désespérance avec une telle vérité qu’on en est frappé au deuxième acte ; et puis c’est légèrement plus maîtrisé au troisième, plus lyrique aussi, presque plus poétique : la mise en scène et les échanges de regards bouleversants Kundry/Parsifal aident à installer cet espace lyrique que le chanteur impose après les explosions vocales précédentes. Ce qui frappe encore là, c’est l’intelligence du chant, c’est la présence, c’est l’engagement résolu dans la mise en scène, c’est aussi un texte d’une telle évidence qu’on n’a même pas à lever les yeux vers les surtitres, car on comprend tout. Et quel jeu ! qui passe de la fraîcheur juvénile à l’adulte plus contrôlé.
Il faut voir la manière dont il se gratte le mollet, comme un tic : on se dit d’abord qu’il a une démangeaison toute humaine, mais son double se gratte aussi, et on découvre que c’est dans le jeu. Il faut voir aussi la manière saccadée dont il se change, dont il fouille dans son sac à dos…incroyable Tcherniakov. Et incroyable Schager qui construit un personnage de Parsifal neuf, frais, naturel, irremplaçable dans cette mise en scène, et incroyable d’incarnation. L’interprétation a mûri par rapport à l’an dernier, plus maîtrisée, plus intérieure, plus construite : il m’a fait penser à l’urgence de Vickers…c’est dire…
Alors bien sûr, l’adieu à Kundry de Waltraud Meier donnait à la soirée un parfum particulier, mais c’est bien l’un des grands Parsifal de ces dernières années qu’on a revu-là avec une distribution et une direction exceptionnelles, et c’est ce qui fait le prix de la soirée : on a vu et on est enthousiaste d’un Parsifal, c’est à dire de l’œuvre que les circonstances n’ont pas fait disparaître. C’est le plus beau cadeau à offrir à notre Waltraud qu’une représentation digne d’elle.
Alors bien sûr, presque 30 minutes d’applaudissements, avec discours chaleureux de Jürgen Flimm l’intendant, de Daniel Barenboim, avec couronnement de Waltraud d’une couronne de fleurs qu’on croirait sortie de la Festwiese des Meistersinger, ce qui pour une Meistersängerin, se justifie pleinement. Délire du public, joie des collègues, des musiciens. L’Opéra comme on le rêve, dans une salle qui a acquis une personnalité si attachante qu’on en viendrait presque à souhaiter des retards supplémentaires aux travaux de la Staatsoper unter den Linden.
Et puis, fidèle à la tradition humaniste de la maison, joint à la distribution, un petit papier à en tête de l’opéra, très officiel et signé Die Intendanz nous demande de donner à l’association Be an Angel pour les réfugiés avec aux portes, comme il y a six mois pour Meistersinger, du personnel recueillant les dons. On aimerait voir en France cette présence et ce type de demande au public… Même à Zurich il y a une fête prochaine pour les « Flüchlinge » sur le parvis de l’opéra. C’est sans doute le signe, malgré les méandres filandreux de la politique bien présents en Allemagne (et en Suisse !) aussi, qu’il y a une âme humaniste qui vibre et surtout qui s’exprime.
Pardon pour ce dernier mouvement d’humeur, mais après une telle soirée, où nous avons tous communié autour de notre art chéri, nous rappeler à la réalité tragique des temps du quotidien, et avec quelle élégance, cela m’émeut, et me désole quand je pense à mon pays.
Ce soir c’est l’humain dans tous ses états qui a triomphé.[wpsr_facebook]