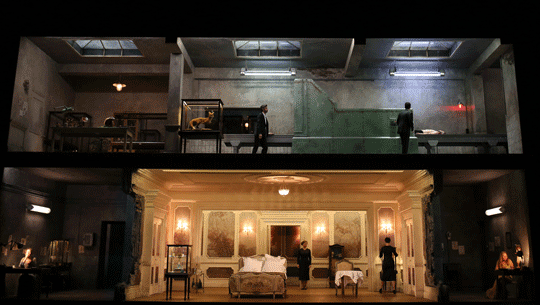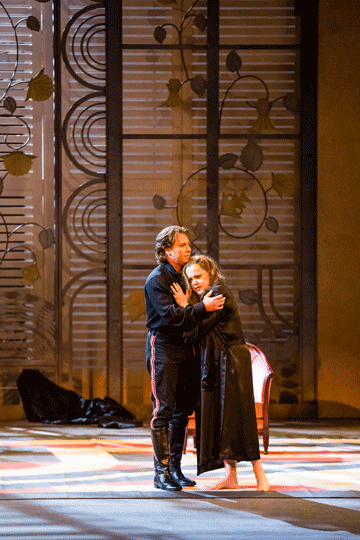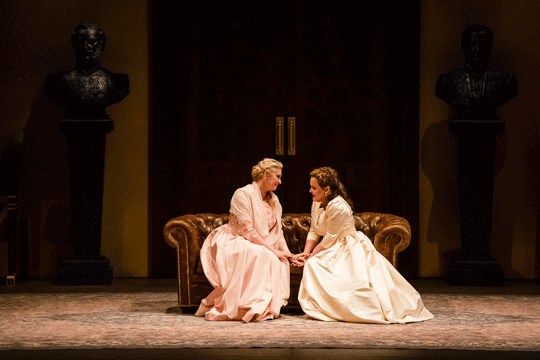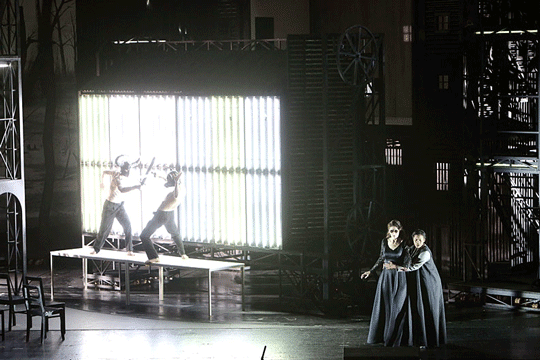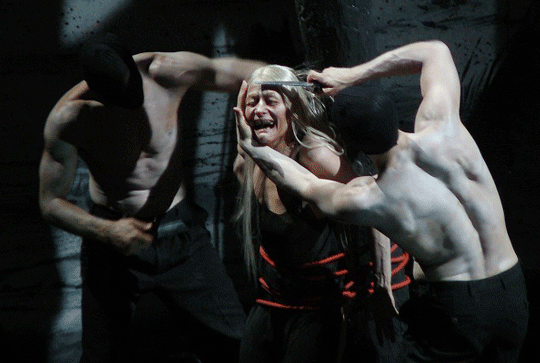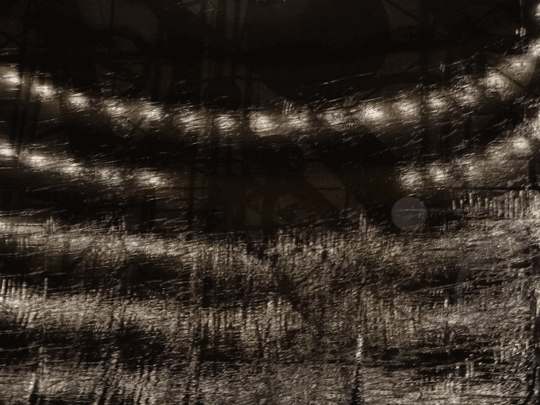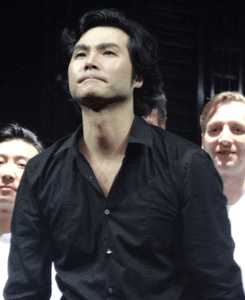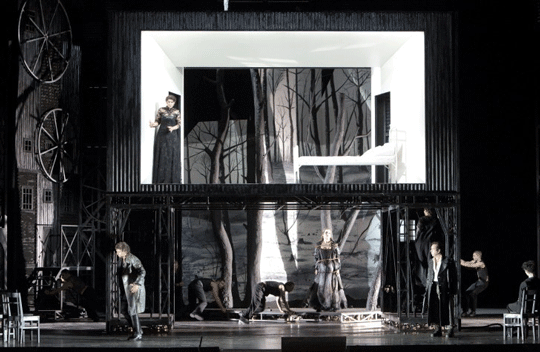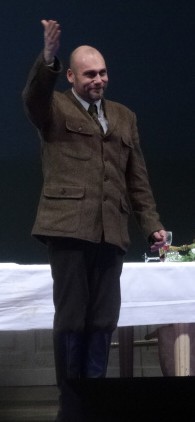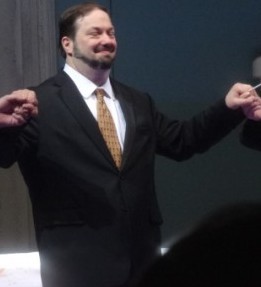Le répertoire ancien et baroque ne fait pas partie des gènes de la Bayerische Staatsoper, même si le Cuvilliés Theater, l’un des joyaux de l’architecture baroque se trouve à quelques mètres du Nationaltheater. Mais c’est au Prinzregententheater que Nikolaus Bachler a décidé de présenter les opéras baroques. Ce théâtre, bâti au début du siècle sur le modèle du Festspielhaus de Bayreuth dont il est une imitation assez fidèle, en plus réduit, permet d’accueillir plus de spectateurs et continue la tradition lyrique d’un théâtre qui abrita la Bayerische Staatsoper tant que le Nationaltheater n’était pas reconstruit, soit jusqu’en 1963. Aujourd’hui, et depuis 1993, il abrite l’Académie August Everding, l’un des centres de formation de jeunes artistes les plus complets de l’Allemagne d’aujourd’hui.
C’est donc au milieu de fresques antiquisantes du début du siècle et au son de la fanfare initiale célébrissime de Monteverdi, dissimulée dans la salle, que cet Orfeo est présenté dans une mise en scène de David Bösch que les lyonnais connaissent bien puisqu’il a mis en scène Simon Boccanegra il y a deux saisons et qu’en cette dernière saison on lui doit Die Gezeichneten de Franz Schreker. C’est un des jeunes metteurs en scène les plus en vue du théâtre allemand, dont l’approche n’est pas forcément fondée sur une relecture du livret à l’éclairage du monde d’aujourd’hui, comme souvent dans le Regietheater, mais plutôt l’inverse une utilisation d’éléments d’aujourd’hui pour illustrer un livret d’hier.

Ainsi de L’Orfeo, travail qui s’appuie sur une sorte de version théâtrale de l’arte povera avec des personnages sortis d’une version hippie du retour à la terre et de bergers version post soixante huitarde qui font leur « chariot de Thespis » d’un Bulli, le fameux van historique de Volkswagen des années 60 et 70. Dans ce monde idéal, reconstitué avec des matériaux pauvres (papier, carton, terre), au milieu de grandes fleurs de papier scandant le paysage, dans de beaux éclairages de Michael Bauer, Orfeo fête son mariage, costume de lin couleur ivoire, sorte de vedette qui chante au micro avec un petit groupe de copains et qui reçoit sa lyre en cadeau de noces. La date du mariage est affichée le 18 juillet 75, soit il y a quarante ans (l’an dernier, la date affichait le 20 juillet 1974). Bösch superpose donc le mythe d’Orphée et celui d’un Eden perdu qui serait cette période d’après 68 où tout semblait possible et où une certaine jeunesse pensait retourner à la nature, aux travaux des champs, dans une vision idéalisée de la vie rurale : l’Arcadie version années 70.
Mais à tout Eden correspond la chute, et c’est bien l’histoire de cet Orfeo qui commence au Paradis et finit aux Enfers.
David Bösch fait dérouler cette histoire dans deux mondes divers par les éclairages, mais proches par le style, deux mondes dessinés de manière aussi pauvre l’un que l’autre : dans l’un les fleurs géantes poussent de la terre, dans l’autre pendent des cintres des images des âmes, figurées à la manière d’un visage à la Munch grâce à de magnifiques projections.
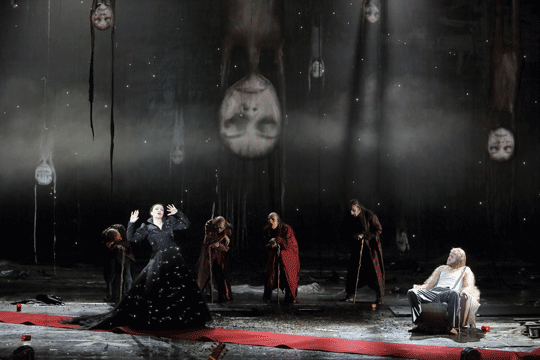
D’un côté un Bulli, de l’autre un chariot composé à partir d’une sorte de châssis pour Charon comme pour Pluton, d’un côté un groupe de joyeux drilles, de l’autre un groupe de dieux décatis et chenus au milieu desquels trône une Proserpine altière à la robe étoilée, et un Pluton barbu à la Charlemagne. Deux mondes symétriques, mais dans un style voisin, on passe facilement de l’un à l’autre, au point que le Bulli à la fin paraît un objet transitionnel qui bascule indifféremment du paradis à l’enfer.
Pas de magie au sens baroque, pas d’effets scéniques lorsque chante Orphée, qui apparaît charmer Cerbère (divisé en trois danseurs masqués) et les Esprits comme Papageno charme les animaux avec son Glockenspiel : ce qui règne tout on long de ce magnifique travail c’est une apparente simplicité, comme si nous étions dans un monde au premier degré, où tout est lisible et compréhensible, dans une expression presque naïve, souriante d’abord, triste ensuite, une sorte de monde premier, presque rousseauiste, un Rousseau du Devin de Village, construit autour d’une imagerie des origines : la Musica ouvre l’opéra avec sa valise, comme un peu perdue dans un espace vide, isolée, et assise sur sa valise, personnage presque sorti de La Strada de Fellini, elle ne trouve sens que lorsqu’elle s’approche en souriant de l’orchestre.

La descente aux enfers (accompagnée par la Musique, devenue la Speranza – l’Espérance-, excellente Anna Stéphany, en troupe à Zürich) puis la remontée sont représentées de la manière la plus élémentaire : il suffit d’un tapis rouge où Orphée précède Eurydice, pour la figurer et David Bösch refuse le happy end prévu par Monteverdi et l’apothéose d’Orphée : Eurydice est morte et gît sur la terre. Orfeo désespéré au milieu du groupe d’amis qui s’apprêtait à fêter de nouveau la résurrection du couple, et qui ne lui est plus d’aucun réconfort, ne peut plus chanter et rompt les cordes de sa lyre, Apollon (vu non comme un Dieu triomphant mais comme mendiant claudiquant) intervient pour l’inviter à le rejoindre au ciel et contempler Eurydice dans les étoiles, mais Orfeo s’ouvre les veines et préfère s’allonger auprès de son aimée pour s’ensevelir avec elle.
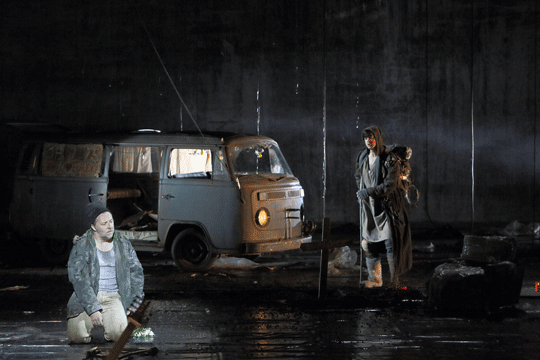
Ainsi donc David Bösch refuse ce merveilleux que la mythologie peut apporter pour lui préférer le merveilleux – si l’on peut dire – humain de la passion amoureuse et du désespoir. Il n’y rien de surhumain dans la manière de représenter l’histoire, elle est au contraire très linéaire, voire parabolique, Orphée et Eurydice rejoignant Roméo et Juliette, ou Tristan et Yseult dans le monde des amants qui vivent l’Eros définitif à travers Thanatos. Le drame n’en est que plus fort, et l’adhésion n’en est que plus vive.
Dans une salle au rapport scène-salle idéal pour ce type de travail où les chanteurs sont proches, où la mise en scène apparaît très épurée et stimulant en même temps l’imaginaire. Le drame s’apaise presque devant l’émotion. Il n’y a plus “spectacle” qui serait divertissement un peu extérieur et formel, mais intériorisation dans une simplicité et une épure qui favorisent la rentrée en soi.

Cette simplicité, le chant époustouflant de Christian Gerhaher, Orfeo baryton, et donc inhabituel en est le modèle. On est d’abord sous le charme d’un timbre clair d’une douceur ineffable, qui n’a pas le style quelquefois trop apprêté d’un Fischer-Dieskau, mais qui au contraire cultive une ligne de chant qui semble naturelle, fluide, avec une diction miraculeuse et une expressivité uniques, y compris dans les moments plus tendus où la voix s’élargit. Chaque note, chaque mot est scandé voire sculpté et pourtant rien ne semble artificiel. Miracle de style et miracle de maîtrise d’un chant direct sans une once d’affèterie : nous sommes aux antipodes d’un chant hyper élaboré comme quelquefois peut paraître le chant baroque, mais toute l’émotion procède de l’impression d’évidence. L’auditeur peut se reporter à YouTube où la Bayerische Staatsoper a posté “Possente Spirto” sans doute le moment le plus extraordinaire de la soirée. C’est bluffant.
Toute la compagnie d’ailleurs m’est apparue cultiver cette simplicité, qui est évidemment l’expression suprême du travail : apparaître comme le parangon de l’évidence aussi bien des chanteurs qui viennent de la troupe, à commencer par Elsa Benoît, Euridice à la fois élégante et maîtrisée, mais aussi Tareq Nazmi, Goran Jurić, Plutone, Dean Power, Apollo exemplaire vu de manière inhabituelle par la mise en scène (un mendiant claudiquant) qui était la veille Elemer d’Arabella.

Ce qui caractérise l’ensemble de la compagnie c’est une expression loin de toute minauderie ou d’une quelconque recherche de l’artifice : Anna Stephany (La Musica/La Speranza) est à ce titre exemplaire ou la très belle Proserpina (qui chante aussi la messagiera dans une intervention très émouvante) d’Anna Bonitatibus, très belle en scène, chantant avec profondeur et beaucoup de sentiment, mais sans jamais en rajouter dans la déploration (quand elle chante la messagiera) et toujours avec une certaine noblesse.

Son arrivée en messagère de malheur, ou sa tenue en Proserpine à la robe constellée, sont de vrais moments de théâtre, qui tiennent exclusivement à sa présence. Notons aussi les esprits (qui sont aussi les bergers) de Mathias Vidal (excellent pastore I) Jeroen de Vaal, James Hall et Simon Robinson, avec un effort de la mise en scène de caractériser chacun pour éviter tout ce qui pourrait ressembler à une vision faite de lieux communs ou de figures imposées, plutôt que des individus vivants et singuliers.
Ce naturel dans l’expression est aussi ce qui caractérise l’excellent chœur de la Zürcher Sing Akademie dirigée par Tim Brown, d’une grande fraîcheur vocale au son impressionnant et d’une belle présence scénique, projetant une image de jeunesse et de bonheur sans mélange. Enfin, l’orchestre composé d’éléments du Bayerisches Staatsorchester de l’opéra et du Monteverdi-Continuo Ensemble est dirigé par Christopher Moulds, et accompagne les solistes avec une grande efficacité. Le dialogue entre Orfeo et l’orchestre dans l’impressionnant « Possente Spirto e formidabil Nume », l’air central d’Orfeo, où les instruments solistes répondent tour à tour aux paroles est un moment exceptionnel où la qualité de l’accompagnement orchestral contribue à créer une très grande émotion. Sans jamais là non plus imposer une présence qui serait envahissante, mais sans être un simple accompagnement, l’orchestre est un véritable personnage tantôt discret, tantôt présent, avec une vraie ligne rigoureuse et peu décorative dans une musique où il est si facile de faire de la maniera excessive : il en résulte une fraîcheur où tout se répond, le chant, le chœur, la mise en scène et l’orchestre dans une harmonie qui fait image : il m’a rarement été donné de voir un Orfeo aussi fluide, aussi naturel, aussi présent et en même temps aussi jeune, aussi frais et aussi fort.
Voilà encore une réussite de la Bayerische Staatsoper là où on l’attendait moins. On aimerait voir David Bösch, comme Barrie Kosky à Berlin (et avec quel bonheur) continuer à travailler la trilogie Monteverdienne, vu la réussite éclatante et émouvante de cet Orfeo.[wpsr_facebook]