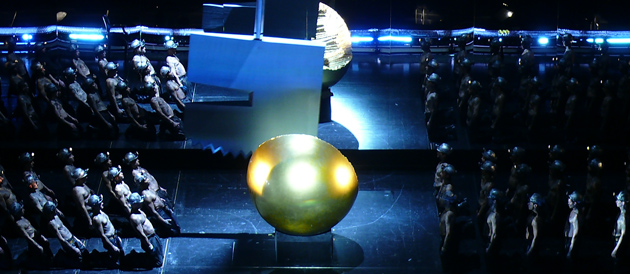Six nouvelles productions, 10 reprises et donc trois productions en moins que la saison actuelle (c’est la crise…): 3 Mozart, 1 Verdi, 2 Puccini, 1Cilea, 1 Strauss, 1 Rossini, 1 Humperdinck, 5 opéras en français (Faust, Alceste, Le Cid, Le Roi Arthus, Pelléas et Mélisande) et 1 Dvorak. Voilà une saison (la dernière préparée par Nicolas Joel) qui se colore d’un répertoire français connu (Faust et Pelléas) et moins connu (Le Cid et Le Roi Arthus, qui fait son entrée à l’Opéra de Paris) et de nouvelles productions de standards tiroir-caisse: la Tosca de Werner Schröter, qui a fait les beaux soirs de Bastille depuis vingt ans et qui est sans doute amortie depuis des lustres, est remplacée par une production de Pierre Audi, dont il faut attendre sans doute un travail propre et suffisamment sage pour ne pas effrayer. Après Coline Serreau dont le Barbier de Séville a été vu suffisamment semble-t-il depuis 2002, c’est la production du grand Théâtre de Genève qui est importée, signée Damiano Michieletto qui va ainsi faire sa première mise en scène à Paris.
Pour les stars, il faudra repasser plus tard: pas de Jonas ni de Nina, ni évidemment de Anja, qui aura fait sa première apparition avec l’Orchestre de l’Opéra cet été…mais à Lucerne .
Pas de stars de la baguette non plus, mais des débuts dignes d’intérêt, comme ceux de Dan Ettinger dont on fait grand cas en terre germanique et américaine pour La Traviata, ceux de Constantin Trinks et Patrick Lange, deux jeunes baguettes germaniques des plus intéressantes qui se partageront Die Zauberflöte et des retours comme celui d’Alain Altinoglu dans Don Giovanni, ou de Michel Plasson dans Faust et Le Cid; enfin, un éternel retour, celui de Daniel Oren, pour la nouvelle production de Tosca (il alternera avec Evelino Pido’, autant dire le ying et le yang) et pour la nouvelle production d’Adriana Lecouvreur . Philippe Jordan dirigera moins cette année et s’est réservé seulement trois productions Die Entführung aus dem Serail, Pelléas et Mélisande, Le Roi Arthus, ainsi qu’un cycle des symphonies de Beethoven en concert.
Si cette saison propose quelques soirées digne d’intérêt, on ne peut pas dire qu’elle soit vraiment stimulante; on a l’impression une fois de plus que la travail consiste à mettre des noms devant des titres, sans vrai projet, qu’il faut remplir les caisses et donc Tosca (20 représentations!), Traviata, Bohème, Zauberflöte, Don Giovanni, Faust font office de tiroir-caisse.
Du côté des distributions, même couleur gris-répertoire, même si on note le retour fort bienvenu de la grande Karita Mattila dans Ariane à Naxos, une reprise bien distribuée dirigée par Michael Schønwandt avec par ailleurs Sophie Koch, Daniela Fally et Klaus Florian Vogt dans Bacchus (il FAUT y aller). On reverra avec immense plaisir Stéphane Degout pour Pelléas et Mélisande (Pelléas) et pour Alceste (le Grand prêtre), une reprise de la production de Py avec cette fois Véronique Gens et le jeune et très talentueux Stanislas de Barbeyrac dans Admète. Rusalka revient aussi avec Olga Guryakova, dans la production Carsen, mais Lyon propose l’an prochain une Rusalka autrement stimulante, celle de Stefan Herheim vue à La Monnaie et à Bercelone.
Malgré une saison où apparaissent Alagna, Antonacci, et Gheorghiu le pompon noir sera sans doute porté par Tosca avec l’insupportable Oksana Dyka et Martina Serafin, qui s’est fait jeter à la Scala dans le rôle, et où, seule, Béatrice Uria-Monzon tiendra sans doute la route; parmi les trois ténors prévus pour Cavaradossi, Marcelo Alvarez sera sans doute le phoenix des hôtes de ces bois (on a les phoenix qu’on peut), les autres étant plus ou moins des ténors à décibels (Berti et Giordano). Un nouveau ténor pointe à l’horizon d’ailleurs, Khachatur Badalyan qu’on va entendre plusieurs fois. Mais dans l’ensemble, il n’y a pas de production qui puisse accrocher l’intérêt véritable, pas un moment qu’on doive vivre toutes affaires cessantes: c’est un peu triste et c’est dommage.
Alors regardons d’un peu plus près les nouvelles productions, dont certaines le sont seulement pour Paris: Le Cid vient de Marseille, Le Barbier de Séville vient de Genève, Adriana Lecouvreur a déjà été vue à Londres.
Il Barbiere di Siviglia, sera dirigé par Carlo Montanaro, ex violoniste de l’orchestre du Mai musical florentin, actuel directeur musical du Teatr Wielki, l’opéra de Varsovie qui a circulé dans bien des théâtres (de Macerata à Graz, de Stuttgart à Berlin, de Reggio Calabria à Tel Aviv) et qui fait escale à Paris. Un chef de bonne réputation pour le répertoire italien.
La mise en scène est assurée par Damiano Michieletto (décor de Paolo Fantin), nouvel enfant terrible de la scène italienne, qui a déjà fait parler de lui à Salzbourg (Bohème) et à la Scala: elle sera décoiffante, comme tout ce qu’il fait.
La distribution dominée par Karine Deshayes (qui alterne avec Marina Comparato), très aimée de Nicolas Joel, ne semble pas destinée à marquer les esprits même si on entendra avec curiosité René Barbera, venu de Chicago qui semble marcher sur les traces de Juan-Diego Florez et qui écume déjà les scènes américaines (en alternance avec Edgardo Rocha, jeune ténor uruguayen valeureux) en Almaviva, Carlo Lepore (et Paolo Bordogna) en Bartolo, Dalibor Jenis en Figaro, alternant avec Florian Sempey, qui sera lui aussi très intéressant à entendre. (14 représentations du 19 septembre au 3 novembre). L’intérêt de ce Barbier de Séville réside essentiellement dans la découverte de ces deux jeunes voix, un ténor et un baryton.
Tosca, de Puccini, mise en scène de Pierre Audi, direction musicale Daniel Oren et Evelino Pido’. Oren est dans son élément, Pido’ est inattendu dans ce répertoire, mais pourquoi pas. Deux chefs néanmoins aux styles très différents, mais deux professionnels. Mon conseil aller plutôt écouter Pido’. 20 représentations du 10 octobre au 28 novembre et trois distributions dont j’ai révélé plus haut les merveilles. Restent les (quatre) Scarpia: Ludovic Tézier, et ce sera sans doute bon, comme d’habitude, Georges Gagnidze, sans doute un peu moins bien, et Sergey Murzaev en alternance avec Sebastian Catana. Avec 10 chanteurs dans les principaux rôles, aux qualités d’acteur contrastées, on souhaite bien du plaisir au metteur en scène. Une Tosca de grande industrie.
Bonne idée que de proposer Die Entführung aus dem Serail devenu plus rare sur les scènes. Philippe Jordan assurera la direction musicale de la première série (9 représentations en octobre et novembre) tandis que la seconde série (10 représentations en janvier et février) sera dirigée par Marius Stieghorst, son assistant devenu directeur musical de l’Orchestre Symphonique d’Orléans. La distribution est dominée par Erin Morley, Konstanze qui assure la première série, tandis qu’Albina Shagimuratova (La Lucia de la Scala cette saison) sera Konstanze dans la seconde série. Belmonte sera le très bon Bernard Richter en automne et Frédéric Antoun en hiver, très intéressant lui aussi. Anna Prohaska sera Blonde (automne), tandis que Sofia Fomina le sera en hiver.
La mise en scène sera assurée par Zabou Breitman, et ce sera sa première mise en scène d’opéra.
Le Cid de Massenet vient de Marseille, dans une mise en scène de Charles Roubaud et sera dirigé par Michel Plasson, un nom qui suffit à rendre cette nouvelle production digne d’intérêt. La distribution construite autour du trio Roberto Alagna, Anna Caterina Antonacci et Annick Massis est entièrement française (Paul Gay, Luca Lombardo etc..). Une fois de plus, l’appel à une production extérieure montre que l’on ne parie pas sur la pérennité du titre dans le répertoire. Mais c’est l’occasion une fois dans une vie d’écouter Le Cid, même si Corneille, c’est bien mieux!
Entrée à l’Opéra de Paris du Roi Arthus d’Ernest Chausson (que Strasbourg présente en mars 2014 dans une mise en scène de Keith Warner et la direction musicale du canadien Jacques Lacombe), créé à Bruxelles en 1903. Après 111 ans, il était temps et c’est une bonne initiative de la direction de l’Opéra. La distribution est prestigieuse: Sophie Koch, Thomas Hampson, Roberto Alagna, Bernard Richter, Peter Sidhom et c’est Philippe Jordan qui dirigera, ajoutant à son répertoire une oeuvre où on ne l’attend pas.
La mise en scène est confiée au très professionnel Graham Vick, dans des décors et costumes de Paul Brown. Il faut évidemment y aller (10 représentations en mai et juin 2015).
Dernière nouvelle production de la saison, Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea. Comme il se doit à Paris pour ce répertoire, c’est à Daniel Oren qu’on confie les rênes de l’orchestre et c’est David Mc Vicar qui en assurera la mise en scène déjà présentée à Londres en 2012 (avec Kaufmann et Gheorghiu, un DVD DECCA en témoigne), une production très naturaliste: il ne manque pas un bouton de guêtre à la reconstitution de la Comédie Française au XVIIIème.
Rappelons qu’Adriana Lecouvreur est entrée à l’Opéra de Paris en 1993-1994, sous la brève ère Jean-Marie Blanchard, avec Mirella Freni dont ce fut la dernière apparition à l’Opéra: elle y reçut des ovations délirantes dont les échos s’entendent encore à Bastille.
C’est Angela Gheorghiu (en alternance avec Svetla Vassilieva) qui sera l’amoureuse Adriana, face au Maurizio de Marcelo Alvarez, le ténor à tout faire, qui est en général meilleur dans ce répertoire que dans Verdi, et Luciana d’Intino sera la méchante Princesse de Bouillon. Nous irons, bien sûr, avec notre bouquet de violettes…
Enfin notons les concerts, qui, en dehors de l’intégrale Beethoven dirigé par Philippe Jordan (9ème symphonie les 17 juin et 13 juillet avec Ricarda Merbeth, Daniela Sindram, Robert Dean Smith, Günther Groissböck) afficheront la 4ème de Brahms et surtout Erwartung de Schönberg avec Angela Denoke dirigé par Ingo Metzmacher (14 octobre) et la 7ème de Mahler le 4 avril où l’on découvrira le jeune Cornelius Meister, un des chef allemand qui monte..
Fin de règne de Nicolas Joel. S’il n’a pas brillé par le projet ou l’originalité, et cette saison en est la preuve, il laisse à Stéphane Lissner un théâtre en état de marche, en bon état, avec une politique marketing bien rodée: le marketing consiste à faire bien vendre des produits moyens.
Nul doute que Lissner pourra se pencher sur les contenus sans avoir (trop) de problèmes de contenant, nous l’attendons avec intérêt, voire impatience.
[wpsr_facebook]