
Nos rappels sur le Blog du Wanderer
Götterdämmerung 2013
Götterdämmerung 2014
Götterdämmerung 2014(2)
Götterdämmerung 2015
Götterdämmerung 2016
Abécédaire

La fin de la belle histoire de la naissance et de la fin d’un monde. Une fin dans les flammes qui dévorent et dans la lumière de l’or qui repose de nouveau au fond du Rhin. Une fin que marque le retour à l’ordre éternel…
Telle est l’attente du spectateur au terme de la plus longue et sans doute plus spectaculaire des journées du Ring, celle où pour la première fois, apparaît le chœur, c’est à dire le peuple, c’est à dire les autres, ceux qui ne font pas partie du jeu ouvert à Rheingold. Ce peuple mené par Hagen apparaît pour montrer, pour la première fois dans cette histoire que Hagen est d’abord un politique, il utilise son pouvoir populaire pour réaliser ses desseins et donc cet appel au peuple est l’intrusion du politique dans le mythique.
Le monde comme il va (mal)
Castorf évite le mythe, au moins celui qui nous fait rêver ou qui entraîne des mécanismes d’identité ou de catharsis. Il distancie, analyse, et fait en sorte que le prosaïque le plus cru (ici Patric Seibert au milieu des légumes et des mayonnaises, Gutrune bouffant des boites de chocolat, ou Brünnhilde lisant le Spiegel, voire Siegfried tué au milieu des cageots) mais c’est évidemment un prosaïque choisi, qui vise à montrer que le mythe est ce que nous vivons au quotidien, qu’il n’y pas un monde des Dieux et des héros, mais qu’il y a notre monde, au quotidien, celui que nous avons bâti ou que l’Histoire nous a livré, même s’il insiste sur des survivances profondes des mondes païens comme le Vaudou, dont il fait des trois Nornes des sortes d’officiantes (en habits composant le drapeau allemand…).
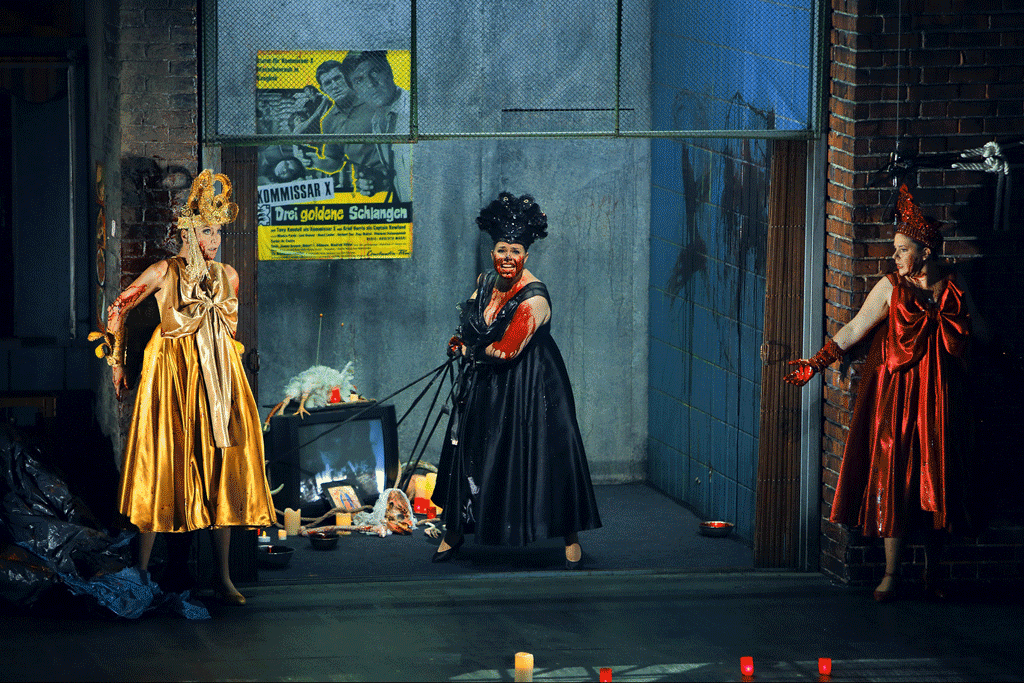
En ce sens l’entreprise de Castorf est évidemment la plus forte à Bayreuth depuis Patrice Chéreau, et sans diminuer les qualités de celle de Kupfer, sans doute la troisième du trio (les autres mises en scène du Ring, Hall, Kirchner, Flimm, Dorst n’ayant pas apporté de regard fondamentalement novateur, au-delà d’images et au-delà d’idées çà ou là intéressantes).
C’est pourquoi ceux qui estiment Frank Castorf dépassé, dernier avatar de la génération du Regietheater se rassurent sans doute parce qu’ils sont culturellement hermétiques à son univers hyper-référencé dont l’abécédaire du site Wanderer n’est qu’un aperçu, tant le monde de Castorf, à l’image du nôtre, est foisonnant : c’est bien parce qu’il nous parle trop crûment que certains détournent les yeux, voire le cerveau.
Et dans ce Götterdämmerung, il serait trop simple de penser qu’une fois transformé le Walhalla en Wall Street, la messe est dite. La messe serait trop simple. D’ailleurs Castorf ici ne fait que reprendre une idée de Wieland Wagner, mort il y a 51 ans, peu suspect de crime de Regietheater…
Le final de Götterdämmerung nous concentre sur un feu réduit à l’embrasement d’un baril de pétrole que tous regardent fascinés, pendant que tourne le monde. Il est évident que cette tournette sur laquelle est installé le monumental décor d’Aleksandar Denić c’est aussi le temps qui passe, l’heure qui tourne, l’idée même d’une permanence et d’un changement dans une continuité, comme la présence de l’horloge universelle Urania le rappelait dans Siegfried. On ne peut s’étonner alors que ce Ring n’ait pas de fin, que Brünnhilde s’en aille comme vers de nouvelles aventures après qu’elle eut renoncé à allumer le brasier, après que les filles du Rhin eurent aussi éteint les briquets, et que ceux qui restent (filles du Rhin et Hagen) regardent fascinés un petit baril qui brûle. Castorf nous annonce simplement que rien ne se termine, et que le Ring de Wagner pointe des mécanismes de désir, de pouvoir, d’ambition qui avec des instruments divers selon l’époque, Or ou Or noir hier, nucléaire ou numérique demain, installent un monde dont les caractères permanents sont la désillusion et l’oppression.
Nous avons évoqué ailleurs l’apparition de personnages « castorfiens » dans notre monde d’aujourd’hui, Ceaucescu et son Walhalla délirant de Bucarest, Trump, Berlusconi, Kim-Jong-Un ou un Poutine tout en muscles siegfriedesques, quant à moi je trouve à Teresa May un air de Fricka – de Rheingold– au petit pied… tout simplement parce que notre monde tel qu’il est, est exactement ce que Castorf en lit. Ce n’est pas notre monde qui est castorfien, c’est simplement Castorf qui est notre monde…Et Castorf nous en dit la permanente absence de sens. Pas de cycle cyclique, où l’on reviendrait sans cesse aux origines, mais un Ring en continu, aux épisodes semblables et différents, le soap-opera éternel qu’annonçait Rheingold.
C’est sans doute la plus amère et la plus pessimiste des visions, qui ne laisse aucun espoir et c’est sans doute ce qui crée chez le spectateur des tiraillements, pris entre cette mise en scène très dure et distanciée et une musique qui semble au contraire favoriser nos délires cathartiques..
Dans ce cadre général, quelques points cette année ont focalisé mon attention.
Hagen
Dans cette vision que sanctionne un Götterdämmerung virtuose (la mise en scène du 2ème acte simplement étourdissante), un personnage surnage, c’est Hagen, qui tire les fils de l’histoire : un personnage qui chez Castorf acquiert une profondeur inhabituelle, différente en tous cas des Hagen noirs tout d’une pièce qu’on voit souvent.
Hagen est un personnage hybride, qu’Alberich a eu avec Grimhilde : l’importance de la mère est grande chez Hagen, on en parle dès les premières répliques de l’acte I puisque c’est aussi la mère de Gunther et Gutrune. Il y a chez Hagen le regret que sa mère l’ait livrée à Alberich, et donc ne lui ait pas donné de repos, Hagen ne sait ni aimer ni prendre le plaisir et il en éprouve une sorte d’amertume éternelle. Il est probable que cet anneau recherché par Alberich, Hagen ait l’idée de le garder pour lui : Alberich est toujours pris au piège par plus malin…Hagen, héros terrestre et politique, utilise sa bande, sa horde ou son peuple pour célébrer les noces de Siegfried et Gutrune et ne cesse de manœuvrer chacun, comme le ferait un Wotan terrestre, et tout comme Wotan Hagen ne dédaigne pas l’inceste. Castorf introduit le désir de Hagen vers Gutrune, sans doute réciproque, parce que le désir n’a pas de frontières dans le monde sans aventure de Gibichungen, mais aussi dans le monde plus général du Ring.
Ainsi Hagen est à Alberich ce que Siegmund est à Wotan, le fils conçu pour récupérer Or, Anneau et puissance, mais si à Siegmund le temps a manqué, Hagen a développé une intelligence (que Gunther appelle sagesse) qui en fait un personnage particulier dans le Ring, notamment en opposition aux Gibichungen écervelés, un personnage qui a plus que d’autres, une psychologie, notamment au deuxième acte et qui après la visite de son père qui lui demande de reconquérir l’anneau pour eux deux, décide sans doute de le reconquérir pour lui-même.
Plusieurs scènes au troisième acte semblent poser des questions irrésolues à propos de Hagen, essentiellement dans l’image qu’en renvoient les projections.
L’écran est utilisé ici comme les morceaux d’un film de cinéma pas encore terminé qui constitueraient une histoire autonome, une sorte d’histoire du Ring telle qu’on la veut, avec sa nature, sa forêt, son vrai Grane (dans Siegfried).
À peine Hagen a-t-il tué Siegfried, qu’on le voit à l’écran marcher dans une forêt, une image d’une insigne poésie : rentre-t-il au bercail pour annoncer la nouvelle ? profite-il de ce répit pour à son tour jouir de l’instant, une fois la tâche terminée, pour vivre un peu en harmonie avec la nature, pour être un peu lui-même ? Cet Hagen-là est en tous cas inhabituel, dans une sorte de solitude apaisante.
Car autour de lui, un père honni (Alberich), qui part avec sa valise vers un ailleurs indéfini (comme Brünnhilde à la fin) et qui même dans l’histoire de Wagner, ne meurt pas (Kupfer l’avait bien souligné), deux Gibichungen, l’un, Gunther, une frappe lâche, l’autre, Gutrune, une petite vertu, qui se laisse tripoter par Hagen, mais aussi par les compagnons de Hagen au deuxième acte, pas plus recommandable que les autres, une sorte de ravissante idiote. Pas de quoi être stimulé…
La dernière image du Ring est aussi d’une grande poésie : pendant qu’au bord du baril qui brûle (avec l’anneau dedans) filles du Rhin et Hagen sont plongés dans une sorte de désarroi comme s’il n’y avait plus qu’à rester dans cette fixité interrogative en un « et après ? » terrible, sur l’écran défile la fin qu’on aime et qu’on a envie de voir, la fin pour la galerie : les filles du Rhin observant le cadavre d’Hagen avec sa crête originelle, Hagen de cinéma glissant et s’éloignant sur l’eau. La fin de théâtre est moins optimiste.
Les deux fins sont contradictoires et disent chacun l’opposé de l’autre. Il y a une fin de cinéma « pour le cinéma ». Et une fin de théâtre, et seul le théâtre ne raconte pas d’histoire mais l’Histoire.
Siegfried
Siegfried, arrivé avec ses breloques, Notung, c’est à dire une Kalachnikov enveloppée comme pour un cadeau à donner à Gunther, qui s’en amuse comme un gosse (comme Siegfried dans Siegfried), un Tarnhelm dont il ne sait pas l’usage et que Hagen va lui apprendre, mais sans anneau qu’il reprendra à Brünnhilde en fin d’acte, comme s’il devait reconquérir les breloques du dragon, comme si la mémoire de Brünnhilde lui faisant défaut, il lui fallait retrouver le statu quo ante, celui qu’il avait avant de la connaître et de connaître la peur.
Le Siegfried du Götterdämmerung, ce n’est pas le Siegfried qui a été un peu éduqué par Brünnhilde (les runes), mais celui d’avant : la brute-qui-tue-tout-le-monde. L’effet du philtre de Hagen est de redonner à Siegfried son identité de petite frappe, et ainsi la boucle est bouclée : ils sont tous les mêmes ! D’ailleurs le combat de Hagen et Siegfried au deuxième acte (avec leurs planches) les met exactement au même niveau.

Jusqu’au troisième acte Siegfried reste le même mauvais garçon, il bat le pauvre type qui dort avec une jeune femme, et avec les filles du Rhin, il se comporte comme avec l’Oiseau dans Siegfried, il est vrai qu’elles usent de tous leurs moyens appétissants pour lui prendre l’anneau. Siegfried n’est ni bon ni mauvais, il est ce que le monde a fait de lui, il n’a pas de distance, pas d’intelligence des rapports humains ni d’ailleurs des rapports avec les femmes qui ne servent qu’à …ça…
Dans ce Götterdämmerung, aucun personnage ne se sauve, ils sont presque tous méprisables à des degrés divers, les seuls à posséder une épaisseur sont Hagen et Brünnhilde, parce que chacun ont une mission et d’ailleurs la même mission. Terrible constat.
Pour Castorf, pareil jeu de massacre (où seul le personnage de Brünnhilde reste un tant soit peu proche de la vision traditionnelle) n’est rendu possible que par le cadre où se déroule l’histoire, nous sommes au moment agité de la Berlin du mur, au moment du pont aérien, et nous passons indifféremment de l’est (Schkopau, Buna et les conglomérats pétroliers de l’Est ) à l’Ouest de l’autre côté du mur (que les personnages allègrement traversent) vu sous l’angle d’un kiosque à Döner berlino-turc (les deux drapeaux y trônent) et d’un magasin de fruits et légumes, ce qui manque à l’Est, comme le montre le personnage incarné par Patric Seibert qui mange une banane en secret, que les allemands de l’Est devaient se procurer à prix d’or ( voir notre article banane de l’abécédaire à ce propos).
La Berlin d’après-guerre cristallise les enjeux de pouvoir et les luttes idéologiques : le fait que l’immense bâche qui croit-on recouvre le Reichstag (allusion à Christo) recouvre en réalité Wall Street, montre pour Castorf en même temps et le vrai pouvoir, et l’inféodation d’une certaine Allemagne, à l’Est Schkopau et à l’ouest Wall Street. Tout cela est d’ailleurs désormais connu et analysé.
Ce qu’ajoute Götterdämmerung, ce n’est pas tant la manière dont les foules sont toujours manœuvrées (Acte II), ou que les idéologies aient toutes les mêmes intérêts (Le pétrole…), c’est que toute cette histoire du Ring passionnante et si agitée finisse dans un néant presque shadockien. Ces Shadocks qui pompent (le pétrole ?) sans jamais construire, c’est ce qui se déroule devant nous : Castorf (qui ne connaît probablement pas cette série culte de la culture médiatique française) arrive au même vide, au même gouffre. Chez Castorf, Siegfried est mort, tout comme Siegmund et Hunding, comme Mime, comme Gunther. Restent vivants à l’ombre de Wall Street Alberich, Brünnhilde, Hagen, les filles du Rhin et Gutrune…bonjour la reconstruction !
Le Ring wagnérien dans son mouvement semblait pourtant proposer quelque chose de plus optimiste, d’ailleurs Chéreau laissait les hommes présents sur scène comme pour dire « au boulot », laissant une trace d’espoir, Kriegenburg à Munich arrive à une vision optimiste de solidarité (Gutrune accueillie par le groupe qui ouvrait Rheingold). Chez Frank Castorf, qui lit notre monde comme soi-disant post idéologique, voire post historique, on conclut par le vide, comme image de notre chute, et de notre désespérante impéritie.
Sans doute cette frustration d’une absence de lendemain possible, de lever de soleil sur une vie éventuelle d’après est-elle totalement anti cathartique et rend un certain public qui a soif d’identification terriblement colère. Mais on ne va pas à Bayreuth pour voir du Walt Disney…
 Il faut à cette vision qui évidemment secoue, une musique qui se déploie d’une manière plus singulière. Parce que devant les scènes finales telles que les voit Castorf, la musique sonne évidemment plus creux, et accentue le malaise : trop plein de beauté devant l’image du vide…Comme dans le final de Siegfried mais pas avec le même discours: le final de Siegfried nous disait qu’il n’y avait rien à croire de l’histoire du couple Brünnhilde-Siegfried et que la musique ne disait pas ce qu’on croyait, le final de Götterdämmerung doit musicalement laisser une place au doute, devrait nous laisser aussi un peu insatisfait, comme lorsqu’on disait de Petrenko qu’il n’était pas assez « spectaculaire ».
Il faut à cette vision qui évidemment secoue, une musique qui se déploie d’une manière plus singulière. Parce que devant les scènes finales telles que les voit Castorf, la musique sonne évidemment plus creux, et accentue le malaise : trop plein de beauté devant l’image du vide…Comme dans le final de Siegfried mais pas avec le même discours: le final de Siegfried nous disait qu’il n’y avait rien à croire de l’histoire du couple Brünnhilde-Siegfried et que la musique ne disait pas ce qu’on croyait, le final de Götterdämmerung doit musicalement laisser une place au doute, devrait nous laisser aussi un peu insatisfait, comme lorsqu’on disait de Petrenko qu’il n’était pas assez « spectaculaire ».
Mais Petrenko regardait attentivement ce qui se passait sur scène.
Avec Marek Janowski, pas de surprise, pas de frustration, pas de second degré. C’est très bien dirigé, très bien mené, avec des tempi larges, avec de la respiration, avec des cordes sublimes, sauf que la musique ne dit pas vraiment ce qui se passe en scène. On peut écouter avec un masque de sommeil, comme certains idiots patentés l’ont fait, on aura le Wagner qu’on attend, le Wagner pour toujours, le Wagner qui fait plaisir à l’oreille sans trop se poser de questions, mais pas le Wagner qui accompagne cette production-là, l’œuvre d’art non totale, mais partielle, Janus qui dit deux choses contradictoires. Je le répète : il n’y a rien à reprocher à l’exécution technique de l’œuvre, en concert cela ferait un effet garanti, mais sans doute aussi si la mise en scène offrait casques vikings et heaumes rutilants.
Mais là, ça coince et ça gêne, parce que les accents ne correspondent pas vraiment entre scène et fosse, sauf peut-être au deuxième acte, dont l’ensemble est très réussi et scéniquement et musicalement, et dont le trio final est enthousiasmant à tous niveaux.
Il ne s’agit pas de crier haro sur le baudet, et de déplorer le départ de Petrenko remplacé par un Janowski non concerné. Mais dans un travail où musique et mise en scène ont été travaillées jusqu’au plus infime détail dès l’origine, on remarque bien trop les deux chemins qui se séparent ou qui quelquefois se rencontrent par hasard.
Autant Rheingold, trop théâtral, n’a pas bien fonctionné dans son rapport scène-fosse,autant Walküre a mieux fonctionné, et Siegfried partiellement. Il en est de même pour ce Götterdämmerung avec ses moments d’ivresse musicale (Acte II, mort de Siegfried et marche funèbre) et ses moments contradictoires où la scène et la musique ne vont pas au même pas. Il n’importe : on sent quand même un travail mieux maîtrisé, plus accompli que l’an dernier, et on sent les chanteurs bien plus à leur aise.
Ce Ring a d’ailleurs été mieux dominé du point de vue vocal, et ce Götterdämmerung le confirme : des Nornes superbes (Christiane Kohl toujours un peu acide cependant, mais Wiebke Lehmkuhl et Stephanie Houtzeel magnifiques), des filles du Rhin toujours aussi fraiches et justes (Stephanie Houtzeel et Weibke Lehmkuhl encore, mais aussi Alexandra Steiner), le chœur impressionnant du deuxième acte, avec une mise en scène si fluide dans un espace si réduit, renforcée par une prise vidéo virtuose, impose sa puissance étonnante, écrasante même, sous la direction d ‘Eberhard Friedrich.
Marina Prudenskaia en Waltraute va au bout du récit de manière honorable, mais elle ne fait pas oublier Claudia Mahnke, ni par l’engagement vocal, ni par l’énergie.
Albert Dohmen est en revanche plus à l’aise dans Alberich : la voix a repris de l’éclat, la diction est toujours d’une clarté impeccable, il impose un profil de Wotan déchu qui va très bien avec la mise en scène.
Markus Eiche, plus à l’aise dans Gunther que dans Donner, fait entre son timbre chaud, avec une belle projection et une magnifique intelligence du texte, la prestation est tout à fait remarquable.
Remarquable comme toujours aussi Allison Oakes dans son personnage de Gutrune ravissante idiote, la voix est bien projetée, bien assise, et elle acquiert dans la scène finale une véritable dimension tragique, une grande Gutrune, probablement une des meilleures sur le marché, pour un rôle difficile à incarner.
Stephen Milling est peut-être encore plus impressionnant cette année que les années précédentes, la voix est magnifiquement projetée, avec une carure vocale (et physique) bluffante. Même sans sa crête (portée par Attila jun, son prédécesseur dans le rôle), il impose sa présence, à la voix rude et retenue, terrible et réservée. Une très grande incarnation.
Stefan Vinke dans Siegfried payait sans doute les efforts déployés dans Siegfried. Le Siegfried de Götterdämmerung est différent du Siegfried de Siegfried, demande moins de force et plus de subtilité et un peu plus de lyrisme, et Stefan Vinke chante avec une émission très nasale qui est indice de fatigue (Lance Ryan avait aussi cette nasalité fréquente). Il reste néanmoins un très grand Siegfried, convaincant. Moins mauvais garçon que Lance Ryan il est un ado poupin et souriant qui ne comprend rien à rien, et qui joue sans cesse à Siegfried, c’est bien vu. Vinke reste le Siegfried du moment.
Catherine Foster vient à bout du rôle avec cran et grandeur, sans fatigue apparente, particulièrement intense et émouvante. Ne l’ayant jamais entendue ailleurs qu’à Bayreuth, je ne sais comment la voix sonne dans une autre salle (Bayreuth reste une salle tellement favorable aux voix !), mais ici, elle est l’une des Brünnhilde les plus vocalement convaincantes qu’on ait vue depuis très longtemps, sans une note ratée, toujours impressionnante par la justesse et surtout, ce qui est plus rare, toujours claire dans sa diction : on entend et on comprend tout. Grandiose prestation.
On quitte ce Ring avec le sentiment d’un spectacle d’exception de très grand niveau musical malgré les réserves exprimées, avec des chanteurs de très haut niveau. Que nous réservera 2020… ?
