 Je remarque que mon compte rendu de La Traviata genevoise est très lu et provoque des opinions contrastées: il est salutaire que l’opéra provoque encore des discussions passionnées, comme l’a remarqué l’un des commentateurs. Mais en ce week-end froid et vaguement neigeux, je me suis mis à écouter les Traviata (en évitant Callas, pour ne pas être accusé d’être un vieux barbon radoteur) qui remplissent ma discothèque, et j’ai eu quelques surprises: il y a longtemps que je n’en avais écouté certaines, qui surgissent à l’audition et qui montrent combien la relation du chant au public change, c’est normal et c’est la loi de l’herméneutique. L’audition de Mirella Freni par exemple stupéfie. Pareil chant aujourd’hui planterait là les Netrebko et autres Ciofi et Harteros (dont entre nous le seul enregistrement existant avec Mehta n’est pas extraordinaire, même si ce que j’entendis à Berlin fut grandiose).
Je remarque que mon compte rendu de La Traviata genevoise est très lu et provoque des opinions contrastées: il est salutaire que l’opéra provoque encore des discussions passionnées, comme l’a remarqué l’un des commentateurs. Mais en ce week-end froid et vaguement neigeux, je me suis mis à écouter les Traviata (en évitant Callas, pour ne pas être accusé d’être un vieux barbon radoteur) qui remplissent ma discothèque, et j’ai eu quelques surprises: il y a longtemps que je n’en avais écouté certaines, qui surgissent à l’audition et qui montrent combien la relation du chant au public change, c’est normal et c’est la loi de l’herméneutique. L’audition de Mirella Freni par exemple stupéfie. Pareil chant aujourd’hui planterait là les Netrebko et autres Ciofi et Harteros (dont entre nous le seul enregistrement existant avec Mehta n’est pas extraordinaire, même si ce que j’entendis à Berlin fut grandiose).
Et pourtant, la Traviata de Freni à la Scala fut l’une des plus grandes broncas des cinquante dernières années, au point que le théâtre renonça au titre pour des dizaines d’années.

On va donc commencer par cette interprétation, qui je le répète non seulement montre ce que chanter veut dire, mais aussi ce que diriger veut dire: Herbert von Karajan à la tête de l’orchestre de la Scala est tout simplement, non pas exceptionnel non pas prodigieux, mais simplement évident, et d’une évidence cruelle quand on le compare à d’autres. Accompagnée par le pâle Renato Cioni, au timbre nasal, et très banal et par le très correct Mario Sereni, la jeune Mirella Freni, gloire émergente du chant italien, affronte Violetta.
Certes Freni évite le mi-bémol final du premier acte, comme bien d’autres, et fait passer à la limite de la casse les ré bémol de “Gioir”, mais pour le reste, quelle classe! quelle science du chant! quelle sensibilité et quelle extraordinaire présence vocale. Il faut entendre dans ‘”Amami Alfredo” et Freni (même sans la largeur voulue), et surtout Karajan, accompagnant plus que dirigeant, accompagnant le dessein vocal . Il faut surtout entendre Freni dans “L’addio del passato”, éthéré, fatigué, épuisé, hésitant, mais en même temps chanté, avec une couleur désespérée, jouant sur le volume, la variété des couleurs, et à côté Karajan mimant avec son orchestre les couleurs de la voix. Un chant bien appuyé sur le souffle et contrôlé, qui permet d’élargir et de vibrer. Même sans le Da Capo quelle leçon! On disait toujours dans les années 70 que Freni ne chantait jamais si bien que guidée par Karajan, y compris dans des rôles dans lesquels on ne l’attendait pas: je me souviens de son Aïda à Salzbourg avec le Maître en 1979, toujours si attentif aux voix qu’il ne les couvrait jamais (on le sent aussi dans cette Traviata dont l’orchestre phénoménal est la vedette incontestée). Freni est restée le modèle des Aïda avec un troisième acte inégalé pour moi. Et pourtant que n’a-t-on pas écrit sur son “erreur” d’avoir accepté le rôle. Et puis il y a ce phénomène d’une voix restée fraîche jusqu’à la fin de sa carrière (il faut l’avoir entendu dans Desdemona, dans Tatjana où elle était encore fabuleuse dans les années 80). A écouter pour être surpris, et par Freni, et par Karajan au tempo ni lent (il l’est pourtant souvent mais ne semble pas parce qu’il n’est jamais lourd), ni rapide ( et pourtant il n’est aussi notamment au début). Et le public d’alors voulait donner une leçon au chef, dont la venue à la Scala pour Traviata semblait un crime de lèse-italianité, lèse-verdianité, et un tsunami a emporté la salle dressée contre le plateau à la fin du premier acte ( parce que Freni était là moins à l’aise, mais pas scandaleuses) même si la jeune et frêle Freni d’alors est venue crânement braver ce public qui se trompait, en saluant la tête haute et les mains sur les hanches. Un “Osso duro”, la tendre Mirella!
On trouve plus facilement sur le marché la même Traviata avec Anna Moffo qui quant à elle avait triomphé, toujours aux côtés de Karajan. Mais l’enregistrement ARKADIA que je possède donne en bonus des extraits d’Anna Moffo, effectivement très bonne avec les aigus qui sont dûs, mais qui en même temps me parle moins que Mirella Freni.
 Dans ma pile qui est très désordonnée, je trouve maintenant l’enregistrement du MET, James Levine, Cheryl Studer, Luciano Pavarotti, Juan Pons et là mon oreille fait à peu près la chute libre de Felix Baumgartner. Cela ne commence pas si mal pourtant avec un prélude assez lyrique, très léger, voire intime, mais continue mal avec un tempo assez lent et sans mordant. Big Luciano n’est pas dans un de ses meilleurs moments, son Alfredo est un peu fatigué, Pons à la limite de la justesse. Et Cheryl Studer à sa place ni dans Verdi ni dans le rôle. Avec sa voix d’une qualité exceptionnelle, Cheryl Studer eût été la plus grande straussienne de la fin du XXème siècle, elle était une mozartienne de qualité, elle n’a jamais brillé dans le répertoire italien et s’est même largement fourvoyée (Lucia di Lammermoor), en se prétendant colorature dramatique d’agilité…
Dans ma pile qui est très désordonnée, je trouve maintenant l’enregistrement du MET, James Levine, Cheryl Studer, Luciano Pavarotti, Juan Pons et là mon oreille fait à peu près la chute libre de Felix Baumgartner. Cela ne commence pas si mal pourtant avec un prélude assez lyrique, très léger, voire intime, mais continue mal avec un tempo assez lent et sans mordant. Big Luciano n’est pas dans un de ses meilleurs moments, son Alfredo est un peu fatigué, Pons à la limite de la justesse. Et Cheryl Studer à sa place ni dans Verdi ni dans le rôle. Avec sa voix d’une qualité exceptionnelle, Cheryl Studer eût été la plus grande straussienne de la fin du XXème siècle, elle était une mozartienne de qualité, elle n’a jamais brillé dans le répertoire italien et s’est même largement fourvoyée (Lucia di Lammermoor), en se prétendant colorature dramatique d’agilité…
Ainsi sa Violetta a à peu près les notes (mais pas le mi-bémol, elle non plus), mais avoir les notes n’a jamais signifié avoir et le style et la personnalité ni être une incarnation. Au niveau de l’incarnation, ce n’est pas grand chose, cela ne vibre pas, cela ne sent pas, cela ne palpite pas. Elle remplace l’émotion du chant par des larmes ou des sanglots à la fin de “Dite alla giovine”, et son “addio del passato” manque de ressenti, reste plat comme un exercice de style (et encore quelques sanglots, faute de mieux), même avec le Da capo.
Passons cette version indifférente pour examiner rapidement trois versions Kleiber, l’une, officielle, avec Cotrubas, Domingo et Milnes, l’autre “live” avec Cotrubas, Aragall et Bruson, la dernière avec Gasdia, Dvorsky, Zancanaro.
 La version officielle de La Traviata (1977) dirigée par Carlos Kleiber n’a pas à sa sortie provoqué un concert de louanges. Peut-être parce que Ileana Cotrubas, pourtant très réclamée à l’époque, n’est pas considérée comme une Traviata d’exception. La direction de Kleiber est évidemment exceptionnelle, de dynamisme, de contrastes, de ruptures de ton(entre le prélude et la fête par exemple), mais trahit quelquefois quelques défauts véristes, tout en respectant les coupures traditionnelles, à quelque exception près. Alfredo n’est pas un rôle pour le Domingo de l’époque qui abordait Otello, malgré son timbre de rêve, mais en revanche Milnes n’est pas exempt d’élégance lui qui est souvent un peu froid. Ileana Cotrubas, une grande Mimi, n’est pas une exceptionnelle Traviata, sa personnalité ne colle pas vraiment au personnage, même si les notes y sont le plus souvent, les sons n’y brillent pas toujours, notamment les aigus et le manque de legato dans les morceaux de bravoure (mi bémol du premier acte).
La version officielle de La Traviata (1977) dirigée par Carlos Kleiber n’a pas à sa sortie provoqué un concert de louanges. Peut-être parce que Ileana Cotrubas, pourtant très réclamée à l’époque, n’est pas considérée comme une Traviata d’exception. La direction de Kleiber est évidemment exceptionnelle, de dynamisme, de contrastes, de ruptures de ton(entre le prélude et la fête par exemple), mais trahit quelquefois quelques défauts véristes, tout en respectant les coupures traditionnelles, à quelque exception près. Alfredo n’est pas un rôle pour le Domingo de l’époque qui abordait Otello, malgré son timbre de rêve, mais en revanche Milnes n’est pas exempt d’élégance lui qui est souvent un peu froid. Ileana Cotrubas, une grande Mimi, n’est pas une exceptionnelle Traviata, sa personnalité ne colle pas vraiment au personnage, même si les notes y sont le plus souvent, les sons n’y brillent pas toujours, notamment les aigus et le manque de legato dans les morceaux de bravoure (mi bémol du premier acte).
 Un an plus tard, sur scène, c’est autre chose: entourée de Bruson et de Aragall, avec l’ambiance du théâtre et non du studio, c’est nettement différent. D’abord Kleiber encore plus théâtral et plus rapide dès le prélude, et moins éthéré que dans le disque officiel. L’explosion initiale de la fête qui fait contraste part à une vitesse étourdissante, haletante, virevoltante. Même les chanteurs portés par la scène, et Cotrubas en tête font preuve de dynamisme et d’engagement avec la voix claire et solaire de Giacomo Aragall. Ileana Cotrubas, dans le premier acte est très engagée, très en forme, les aigus sortent avec facilité (y compris le mi bémol) , et elle est surtout portée par la dynamique du chef et son tempo. Le duo “dite alla giovine” avec un Bruson qu’on était en train de découvrir ( à l’époque LE baryton verdien était Piero Cappuccilli) et sa douceur, son intensité, sa magnifique technique est vraiment un moment tout particulier à vivre et à ressentir. Beaucoup plus impliquée que dans l’enregistrement officiel, Cotrubas démontre là qu’elle est une grande Violetta, expressive, profonde, intense en ce deuxième acte avec un “amami Alfredo” parmi les meilleurs entendus dans cette série, grâce à un Kleiber d’une énergie incandescente. Quant à son “Addio del passato” et la lecture de la lettre qui précède, dite sur un ton presque absent qui se conclut par un accord particulièrement senti à l’orchestre, il est chanté sans Da capo, de manière très haletante avec des effets de souffle, c’est assez réussi mais un peu trop fort à mon goût et ce n’est pas le meilleur moment de Cotrubas, je trouve l’effet vaguement vériste. Mais toute la fin de l’acte, avec un lumineux Aragall est gouvernée par une direction musicale étourdissante. C’est bien quand même ici Kleiber qui mène la danse et qui fait entendre ce dont il est capable dans la fosse, en direct.
Un an plus tard, sur scène, c’est autre chose: entourée de Bruson et de Aragall, avec l’ambiance du théâtre et non du studio, c’est nettement différent. D’abord Kleiber encore plus théâtral et plus rapide dès le prélude, et moins éthéré que dans le disque officiel. L’explosion initiale de la fête qui fait contraste part à une vitesse étourdissante, haletante, virevoltante. Même les chanteurs portés par la scène, et Cotrubas en tête font preuve de dynamisme et d’engagement avec la voix claire et solaire de Giacomo Aragall. Ileana Cotrubas, dans le premier acte est très engagée, très en forme, les aigus sortent avec facilité (y compris le mi bémol) , et elle est surtout portée par la dynamique du chef et son tempo. Le duo “dite alla giovine” avec un Bruson qu’on était en train de découvrir ( à l’époque LE baryton verdien était Piero Cappuccilli) et sa douceur, son intensité, sa magnifique technique est vraiment un moment tout particulier à vivre et à ressentir. Beaucoup plus impliquée que dans l’enregistrement officiel, Cotrubas démontre là qu’elle est une grande Violetta, expressive, profonde, intense en ce deuxième acte avec un “amami Alfredo” parmi les meilleurs entendus dans cette série, grâce à un Kleiber d’une énergie incandescente. Quant à son “Addio del passato” et la lecture de la lettre qui précède, dite sur un ton presque absent qui se conclut par un accord particulièrement senti à l’orchestre, il est chanté sans Da capo, de manière très haletante avec des effets de souffle, c’est assez réussi mais un peu trop fort à mon goût et ce n’est pas le meilleur moment de Cotrubas, je trouve l’effet vaguement vériste. Mais toute la fin de l’acte, avec un lumineux Aragall est gouvernée par une direction musicale étourdissante. C’est bien quand même ici Kleiber qui mène la danse et qui fait entendre ce dont il est capable dans la fosse, en direct.
 Quelques années plus tard, en 1984, au Mai Musical Florentin, à l’époque où Florence était traditionnellement la scène alternative à la Scala, c’est au tour de la toute jeune Cecilia Gasdia, un peu oubliée aujourd’hui, qui avait remplacé au pied levé à la Scala deux ans plus tôt Montserrat Caballé plus que copieusement huée dans Anna Bolena lors d’une malheureuse première approximative il est vrai, avec un énorme succès. On verra depuis Gasdia un peu partout (à Paris, dans Moïse, elle avait été magnifique, à Pesaro, dans Il Viaggio a Reims, avec Abbado où elle chantait une délicieuse Corinna). La voilà donc avec Carlos Kleiber, aux côtés de Peter Dvorsky, un de ces ténors très honnêtes sans être une star qui chantait beaucoup à l’époque et Giorgio Zancanaro, baryton favori de Muti, le troisième dans l’ordre après Cappuccilli et Bruson. Certes elle ne fait pas elle non plus le mi bémol final de l’acte I, même si elle fait le reste avec panache, et avec une voix claire et jeune, mais quel “dite alla giovine” murmuré (Zancanaro est correct, sa voix plus claire et plus jeune manque cependant d’une vraie personnalité) porte le drame dans le son: pas besoin de gargouillis ni de pleurs, la larme est dans le chant. Tout est merveilleuse appuyé sur le souffle. Kleiber, ferme, mais moins énergique qu’à Munich six ans plus tôt, suit les chanteurs avec le souci de les soutenir: un très grand moment salué d’ailleurs par le public. Gasdia est une de ces chanteuses qui excellait dans les parties lyriques et mélancoliques, et ce deuxième acte lui allait à merveille. Son “amami Alfredo” et les moments qui précèdent, aidés par des crescendos étourdissants de Kleiber, intense, parmi les plus prenants de ceux que j’ai entendus au disque. En revanche “l’addio del passato” est décevant, tempo rapide, sans da capo, la Gasdia essaie de terminer sur un pianissimo court et hésitant. Il reste que la suite, conduite par Kleiber qui excelle dans le final, reste de très haut niveau. Une version intéressante pour la voix de la Gasida, qu’on n’entend pas si souvent, qui n’atteint cependant que par moments l’intensité de la version précédente avec Cotrubas.
Quelques années plus tard, en 1984, au Mai Musical Florentin, à l’époque où Florence était traditionnellement la scène alternative à la Scala, c’est au tour de la toute jeune Cecilia Gasdia, un peu oubliée aujourd’hui, qui avait remplacé au pied levé à la Scala deux ans plus tôt Montserrat Caballé plus que copieusement huée dans Anna Bolena lors d’une malheureuse première approximative il est vrai, avec un énorme succès. On verra depuis Gasdia un peu partout (à Paris, dans Moïse, elle avait été magnifique, à Pesaro, dans Il Viaggio a Reims, avec Abbado où elle chantait une délicieuse Corinna). La voilà donc avec Carlos Kleiber, aux côtés de Peter Dvorsky, un de ces ténors très honnêtes sans être une star qui chantait beaucoup à l’époque et Giorgio Zancanaro, baryton favori de Muti, le troisième dans l’ordre après Cappuccilli et Bruson. Certes elle ne fait pas elle non plus le mi bémol final de l’acte I, même si elle fait le reste avec panache, et avec une voix claire et jeune, mais quel “dite alla giovine” murmuré (Zancanaro est correct, sa voix plus claire et plus jeune manque cependant d’une vraie personnalité) porte le drame dans le son: pas besoin de gargouillis ni de pleurs, la larme est dans le chant. Tout est merveilleuse appuyé sur le souffle. Kleiber, ferme, mais moins énergique qu’à Munich six ans plus tôt, suit les chanteurs avec le souci de les soutenir: un très grand moment salué d’ailleurs par le public. Gasdia est une de ces chanteuses qui excellait dans les parties lyriques et mélancoliques, et ce deuxième acte lui allait à merveille. Son “amami Alfredo” et les moments qui précèdent, aidés par des crescendos étourdissants de Kleiber, intense, parmi les plus prenants de ceux que j’ai entendus au disque. En revanche “l’addio del passato” est décevant, tempo rapide, sans da capo, la Gasdia essaie de terminer sur un pianissimo court et hésitant. Il reste que la suite, conduite par Kleiber qui excelle dans le final, reste de très haut niveau. Une version intéressante pour la voix de la Gasida, qu’on n’entend pas si souvent, qui n’atteint cependant que par moments l’intensité de la version précédente avec Cotrubas.
1982. A 41 ans, Muti est encore un chef qui s’installe durablement dans le paysage musical, qui propose une vision du monde verdien opposée à celle d’Abbado, et déjà la presse le considère comme le prétendant; il a régné à Florence jusqu’à 1980, en revisitant Verdi, (par exemple Otello ou il Trovatore) en proposant des lectures d’une folle énergie, contrastées, explosives, surprenantes. Il a aussi étonné dans Mozart, dans une magnifique production des Nozze di Figaro mise en scène par Antoine Vitez qui a laissé une trace profonde dans les mémoires. Il a derrière lui des enregistrements à succès, Aïda avec Caballé, Nabucco avec Manuguerra et Scotto, Ballo in Maschera, Macbeth qui n’arrivera jamais à s’imposer parce qu’il sort à peu près en même temps que celui d’Abbado. Dans le monde lyrique italien, il est l’autre pôle, et passionne, et divise.
J’ai vu l’Otello de Florence, en 1980, avec Carlo Cossutta, Renata Scotto, Renato Bruson, édition qu’il a plus ou moins reniée, disant que ce fut une erreur. Quelle erreur fantastique: ah! ce troisième acte complètement tourné autour de Iago/Bruson, quel extraordinaire moment! Quelle direction! Je me souviens de l’extraordinaire enthousiasme du public, même si la mise en scène (Enrico Job) n’était pas de celles qui marquent. Mais Muti n’a jamais été intéressé par l’innovation théâtrale.
Dans cette édition de La Traviata, on trouve tout ce que Muti était dans les années 1980, tout ce qu’il apportait de neuf, l’énergie, la pulsion rythmique, un sens inné du théâtre, des intuitions géniales, la précision, l’attention au chant, le souci du son et des équilibres. Cette direction est une pure merveille, sans doute supérieure à Kleiber, car elle est neuve là où Kleiber reste assez traditionnel.
Par la suite, et je l’ai souvent écrit, il a abandonné l’énergie et la pulsion pour une recherche minutieuse et tatillonne d’effets de son et de construction trop intellectualisée: son Verdi s’est affadi (voir son dernier Simon Boccanegra à Rome), il ne dit plus quelque chose de chair et de sang, il dit quelque chose de technique et de froid, même si le “concertatore” qu’est Muti reste unique. Il en résulte par exemple un Trovatore ennuyeux à la Scala ou une Forza del Destino routinière dans le même théâtre alors qu’il en a signé sans aucun doute le plus bel enregistrement. Quand on réécoute le Trovatore de Florence, on est stupéfait, quand on écoute celui de Milan on est anesthésié.
Oui, cette Traviata est un miracle d’abord à l’orchestre, qui étonne, qui explose et envahit tout et dans la minute suivante s’allège et se fait discret, léger, qui accompagne les chanteurs dans un équilibre miraculeux, qui donne au mot théâtre son vrai sens (ce qu’une version comme celle de Pritchard avec Sutherland a totalement mis sous le tapis). C’est qu’il a réuni une équipe de trois chanteurs totalement hors normes: Alfredo Kraus qui a promené son Alfredo depuis la fin des années cinquante avec des chefs la plupart du temps médiocres et qui rencontre là le chef qui va mettre encore plus en valeur ses qualités de phrasé, de style, sa technique redoutable, il faut entendre son “Parigi O cara” où à chaque syllabe on a une modulation des volumes qui est du travail d’orfèvre: la perfection! Et Bruson, à la diction exemplaire, à la voix chaude, à l’interprétation empathique, sans froideur. Le duo de l’acte II avec Scotto est un sommet inaccessible. Car Scotto, qui à 48 ans n’est plus une Traviata évidente, se sert de ses limites techniques notamment dans le suraigu pour faire de son 1er acte un moment forcé, où se lit l’insouciance de surface et la désespérance réelle (second “Gioir”, presque accompagné d’un spasme de douleur). Du grand art. Pour moi sans aucun doute la version de référence. On n’a pas fait mieux depuis, même si sa version de 1993, issue des représentations de 1990, n’est pas loin par moments de la rejoindre.
 Rappelons brièvement les circonstance: La Traviata n’a pas été représentée depuis 1964, après le scandale Karajan-Freni et Riccardo Muti hésite à reprendre le titre. Pour conjurer le sort et circonvenir un public toujours très sensible à la corde verdienne, il décide de faire une “Traviata de jeunes” et la Scala accompagne cette décision d’une campagne de communication serrée et sans précédents, s’appuyant sur les associations de soutien, Amici della Scala, Amici del Loggione della Scala, presse spécialisée et quotidiens (souvent aux ordres à cette époque): il crée l’événement en appelant un certain Roberto Alagna comme Alfredo et une certaine Tiziana Fabbricini pour interpréter Violetta. Les critiques dirent alors “Un ténor est né”, et de fait la carrière de Roberto Alagna, partie de Milan, ne s’est pas arrêtée depuis: voix solaire, aigus triomphants, phrasé impeccable, le ténor français (d’origine sicilienne) est vocalement splendide, même si l’interprète manque encore de maturité, il a tendance à chanter un peu tout de la même façon, il devra travailler encore les accents. Paolo Coni a travaillé avec attention le texte, chaque parole est sculptée, respirée, émise avec une rare justesse et une rare intelligence, même si en scène la voix est petite, ces qualités le font oublier.
Rappelons brièvement les circonstance: La Traviata n’a pas été représentée depuis 1964, après le scandale Karajan-Freni et Riccardo Muti hésite à reprendre le titre. Pour conjurer le sort et circonvenir un public toujours très sensible à la corde verdienne, il décide de faire une “Traviata de jeunes” et la Scala accompagne cette décision d’une campagne de communication serrée et sans précédents, s’appuyant sur les associations de soutien, Amici della Scala, Amici del Loggione della Scala, presse spécialisée et quotidiens (souvent aux ordres à cette époque): il crée l’événement en appelant un certain Roberto Alagna comme Alfredo et une certaine Tiziana Fabbricini pour interpréter Violetta. Les critiques dirent alors “Un ténor est né”, et de fait la carrière de Roberto Alagna, partie de Milan, ne s’est pas arrêtée depuis: voix solaire, aigus triomphants, phrasé impeccable, le ténor français (d’origine sicilienne) est vocalement splendide, même si l’interprète manque encore de maturité, il a tendance à chanter un peu tout de la même façon, il devra travailler encore les accents. Paolo Coni a travaillé avec attention le texte, chaque parole est sculptée, respirée, émise avec une rare justesse et une rare intelligence, même si en scène la voix est petite, ces qualités le font oublier.
Et la Fabbricini? Dans une époque, je l’ai écrit, très influencée par l’école anglo-saxonne et le baroque, où la technique de chant et le son comptent plus que la tripe (et ainsi aussi bien dans Verdi que Puccini il nous manque toujours quelque chose), Tiziana Fabbricini, qui mise tout sur la couleur, les accents, l’infinie variété des paroles et de leur traduction musicale, avec une maturité interprétative étonnante pour son âge (elle a alors une trentaine d’années), ne pouvait totalement plaire à un public habitué à ce que j’appelle les voix sous vitrine. Fabbricini pour pallier ses défauts évidents (notamment une lutte sans cesse affichée avec la justesse) invente à chaque instant des solutions nouvelles, qui ne peuvent que surprendre les habitués des voix lisses: oui Fabbricini a la voix accidentée et cela va très bien à cette accidentée de la vie qu’est Violetta. Car avec les défauts de la voix, pas très large, au centre incertain, aux passages quelquefois un peu sales, elle a un aigu purifié, sûr, triomphant et aborde ré bémol et mi bémol (que Muti lui fait faire) avec une désarmante facilité, un naturel époustouflant. Effectivement, Fabbricini a toujours eu les aigus facile et une une justesse sans failles dans le registre le plus haut. Une étrange personnalité vocale qu’il fallait voir sur scène: une vraie bête de scène, avec un naturel et une spontanéité incroyables: Fabbricini a toujours épousé ses personnages notamment ceux qui demandaient une grande puissance dramatique (Traviata, Tosca: je l’ai vue à Berlin dans une mémorable Tosca, chantée avec les défauts, mais sur scène, elle était Tosca): elle fut un très mauvaise Corinna avec Abbado dans Viaggio a Reims, Fabbricini n’est pas une lyrique et tout sauf une rossinienne. Je répète ce que j’ai écris ailleurs: elle a été rejetée par la cruauté du système, elle a y aussi beaucoup contribué par son imprudence: mais c’est une perte. L’ayant entendue encore il y a quelques mois dans une Manon Lescaut provinciale, elle a encore beaucoup à donner. Et la voix est restée telle quelle, qualités et défauts compris.
Avec Muti, nous sommes sur la trace de son enregistrement précédent avec des complexes de la Scala au sommet de leur forme, et un sens de la couleur, de drame, un lyrisme et une théâtralité extraordinaires; Muti est sans doute l’interprète de référence de Traviata aujourd’hui au disque.
Quant à la vidéo, elle montrera une pitoyable production de Liliana Cavani, mais qui vaut pour voir Tiziana Fabbricini.

Plus récemment, le Festival de Salzbourg en 2005 avait affiché une Traviata devenue la référence des années 2000, dans une mise en scène de Willy Decker avec Anna Netrebko, Rolando Villazon, Thomas Hampson. Cette mise en scène qui a un peu tourné et qu’on peut voir régulièrement au MET était un écrin pour le couple glamour du début des années 2000, Villazon/Netrebko.
De Rolando Villazon, on sait ce qu’il en est advenu: il s’est brûlé au soleil de la scène, donnant tout et donnant trop, dans l’excès, dans une sorte de folie, il a forcé sa voix au joli timbre à la Domingo.
Quant à Anna Netrebko, elle a été un peu victime de la campagne d’image dont elle a été le sujet. On l’a prise pour une image de papier glacé, superficielle et capricieuse, une Gheorghiu bis en quelque sorte, alors que c’est une artiste sérieuse, appliquée, soucieuse de la technique, de l’interprétation, et qui donne beaucoup: une artiste quoi! Aujourd’hui, elle apparaît différente, avec une voix changée, un peu plus métallique, avec un corps plus massif, mais toujours impressionnante (voir ses Donna Anna à la Scala l’an dernier).
Au disque, la production apparaît en-deçà de l’attendu, Hampson n’est pas un Germont, ce n’est pas un verdien (l’a-t-il jamais été?) et la voix est fatiguée. Villazon est au contraire un Alfredo intéressant, engagé, avec une voix qui sait moduler, adoucir (qu’il a de jolis pianissimi!) interpréter, le chanteur est intelligent, il est totalement dans le rôle et cela se sent. Quant à Netrebko, dont l’intelligence n’est pas la moindre des qualités, il semblait qu’elle puisse à l’époque tout chanter de Mozart à Puccini (voir son disque avec Abbado), tout n’est pas parfait dans ce chant avec des aigus quelquefois pris d’une manière maladroite (pas de mi bémol) et quelque problème de reprise de souffle ou une largeur vocale au centre encore insuffisante, mais la diction est d’une grande clarté et l’attention au texte évidente, suivie dans la fosse par un Rizzi routinier au tempo un peu plan plan, qui a la chance d’avoir dans la fosse le Philharmonique de Vienne et non un orchestre moins rompu au grand répertoire. Sans doute ce fut un essai pour l’agent de le projeter sous la rampe: c’est raté et il n’a pas été vraiment lancé, il est encore aujourd’hui considéré comme un chef de répertoire moins inspiré.
Non, ce n’est pas le CD qu’il faut acheter, mais le DVD, pour la production de Willy Decker qui a marqué d’une pierre miliaire l’histoire de la mise en scène de l’œuvre: Visconti a marqué la fin du XXème siècle (avec ses déclinaisons qu’on voit chez Zeffirelli , chez la pitoyable Cavani et même très récemment chez McVicar à Genève), et Decker marque indubitablement les années 2000; cette mise en scène est à voir absolument car elle change toute l’opinion qu’on peut avoir sur l’aspect musical et le chant, elle dynamise une production musicalement moyenne, malgré l’hystérie collective qui a saisi Salzbourg en 2005 et en fait une référence de théâtre incontournable.
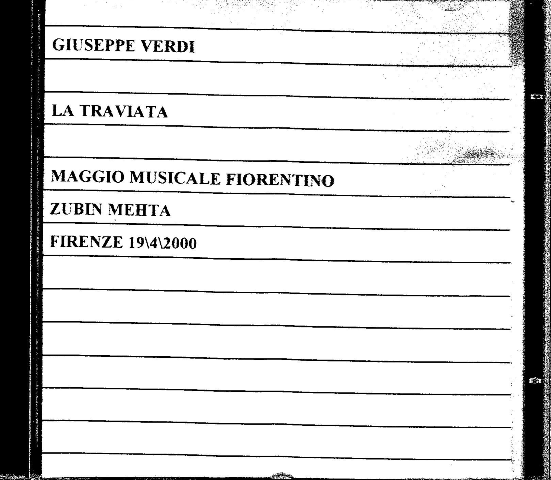 Dernier enregistrement, un enregistrement privé de La Traviata en 2000 au Maggio Musicale Fiorentino avec Mariella Devia en Violetta et Zubin Mehta au pupitre. De Zubin Mehta, un DVD à fuir absolument celui avec Eteri Gvazava et José Cura où le meilleur est le troisième, Rolando Panerai, un Germont de 74 ans. Production tournée au Hameau de Versailles, pitoyable entreprise médiatique où l’on voulait reproduire l’effet de la Tosca en direct de Rome avec Placido Domingo et Catherine Malfitano qui avait un tout autre style (à la TV au moins).
Dernier enregistrement, un enregistrement privé de La Traviata en 2000 au Maggio Musicale Fiorentino avec Mariella Devia en Violetta et Zubin Mehta au pupitre. De Zubin Mehta, un DVD à fuir absolument celui avec Eteri Gvazava et José Cura où le meilleur est le troisième, Rolando Panerai, un Germont de 74 ans. Production tournée au Hameau de Versailles, pitoyable entreprise médiatique où l’on voulait reproduire l’effet de la Tosca en direct de Rome avec Placido Domingo et Catherine Malfitano qui avait un tout autre style (à la TV au moins).
Le trio est composé de Mariella Devia (Violetta), Marcelo Alvarez (Alfredo) Juan Pons (Germont). Mariella Devia est peu demandée en France: l’archive de l’Opéra de Paris la signale en 1995 pour Lucia di Lammermoor, et en 2000 pour Donna Anna. Pour l’une des grandes du bel canto romantique c’est peu. Mais Paris sera toujours Paris…
Zubin Mehta s’y montre moins routinier que dans son précédent enregistrement avec Te Kanawa hors de propos, Alfredo Kraus et Dmitri Hvorotovski où Kraus à 60 ans passés chante mieux que le baryton russe qui en a trente de moins…
L’intérêt réside évidemment dans l’interprétation de Mariella Devia, habituée des rôles de bel canto, qui chante Violetta, oui, elle chante, et le chant prend toute la place, tant la technique est contrôlée, le volume appuyé sur le souffle fait sembler la voix plus grande qu’elle ne l’est, toutes les notes, toutes les nuances, toute la couleur y sont. C’est un vrai miroitement vocal tout à fait extraordinaire à qui il manque cependant une incarnation. Mariella Devia en scène chante à la perfection, mais reste toujours en retrait du côté de l’engagement, de la tripe. Une sorte d’anti-Fabbricini. C’est ici le cas: rarement on entend ainsi toute la partition avec tous ses possibles, mais on reste un peu en retrait et pas très ému. Certes, Mehta y est pour beaucoup, toujours un peu trop fort, sans vraie pulsion (Mehta, on le sait, peut alterner entre le terriblement routinier et le feu d’artifice du génie) tout de même avec un certain allant, mais un tempo un peu lent.
Aux côtés de Devia, un Juan Pons indifférent et un Marcelo Alvarez encore jeune, au timbre clair, au phrasé exemplaire, plein de qualités qu’il est en train de perdre peu à peu aujourd’hui. A écouter pour Devia, parce qu’elle donne une leçon de chant et sait ce que chanter veut dire.
Dans cette promenade ne figurent pas à dessein Sutherland – Pritchard, décidément trop peu théâtral ni Solti – Gheorghiu, pour lesquels on cria trop vite au miracle à la sortie de l’enregistrement, ni Caballé – Bergonzi (bien que Caballé soit intéressante, à mi-chemin entre Sutherland et Scotto et bien que Bergonzi fasse le plus beau deuxième acte de toute la discographie, c’est quand même le plus grand ténor verdien de l’après guerre); je me suis contenté des coffrets qui remplissent ma discothèque et qui reflètent mes curiosités et mes humeurs. Alors au terme du petit voyage, Callas mise à part que chacun doit posséder, mais non dans la discothèque, mais sur l’autel (ce clin d’oeil à ceux qui me reprochent de sacraliser Maria), car avec sa voix et ses défauts, faire une Violetta pareille, c’est d’un autre ordre, je conseillerai d’écouter Karajan avec Freni pour la surprise, et de s’acheter si ce n’est fait au plus vite Muti avec Scotto et Kraus. Cela suffit pour la survie, le reste n’est que complément alimentaire.



















