
Le Festival annuel est dédié cette année à un étrange thème : « Les jardins enchantés », c’est à dire à ces espaces qui figurant un idéal de nature, et aussi de culture, posent la question du statut de notre monde et du rapport réel/irréel, permis/interdit, vie/mort. Pour illustrer ce thème, sans doute choisi en fonction de la création de Michael van der Aa Sunken garden « le jardin englouti », Serge Dorny propose aussi Les Stigmatisés et son île paradisiaque devenue un enfer et l’étrange voyage d’Orphée dans le monde des morts chanté par Gluck dans Orfeo ed Euridice (puisque c’est la version italienne de Calzabigi et non celle, française, de Moline, qui est présentée).
Die Gezeichneten (Les stigmatisés) de Franz Schreker créé en 1918 , a connu dès sa création à Francfort un triomphe et une très belle carrière, interrompue dès la fin des années 20 par l’évolution de la musique (deuxième école de Vienne) qui remisait Schreker au rang des compositeurs kitsch, puis par la disparition de son auteur en 1934, alliée à l’arrivée du nazisme en Allemagne. Schreker a disparu de l’horizon musical, classé dans les dégénérés, même si on a continué aujourd’hui à représenter son chef d’œuvre, Der ferne Klang, et de loin en loin, Die Gezeichneten, qui ont fait l’objet de reprises à Cologne, à Stuttgart ou à Amsterdam (qui a représenté aussi récemment Der Schatzgräber dans une production d’Ivo van Hove). En France, Schreker est terra incognita, la mère des Arts n’ayant jamais trouvé de lieu pour une création scénique : c’est ainsi que Lyon, 97 ans après la Première mondiale, en propose la création scénique française, dans une mise en scène du jeune David Bösch, un des espoirs les plus courus de la scène allemande, qui a déjà réalisé à Lyon un bon Simon Boccanegra, avec une direction musicale du jeune chef argentin Alejo Pérez.
C’est dire l’intérêt de cette production qui porte enfin sur un plateau français l’une des œuvres les plus marquantes du début du siècle.
A l’origine, c’est Zemlinsky qui passa commande à Schreker du livret, qui devait porter sur la tragédie de la laideur, mais celui-ci en l’écrivant, s’est pris d’intérêt pour l’histoire et décida de la porter lui-même en musique. Zemlinsky, alors, sur le même thème, composera Der Zwerg.

L’histoire est assez simple. Alviano, richissime mais d’une repoussante laideur s’est interdit l’amour, persuadé qu’il ne peut aimer ni être aimé. Il a offert aux génois une île paradisiaque, l’Elysée, dédiée à la beauté. Mais cette île où Alviano s’est interdit de pénétrer de peur de la ternir est utilisée à son insu(?) par la noblesse pour des orgies où des jeunes filles de la bourgeoisie sont enlevées, puis violées. Face à lui, le jeune noble Tamare, à qui tout réussit et sublime de beauté organise avec ses amis les orgies. Alviano tombe amoureux de Carlotta, jeune femme peintre, au cœur fragile, fille du podestat, issue de la bourgeoisie. Cet amour est partagé parce que Carlotta a deviné en Alviano une grande âme dans un corps difforme, un silène en sorte…Mais Alviano hésite et la jeune fille va croiser sur sa route Tamare dont elle va tomber amoureuse, tiraillée entre la beauté physique et la beauté morale.
Alviano le découvre et tue Tamare, qui a conduit Carlotta sur l’île et avec qui il a passé une nuit brûlante, bouleversant la jeune fille fragile. Apprenant la mort de Tamare, elle en meurt de désespoir et Alviano devenu fou s’éloigne pour toujours.
Tout se déroule sur fond d’opposition de classe entre la bourgeoisie et la noblesse (comme dans Simon Boccanegra, autre opéra « génois »), luttes de pouvoir, excès de la noblesse, qui finalement prend en otage les jeunes bourgeoises, et impunité décrétée par le Doge, un aristocrate, pour éviter une insurrection ou des luttes politiques trop âpres.
On sent comment un tel livret, au texte d’ailleurs particulièrement dense et vraiment réussi, peut être utilisé en relation aux débuts de la psychanalyse, mais aussi aux relations sociales et politiques entre noblesse et bourgeoisie, où même en approfondissant le caractère d’Alviano dont la fascination presque morbide pour la beauté confine à la paranoïa : c’est d’ailleurs un personnage d’une grande épaisseur, grand naïf ou grand pervers, manipulateur ou bienfaiteur. David Bösch finalement ne répond pas aux questions sociales, politiques, psychanalytiques que pose le livret et propose la vision esthétiquement cohérente d’un opéra nocturne, dans un espace de hangar sombre, sur un sol jonché d’objets, avec des reliques de festins qui sembleraient presque étranges (décor de Falko Herold). Cet univers s’étend aux premier et second acte – le second acte se limitant pour l’essentiel à la scène, pivot il est vrai, du portrait d’Alviano par Carlotta dans son atelier où l’amour de la jeune fille explose ayant découvert l’extraordinaire beauté d’âme de cet homme au physique hideux.
Ainsi la structure de la pièce est-elle symétrique : une première partie qui expose à la fois l’attitude d’Alviano et celle des jeunes nobles, et qui pose la situation sociale et morale, l’acte II est centré sur Alviano et Carlotta et l’acte III est l’acte de résolution où à la fois l’amour physique de Carlotta pour Tamare explose et où Alviano devient fou après la mort de la jeune fille.
L’organisation dramaturgique de l’œuvre est certes un peu bancale, avec une première partie qui crée les nœuds (acte I et II) et qui les dénoue assez brutalement au troisième acte, et un acte II à peu près réduit à une scène.
David Bösch change donc d’ambiance, plus onirique pour le troisième acte, où le décor est parsemé de bosquets lumineux vaguement kitsch (on a accusé cette musique de l’être) sous lequel des orgies se passent, espace assez mystérieux, presque pesant, traversé par des ombres, par des gens du peuple, par des familles, où les femmes sont piégées, qu’elles soient pubères ou matures, où les hommes sont à l’affût, qui font disparaître les victimes dans une trappe (la fameuse grotte artificielle souterraine où se passent tous les méfaits).

La partie finale n’est pas sans rappeler Falstaff, mais un Falstaff où le monde ne serait pas burla mais tragedia: l’isolement d’Alviano peut renvoyer à cette figure là.

David Bösch utilise aussi la vidéo, images vaguement psychédéliques (un bleu Yves Klein pour la scène de l’atelier…) mais c’est pendant l’ouverture que la vidéo est utilisée de manière la plus intelligente pour mettre le spectateur « dans l’ambiance » avec la projection de multiples avis de recherche de jeunes filles disparues, mais aussi d’enfants, posant directement le crime comme le centre du propos, puis projetant un petit film évoquant assez crûment les violences faites aux jeunes adolescentes.
Mais cette crudité affichée laissait attendre un travail plus violent: son travail scénique reste plus évocatoire et plus suggestif que réaliste, faisant d’Alviano quelquefois une sorte de Monsieur Loyal (avec ses costumes qui rappellent un peu le monde du cirque) et donc suggérant presque l’idée que l’histoire toute entière est suscitée par les fantasmes pervers du héros. Mais ce n’est que suggéré, car ce qui manque à cette mise en scène par ailleurs remarquable de précision dans la direction d’acteurs et dessinant un univers très cohérent, c’est un point de vue plus distancié, plus conceptuel, plus réflexif, menant le spectateur à une clef plus claire. Tel qu’il est ce travail est d’une grande rigueur et d’un grand classicisme, globalement plus illustratif qu’analytique. C’est d’autant plus dommage que le texte est d’une grande densité et souvent d’une très grande beauté, que la période (1918) appelle une épaisseur qui manque un peu ici. Je peux comprendre aussi que certains apprécient ce choix, parce que décider de poser un univers évocatoire plutôt qu’une transposition analytique à la mode du Regietheater est évidemment un choix assumé.
Il est servi par une distribution très nombreuse, faites de petits rôles confiés à des artistes du chœur ou à des membres de l’opéra studio, et dans l’ensemble vraiment engagée et très juste.
Markus Marquardt est très solide en duc Adorno (on est à Gênes, les Adorno sont une famille aristocratique qu’on retrouve dans Simon Boccanegra de Verdi dans le personnage de Gabriele ), c’est un des barytons de bonne facture de la scène allemande qui sans faire une carrière de star, se retrouve engagé sur des scènes de référence comme Stuttgart, Dresde ou Leipzig, voix forte, jolie diction : une bonne prestation pour un rôle important qui reste épisodique. Mais l’opéra s’appuie sur les trois rôles principaux de Carlotta (Magdalena Anna Hoffmann), Alviano (Charles Workman) et Tamare (Simon Neal), trois chanteurs qui sont habitués à Lyon.
La Carlotta de Magdalena Anna Hoffmann est tendue, engagée, à la fois solide et fragile : elle est incontestablement le personnage, avec son aspect passionnel, mais aussi quelquefois réservé, tendre : elle arrive a proposer des facettes très différentes du personnage, aussi grâce à la précision de la direction théâtrale de David Bösch. Du point de vue vocal, elle assume la partition, mais il m’a semblé que la voix était un peu en retrait par rapport à d’autres prestations (Erwartung !) et notamment les notes très aiguës manquaient de rondeur, et montraient quelque stridence et acidité.
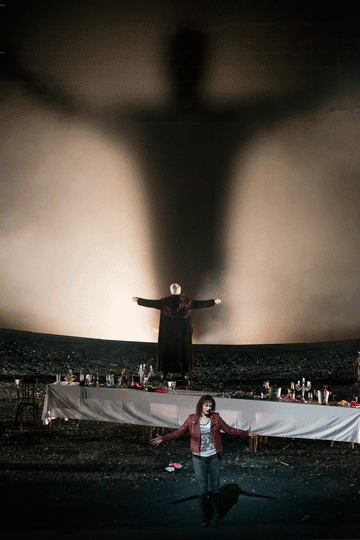
Aucune acidité chez Charles Workman, au timbre suave, doux, clair, qui colle si bien au personnage : la laideur apparente et la voix ensorceleuse. Workman est prodigieux en scène, dans un personnage à la tenue aristocratique et à l’aspect repoussant : il réussit à rendre la dualité par une manière de se déplacer, un port altier et en même temps une très grande tendresse dans la voix qui le fragilise. Une véritable incarnation dont l’un des sommets est son arrivée au troisième acte, traversant la scène avec un pas décomposé hallucinant. Vocalement toutefois, la voix accuse la fatigue dans les notes de passage, avec de nombreux problèmes de justesse, notamment dans les moments tendus et qui exigent une tenue plus longue. Mais ces problèmes, réels, sont moins marquants que la prestation d’ensemble, la présence, l’élégance. On connaît le chanteur depuis très longtemps, on connaît son style, son sérieux, son engagement : c’est cela qu’il faut saluer. Il faut saluer aussi ce choix, parce que souvent le rôle est confié à un ténor de caractère, un Mime ou un Loge (Robert Brubaker dans l’enregistrement de James Conlon par exemple), un peu comme le rôle du nain dans Der Zwerg de Zemlinsky. Le choix de Charles Workman est assez inattendu et pourtant parfaitement cohérent.

Quant à Simon Neal, je reste encore sur son Jago phénoménal à Bâle en janvier dernier dans la production de Calixto Bieito. Et son Tamare confirme dans la même veine un chanteur à la diction impeccable, à l’engagement scénique remarquable, il joue une sorte d’aristo qui a mal tourné, sûr de lui et dominateur, et donne au texte qu’il chante une présence, une couleur, et malgré tout une élégance frappantes. Il réussit à montrer la noirceur, le mépris, l’énergie dans le mal, et en même temps garde du style, en scène et dans la voix, un exemple de grand seigneur très méchant homme : son changement de ton vaguement teinté à la fois de désespérance et d’exigence lorsqu’il est face à Carlotta, c’est vraiment du grand art.

C’est vraiment une grande réussite de la production que de s’être concentré sur les personnages, plus que sur les situations, des personnages qui me font irrésistiblement penser à l’univers d’Egon Schiele, un Egon Schiele qui serait regardé par Céline, ou quelquefois d’un Klimt qui aurait renoncé aux ors pour choisir les noirs.

Mais la grande réussite de la soirée, c’est de faire découvrir au public cette musique extraordinaire, luxuriante, rutilante quelquefois, sombre et obscure, changeant sans cesse de reflet, à la fois multiple et miroitante, très ronde et très chaleureuse, quelquefois rèche aussi, mais toujours riche, profonde, tendue, tenant l’auditeur en haleine, qui reconnaît là Strauss, ici Wagner, quelquefois aussi, c’est très net, Debussy : bien sûr il n’y a pas d’imitation, mais une inspiration due à la fréquentation d’un monde musical lui-même ouvert varié et riche : rien de moins kitsch dans cette musique, pas plus en tous cas que certains moments de Die Frau ohne Schatten des mêmes années. Le prélude est vraiment prodigieux, et j’y ai entendu des choses que je n’avais pas remarquées, notamment dans les toutes premières mesures grâce à la direction d’Alejo Pérez, d’une grande clarté, qui rend l’orchestre moins sec, moins tranchant que d’habitude, avec une rondeur et un éclat qu’on ne lui connaissait pas. Voilà un chef à inscrire sur les tablettes de l’excellence, il a réussi à créer une ambiance, à faire ressortir les couleurs multiples de la partition, avec toujours le tempo juste, relevant çà et là les innovations (il dirige souvent du contemporain), mais aussi insistant sur la chatoyance, sur la diversité, sans jamais exagérer (ce qui pour une telle musique serait aisé) ni souligner ce qui pourrait être perçu comme des vulgarités : lui aussi, comme les chanteurs et comme la mise en scène, malgré cette histoire torturée, il a choisi de travailler l’élégance, non pas superficielle, mais l’élégance vécue, ressentie, communiquée. Grand moment musical, qui fait du chef le grand architecte de la soirée, et l’artisan de la réussite de cette Première d’une production qui n’en doutons pas, sera un grand succès.
Strasbourg avait proposé en 2012 Der Ferne Klang, alors, il ne nous reste plus qu’à réclamer à Lyon Der Schatzgräber .
Au total une ouverture de Festival de style assez classique, et de grande tenue, pour une soirée qui emporte la conviction par la musique, par l’engagement, où la mise en scène, qui ne m’a pas totalement convaincu, épouse plus qu’elle ne divise ou ne clive.
Musiktheater mit Regie plus que Regietheater.[wpsr_facebook]

