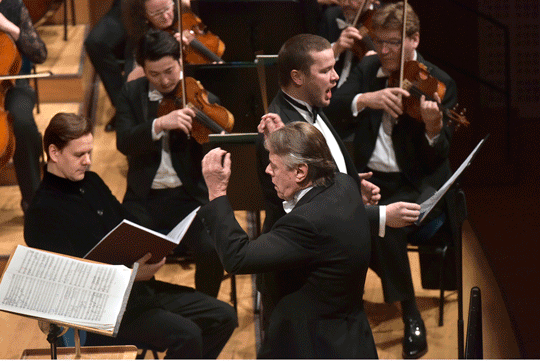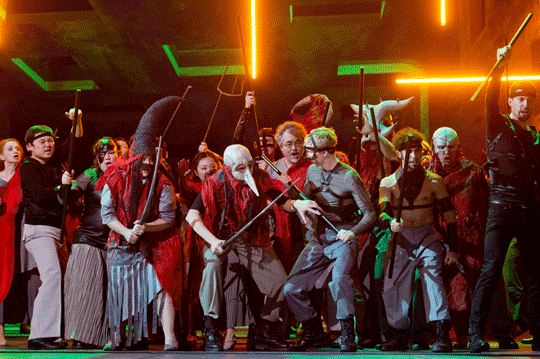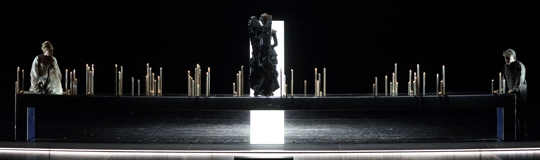Le 6 avril 2014, le concert hommage du LFO à Claudio Abbado avait ravagé de chagrin et l’orchestre et les spectateurs du KKL. Deux ans après, à la même période à peu près, c’est à Pierre Boulez que le Lucerne Festival rend hommage.
Le 6 avril 2014, le concert hommage du LFO à Claudio Abbado avait ravagé de chagrin et l’orchestre et les spectateurs du KKL. Deux ans après, à la même période à peu près, c’est à Pierre Boulez que le Lucerne Festival rend hommage.
Le renouvellement du festival de Lucerne, sous l’impulsion de Michael Haefliger, tient essentiellement à l’arrivée de ces deux immenses personnalités musicales : l’une refonda l’orchestre du festival pour succéder au Schweizerische Festspielorchester, qui avait animé les Internationalen Musikfestwochen Luzern désormais appelées Lucerne Festival, l’autre anima depuis 2003 une Académie destinée à enseigner aux jeunes musiciens la musique des XXème et XXIème siècles. Pendant qu’Abbado enflammait les concerts inauguraux du festival, en un rendez-vous annuel, Boulez travaillait avec ses jeunes avec des Master class et des programmes de concerts allant grosso modo de Mahler à nos jours, suivant le fil rouge de l’essentiel de sa carrière. Boulez passait à Lucerne un petit mois, pour l’essentiel le mois d’août et les premiers jours de septembre, et dirigeait plusieurs programmes. On le voyait souvent modestement déjeuner ou dîner au « World café », et il assistait à de nombreux concerts. En bref, il était le second pilier du festival.

C’est que Boulez – nemo propheta in patria – n’a jamais été contesté dans la sphère germanique où il demeurait et où il fréquenta Donaueschingen et surtout Darmstadt et encore plus depuis le Ring du centenaire à Bayreuth, ami de Wieland puis de Wolfgang Wagner, ami de Barenboim aussi, mais il ne participa pas du circuit classique des chefs d’orchestres de référence : il ne fut invité que pendant la dernière partie de sa carrière un peu par les Berliner et surtout par les Wiener Philharmoniker avec qui depuis il a tissé des liens forts et fait des enregistrements qui ont marqué. Si Abbado a fait une carrière somme toute traditionnelle, même si exceptionnelle, Boulez a répondu présent à tous les niveaux de l’institution musicale, comme compositeur, comme chef, mais aussi comme organisateur, et comme conseiller. Ila été longtemps considéré comme un enfant terrible, avec des déclarations à l’emporte pièce, contre l’institution, mais a patiemment contribué et avec quelle autorité à dessiner le paysage musical français. Ce fut un agitateur d’idées, cherchant obstinément à réaliser ses projets, y compris dans le domaine de l’architecture : la Cité de la musique lui doit beaucoup, sinon tout, et la Philharmonie aussi évidemment par ricochet; et si la “salle modulable” de Bastille (qu’il voulait à toutes forces) dont l’espace existe (une remise à décors aujourd’hui) n’a pas vu le jour, c’est par une succession de renoncements, à cause des débuts hoqueteux de l’Opéra Bastille. Boulez a utilisé tous les leviers possibles pour mener à bien ses projets et a déchaîné bien des polémiques (on se souvient de celle qui l’opposa si violemment à Michel Schneider, alors directeur de la musique au Ministère de la Culture.), mais volens nolens, c’était un phare du monde intellectuel et artistique français, et c’était sans contredit une voix de la France.
Le fait qu’Abbado et Boulez se retrouvent dans ce lieu n’est donc pas un hasard : d’ailleurs les deux personnalités se respectaient et s’estimaient. Boulez a même remplacé Abbado sur le podium du Lucerne Festival Orchestra à Carnegie Hall pour une 3ème de Mahler mémorable et Lucerne est un festival né comme creuset international, où se retrouvent tous les grands chefs, les grands orchestres, dans la continuité de cette tradition née en 1938 sous l’impulsion d’Arturo Toscanini dans les conditions politiques que l’on sait, comme réponse humaniste à ce qui se dessinait aux temps de l’Anschluss,. Le profil du festival, sous l’impulsion de Michael Haefliger bien sûr, mais aussi d’Abbado et de Boulez, a évolué : ce n’est plus du tout un garage de luxe pour grands orchestres internationaux en tournée, il y a des conférences, des films, des concerts de tous types, musique de chambre, récitals, concerts symphoniques, à tous les heures, le matin, l’après midi, le soir, le soir tard, des concerts très chers et d’autres très accessibles et même gratuits, des résidences d’artistes, des résidences d’orchestre des master class, et trois moments annuels, le cycle piano en automne, le festival de Pâques dédié à la musique chorale et sacrée, et le festival d’été qui dure de mi-août à mi septembre et qui n’est que foisonnement musical. Ce contexte plaisait évidemment à Boulez, d’autant qu’à Lucerne, tout semble possible (enfin presque tout puis la « salle modulable » n’a pas été construite), et entre 2000 et 2011, il donna un nombre impressionnant de concerts (au moins trois programmes par session).
En deux ans, le Festival qui s’est appuyé pendant une petite quinzaine d’années sur ces deux piliers a dû tourner la page, la mort d’Abbado en 2014, et le retrait de Boulez avant sa disparition ont imposé d’autres choix. Riccardo Chailly à la tête du LFO a déjà annoncé des programmes d’une couleur très différente de ce qui précédait, tandis que s’est mise en place dans l’académie une direction bicéphale, Wolfgang RIhm comme directeur artistique et Matthias Pintscher comme directeur musical de l’orchestre « des alunni ». Boulez laisse ici un héritage, avec une rupture moindre que celle marquée par l’arrivée de Chailly au LFO : Matthias Pintscher est directeur musical adoubé de l’Ensemble Intercontemporain, fondé par Boulez, et dont les pupitres guident les jeunes de la Lucerne Festival Academy : de fait l’Ensemble Intercontemporain est un autre pilier du Lucerne Festival, incontournable quand il s’agit de musique contemporaine.

Ce concert-hommage a donc réuni une partie des jeunes qui avaient travaillé avec Boulez, venus spécialement pour l’occasion : Wolfgang Rihm a prononcé quelques mots, visiblement ému, notamment autour de la question du « faire », qui disait-il a guidé Boulez pendant toute sa vie, faire et mener à bien. Seul, sur la scène déserte, devant le pupitre du chef avec la partition ouverte, Wolfgang Rihm montrait par là la manque et le vide qui frappe le monde musical en une allocution directe, sans notes, sans grandes phrases, et avec cette simplicité qui fait les vrais pédagogues : il a cherché à définir le plus naturellement du monde ce que représentait Boulez, lui-même pédagogue exceptionnel, avec de l’émotion et sans aucun artifice. Ce fut un authentique moment qui vaut toutes les nécrologies officielles et obligées.
L’orchestre réuni est composé d’ex élèves qui ont travaillé avec Pierre Boulez au long de ces années d’académie, chaque année, le Lucerne Festival Academy donnait plusieurs concerts, l’orchestre réuni ici est une sorte de « fusion » de toutes ces années, c’est pourquoi il porte le nom d’ «Alumni-Orchester der Lucerne Festival Academy» et c’est aujourd’hui son premier concert.

La programme du concert sans entracte était un vrai résumé du répertoire de Boulez, alliant ses propres œuvres, les 3 Orchesterstücke op.6 de Berg, qu’il dirigea souvent, et le Sacre du Printemps de Stravinski.
Dans les œuvres de Boulez, l’une était « Don », extrait de Pli selon Pli, repris de « Don du poème » de Mallarmé dont il ne cite que le premier vers. Mallarmé n’est jamais loin des débats musicaux de son temps : il a inspiré Ravel, Debussy, et Boulez, et lui-même faisait partie avec Verlaine de la revue wagnérienne. En écoutant la musique de Boulez, on comprend aussi sa manière d’aborder les œuvres qu’il dirigeait : une écriture très raffinée, jouant sur les contrastes, poussant les sons jusqu’aux extrêmes avec une très grande précision et surtout une très grande clarté. Cette clarté dans la composition, on la retrouvait chez le chef d’orchestre dans la manière qu’il avait de révéler l’œuvre jusque dans ses détails, avec une rigueur notable, en évitant les complaisances. Il était beaucoup plus lyrique à la fin de sa carrière (il n’est que de comparer son Parsifal de Bayreuth dans l’enregistrement de 1971 et celui qu’il proposa entre 2002 et 2004). Il reste que cette musique difficile, est contraignante pour le spectateur : elle n’autorise pas le rêve ou l’inattention et oblige à la concentration et à l’écoute.

Les jeunes musiciens qui connaissent ce répertoire sont souverains tout comme Yeree Suh, magnifique soprano qui d’ailleurs chante aussi bien le répertoire baroque que contemporain (Boulez n’avait-il pas une fascination pour Gesualdo ?) qui réussit à créer un univers, avec ces mots lancés comme des sons, de loin en loin répondant aux sons métalliques de l’orchestre. Don est la dernière pièce de « Pli selon Pli » composée par Boulez, en 1989, même si elle ouvre le cycle et le choix de Pintscher d’interpréter un extrait de cette œuvre est aussi un choix sensible, celui de souligner à la fois une œuvre de vie (1957-1989), et celui de montrer en Boulez le compositeur d’un « work in progress » permanent, sur lequel il revenait sans cesse, mais aussi d’ouvrir le concert par une ouverture même, où les mots (basalte…y…écho…et …une…)lancés de loin en loin semble être autant de cailloux semés qui constituent une sorte d’armature possible, de texte du future, de texte à tisser avec la musique pour liant et pour lien. Moment de poésie, d’une très grande clarté et lisibilité, où l’hermétisme mallarméen semble s’ouvrir.
Avec les 3 Orchesterstücke de Berg, dédiés à Arnold Schönberg, le programme nous invitait à méditer sur la longue relation intellectuelle et musicale de Boulez à Berg : trop viennois, trop nostalgique disait-il dans sa fougueuse jeunesse où il jeta quelques anathèmes sur lesquels il revint plus tard. Son compagnonnage avec Berg culminera bien sûr avec Lulu, en 1979, dont il assurera la première représentation de la version en trois actes dans l’orchestration complétée par Friedrich Cerha. Ces pièces pour orchestre sont construites presque en crescendo, jusqu’à l’expression d’un chaos final (dans Marsch, la troisième pièce) d’une rare intensité. Reigen avec son mouvement de valse semblait peut-être trop viennois à Boulez au départ, et Präludium est un lent mouvement ascendant-descendant appuyé sur les bois et les vents ; Matthias Pintscher conduit les musiciens, enthousiasmants de netteté et de précision, avec une volonté d’objectivité, laissant la musique, sombre, (qui doit tant à l’expressionnisme) se développer sans essayer de « surinterpréter », Marsch est vraiment un moment éblouissant, pas forcément lyrique ou raffiné comme le faisait Abbado par exemple, mais net, précis sans être métronomique, et d’une force marquante, presque tellurique qui n’est pas sans rappeler à certains moments l’œuvre suivante.

Car la première version de ces Orchesterstücke est de 1913-1914, et donc contemporaine du Sacre du Printemps. Et tout prend ainsi sens.
Le Sacre du printemps a été une pièce maîtresse du répertoire de Pierre Boulez, l’orchestre des « Alumni », fait merveille, la direction de Pintscher ne se laisse pas déborder par l’excès, comme l’œuvre s’y prête. Je me souviens de Boulez analysant la danse sacrale dans une master class il y a quelques années avec l’orchestre du Lucerne Festival Academy, demandant justement aux élèves ne ne jamais surjouer une œuvre qui s’y prête tant. L’approche de Pintscher organise le chaos et l’explosion, peut-être cela manque-t-il un tantinet de folie ou d’imagination, mais laisse jouer la musique, rien que la musique qui en l’occurrence se suffit à elle-même : le rythme est très serré, presque métronomique (cela me rappelait ce que Scherchen demandait aux musiciens dans le Boléro de Ravel, à savoir de serrer le tempo sans jamais varier, pour éviter l’effet crescendo et créer la tension jusqu’à l’insupportable) , les bois et notamment clarinette et basson sont vraiment magnifiques, bientôt rejoints par les cordes dans la première partie : après le début un peu mystérieux, avec des silences pesants, c’est bientôt l’impression de force tellurique qui domine, en cohérence avec la thématique de l’explosion dionysiaque du Printemps : on trouve à la fois une certaine noirceur, mais en même temps un éclat singulier et une certaine objectivité froide qui finalement fonctionne car elle crée une tension permanente.

La dernière pièce du concert, Mémoriale, extraite d’Explosante fixe (encore un « work in progress » boulézien avec ses versions successives sur lesquelles il ne cessa de revenir) composée au départ en 1972, comme contribution mémorielle à la mort d’Igor Stravinski, puis aussi un peu plus tard pour évoquer Bruno Maderna (mort en 1973) est une conclusion mémorielle en abyme, puisque Mémoriale est une révision proposée en 1985 pour évoquer la mémoire de Lawrence Beauregard, flûtiste de l’Ensemble Intercontemporain qui travailla étroitement avec Pierre Boulez. Une pièce pour flûtiste soliste et huit instruments qui est mis en exergue comme pièce finale d’un concert qui aurait dû se terminer par l’explosion stravinskienne (mais Boulez lui-même aimait rompre les traditions du concert) . Et cette pièce provenant d’une œuvre évoquant Stravinski, puis Maderna, elle-même évoquant enfin un flûtiste disparu, devient la dédicace mémorielle finale du concert en une sorte de Mémorial à Pierre Boulez lui même ; ainsi ce concert se termine-t-il par une pièce méditative, élégiaque au rythme de la flûte de Yi Wei Angus Lee, qui fut dans la Lucerne Festival Academy en 2013 et 2015 : c’est un de ces moments suspendus, aux cordes à l’extrême de la légèreté, qui font plonger en soi-même et qui constituent le plus beau des hommages. Et j’avoue y avoir pensé très fortement lors de ma visite quelques semaines après sur la tombe de Boulez à Baden-Baden.
Ce fut un moment fort, qui n’avait peut-être pas la violence émotive du concert du 6 avril 2014 dédié à Abbado, mais Abbado, bien que discret et réservé, déchaînait d’incroyables passions. Ce concert avait une vraie force intellectuelle, le programme et la couleur étaient typiquement bouléziens . Boulez lui suscitait aussi la passion polémique, mais les haines qu’il a déchaînées (encore même post-mortem, ce qui est un comble de lâcheté) ne sont que babil de médiocres. Boulez pour moi suscitait avant tout l’admiration et la stupéfaction, et ce concert, par sa composition assez subtile était une construction : les œuvres se croisent, soit par les dates (Berg-Stravinsky) soit par le sujet (« Mémoriale »), soit aussi par les traces emblématiques: Pli selon Pli est le programme de l’avant dernier concert donné à Lucerne en 2011, et de la tournée européenne qui a suivi, et les 3 Orchesterstücke de Berg étaient au programme de son tout dernier concert au KKL. Abbado faisait sentir et pleurer, Boulez faisait penser, et donc être. Ils sont tous deux irremplaçables et ils ont tout deux fait le Lucerne Festival d’aujourd’hui.
La musique continuera sans eux, mais a perdu un peu de son odeur. [wpsr_facebook]