
Deux créations scéniques à Salzbourg : West Side Story, dont nous avons évoqué la production et le Faust de Gounod, pourtant fameux dans le monde entier et particulièrement dans le monde germanique (et pour cause ! l’œuvre de Goethe y est fondatrice) où il est connu sous le titre Margarethe.
Gounod a eu les honneurs de Salzbourg avec Roméo et Juliette, présenté trois fois depuis les années 2000, en version de concert (2002) et dans une version scénique de Barlett Sher (2008-2010). Mais Faust, l’un des opéras les plus représentés au monde (plus de 2600 représentations à l’opéra de Paris), n’avait jamais eu les honneurs du Festival. Il est vrai que la vocation d’un Festival est d’aller vers des œuvres moins connues que les théâtres d’opéra hésitent à monter (c’est le cas cette saison de Die Liebe der Danae de Strauss), mais quelque production qui attire le public permet aussi de remplir les caisses. Ainsi donc de ce Faust, confié à Reinhard von der Thannen, le décorateur de Hans Neuenfels, on lui doit notamment le décor du Lohengrin « des rats » du Festival de Bayreuth. Il signe là la première mise en scène, suivant les exemples de grands décorateurs passés à la mise en scène, Jürgen Rose, Pier Luigi Pizzi, Yannis Kokkos.
J’ai beaucoup de tendresse pour le Faust de Gounod. Je lis les sourires crispés d’un certain nombre de mes meilleurs amis, mais j’ai eu la chance d’entrer en Faust avec la production magnifique de Jorge Lavelli au Palais Garnier (puis à Bastille), accueillie comme il se doit par un scandale (le public parisien toujours lucide…) puis par une grève. C’était donc deux signes que la production durerait, d’autant qu’elle a été portée sur les fonds baptismaux par Michel Plasson, Nicolaï Gedda, Nicolaï Ghiaurov (puis Roger Soyer – il y eut aussi José Van Dam), et Mirella Freni. Il y avait là de quoi faire aimer Gounod…
Une erreur de Mortier fut d’ailleurs de détruire le décor qui dormait dans les réserves de Bastille : il était en effet impossible de démonter la fameuse verrière qui encombrait l’espace, car elle avait été fixée pour des raisons de sécurité. Cette production pouvait parfaitement faire office de production-emblème de Paris, à l’instar des Nozze di Figaro de Strehler.
J’ai donc vu Faust des dizaines de fois, et l’en connais même bien le texte (personne n’est parfait !) et je l’écoute avec plaisir.
C’est donc confiant et armé que j’ai vu cette production salzbourgeoise.
Comme la tradition de l’opéra français n’est pas toujours bien connue, on fait souvent l’erreur de croire que Faust a été d’abord un opéra-comique et procède de cette tradition, sans doute due à la présence de dialogues parlés à la création (Théâtre Lyrique, 1859).
Mais pour moi, Faust, dont la gestation remonte aux années 1840, procède beaucoup plus dans sa forme lorsqu’il entra à l’Opéra de Paris en 1869 du Grand-Opéra à la française dont on trouve tous les ingrédients :
- Tous les types de voix dans les rôles principaux ou secondaires : Ténor (Faust), basse (Méphisto), baryton (Valentin), soprano (Marguerite), mezzosoprano (Dame Marthe)
- Présence d’un rôle travesti (Siebel)
- Des moments vocaux virtuoses (Faust, Marguerite)
- Abondance de chœurs importants
- Inscription dans une période historique à la mode (le Moyen âge)
- Présence d’un ballet, l’un des plus connus du répertoire (la nuit de Walpurgis)
- Une longueur respectable, d’autant plus que Gounod avait vraiment prévu grand et qu’il a dû couper quelques scènes.
Toute mise en scène de Faust doit à mon avis tenir compte de ces aspects formels, à commencer par un pittoresque et un spectaculaire qui font partie du style de l’œuvre: le Faust de Goethe et ses questions métaphysiques ne sont pas vraiment le centre de l’histoire (à peine évoquées dans le premier monologue de Faust « Rien, en vain j’interroge en mon ardente veille, la nature et le créateur… »), mais c’est en fait l’histoire de Marguerite qui est centrale, une histoire tragique digne des grands opéras romantiques…Et les allemands ne s’y sont pas trompés en proposant pour titre de la version allemande Margarethe .
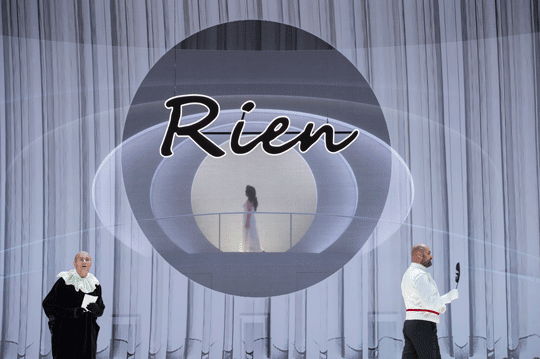
Reinhard von der Thannen, en bon disciple de Hans Neuenfels, pose une question théorique, voire philosophique, comme point de départ, c’est le sens de « Rien » en lettres gigantesques au-dessus de la scène, c’est le sens aussi d’un espace abstrait, de costumes totalement indifférenciés, d’éléments symboliques qui effacent au contraire tout pittoresque et ignorent volontairement la forme et l’histoire du genre. Il met en scène un Faust, dans une tradition goethéenne et moins l’histoire de Faust et Marguerite, avec des références très distanciées et abstraites, qui exigent de la part du spectateur un effort pour donner du sens à ce qu’il voit…

Dans le sens de l’abstraction, cet espace unique, blanc, qui rappelle vaguement par son style le décor du Lohengrin de Bayreuth (auquel on pourra aussi se référer à d’autres moments), avec des ogives stylisées de chaque côté (vague espace médiévisant), avec au centre un œil immense et un praticable par lesquels passent la plupart des personnages. Le rideau se lève sur cet espace au centre duquel Faust se désespère au milieu de ses grimoires et au-dessus, un immense « Rien » soulignant évidemment la vacuité des choses et des espaces, la vacuité du monde qui a perdu tout sens. Méphisto est une sorte de Wanderer qui parcourt le monde en quête de victimes, muni qu’une malle de voyage gigantesque marquée d’un M dans un médaillon (qui rappellerait presque un logo de parfum et qui pourrait tout aussi bien référer à Marguerite) une malle de voyage qui est une sorte de loge d’artiste, où l’on s’habille, où l’on se mire. Voilà l’objet transitionnel qui va occuper latéralement et par moments l’espace scénique. Il y a évidemment quelque chose d’un théâtre itinérant, le théâtre itinérant du diable, le théâtre diabolique (car le théâtre est un monde diabolique). Un théâtre du monde qui est un théâtre-cirque. L’univers du cirque est lourdement marqué, un peu comme dans la Manon Lescaut de Hans Neuenfels…Tout le chœur est vêtu de combinaisons qui rappellent par leur forme celles des rats de Lohengrin et par leur couleur le jaune qui est couleur diabolique…mais par leur allure le monde circassien : une vision d’un monde uniforme collectif, un monde suggéré plus que « réel », qui sort de cet œil gigantesque, un monde ordonné aussi : le chœur chante de manière chorégraphiée et assez bien réglée d’ailleurs pour un chœur qui effectue des mouvements tirés au cordeau (chorégraphie de Giorgio Madia) : bien sûr, tout cela renvoie à ce qui était déjà développé par Neuenfels d’un peuple indifférencié, mécanisé, qui ne pense pas (et dans Faust le chœur ne fait guère que commenter l’action et la déplorer sans jamais vraiment participer) : le chœur est dans le Faust de Gounod purement décoratif. Mais cela renvoie aussi à un monde théorique et artificiel réuni sur ce plateau par la seule volonté de Méphisto : le Monde comme volonté et comme représentation…de Méphisto. La présence de Méphisto, substitut du metteur en scène, va organiser l’histoire, les mouvements, les péripéties. Le cirque du diable en quelque sorte.
La seule question qu’on se pose est « tout ça pour ça ? » car la trame de Gounod vaut-elle tant de pensée passée au prisme de la philosophie et de la théorie : c’était bien le génie du travail de Lavelli jadis d’avoir proposé un regard historié, fondé sur la réception de l’œuvre et son public originel, qui transformait les aventures sans jamais quitter un certain pittoresque du XIXème, en abandonnant le pittoresque médiéval. Martinoty dans sa mise en scène de 2011 avait essayé de mélanger vision philosophique et pittoresque, avec le résultat malheureux que l’on sait. Ici le choix est clair, mais est-il pour autant utile ? Sert-il l’œuvre ou la projette-t-il dans un univers qui n’est pas la sienne. Von der Thannen veut montrer un Faust, mais Gounod écrit-il vraiment un Faust avec ses références philosophiques et ses racines goethéennes ou bien raconte-t-il une histoire ?
D’une certaine manière, une mise en scène de ce type conviendrait peut-être mieux à La Damnation de Faust de Berlioz qui par sa forme, par la succession de ses tableaux, peut-être traitée de manière beaucoup plus abstraite que le Faust de Gounod. Ainsi, le travail de von der Thannen (aidé de son épouse Birgit von der Thannen et de Giorgio Madia) me paraît-il mal ciblé, à côté de l’histoire, malgré des qualités esthétiques indéniables, des lumières splendides (de Franck Evin) certaines idées (la question du double Faust/Méphisto, déjà d’ailleurs traitée ailleurs) et une tenue d’ensemble qui en fait un spectacle de niveau incontestable, mais sans véritable intérêt ; il n’apprend rien sur l’œuvre sinon qu’elle s’ouvre et qu’elle se clôt sur « rien » c’est-à-dire qu’on nous dit » que tout cela n’a servi à rien » ou que « beaucoup de bruit pour rien ».
Ceci dit, il y a de jolis tableaux et des scènes intéressantes visuellement. Le chœur « gloire immortelle de nos aïeux » sous un gigantesque squelette par exemple: on se souvient que Lavelli en avait fait un chœur d’éclopés qui à l’époque avait choqué, pour montrer l’espace ironique entre un chœur triomphant et les réalités de la guerre. Ici, c’est un chœur de clowns petits soldats surmonté d’un squelette, autre réalisation de la même idée.
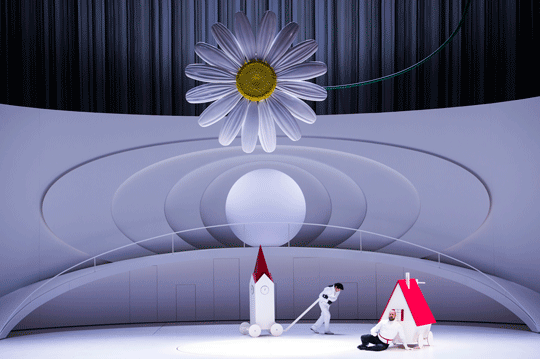
Autre belle image, celle de la maison et l’église, au 4ème acte au retour de Valentin : une immense Marguerite (la fleur) suspendue montre par cette métaphore l’enjeu de l’acte et les personnages (Faust) poussent une maison et un clocher, sorte de jouets de bois figurant le décor, un peu comme dans des représentations de tréteaux ou un peu comme des jeu de gamins. Evidemment, ce tableau nous montre la scène sous le regard et la manipulation de Méphisto, démiurge qui voit ces hommes qui s’agitent comme un jeu d’enfants qui se battent, dans un monde faussement enfantin, qui est monde de violence tout autant que celui des adultes.

Dernière image intéressante, celle de la scène de l’église où Marguerite est entourée d’ombres menaçantes, mais aussi de tuyaux d’orgues tombés du ciel, comme si l’orgue figurait l’arrêt des destins et sanctionnait celui de Marguerite: l’orgue comme substitut du divin, comme instrument de la musique divine, pour une musique qui dans l’église semble effectivement à la fois monter vers le ciel (l’instrument) et descendre vers les hommes (le son).
Ces trois exemples montrent la limite de ce travail : c’est le visuel qui gouverne le travail scénique, qui donne les « indications » au spectateur. Au-delà, le travail sur l’acteur est assez fruste : seuls certains s’en sortent par leurs qualités propres (Marie-Ange Todorovitch en Dame Marthe par exemple, voire à la limite la Marguerite de Maria Agresta). Reinhard von der Thannen a montré une fois de plus ses belles qualités de faiseur d’images ; pour la question spécifique de la mise en scène , cela reste à confirmer, même si au moins une scène a bien fonctionné, celle du jardin où les quatre protagonistes sont sur le lit et chantent en alternance : le jeu des échanges désopilant, est très bien réussi.
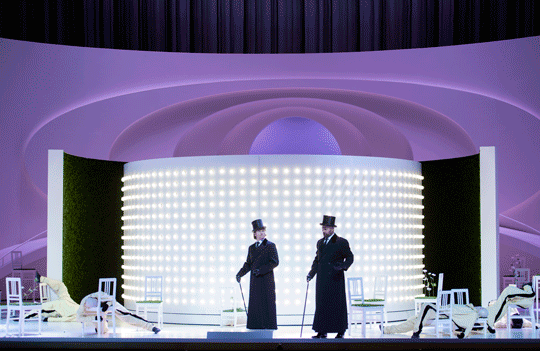
Musicalement les choses sont tout aussi contrastées : la distribution sur le papier n’appelle pas de commentaires, on y trouve trois des grandes vedettes du chant du moment, une des meilleures basses, (Ildar Abdrazakov) un des meilleurs ténors (Piotr Beczala), un soprano qui désormais fait partie des chanteuses de référence (Maria Agresta), entourés de très bons seconds rôles: Alexey Markov en Valentin, Tara Erraught en Siebel et Marie Ange Todorovitch en Dame Marthe ainsi que le Wagner de Paolo Rumetz. Dans la fosse le Philharmonique de Vienne et sur le podium un des chefs de la jeune génération qu’on commence à considérer. Un tel générique devrait satisfaire les plus difficiles.
La messe (c’est le cas de le dire pour cet opéra méphistophélique !) est-elle dite pour autant. Non évidemment parce que Méphisto a fait son œuvre…
L’auditeur français est évidemment plus sourcilleux que d’autres sur le côté idiomatique et sur la diction. Un compagnon de jury de concours de chant m’avait lancé un jour après une audition assez brouillonne de l’air des lettres de Werther « Ah, pour vous les français, il n’y a que la diction qui compte! » . C’est sûr qu’on est moins regardant sur le tchèque chanté dans Katia Kabanova. C’est un aspect néanmoins qu’il faut considérer, justement pour souligner que pour la plupart des protagonistes, il n’y a rien à redire, Piotr Beczala, quelle que soit la langue a toujours une diction claire et très attentive, Maria Agresta est aussi assez compréhensible (même si pour les italiens le français est souvent difficile), Tara Erraught en bonne chanteuse d’école anglo-saxonne chante un français d’une clarté cristalline, et Marie-Ange Todorovitch bien sûr, n’est pas en reste, même si…Ildar Abdrazakov en revanche, qui a mon avis était dans un mauvais soir, n’était pas vraiment au point sous ce rapport.
Il reste que la langue française n’était pas un obstacle, et que la compréhension du texte était très correcte dans l’ensemble, on peut d’ailleurs dire de même pour le chœur, particulièrement clair.
Du point de vue de la vocalité, il en va peut-être un peu autrement : Paolo Rumetz en Wagner à la voix fatiguée est un choix surprenant, pas de projection, pas d’aigus, diction brouillonne, mais le rôle est limité.

Tara Erraught était Siebel, un rôle travesti. Tara Erraught chante souvent les travestis, elle a chanté Octavian à Glyndebourne, Orlofsky, Hansel, Sesto et toujours avec bien du succès. La chanteuse irlandaise commence à être assez connue pour se produire désormais un peu partout. Elle débutait à Salzbourg dans Siebel. On regrette simplement qu’on l’ait affublée d’un costume disgracieux qui ne tienne pas compte de son physique et qui l’engonce d’une manière regrettable y compris pour le confort de son chant. Un chant très frais, très bien mené, très attentif, avec une diction parfaite, et qui a été particulièrement bienvenu dans son deuxième air souvent coupé : la romance « Versez vos chagrins dans mon âme » .
Marie-Ange Todorovitch, rompue au répertoire français et pour cause, propose une Dame Marthe désopilante et bien caricaturale comme il se doit. je n’ai pas trouvé cependant que la diction était aussi claire que souhaité, mais l’orchestre était un peu fort; ceci étant, elle a été un personnage très présent. Je dois dire que dans ce rôle il y a une artiste irremplaçable et irremplacée : Jocelyne Taillon, disparue en 2004, que des jeunes générations ne connaissent pas et qui avait aussi bien la voix que le caractère, la couleur et la diction. Un de ces seconds rôles inoubliables qui vous remplissent la scène et la mémoire.

Valentin est un rôle ingrat, il apparaît peu et seulement au 2ème acte pour partir et pour la catastrophe de son retour au 4ème acte. Alors on lui a rajouté un air pour la première londonienne en 1863, le fameux et creux « Avant de quitter ses lieux » sur la musique du prélude. On ne peut pas dire qu’Alexey Markov ait vraiment la couleur du baryton Martin, mais on est frappé par le soin apporté au chant, le contrôle, les paroles qui sont bien prononcées malgré un petit problème d’émission (slavisante). Les différentes prestations que j’ai entendues d’Alexey Markov, tant dans Tomski à Amsterdam avec Jansons que dans « Les Cloches » à Lucerne montrent un chanteur très attentif au texte, très contrôlé. Même impression ici, avec une prestation formellement impeccable, ce n’est pas tout à fait Valentin, mais c’est un vrai baryton, dont les prestations sont à suivre avec attention.

Je viens de l’évoquer, Ildar Abdrazakov, un chanteur que j’aime beaucoup, entendu souvent (Attila, Le Prince Igor…) ne m’est pas apparu au mieux de sa forme. Outre une diction un peu empâtée et un français peu clair, la puissance vocale et les aigus me sont apparus insuffisants, systématiquement couverts par l’orchestre et ses morceaux de bravoure (« Le veau d’Or ! » ) sont un peu tombés à plat, y compris au niveau de l’accueil du public. Seule « Vous qui faites l’endormie ! » au quatrième acte (où Méphisto joue les Don Giovanni) se distinguait par une certaine délicatesse : le reste n’a pas été du tout convaincant. Mais sans doute l‘artiste était-il un peu fatigué. Méphisto peut être confié à une basse slave (Christoff, Ghiaurov!), mais il faut un minimum d’éclat qu’Abdrazakov n’avait pas ce soir-là. Jadis un Roger Soyer, avec une voix moins puissante mais une émission parfaite (sans parler de la diction) faisait un Méphisto de très grande classe… Il y a donc là de ma part une déception certaine.
Maria Agresta était Marguerite. La (encore) jeune soprano lyrique, qui commence à s’attaquer aux rôles plus lourds (Norma) a une voix qui effectivement s’est étoffée. C’est une artiste qu’on a entendue soit dans des rôles de Bel Canto (Norma ou Elvira de Puritani) mais aussi des rôles pucciniens (Liù, Mimi, Suor Angelica) ou verdiens (Amelia de Simon Boccanegra, Desdemona, Amalia de I Masnadieri, Leonora de Il Trovatore). Marguerite est je crois une prise de rôle, qui du point de vue vocal correspond à un type de répertoire qu’elle chante, lirico-colorature, demandant puissance mais aussi agilité. Mirella Freni qui chantait beaucoup de rôles qu’aujourd’hui Maria Agresta chante, fut une des grandes Marguerite du dernier XXème siècle. Il n’y a donc aucune contre-indication. Le rôle est dans sa voix ou dans ses cordes. Marguerite n’est pas un rôle léger.

Certains m’ont dit avoir été un peu déçus par la prestation. Ce n’est pas mon cas: sa Marguerite est sensible, bien contrôlée, avec une diction correcte, et surtout une chaleur et une rondeur notables. Toute sa dernière partie vraiment tendue et engagée, montre une belle personnalité scénique et un certain sens des couleurs. Il faudra qu’elle chante le rôle encore pour affiner l’expression, polir ici ou là un rôle qui a plusieurs facettes (le troisième acte – scène du jardin – requiert agilité et brillance, les quatrième et cinquième sont bien plus dramatiques ) mais Marguerite est un de ces rôles polymorphes qui par ses exigences se rapproche de certains rôles du Grand Opéra ou du jeune Verdi. La mise en scène n’exige pas trop du rôle, sorte d’ange (vêtu de blanc) descendu sur terre qui va être souillée (et qu’on va ensuite habiller de noir – scène de l’église -…c’est classique); victime, elle est relativement passive, sauf au moment où elle appelle Faust « Viens, viens! » dans la scène du jardin où le désir fait son oeuvre. La composition dans son ensemble est intéressante même si perfectible. Elle peut devenir une grande Marguerite.
Plus discutable est Piotr Beczala dans Faust. C’est un rôle qu’il a chanté à Paris, à Barcelone, à New York, à Vienne. Il chante d’ailleurs d’autres rôles français (Roméo, Werther) et bien qu’il ne parle pas français, il le chante avec un souci de clarté et d’exactitude qu’on doit saluer : sa diction est pratiquement impeccable. Beczala est un travailleur, qui a le souci de la précision, qui ne rate pas ses aigus, qui chante de nombreux répertoires: je me souviens d’un duc de Mantoue de Rigoletto au MET peut-être pas idiomatique, mais sans fautes de chant ; -c’est le cas de son Riccardo de Ballo in maschera, de son Alfredo injustement hué de Traviata à Milan et de son récent Lohengrin à Dresde. Impeccablement en place. Il chante les notes, il fait parfaitement le job et à ce titre c’est vraiment l’une des voix les plus sûres aujourd’hui. Je ne suis pas certain qu’il soit pour autant un musicien, et qu’il fasse de la musique. Il chante, il est sérieux et appliqué c’est évident. Mais pour mon goût, il chante un peu tout de la même manière, sans marquer l’expression, sans vraiment colorer, sans dessiner un univers. Un chant pour moi interchangeable et au total assez plat. Je trouve ses prestations intéressantes (son Riccardo de Bal masqué est vraiment travaillé), mais jamais passionnantes. J’avais eu la même impression dans Lohengrin.
Pour Faust, j’ai été élevé au lait Gedda, si j’ose m’exprimer ainsi, c’est à dire un chant techniquement impeccable, un style unique, une diction miraculeuse et une expressivité, une personnalité vocale hors pair qui habitaient le personnage. Pour Faust, il y a pour moi une manière d’attaquer les aigus non pas droite et fixe, à la manière d’un Canio de Pagliacci, mais au contraire subtile en soignant les passages. Les aigus ici, dans son Faust sont négociés comme n’importe quels aigus, ne donnant pas l’ambiance ni la couleur tout de même plus romantique (voire belcantiste) voulue. Il y a une élégance impersonnelle dans ce chant, un chant presque « prêt à porter de luxe » mais pas « haute couture » . Certains vont me trouver sévère, mais pour ne pas plonger dans le passé, un Roberto Alagna a un style et une manière de chanter ça bien autrement passionnante, bien autrement expressive (même avec les difficultés qu’il peut avoir aujourd’hui sur certains aigus). Si l’on devait trouver des Faust non français aujourd’hui, je pense qu’il faudrait chercher du côté de Francesco Meli, qui a l’élégance et le contrôle voulus, et surtout la culture du répertoire ou même Juan-Diego Florez qui s’attaque à Werther. Ce qui est curieux chez Beczala, c’est qu’il a une culture du chant français, et une volonté de se positionner sur ce répertoire, mais qu’il n’en travaille pas la couleur. Chanter les notes n’est pas tout (et il les chante bien et juste), il y a tout le reste. Pour tout dire, Beczala ne me fait jamais rêver ; voilà un chanteur qui aurait grand intérêt à chanter du Lied, à travailler le mot, à travailler l’univers sonore et musical, pour enrichir sa palette interprétative, et peut-être en dépit de tout resserrer sa palette de répertoire, bien qu’il ne s’attaque jamais à un rôle qu’il n’ait pas vraiment en gorge. Comme la tête et les jambes chez les sportifs, il y a la tête et la gorge chez les chanteurs. Il lui manque une vraie personnalité, qui puisse embrasser un rôle dans sa totalité et nous n’y sommes pas.

Le Chœur Philharmonia de Vienne (préparé par Walter Zeh) a été fondé au temps de Mortier, sans doute pour élargir la possibilité d’en appeler à un chœur, puisque Salzbourg emploie pour l’essentiel le Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, c’est à dire l’association qui gère les prestations du chœur de l’opéra de Vienne en dehors de la Staatsoper. C’est donc un chœur qui se compose ad-hoc, pour tel ou tel projet, très adaptable, sans doute aussi très ductile au niveau scénique.
Dans une œuvre qui demande une présence forte du chœur, sur scène et en coulisses, sans doute un chœur d’opéra rompu à ce répertoire et à l’habitude eût été plus efficace, même si le Philharmonie Chor de Vienne participe à de nombreux projets et productions dans de nombreux festivals . Le chœur m’a semblé quelquefois pas toujours bien audible en coulisses, pas toujours non plus en mesure et en phase avec la fosse, avec quelques moments cependant très réussis et spectaculaires (« Gloire immortelle… » bien mis en relief et en scène).
Enfin l’orchestre, le Philharmonique de Vienne, ne pouvait pas faillir à sa réputation : sous la direction très claire d’Alejo Pérez, on entend des phrases musicales, des moments instrumentaux inédits, qu’on n’avait jamais remarqués dans une œuvre que je croyais pourtant connaître par le menu. Il y a des raffinements, des jeux musicaux aux bois notamment qui laissent pour le moins méditatifs, et qui montrent aussi que Gounod n’est pas toujours celui que certains méprisent un peu. Les Wiener Philharmoniker font en fosse un travail magnifique, parce qu’ils sont un orchestre d’exception. Alejo Pérez fait aussi un travail singulier sur le podium, très contrasté, au rythme assez lent, fouillant la partition et lui donnant un relief inattendu, mais sans vraiment avoir une vision globale de l’oeuvre. Il manque à cette approche quelque chose de plus fluide, de plus élégant, de moins appuyé, moins marqué: c’est une direction qui tire plutôt vers un univers plus tardif, au bord du vérisme, là où quelquefois on aimerait entendre des moirures à la Auber. C’est très dramatique, très appuyé plus que lyrique. Plus Gros Opéra que Grand Opéra.
Fallait-il éliminer le ballet de la Nuit de Walpurgis? Eternelle discussion. Musicalement c’eût donné quelque chose de plus dansant qui eût peut-être irrigué le reste de l’approche. Si je me réfère à Lavelli, il avait plaqué le ballet lors de la première série de représentations pour en faire quelque chose de complètement détaché de l’opéra (si je me souviens bien c’était Balanchine qui avait réglé le ballet), qu’on ne revit pas après la première saison. Dans l’optique de cette mise en scène « sérieuse » sans doute la suppression du ballet prend-elle son sens, mais dans l’optique d’une première production de Faust à Salzbourg, peut-être une version complète eût-elle été bienvenue. Un opéra qui a triomphé à l’Opéra de Paris sans son ballet, c’est toujours un peu dommage, mais si l’Opéra de Paris lui-même au nom de la modernité (stupide motif) y renonce, peut-on en vouloir à Salzbourg?
Ainsi donc les anges radieux sont-ils rentrés à Salzbourg pour la première fois, dans une production en demi-teinte, qui ne rend pas totalement justice à l’œuvre : une production respectable, même si oubliable.[wpsr_facebook]

