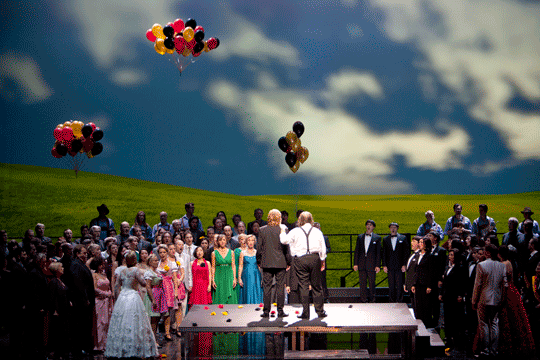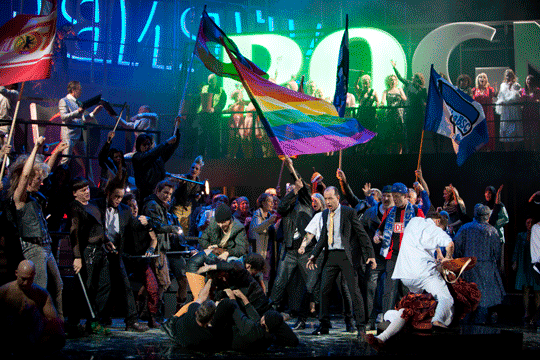
L’Orchestre est prêt, scène ouverte, le chœur s’installe, les Maîtres aussi, tous venus de la salle, on bavarde, on se salue, on s’assoie. On fait silence. Puis au milieu de la scène arrive une dame avec un micro, on se dit : « Aïe ! l’annonce d’un malade… » Mais la dame nous rassure tout de suite en disant que tout le monde est en forme.
Elle vient nous dire simplement qu’après la représentation, le personnel de l’opéra sera aux portes pour recueillir ce que voudront bien verser les spectateurs pour les réfugiés arrivés à Berlin, de manière à résoudre au plus vite les questions pratiques et logistiques, l’argent liquide ira directement à une des associations berlinoises en charge du problème.
On croit rêver.
On croit rêver… et pourtant, cette manière de faire est implicitement cohérente avec la mise en scène de ces Meistersinger d’Andrea Moses, qui, en quelque sorte, fait le point sur l’Allemagne d’aujourd’hui et l’identité allemande.

Je trouve toujours plus que Die Meistersinger von Nürnberg est l’opéra le plus beau, le plus intéressant et le plus profond de Wagner. Je sais pourtant que beaucoup de wagnériens non allemands ont des difficultés avec cette œuvre. Moi même je n’y suis pas facilement entré. Mais quand tombent les blocages, quel univers fascinant ! Voilà une œuvre complexe, qui fut une sorte de modèle, dont on retrouve trace(s) aussi bien dans le Falstaff de Verdi que dans la Cinquième de Mahler, qui cumule les questions, celle du propos, d’abord, qui n’est pas si évident, celle de la réception ensuite, puisqu’elle a été ballotée entre la comédie pour distraire le bon bourgeois bavarois, et le symbole de l’identité allemande, glorifiée par les nazis pour devenir la seule œuvre possible à Bayreuth pendant la deuxième guerre mondiale, c’est elle enfin, en 1956, qui a été complètement nettoyée des scories brunes par Wieland Wagner à Bayreuth.
L’histoire de l’œuvre dans les 50 dernières années à Bayreuth est intéressante à rappeler pour comprendre l’importance de ce qu’Andrea Moses veut transmettre. Dernière œuvre « autorisée » par l’oncle Wolf à Bayreuth et jouée jusqu’en 1944, elle fut la seule des productions du Festival 1951 à ne pas subir le nettoyage par le vide wielandien. Il attendit 1956 et ce fut un scandale énorme, puis en 1963 il en « externalisa » la problématique chez Shakespeare dans un décor très inspiré du Théâtre du Globe essayant alors de « dégermaniser » la question. Une mise en scène qui dura peu, puisque dès 1968, après la mort de son frère, Wolfgang en proposa une vision assez traditionnelle, reprise avec de menues variantes jusqu’en 1996 et au seuil des années 2000. En gardant la main sur l’œuvre, Wolfgang donnait en quelque sorte un gage à ce public de Bayreuth qui ne digérait pas le Regietheater entré dans le temple wagnérien dans les années 70, et l’œuvre très populaire auprès de ce public (elle a même un public très spécifique) n’était ainsi pas remise en cause dans son aspect disons…folklorique. Un deal en quelque sorte.
Katharina Wagner osa affronter la discussion sur une œuvre que Bayreuth avait traité de manière ambiguë et qui continuait de traîner son image un peu délétère. Elle fit de Sachs un libéral qui vire au conservateur puis au dictateur : son discours final devenant clairement un discours hitlérien. Il faut se souvenir de l’excellent Hawlata mimant Adolf avec ses mouvements de main nerveux, entouré de statues à la Arno Breker, et Walther entre du même coup dans le rang dans un conformisme désolant. Et elle fit au contraire de Beckmesser une image d’ouverture et d’innovation. C’étaient des Maîtres « cul par dessus tête ».
En 2017, pour la première fois depuis 1956, une mise en scène des Maîtres à Bayreuth échappera à un Wagner, puisqu’elle est confiée à Barrie Kosky.
Daniel Barenboim, après une petite vingtaine d’années de présence à Bayreuth, a installé à Berlin un pôle wagnérien particulièrement médiatisé : Festival annuel, et productions très discutées ces dernières années : le Tannhäuser de Sasha Waltz puis le Parsifal de Tcherniakov ont installé définitivement la Staatsoper de Berlin et permis de rivaliser avec Munich et Bayreuth sur les exécutions wagnériennes de référence : Guy Cassiers (pour le Ring), Dmitri Tcherniakov et Sasha Waltz sont évidemment des noms qui comptent dans le monde théâtral.
Avec Andrea Moses, l’Opéra d’Etat de Berlin a fait appel à un metteur en scène moins en vue, originaire de Dresde (en ces temps de Pegida, ça compte) une jeune femme (il n’y en a pas trop dans le monde des metteurs en scène) qui affronte le plus tudesque des opéras.
Andrea Moses pose justement la question de l’Allemagne, très nette, très affichée (drapeau géant présent en permanence, dans lequel s’enroulent Eva et Waltehr au deuxième acte, délicieuse cachette pour amants, ballons aux couleurs germaniques, insignes des maîtres aux trois couleurs etc.). Et elle réussit le prodige de ne pas en faire un manifeste nationaliste, parce qu’elle pose la question de l’œuvre en lui permettant de se dérouler telle quelle dans une Allemagne apaisée, faisant de Nuremberg non pas la ville folklorique traditionnelle, mais une image de ville moderne qui reflète une Allemagne du jour, où Sachs cultive son cannabis sur le toit, et où les bagarres naissent des oppositions de supporters d’équipes de foot comme au deuxième acte, une Nuremberg très berlinisée qui abrite des punks berlinois. Même chez Wagner d’ailleurs, Nuremberg n’est pas la ville de Nuremberg, hic et nunc, mais un univers presque abstrait où art et artisanat se parlent, un monde où la discussion esthétique est quotidienne, une sorte de République platonicienne dont poètes et musiciens seraient les Maîtres.
Trois points frappent dans ce travail :
- d’abord, le retour de la farce, du « Witz », la première scène dans l’église où Walther caresse le dos nu d’Eva est à la fois hardie et désopilante, Hans Schwarz (Franz Mazura, 91 ans bien portés !), qui ne cesse d’avaler ses pilules en se faisant encore plus vieux qu’il n’est, David malmené par ses copains, un groupe de Punks un peu agités, on rit beaucoup, on sourit souvent.
- Ensuite, la scrupuleuse obéissance au livret, en le faisant aller au fond des choses, en installant Sachs dans son personnage de poète intellectuel (une bibliothèque riche en livres variés, comme on le voit au début du troisième acte) et notamment en révélant l’ambiguïté d’Eva, et son jeu entre Sachs et Walther (c’est presque d’ailleurs un topos de l’œuvre aujourd’hui) : même transposée, on reconnaît toute la trame.

Acte III: Sachs (Wolfgang Koch) , Eva (Julia Kleiter) Walther (Klaus Florian Vogt) ©Bernd Uhlig - Enfin, cette transposition moderne est plus subtile qu’il n’y paraît : l’affichage du panneau des sponsors comme lors des conférences de presse des entraîneurs au foot ou en formule 1, la présence lors de la Festwiese de délégués d’un Etat du Golfe, à qui on explique le déroulé, sans doute parce qu’ils sont des financeurs potentiels, les néons des toits de Nuremberg qui indiquent Sachs, ou Pogner comme autant de firmes qui cherchent à se vendre, sont des indices des intentions de la mise en scène : ces Maîtres d’aujourd’hui construisent une reconstitution « marketing » de l’histoire des Maîtres Chanteurs, cherchant sans doute un sponsor pour financer l’opération « Meisterfest » comme il y a l’Oktoberfest, et cherchant à affirmer une identité plus festive qu’idéologique, avec les qualités et les défauts du modernisme ambiant.

Acte I Sachs sur fond de sponsors©Bernd Uhlig Et du même coup on comprend évidemment pourquoi on sort le fauteuil de Sänger (« der Sänger sitzt ») sous une housse de plastique transparent, tout comme l’établi de Sachs, comme des objets sortis du grenier, reliques d’une époque disparue qu’on essaie de faire revivre plus ou moins artificiellement , on comprend aussi pourquoi les fauteuils des maîtres au premier acte sont des meubles dépareillés comme sortis du même grenier: nous sommes dans une représentation de « théâtre dans le théâtre ». Je dis « nous », parce que nous, spectateurs à Berlin, sommes évidemment part de la représentation, comme le montre l’accrochage des ballons tricolores sur scène et dans la salle, comme le montre la première image où chœur et spectateurs se font face avec la fosse au milieu pour écouter religieusement l’ouverture, et comme le montre l’image (quasi) finale du Palais impérial de Berlin, fond de scène bien peu nurembergeois, mais allusion claire au débat historique de la reconstitution d’un Palais impérial qui perdit sens et fonction à la chute de l’Empire, et donc à la question de l’Allemagne et de sa mémoire, voire de sa relation à l’histoire. Un texte du programme en souligne d’ailleurs l’absurdité.
Aussi, quand l’effigie du Palais disparaît au profit de celle d’une sorte de prairie idéale et apaisée, une vraie « Festwiese » débarrassée de tout symbole politique, et que tous se tournent vers elle, alors, l’Allemagne unie autour de l’art et de la nature, apparaît, une Allemagne illuministe qu’on veut éternelle, et dont ces Meistersinger se veulent le nouvel emblème. Débats esthétiques, débats médiévaux, débats d’aujourd’hui et surtout débats allemands, voilà l’idée qui nous est proposée.

L’histoire est donc racontée avec distance, avec un regard à la fois tolérant, mais tout de même acéré, qui affiche l’aujourd’hui des sponsors, y compris les plus incongrus, et l’aujourd’hui d’une communauté diverse, pas forcément unie, mais disponible. On croise donc aussi bien un juif orthodoxe un peu ahuri par la bagarre du deuxième acte que des financeurs du golfe, des supporters de foot (un peu hooligans), des nostalgiques de l’Empire qui agitent le drapeau noir/blanc/rouge rétabli par les nazis qu’on fait bien vite taire, et des maîtres qui sont d’authentiques maîtres chanteurs historiques, Siegfried Jerusalem, Rainer Goldberg, Olaf Bär, Graham Clark, Franz Mazura (91 ans) qui chantèrent chacun jadis un des grands rôles de l’opéra et qui furent à un moment symbole d’une identité ouverte (tous ne sont pas allemands) et unie autour de la musique.
Jeu subtil entre représentation et réalité, et représentation de la réalité, l’opéra utilise la salle et les spectateurs comme des spectateurs de Maîtres lointains et proches, qui concernent directement un public allemand et une Allemagne sans doute assez sûre d’elle pour lier de nouveau cette œuvre à un discours identitaire certes, mais jamais dominateur.
Du même coup, ces Meistersinger ont une saveur nouvelle : ils disent la grandeur de l’Allemagne du jour, avec ses qualités et ses défauts, avec sa diversité et ses problèmes, sans se poser le satané problème identitaire qui empoisonne inutilement et stupidement ce type de discours en Allemagne et ailleurs. Si Die Meistersinger von Nürnberg apparaît comme une manière d’opéra national, ce ne fut jamais un opéra nationaliste, sauf dans les fantasmes des âmes nazifiées. Que Daniel Barenboim conduise le bal est évidemment un gage, compte tenu des opinions qu’il a toujours affichées, de son ouverture et il faut bien le dire, de son courage, et bien entendu, de sa propre identité d’israélo-argentin au passeport palestinien vivant à Berlin.
Ainsi, la quête pour les réfugiés (qui apprend-on par un tweet, a recueilli 11000 €) prend-elle place légitimement dans une soirée qui célèbre une autre Allemagne que celle des clichés ou des peurs brunes.
À une mise en scène aussi réussie et aussi profonde correspond un travail musical exceptionnel, qui associe solistes, troupes, chœur et orchestre. Daniel Barenboim, dans une salle de 900 places (au merveilleux rapport scène salle, il faut le souligner), et pour une œuvre aussi monumentale, réussit à équilibrer les volumes au point qu’aucun chanteur n’est jamais couvert, qu’on entend tout, avec un vrai souci du texte, qui est dans cet opéra un élément fondamental, dont on ne peut jamais faire abstraction, tant il y a entre texte et musique une sorte de complicité, de systèmes d’échos, de précisions qui font que l’un est toujours tributaire de l’autre. C’est d’ailleurs le problème pour les spectateurs non germanophones ou non allemands, qui n’arrivent pas toujours à rentrer dans ce texte et ses jeux permanents sur tel ou tel mot, auquel répond une musique construite en fonction et de la lettre et du sens du texte, sans doute portée ici à sa perfection parce qu’elle sonne en même temps intime et collective. Intime… j’ose ici un mot qu’on n’associe pas toujours aux Meistersinger von Nürnberg, mais qui correspond parfaitement à l’une des couleurs de cet opéra- et qui en fait la complexité : Die Meistersinger est un opéra intimiste qui fouille les dédales de l’âme de Sachs, à la fois Tristan et Roi Marke, inventeur et créateur encore plein de ressources, et individu aimant au seuil de la vieillesse, qui se pose en permanence la question de l’être et de l’avoir été, intellectuel et artisan, à la fois citoyen et anti-système, qui raconte ici l’histoire de sa renonciation.
Ainsi la direction de Daniel Barenboim, d’une clarté exemplaire, est peut-être l’une de ses plus grandes réussites, parce que même dans les parties les plus spectaculaires (ouverture, chœurs, final), elle n’est jamais cabotine ou démonstratrice (ce qu’on lui reproche souvent), elle est toute faite de subtilité, de raffinements, de poésie et n’exagère rien dans un dialogue exemplaire entre intimisme et ensemble, entre musique de chambre (oui, vous avez bien lu) et symphonisme : la Staatskapelle Berlin le seconde dans ce propos de manière exemplaire : pas une scorie, des parties solistes à faire rêver (les violoncelles, les bois à se damner), et l’orchestre à lui seul construit cet univers idéal qu’on perçoit sur scène et qui fait que le spectateur sort toujours e heureux et en paix après avoir entendu cette œuvre.
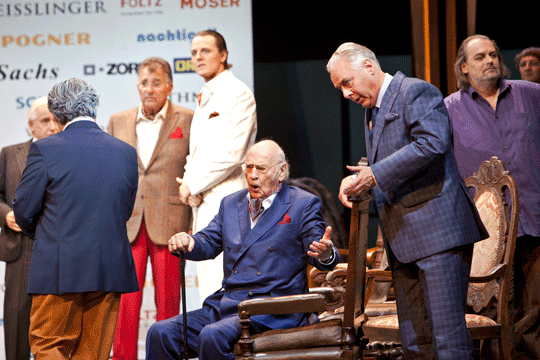
Car sur scène, il y a d’abord une équipe, une troupe, un ensemble dont la cohésion est visible. Il est clair que les chanteurs ont tous pris plaisir à un travail qui va sans doute devenir une grande référence dans l’histoire de la production de l’œuvre.

Les Maîtres d’abord : certes, la distribution des Meistersinger est toujours difficile pour un théâtre notamment à cause de ces 12 maîtres qui ne sont pas des rôles de complément (c’est un peu le même problème pour les Walkyries). La Staatsoper de Berlin a résolu le problème en distribuant huit des douze maîtres à des maîtres du chant, des Maîtres-Chanteurs authentiques d’hier ou d ‘aujourd’hui : aujourd’hui pour les rôles principaux Sachs (Wolfgang Koch), Pogner (Kwangchul Youn), Beckmesser (Markus Werba), mais aussi Kurt Vogelgesang (Graham Clark, qui fut un David merveilleux), Balthasar Zorn (Siegfried Jerusalem, ci-devant Walther, mais aussi Tristan, mais aussi Siegfried, mais aussi Lohengrin, mais aussi Parsifal , mais aussi Siegmund, mais aussi Loge, mais aussi Froh), Ulrich Eisslinger (Reiner Goldberg, un des ténors wagnériens qui réveilla tant d’espoirs au moment où l’on était en panne de ténors et qui fut à Bayreuth Erik, Tannhäuser, Siegfried, et naturellement Walther) , Hans Schwarz (Franz Mazura, une des basses wagnériennes les plus importantes qui chanta à Bayreuth de 1971 à 1995) et le Hans Foltz d’Olaf Bär (considéré en son temps comme le successeur de Dietrich Fischer Dieskau, un des maître du Lied et de la musique sacrée jusqu’au début des années 90 et qui chanta Günther et Donner à Bayreuth). Au-delà de l’émotion de voir ici réunies des gloires du chant wagnérien, l’idée de les réunir dans une œuvre aussi emblématique de l’éducation musicale et de l’éducation au chant est vraiment un vrai coup « de maître ».
Particulièrement « réaliste », la mise en scène assigne à chacun une part du jeu, focalise tour à tour l’action, notamment sur le vétéran Mazura, toujours au premier plan, chacun a quelque chose à faire, avec une précision dans le jeu d’acteur qui rappelle le travail de Frank Castorf, et qui ne démentit jamais Wagner quand il définit ce qui est imposé au chanteur dans Die Meistersinger von Nürnberg en matière de diction et de fluidité des dialogues. Il y a dans ce travail presque « choral » au sens « Bachien » du terme, presque fugué au sensF du terme (combien le Falstaff de Verdi se souvient de ces Meistersinger…), quelque chose d’une ciselure prodigieuse, d’un travail de joaillerie qu’un artisan-maître de Nuremberg ne pourrait démentir.
A

utre exemple de joaillerie dans la mise en scène, le Nachwächter de Jan Martinik de bonne facture, habillé en pasteur, que personne de craint plus, qui veille au salut des âmes –Seelenwächter plus que Nachtwächter-, bientôt victime lui-même des baruffe du final de l’acte II, dans une Allemagne qui n’a pas peur des transgressions.
Évidemment, les grand solistes ne démentent en rien l’observation de ce travail global des maîtres, à commencer par le Veit Pogner de Kwangchul Youn, à la voix toujours sonore, plus vivant et plus coloré que d’habitude, avec un chant à la fois net, à la diction impeccable et à la couleur bon enfant.

Le Beckmesser de Markus Werba est sans doute scéniquement remarquable, jamais caricatural, ni exagéré, mais un peu décalé par son côté « professeur » tiré à quatre épingle, une sorte de Topaze un peu has been, et peu sûr de lui, qui essaie de se glisser dans les habits voulus « au sens propre », puisqu’il est vêtu d’habits médiévaux au deuxième acte pour chanter sa romance (costumes d’Adriana Braga-Peretzki, qui a fait aussi les costumes du Ring de Castorf à Bayreuth); des habits qui rappellent un peu, de loin, le Mezzetin de Watteau, dans une atmosphère de « fête galante » très anachronique par rapport à l’ambiance voulue par cette mise en scène et qui souligne à plaisir l’anachronisme du personnage. Sans vouloir à tous prix établir des liens, soulignons quand même que Verlaine publie ses Fêtes Galantes en 1869, soit un an après la création des Meistersinger. Ce Beckmesser est ridicule parce qu’il n’est plus de ce temps, mais parce que sa jalousie et sa petitesse, elles, le sont. Il est chanté par un Markus Werba valeureux, mais qui ne sort pas du lot des bons Beckmesser, respectables mais pas exceptionnels. Les grands Beckmesser, eux, sont des modèles de chant, qui peuvent en remontrer à Sachs : ils ont nom Hermann Prey (à Bayreuth), ou même Michael Volle, qui, avant d’être Sachs sur scène, à Zurich et Salzbourg, a été un immense Beckmesser (à Bayreuth encore). Il y a vocalement dans Beckmesser un Sachs possible.
Magdalena est la jeune Anna Lapkovskaia, vue à Bayreuth dans le Ring cet été, elle se sort très honorablement d’un rôle un peu ingrat, jamais mis en valeur et pourtant toujours très présent dans les grands moments (le quintette…) et qui est souvent un gage de futur, tandis que le David de Stephan Rügamer (troupe de la Staatsoper de Berlin) est frais, jeune, vif, comme souvent chez ce ténor toujours juste.
Julia Kleiter abordait Eva pour la première fois. Habituée aux rôles plus légers ou aériens : Ännchen, Pamina, Sophie, Eurydice. Ella aborde Eva, un rôle faussement léger, qui demande à la fois les qualités des rôles cités précédemment, mais aussi une assise vocale plus forte, il faut se faire entendre au quintette, et il faut savoir aussi jouer et chanter les coquettes à l’acte II : personnage complexe, qui vire de jeune fille à jeune femme, en faisant passer Sachs de la maturité à la vieillesse. Certains lui ont reproché une certaine raideur, un manque de lyrisme qui donnait au personnage un aspect plus rêche. J’ai trouvé que dans cette salle, la voix sonnait bien et s’affirmait remarquablement, et j’ai aimé ce ton moins uniforme que d’habitude, plus nerveux, plus tendu. Comme un personnage en crise d’identité qui passe de Sophie à Susanne (qu’elle chante d’ailleurs aussi). La mise en scène l’habille plus « femme » que « jeune fille » et c’est ce passage-là que je trouve réussi vocalement dans une sorte d’instabilité théâtrale bien rendue vocalement qui m’a bien plu.
Klaus Florian Vogt est un Walther déjà éprouvé ailleurs, à Bayreuth, et même à Genève, face à une lumineuse Eva qui avait nom Anja Harteros. Il possède chaque inflexion du rôle, chaque nuance, chaque respiration aérienne. Mais il n’a plus ce qu’il avait naguère, une jeunesse de timbre séraphique, certes toujours enchanteur et un peu étrange mais imperceptiblement plus mature, moins éthéré, moins « étonné » et donc moins « étonnant ». Je sais que certains lecteurs peuvent me trouver difficile, mais dans Meistersinger, on chante toujours sur le fil du rasoir : Vogt chantait merveilleusement ce rôle parce qu’il en épousait les évolutions, d’un chant d’élève frais et naïf au premier acte à un chant de Maître au troisième. Il chante ici en professionnel, merveilleux certes, mais dans les équilibres subtils de la partition, on y croit un peu moins.

Reste Wolfgang Koch.
J’avais cet été hautement apprécié le monologue de Wotan du deuxième acte de la Walkyrie, pour moi un des sommets musicaux et vocaux du Ring de Bayreuth, où Wolfgang Koch atteignait un degré de profondeur sidéral, grâce à un corps à corps avec le texte, dont il faisait un gouffre à l’incroyable profondeur. Muni de ce viatique, il aborde Hans Sachs qu’il va reprendre avec Kirill Petrenko à Munich dans la mise en scène de David Bösch en mai prochain. C’est d’emblée un Sachs de référence : il a d’abord ce qui fait Sachs, à savoir la science du Lied, qui construit un univers par le chant : il a le mot en bouche, modulé jusqu’aux inflexions les plus subtiles et les plus fines, il dit un texte avant de le chanter et en ce sens il répond mot pour mot aux exigences de Wagner dans cette œuvre. Il est ensuite le personnage, sur scène, un peu négligé, mais pas trop, très simple et jamais «envahissant » ni imposant ni cabot, un personnage d’une humanité profonde et perceptible par le jeu, les attitudes, voire le côté un peu « farouche ». Un Sachs qui faiblit à peine à la toute fin de l’œuvre (le rôle est écrasant) et qui nous gratifie d’un troisième acte anthologique, dans sa bibliothèque d’intellectuel où trônent toutes sortes de volumes (beaucoup de partitions mais pas que…) sur de hauts rayonnages et un tableau de la renaissance allemande représentant un groupe d’hommes, tout de noir vêtus, image sociale et référentielle à la fois. Un Sachs déjà de référence, et qui marque cette représentation de son empreinte : ni basse profonde, ni haute stature, un Sachs à l’allure commune, ni aristocrate à la Fischer Dieskau, ni popu à la Hawlata, mais un humain ordinaire parmi les humains, à la fois simple et définitif.
Voilà ce que furent ces Meistersinger von Berlin, magnifiquement adaptés à cette ville ouverte et disponible, extraordinairement plurielle, qui célébrait le 3 octobre le « Jour de l’Unité » et où on le célébrait en fête à la Staatsoper pour la Première de cette production, une production très politique et très ironique en même temps, mais jamais cynique, jamais amère, jamais autre que souriante et apaisée. Il sera d’autant plus stimulant de comparer ces Meistersinger berlinois aux Meistersinger munichois en mai prochain, qui vont réinstaller ce pilier du répertoire munichois où ils ont été créé.
Mais ce soir, nous étions tous des berlinois. [wpsr_facebook]