
Dans son essai Wagner Theater (Suhrkamp 1999, 4ème édition 2013) Nike Wagner, fille de Wieland, souligne que les thèmes wagnériens, dans les opéras, dans l’histoire d’Allemagne et dans l’histoire même de la famille Wagner, oscillent entre deux pôles, le pôle Ring et le pôle Graal. L’esprit Ring, ce sont les luttes pour le pouvoir et l’argent, les histoires de famille et l’esprit Graal, c’est l’idéal, le sublime, le testament de l’œuvre. Nike Wagner met en regard le final destructeur de Götterdämmerung et du Ring et celui apaisé et suspendu de Parsifal, les seules œuvres indissolublement liées à Bayreuth. Quelle que soit la manière dont on y pense, dont on pense son histoire et ses péripéties, Bayreuth est une succession d’esprit Ring et d’esprit Graal, esprit Graal sur scène et esprit Ring dans la coulisse, et c’est peut-être sous cet angle qu’il faut regarder la mise en scène de Castorf, toute dédiée au décryptage de l’esprit Ring. Comme le Parsifal de Herheim racontait d’une manière toute particulière le passage de l’esprit Ring à l’esprit Graal.
Car Bayreuth est un lieu tout particulier que le travail de Herheim avait bien décrypté.
C’est d’abord un lieu de la culture allemande, de la germanité entendue comme espace culturel et non comme revendication politique (ce qui a pu aussi être le cas dans l’histoire), les français se reconnaissent volontiers dans leur théâtre et leur littérature, et la Comédie Française, quelle qu’en soit la qualité effective, est bien en quelque sorte le théâtre de la nation. Le Festival de Bayreuth est un lieu où se croisent trois piliers de la culture allemande, la musique, si essentielle pour comprendre ce pays, la philosophie (comme le montre une vitrine consacrée à Schopenhauer à Wahnfried, mais aussi les démêlés de Nietzsche avec Wagner), le théâtre, au vu des polémiques nombreuses nées ici, mais surtout au vu du rôle national et international de Bayreuth dans les regards portés sur l’évolution du théâtre : ce n’est pas là qu’est né le Regietheater ou une nouvelle manière de faire du théâtre, mais c’est à Bayreuth, dès 1972 avec le Tannhäuser de Götz Friedrich, qu’il a été légitimé, même si l’année précédente et pour la première fois depuis 1951, soit 20 ans après, un metteur en scène autre que Wieland ou Wolfgang, August Everding, avait mis en scène Der fliegende Holländer.
Wieland Wagner avait installé l’idée essentielle selon laquelle on ne pouvait jouer Wagner indéfiniment comme à ses origines (c’était un peu la position sacrale de Cosima), et que Wagner était dans la cité.
D’une certaine manière, Wieland Wagner a relativisé le rôle « religieux » de Bayreuth, exalté en France par la fameuse phrase d’Albert Lavignac (Le Voyage artistique à Bayreuth, 1897) : « On va à Bayreuth comme on veut, à pied, à cheval, en voiture, à bicyclette, et le vrai pèlerin devrait y aller à genoux », pour installer la centralité de l’art et une certaine distance critique: « Hier gilt’s der Kunst » c’est en quelque sorte le motto du NeuBayreuth, un lieu du débat artistique.
C’est ensuite un haut lieu de la culture internationale : au delà des vicissitudes politiques entre France et Allemagne, très tôt Bayreuth devient un voyage presque obligé dans une bonne partie de la classe intellectuelle française de la fin du XIXème siècle : il suffit de rappeler le nom du premier wagnérien prémonitoire, Charles Baudelaire , et de lire les noms des collaborateurs de la revue wagnérienne (1885-1888) où l’on trouve Verlaine, Villiers de l’Isle-Adam, Mallarmé, Catulle Mendès, et les nombreux musiciens français de l’époque, bousculés entre la fascination pour Wagner et l’identité de la musique française. En 1921 un livre, Richard Wagner et la France, de Jacques Gabriel Prod’homme écrit au lendemain de la guerre retrace avec une grande précision les vicissitudes et les contradictions du regard français sur Wagner. Les français restent encore aujourd’hui le contingent étranger le plus nombreux sur la colline verte.
Mais on aimait Wagner en Angleterre et en Belgique bien avant : on trouve dans les cercles wagnériens historiques des irlandais comme George Bernard Shaw à qui l’on doit The Perfect Wagnerite: A Commentary on the Niblung’s Ring (1897) belle étude du Ring (parue la même année que la première édition du Lavignac) que tout wagnérien débutant devrait lire, et de l’autre côté du spectre politique à l’extrême droite, les anglais Houston Stewart Chamberlain (qui a écrit dans la revue wagnérienne) et bien sûr Winifred Williams Klindworth qu’on fit épouser à Siegfried Wagner, anglaise installée en Allemagne, admiratrice de Wagner et amie d’Hitler bien avant son arrivée au pouvoir.
Il est d’ailleurs amusant de constater que Cosima gardienne de ce temple de la germanité est fille d’un hongrois (il est vrai le plus européen des hongrois) et d’une française et que la compromission de Bayreuth avec le nazisme n’est pas née de l’initiative d’allemands, mais d’anglais.
En appelant des chanteuses françaises (Marcelle Bunlet avec Toscanini pour Kundry, puis Germaine Lubin pour Isolde) ou des chefs italiens (Arturo Toscanini, Victor De Sabata), aussi bien Siegfried Wagner que Winifred ont ouvert le festival aux artistes internationaux. Ce que les frères Wieland et Wolfgang Wagner dans le cadre du Neubayreuth ont poursuivi en invitant très tôt des chanteurs ou des chefs non germaniques (Ramon Vinay, Regina Resnik, André Cluytens)
Enfin il suffit de voir les polémiques et les discussions sur les réseaux sociaux d’aujourd’hui pour mesurer encore la force du wagnérisme et la réactivité des wagnériens dans le monde.
Bayreuth (parce que c’est Wagner) concerne à des titres divers aussi bien l’Allemagne que le reste du monde, c’est bien la question du Ring actuel de Franz Castorf.
La question du rapport de Bayreuth à son histoire a été posée par deux mises en scènes récentes, celle des Meistersinger von Nürnberg, œuvre chantre de « l’art allemand » dernière œuvre autorisée à Bayreuth par les nazis en 1942 et 1943, par Katharina Wagner en 2007, et Parsifal, par le norvégien Stefan Herheim en 2008. Castorf n’est pas le premier à lier explicitement l’œuvre de Wagner à l’Histoire.
J’ai souligné plus haut l’importance de Bayreuth dans l’histoire de la mise en scène d’opéra, mais aussi de la mise en scène théâtrale en général, dans la mesure où l’arrivée à Bayreuth d’une nouvelle génération de metteurs en scène, survint quand il fut clair à Wolfgang Wagner que les mises en scènes de Wieland, dont la dernière (Parsifal) a duré jusqu’en 1973, ne pourraient durer indéfiniment, et que lui même n’avait pas les capacités artistiques de son frère ni le temps pour assumer tout seul la suite. Néanmoins, jusqu’à 2002, Wolfgang a été présent de manière continue comme metteur en scène sur la colline : il estimait que sa légitimité procédait aussi de sa participation aux productions. Entre 1976 (début du Ring de Chéreau et installation définitive du Werkstatt Bayreuth) et 2002 (dernière année où il apparaît comme metteur en scène), on lui doit une production de Tannhäuser (représentée sept fois en 1985 et 1995) deux productions de Parsifal (1975-1981 et surtout 1989-2001, soit représentée 13 années de suite ) et il met en scène continûment Die Meistersinger von Nürnberg, avec une production entre 1981 et 1988 et une autre entre 1996 et 2002. C’est la seule œuvre qui n’ait pas échappé à un Wagner de 1951 à 2011 (Wieland, Wolfgang, Katharina) et qui sera confiée en 2017 pour la première fois depuis 1951, à un non-Wagner, à Barrie Kosky qui avait affirmé qu’il ne ferait jamais de Wagner.
Pour conclure sur ces longs prémices : c’est Bayreuth qui réinvente la mise en scène wagnérienne après la deuxième guerre mondiale avec Wieland Wagner. Mais avant la guerre, Bayreuth avait toujours confié les productions à des artistes extérieurs à la famille. Le Neubayreuth était un modèle différent, où tout restait dans la famille, essentiellement pour deux motifs :
- Wieland Wagner était un véritable artiste, un inventeur.
- Wolfgang était un artisan de la scène peu inventif mais honorable, mais un très bon manager ; il savait que de toute manière il coûtait moins cher au Festival d’avoir deux metteurs en scènes maison, à un moment où les frais de régie n’étaient d’ailleurs pas aussi importants qu’aujourd’hui : les mises en scènes de Wieland, très essentielles ne devaient pas coûter trop cher en termes de construction et on sait que les débuts de Bayreuth après la 2ème guerre mondiale furent très artisanaux.
Quand on voit ce qu’a dû coûter le décor d’Aleksandar Denić pour le Ring de Castorf ou même les fabuleux décors de Peduzzi pour le Ring de Chéreau, on n’est pas sur la même échelle de coûts. Il ne faut jamais oublier les questions économiques, motif essentiel de la création de la fondation Richard Wagner en 1973. La longévité de la dernière production de Wolfgang Wagner, Parsifal (13 ans) n’est pas étrangère non plus aux préoccupations économiques.
Après le Neubayreuth lié à Wieland, Wolfgang a besoin de transformer en concept la nécessité qu’il a d’en appeler à d’autres metteurs en scène. Ce sera le Werkstatt Bayreuth, manière de faire continuer à parler de Bayreuth, un concept intéressant en soi mais aussi pour le marketing maison : manière de prolonger la singularité de Bayreuth en en faisant une scène de propositions plus ou moins expérimentales : l’appel initial à Peter Stein, alors le chien fou de la Schaubühne, pour le Ring du centenaire, qui a échoué et s’est transformé en appel à Chéreau, puis l’appel à Harry Kupfer pour un Fliegende Holländer aujourd’hui encore inégalé en sont, avec le Tannhäuser de Friedrich, évoqué plus haut, les éléments premiers.
Et de fait, le Ring de Chéreau fut un incroyable choc pour le milieu théâtral et culturel, dont les conséquences sur le monde du théâtre européen et de l’opéra se font encore sentir: les huées de Castorf ne sont rien à côté des cris qu’on entendait dans la salle pendant la musique, ou des tracts qui vous accueillaient à l’entrée, ou des déclarations vengeresses de certains chanteurs de la distribution.
Chéreau a légitimé toutes les approches de Wagner par la suite et plus généralement le regard du théâtre sur l’opéra, même si Ronconi (avec son Ring initié en 1974) et Strehler pour le reste du répertoire (il abordera Wagner avec Lohengrin en décembre 1981 à la Scala) avait commencé à bousculer les choses, mais sans la chambre d’écho qu’est Bayreuth. Ce n’est pas un hasard si Kupfer parlait dans les années 80 de « Papa Chéreau ». Chéreau fut pour le Festival de Bayreuth ce que Mortier a été pour Salzbourg : il a permis de relancer la machine, de ravaler les façades, il a permis au monde de l’opéra d’être considéré par le monde du théâtre : jusqu’à Chéreau, les deux mondes étaient parallèles. Depuis Chéreau, cela n’étonne plus personne qu’un homme de théâtre fasse de l’opéra.
Il faut aussi comprendre l’appel à Peter Hall pour le Ring de 1983 (Solti) qui a semblé un recul. Après le choc Chéreau, il n’y aurait eu aucun sens à proposer un travail du même type. Il fallait une nouvelle rupture, comme une volonté de balance entre un Ring «moderne » et un Ring « classique », affirmation d’une volonté de balayage de tous les «possibles » : une proposition qui a coûté tout autant sinon plus que Chéreau vu la fabrication du plateau tournant verticalement sur lui même, une prouesse technique qui a l’époque avait beaucoup fait parler…plus que la mise en scène en tous cas.
Ainsi se sont succédés ensuite Jean-Pierre Ponnelle (Tristan), Werner Herzog (Lohengrin), Dieter Dorn (Fliegende Holländer), Harry Kupfer (Ring, magnifique), Heiner Müller (Tristan), Alfred Kirchner (Ring), Keith Warner (Lohengrin), Jürgen Flimm (Ring) qui représentent tous une modernité raisonnable. Le Ring de Jürgen Flimm étant la somme des Ring new look des dernières années et d‘une certaine manière la fin d’une époque.
L’appel à Christoph Schlingensief pour Parsifal en 2004 a constitué l’entrée en scène de Katharina Wagner, très liée au milieu du Regietheater, dans la programmation des mises en scène, et l’irruption de la performance esthétique et artistique à Bayreuth. Cette mise en scène, qui a bénéficié pendant deux ans de la merveilleuse direction de Pierre Boulez, a été plombée par une des distributions les plus médiocres des quinze dernières années.
Il est probable que c’est dans cette direction qu’aurait été Jonathan Meese, plus performeur qu’homme de théâtre, pour son Parsifal en 2016 s’il n’avait pas été remplacé pour raisons financières (!!) par le plus politiquement correct Uwe-Erich Laufenberg.
La proposition de Stefan Herheim pour Parsifal en 2008 a constitué sans doute le plus grand succès de ces dernières années. On peut seulement regretter d’une part qu’elle n’ait pas été prolongée au-delà de 2012, et que Daniele Gatti n’ait pas continué à la diriger car avec le Ring, Parsifal constitue l’enjeu symbolique le plus important à Bayreuth. L’œuvre a d’ailleurs été jouée continûment de 1951 à 1973, de 1975 à 1985, de 1987 à 2001. Ce n’est que très récemment (2002-2013-2004) qu’un laps de temps supérieur à un an existe entre deux productions, encore que Parsifal ait été joué en continu de 2004 à 2012 avec deux productions différentes, mais que 2013, 2014, 2015 sont des années sans. On s’est d’ailleurs étonné que Parsifal ne figurât pas au programme du bicentenaire de Richard Wagner de 2013.
Hors Castorf, les autres propositions liées à Katharina Wagner, sont pour l’une un gros échec, Tannhäuser (Sebastian Baumgarten), une production loin d’être sotte, mais qui a constitué un repoussoir pour le public (encore une équipe qui a hésité entre scène et performance) avec le décor de Joep van Lieshout, fondateur d’un collectif artistique (AVL) à la frontière entre Art, design, architecture et pour l’autre un succès, le Lohengrin de Hans Neuenfels dont les rats ont fait huer, puis parler, puis ont amusé, puis ont été digérés, sans doute à cause de la présence successive dans la distribution de Jonas Kaufmann et de Klaus Florian Vogt et dans la fosse d’Andris Nelsons jusqu’à l’an dernier. Avec le Ring, c’est le plus grand succès musical de cette année, avec un accueil hallucinant (et justifié) pour Vogt et très positif pour le chef Altinoglu et la distribution.
De même qu’il était inévitable un jour d’inviter Hans Neuenfels à Bayreuth, après une des carrières les plus inventives et des plus importantes du théâtre allemand, il était inévitable d’inviter Frank Castorf, l’autre symbole d’un théâtre idéologique, très lié à l’Est, à un moment où l’un et l’autre sont déjà dans le troisième âge. C’est une reconnaissance de l’importance de leur travail depuis plus d’un quart de siècle dans le paysage théâtral d’aujourd’hui et n’a rien d’une expérience de la médiocrité ou d’une provocation comme on lit quelquefois sous des plumes aussi imbéciles qu’ignorantes.
Et pourtant le choix de Castorf est un deuxième choix : Katharina Wagner nourrit depuis longtemps l’idée de confier un Ring à un cinéaste : c’était Wim Wenders qui était en vue pour 2013, après Lars von Trier pour le Ring précédent (confié finalement à Tankred Dorst, qui ne fut ni une réussite théâtrale, ni musicale).
Qui mettra en scène le prochain Ring (2020, avec Thielemann? avec un autre chef?) ?
Alors, qu’en est-il de ce Ring après une troisième vision ? Je continue de l’affirmer, voilà une production qui est un chiffon rouge pour notre époque post idéologique, mais qui nous renvoie en pleine face un regard sans concession sur monde d’aujourd’hui et de ce qu’il vaut, sans amour ni héroïsme.
En écrivant le Ring, Wagner faisait-il autrement ?
C’est ce que Nike Wagner appelle l’esprit Ring : complots, coup bas, affaires de famille, luttes de pouvoir, soif d’argent, massacre de l’innocence et de l’amour. C’est juste l’histoire que raconte Frank Castorf, en faisant de Rheingold une sorte d’épilogue et non de prologue de l’histoire (dont le premier jour, rappelons-le est Die Walküre) en en faisant une histoire de petits truands dans une station service véreuse du Texas liée à un motel (un Golden Motel quand même) pas trop bien fréquenté. C’est une manière de réduire le mythe à des marchés sordides qui avaient déjà été soulignés par Chéreau d’abord puis par d’autres.
Ce qui change chez Frank Castorf, c’est la volonté d’inscrire cette histoire dans la grande histoire du pétrole, qui est pour lui la cause de l’état du monde aujourd’hui, la cause implicite des conflits qui ont essaimé le XXème siècle au nom de ce que l’Or d’hier est le pétrole d’aujourd’hui. Chéreau insérait l’histoire dans un monde de l’industrialisation naissante (voir la forge de Siegfried), Castorf dans l’histoire de l’Or Noir, de la naissance des premiers puits en Azerbaïdjan jusqu’à Wall Street. Mais là où Chéreau évoquait seulement, Castorf montre, cherche à démontrer jusqu’au plus petit détail avec une précision d’orfèvre (d’ORfèvre…). Là où chez Chéreau il y avait encore de quoi espérer en l’homme (Siegfried restait un innocent positif), il n’y a plus rien à espérer chez Castorf, dont le Siegfried, pur produit de son éducation sans amour et seulement idéologique (à voir les livres en nombre autour du décor de l’acte I de Siegfried) par un Mime intellectuel radical (certains lui ont trouvé le visage de Brecht), est un terroriste, cruel, indifférent, sans âme, un garçon mauvais plus qu’un mauvais garçon.
Castorf inscrit ses personnages dans les mouvements de l’histoire : c’est pourquoi ce Ring est sans cesse mouvement et notamment mouvement giratoire de la tournette où changent sans cesse les ambiances et les époques, qui en est la traduction scénique ; c’est pourquoi aussi cela bouge tout le temps, notamment dans Rheingold, dans Siegfried (sur tout l’espace y compris en hauteur), dans Götterdämmerung, et logiquement un peu moins dans Walküre où sont posées les racines du mal, opéra plus discursif, rempli de longs dialogues et longs monologues.
Certains personnages changent sans cesse : Wotan est petit maquereau, puis propriétaire d’un puits an Azerbaïdjan, puis théoricien de la révolution, enfin voyageur sans bagage. Seul Alberich ne change pas, ne vieillit pas et traverse toute l’histoire, tel qu’en lui même enfin l’éternité le change, car il est le point focal, l’image éternelle du mal. Rappelons Kupfer (80 ans il y a quelques jours) qui laissait Alberich seul vivant face au public au final du Götterdämmerung.
Contrairement à ce qu’ont écrit certains, Castorf joue parfaitement, et avec plus de cohérence que d’autres la différence prologue (Rheingold) et trois autres jours, qui constituent l’histoire proprement dite, des origines à aujourd’hui, et Die Walküre, qui pose les jalons de ce récit, est volontairement plus « traditionnelle » au sens où le livret est à peu près suivi sans trop de didascalies, même si les événements de Bakou en sont la toile de fond. La question de Bakou et de l’Azerbaïdjan se pose encore aujourd’hui, et elle fut aussi bien pendant la première que pendant la seconde guerre mondiale un enjeu stratégique. Castorf s’intéressant à l’histoire de l’Or noir, ne peut qu’insérer les événements multiples qui eurent lieu à Bakou dans le tissu de son Ring, en faisant de Wotan un chef révolutionnaire et de sa fille Brünnhilde une aide au terrorisme : elle prépare les flacons de nitroglycérine pendant le récit de Wotan, qui est l’un des moments musicaux les plus passionnants de ce Ring, où non seulement Wolfgang Koch est un miracle d’intelligence du texte, mais où Kirill Petrenko accompagne avec une précision rythmique phénoménale la mise en scène volontairement très immobile de Castorf, il en résulte une tension prodigieuse, qui se poursuit dans l’annonce de la mort avec une cohérence extraordinaire.
C’est là où l’on peut saisir ce que diriger veut dire : ce n’est ni aller vite ou pas vite, ni diminuer ou retenir le son ou le laisser aller selon l’humeur, c’est au contraire avec une rigueur incroyable à partir de la partition s’obliger à accompagner le plateau, en épouser les cohérences et le discours, au nom de ce que Wagner appelle la Gesamtkunstwerk, l’œuvre d’art totale. Il ne peut y avoir , à Bayreuth notamment, un discours musical d’un côté et un discours scénique de l’autre qui seraient deux côtés d’un balancier : chef et metteur en scène sont tenus (plus qu’ailleurs et non comme ailleurs) de travailler ensemble pour produire un discours commun cohérent. Et que ceux qui ont trouvé certains moments trop ceci ou pas assez cela aillent simplement au texte, que la plupart du temps ils n’ont pas lu. De même ceux qui pensent qu’un chef a une conception une fois pour toutes indépendante des lieux et des plateaux se trompent : la lecture de Petrenko est certes toujours très fine, très discursive, quelquefois même intimiste (voir sa Lulu); mais il ne dirigeait pas le Ring à Munich (la merveilleuse production d’Andreas Kriegenburg) comme il dirige à Bayreuth, beaucoup de spectateurs qui ont entendu les deux en salle l’ont remarqué. C’est là qu’on reconnaît un vrai chef, qui chaque jour est neuf, qui chaque jour donne à découvrir, qui est toujours inattendu.
Je défends le travail de Castorf même si parmi les travaux récents j’adore celui de Kriegenburg à Munich, parce que Castorf a une approche d’abord intellectuelle, parce qu’il oblige à lire, travailler, s’informer. Impossible de comprendre ce travail sans entrer dans cette logique. Ce qui me fascine, c’est que ce travail d’une rigueur et d’une profondeur stupéfiantes va contre la consommation culturelle qu’on peut voir ailleurs, même dans Wagner, et qu’il va contre notre paresse. C’est un travail nihiliste si l’on veut, mais le Ring de Wagner ne nous laisse guère qu’un tas de cendres à la fin du Crépuscule.
Je ne cesserai donc pas de défendre ce travail, même si d’autres m’ont fasciné sans doute pour le reste de ma vie, Chéreau d’abord, Kupfer ensuite, et Kriegenburg enfin, parce que son approche tient compte du mythe et de sa poésie, puis de l’Histoire.
Castorf effectue un travail typique du Werkstatt Bayreuth, en cela Katharina Wagner ne s’est pas trompée, cette production si décriée par certains est à la hauteur de la tradition théâtrale et culturelle allemande. Mais aussi et surtout parce qu’il constitue, avec la distribution de cette année, et avec la direction de Kirill Petrenko, l’un des Ring les plus réussis à Bayreuth depuis très longtemps.
Pour une fois, mise en scène, distribution et direction musicale sont à la hauteur des attentes et des enjeux (je sais, je vais faire frémir les catastorfiens). Petrenko dans ce Ring a refait de Bayreuth un lieu de l’innovation et de la recherche musicale, il a fait du neuf, et il a produit du sens en créant cette dentelle musicale à l’affût perpétuel de ce qui se passait sur scène. Et cette direction si singulière, impressionnante par sa précision et sa variété, a pu aussi provoquer des discussions et des déceptions, parce que ce Wagner-là est un Wagner musical de l’après. Ce fut le même choc après le Ring de Boulez: il suffit de lire certains critiques très acerbes de l’époque…mais cette fois-ci, à la différence d’alors, c’est l’unanimité. Le délire qui saisit le public à chacune de ses brèves apparitions lors des saluts est un indice de son effet. Cette musique, telle qu’elle se déroule sous sa baguette, provoque une incroyable émotion. ce Ring est le Ring de Petrenko.
Deviendra-t-il le Ring de Marek Janowski? Pour deux ans encore, Marek Janowski, l’un des grands spécialistes de cette musique qu’il a enregistrée deux fois, va se confronter à une mise en scène qu’il ne doit pas vraiment partager au vu de ce qu’on connaît de ses goûts, avec une distribution largement renouvelée. Pour le festival, c’est l’occasion de relancer cette production en lui donnant de nouveaux visages. Nous verrons.
Et désormais Katharina Wagner arrive dans 15 jours aux rênes d’un festival que papa Wolfgang lui avait amoureusement préparées. Le deal de 2008, entre une jeune femme de 30 ans alors et sa sœur qui en avait plus ou moins le double ne pouvait que conduire à cette situation pour que personne ne perde la face, à commencer par le conseil de la Fondation qui avait déjà une première fois proposé Eva Wagner-Pasquier à la direction du festival. Voilà un membre de la famille qui a fait une carrière discrète, élégante, et qui n’a pas été assoiffée par le pouvoir, vu qu’elle a été essentiellement une conseillère compétente ici ou là. Pour elle, Bayreuth était un logique bâton de maréchal, pour Katharina en revanche, c’est une question de carrière et peut-être de vie : elle est sans doute de la race des femmes de pouvoir de la famille…Elle l’a d’ailleurs prouvé en affrontant des Meistersinger décapants allant contre toute la tradition locale.
Elle le prouve encore cette année en affrontant un Tristan, sans doute moins inventif dans le détail (il est vrai que le livret en est plus linéaire), mais en même temps d’une grande cohérence. Sa mise en scène pose la question de l’amour absolu, et de son impossibilité au regard des codes sociaux représentés par les serviteurs (qui inventent tant de stratagèmes pour qu’ils s’évitent) et par Marke, vrai mari trompé vengeur et sarcastique. Tous les autres personnages de l’œuvre sont contre le couple. Est-ce si loin de la vision sans amour de Castorf ? Le départ final d’Isolde entraînée par Marke qui a l’air du dire « bon, assez joué ! » n’est-il pas aussi une manière d’aller contre notre volonté d’ivresse musicale, de notre volonté d’y croire. Marke est une version plus policée des crocodiles de Castorf, mais c’est bien le même discours. Cette production de Tristan qui m’a plus séduit à première qu’à seconde vision doit être à mon avis rodée encore, mais elle montre tout de même un regard plus qu’acéré de Katharina Wagner sur les œuvres de l’aïeul.
La présence dans les lieux depuis 2000, puis depuis 2008 avec une fonction de conseiller, et depuis cette année une fonction nouvelle de Musikdirektor, responsable des recrutements de l’orchestre et de tous les aspects musicaux du festival de Christian Thielemann est un autre signe important de l’évolution de Bayreuth après l’ère Wolfgang.
Thielemann avait des ennemis, il en aura encore plus. Et Katharina Wagner sera plus exposée (les fameux coups de billard à double rebond). Vraie garantie musicale, Thielemann est très aimé du public de Bayreuth, moins Katharina Wagner qui doit gagner une légitimité qui va tenir aux choix de mises en scène, et à ses propres productions. Et on va lire désormais les choix esthétiques, le prolongement ou non du Werkstatt Bayreuth, à l’aune de ce couple là. Il est clair que les deux n’ont pas le même regard sur le théâtre d’aujourd’hui, mais les deux ont des intérêts communs. Et même si c’est l’esprit Ring qui règne sur la colline verte, les mariages de raison sont quelquefois plus solides que les mariages d’amour. [wpsr_facebook]

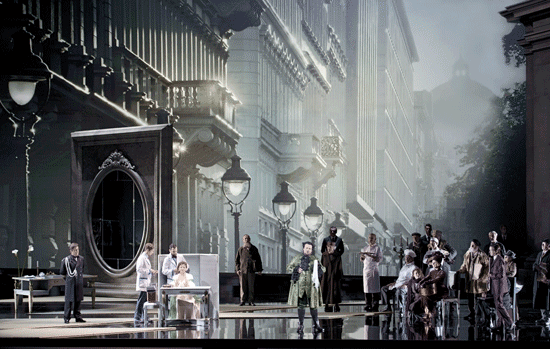
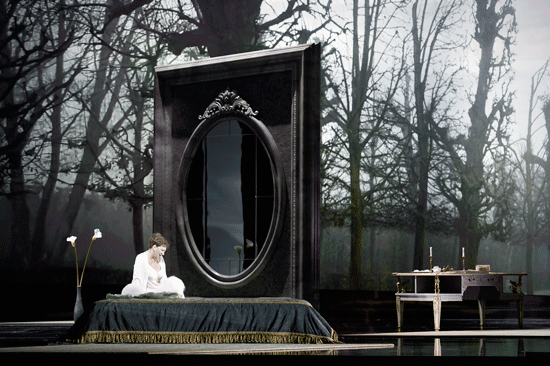





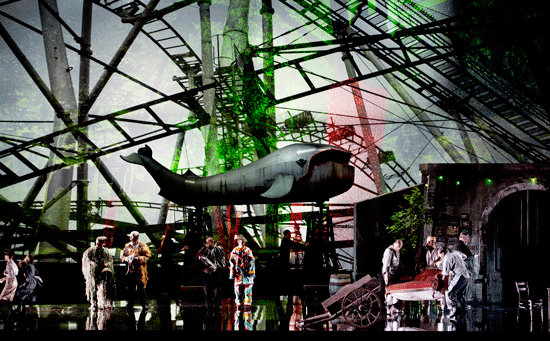

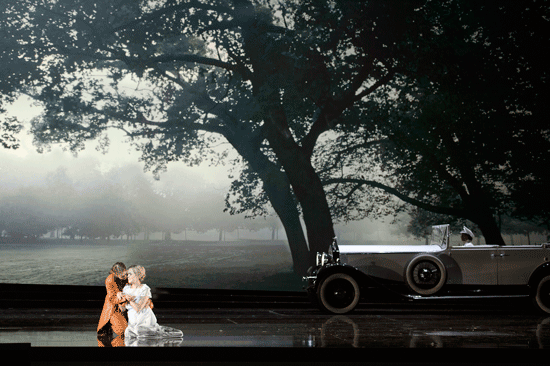





 Salut de Ingo metzmacher
Salut de Ingo metzmacher Peter Seiffert (second plan Nina Stemme et Michael Volle)
Peter Seiffert (second plan Nina Stemme et Michael Volle)

 Le résultat, c’est que Solti se retire de l’opération, laissant la place à Peter Schneider, qui assumera les trois saisons suivantes, en brave soldat de la cause wagnérienne. Signalons pour l’anecdote (mais est-ce une anecdote?) une magnifique exposition en 1983 à Villa Wahnfried sur
Le résultat, c’est que Solti se retire de l’opération, laissant la place à Peter Schneider, qui assumera les trois saisons suivantes, en brave soldat de la cause wagnérienne. Signalons pour l’anecdote (mais est-ce une anecdote?) une magnifique exposition en 1983 à Villa Wahnfried sur Anne Evans(Brünnhilde) et John Tomlinson (Wotan) dans la mise en scène de Harry Kupfer
Anne Evans(Brünnhilde) et John Tomlinson (Wotan) dans la mise en scène de Harry Kupfer