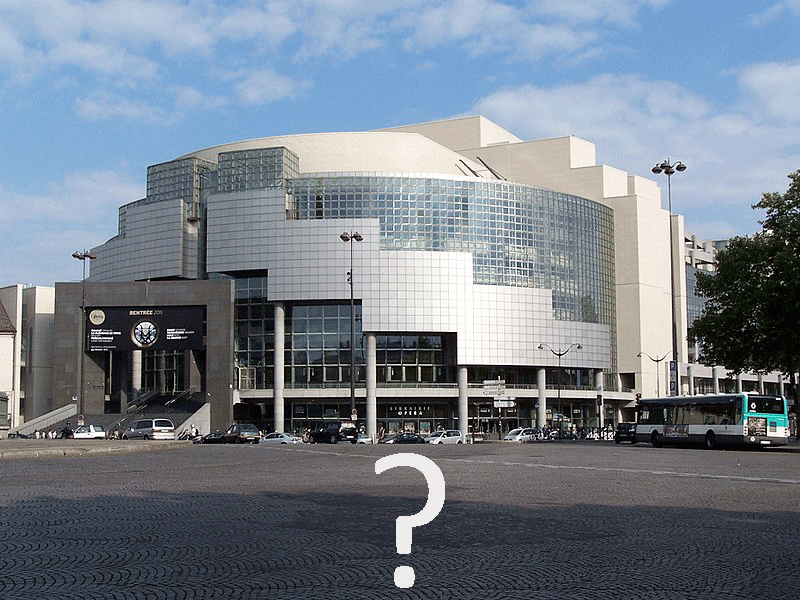Le microcosme du lyrique français vient de s’embraser suite à des affirmations de Stéphane Lissner déclarant l’Opéra de Paris « à genoux » et annonçant son départ anticipé. La nature ayant horreur du vide, on s’est tourné vers Alexander Neef le successeur désigné pour qu’il anticipe à son tour son départ de Toronto et arrive à Paris au plus vite.
Alexander Neef a freiné les ardeurs, déclarant qu’il n’avait pas l’intention d’arriver en catastrophe et qu’il avait besoin d’un peu de temps.
Réponse raisonnable : un nouveau directeur général « préfigurateur » pour prendre ses fonctions en septembre 2021 n’a pas forcément envie d’arriver au cœur d’une crise dont on lui ferait inévitablement porter le chapeau en cas de non résolution. L’État en premier lieu, qui déteste être pris en défaut, et puis la presse, les réseaux sociaux, etc. L’Opéra de Paris étant une institution qui attire le commentaire (exemple, votre serviteur…) ou les déclarations définitives de ceux qui auraient évidemment fait mieux, accoudés au comptoir du café du commerce si c’était autorisé.
Alexander Neef, qui connaît bien la maison, qui connaît bien le contexte parisien et qui a navigué aux côtés de Gerard Mortier, sait parfaitement les jeux troubles et délétères qui entourent la vénérable institution et n’a pas envie de commencer par ramasser les pots cassés par d’autres.
En réalité c’est un jeu de dupes, une comédie à l’italienne qui tient plus de la farce que d’autres choses, sauf que l’Opéra est effectivement mal en point. Comme toutes les salles du monde, il a souffert du confinement, a dû arrêter sa saison et, par la force des choses, annuler, en plus de tout le reste, rien moins qu’une nouvelle production du Ring de Wagner, qui est un ouvrage phare de tout opéra. De cela, Lissner n’est pas responsable.
Il n’a plus de directeur musical, parti à Vienne et qui devait seulement diriger le Ring. Plus de Ring, plus de Directeur musical.
Mais Paris a été en outre fermé en décembre et janvier, c’est- à-dire pendant une période particulièrement rentable (décembre) en termes de public et sans vraie reprise en janvier, qui a aussi été lourdement affecté par les grèves du personnel de l’Opéra. De cela, Lissner n’est pas responsable non plus, ce n’est pas lui qui a édicté une « réforme » (c’est ainsi qu’en langage technocratique on appelle les coups bas sociaux) des retraites.
Quant à Stéphane Lissner, à qui les visiteurs du soir ont savonné la planche en haut lieu et qu’on a empêché d’être au moins prolongé, il en a tiré les conséquences et a offert ailleurs ses services : « Ed io vado all’osteria
a trovar padron miglior » (Leporello, Don Giovanni scène finale).
On voit aujourd’hui le résultat de cette décision. L’Opéra se retrouve sans tête dès la fin 2020, à un moment difficile de sa vie et devant faire face à de multiples problèmes, dont une crise de recettes (dette de 45 millions d’Euros) sans précédent.
Et par-dessus le marché (et le panier est déjà bien lourd), on apprend par un communiqué le 11 juin que le ministre de la culture a confié à Alexander Neef la mission de « revisiter le modèle économique, social et organisationnel » de l’Opéra de Paris afin « d’assurer les conditions d’une exploitation équilibrée ».
Depuis des années, l’Opéra a vu ses subventions (qui représentent aujourd’hui environ 40% de son budget, avec des recettes propres à 60%) baisser de 110 à 95 m€ et le rêve de l’État est évidemment – et notamment en une période économique qui s’annonce très difficile – que l’Opéra, une danseuse de 350 ans, coûte le moins possible.
Le seul problème est d’abord que ce monstre qu’est l’Opéra de Paris (deux salles qui équivalent à deux « vraies » salles d’opéra, d’environ 4700 places à remplir), c’est l’État (en l’occurrence l’État Mitterrand) qui l’a engendré. MET mis à part (et on connaît les difficultés actuelles de remplissage de l’immense vaisseau), les grands opéras du monde ont grosso modo la capacité de Garnier. On avait plus besoin d’un auditorium à Paris que d’un Opéra, mais c’est moins chic. Après 1981, il a fallu attendre encore 34 ans pour avoir un auditorium digne de ce nom…
Si Bastille est un échec architectural, l’Opéra de Paris a néanmoins réussi à attirer le public suffisant sur les deux salles (L’Opéra-Bastille est né il y a trente ans). Mais depuis que je suis spectateur de cette vénérable maison, l’antienne est toujours la même, cela coûte trop cher, il faut réduire les coûts, c’est un gouffre etc. Combien de restructurations, de réformes du management depuis que Liebermann a repris les rênes en 1973, mais avec une constante, le rôle du Prince.
L’Opéra et le Prince, une spécificité de « l’Esprit Français »
Prince Pompidou et Prince Giscard
La fin de l’Opéra de Paris version ancien monde remonte à 1970, au moment où le Prince d’alors, Georges Pompidou, qui s’intéresse à la culture, demande à son Ministre de la Culture Jacques Duhamel de résoudre le problème Opéra de Paris. Et il appelle Rolf Liebermann, alors un des grands directeurs d’Opéra (Hambourg) pour relancer l’Opéra de Paris sur le marché international.
Ce fut socialement douloureux et Liebermann eut immédiatement des ennemis, ceux de l’ancien monde qui l’accusèrent de dilapider l’argent public, d’avoir fait exploser les coûts etc.
Il y eut aussi des grèves (quelquefois amusantes : dès la deuxième du Faust de Lavelli en 1975, on joua sur le plateau vide avec un calicot de la CGT en toile de fond) mais non sans conséquences : le nouveau Prince, Valery Giscard d’Estaing aimait l’opéra, et on l’y voyait souvent (ce fut d’ailleurs le seul qui fréquenta régulièrement la maison) : il offrit une soirée d’opéra aux Français méritants. Et il y eut grève… Exit Liebermann qui ne plaisait plus au Prince. Les vautours qui le haïssaient le chargèrent d’accusations infâmantes et de campagnes de dénigrement à l’odeur nauséabonde (Liebermann était juif)…
Successeur désigné, Bernard Lefort prit les rênes de la maison en 1980 avec un changement politique fort en 1981, qui rebattit les cartes, nouveau Prince (cette fois-ci un vrai disciple de Machiavel et amoureux de Florence), François Mitterrand décida avec le ministre Lang de grands travaux dont la construction d’un nouvel Opéra.
Prince Mitterrand
Ce fut une période délétère pour la maison qui dura 15 ans : ni Mitterrand ni Lang n’aimaient l’opéra, Mitterrand tenait à son Opéra comme signe extérieur de sa puissance, avec un concept qui fit long feu, celui d’« Opéra National Populaire » sur le modèle du TNP de Vilar. Ce fut le cahier des charges pour Bastille et évidemment un rêve qui ne se réalisa pas. Pendant ce temps, l’Opéra continuait à Garnier et le résultat tangible fut pour la maison rien moins que quatre administrateurs généraux (Lefort, Bogianckino, Martinoty, Blanchard, quelques météores (Jean Albert Cartier, Georges François Hirsch, et un autocrate ami du Prince, Pierre Bergé qui secoua la maison comme un prunier à un moment où l’on passait de Garnier à Bastille avec un projet encore flou, et chargé d’une mission régalienne essentielle: assurer l’inauguration de Bastille le 14 juillet 1989 pour une trentaine de chefs d’État avec au centre François Mitterrand comme Prince des Princes. Le Camp du Drap d’Or à côté, c’était de la petite bière.
Tout le reste était jeux d’arrière cuisine, un détail d’intendance : il fallait réinventer une maison avec une configuration nouvelle et une deuxième salle qui se construisait sur les terrains de l’ancienne gare de la Bastille : une grande salle de 2700 places, une salle modulable de 1000 places, une maison de l’opéra juste en face de la billetterie actuelle, un studio, un amphithéâtre. De maison de l’Opéra, on n’a plus entendu parler, les espaces de la salle modulable ont servi de dépôt et l’un des projets de Lissner était de la rouvrir en 2022, soit plus d’une trentaine d’années après la construction. L’État s’est aperçu que tout ça allait coûter cher… reprise de l’antienne…
On est peut-être lassé de ces rappels, mais dans un moment où l’histoire semble peu compter au profit de l’actualité et des réactions à chaud, il faut rappeler ces événements qui marquent l’inconséquence de l’État, tous pouvoirs confondus, qui traîne l’Opéra de Paris comme un boulet nécessaire et qui aboutit à la nième demande de trouver un « modèle économique » selon le langage délicieux de l’administration énarchique.
L’Opéra-Bastille était donc né comme « Opéra National Populaire » inspiré du projet de Jean Vilar pour le théâtre : la gauche étant au pouvoir, c’est le moins qu’elle pouvait faire. Le dispositif technique du théâtre prévoyait un grand nombre de représentations et donc une alternance serrée avec (très probablement) une troupe sur le modèle allemand, seul moyen dans un projet de ce type de contenir les coûts. Mais voilà, l’Opéra de Paris avait connu un système de troupe jusqu’en 1970, et le souvenir en était cuisant. Donc on n’en parlait pas… d’où le « modèle économique » nouveau inventé sous Liebermann qui perdura.
Le concept d’opéra populaire tient bon : la preuve, on appelle à la tête de Bastille René Gonzalès, l’un des hommes de théâtre les plus compétents et les plus respectés du moment. Mais connaissant peu le monde de l’opéra, il quitte dès 1990 Bastille pour diriger avec le succès que l’on sait le Théâtre Vidy-Lausanne. Par ailleurs, bien des futurs acteurs de l’opéra d’aujourd’hui sont déjà là : Lissner est au Châtelet, nommé là par Jacques Chirac Maire de Paris qui tout en se moquant de l’opéra comme d’une guigne veut damer le pion au camp d’en face empêtré dans la nasse.
De l’autre côté, le directeur général de l’Opéra de Paris en préfiguration est Dominique Meyer qui suit les travaux.
La nomination de Daniel Barenboim comme directeur musical qui livre des projets alléchants notamment avec Patrice Chéreau (la trilogie Mozart-Da Ponte) fait rêver le petit monde lyrique. Mais arrive comme président du Conseil d’Administration de l’Opéra Pierre Bergé, amateur de lyrique, créateur des Lundis de l’Athénée, entrepreneur à succès, et surtout ami du Prince du moment à peine réélu en 1988, François Mitterrand.
Bergé arrive et se comporte comme patron de facto de l’Opéra de Paris ce qu’il n’est pas statutairement (mais les faveurs du Prince…) profitant de l’absence de gouvernance claire : il casse le contrat de Barenboim qu’il chasse, lui rendant une liberté bénie qui le fera arriver à la Staatsoper de Berlin réunifiée dès 1992. Il y est encore… il n’aurait jamais duré autant à Paris.
La faute de Barenboim? Une programmation « élitiste » (on dirait ancien monde aujourd’hui) selon un système stagione qui ne saurait convenir à l’opéra du futur qu’est Bastille ;un système qui sera évidemment adopté dès l’ouverture de la maison en 1990 (j’espère que vous suivez…)
On connaît la suite. Au Châtelet, Stéphane Lissner, qui savait humer les bonnes affaires, aura tôt fait de récupérer partie des projets de Barenboim, et donc est en train de naître une amitié solide entre les deux hommes qui ne s’est jamais démentie (Barenboim, qui ira à Naples dès la saison prochaine, est même annoncé au programme de ce qui devait être la dernière saison parisienne de Lissner…). Du même coup, en termes de com, le Châtelet au « modèle économique » tout autre et avec un personnel permanent de quelques dizaines de personnes apparaît (faussement) dans les polémiques comme un rival de l’Opéra de Paris, sans projet artistique et à l’avenir trouble plus qu’aujourd’hui… Mais comme aujourd’hui, largement par la faute de sa tutelle.
Comme on peut le constater, les acteurs sont en place, depuis l’aube de l’histoire, dans cette agitation perpétuelle, essentiellement à cause d’un État incapable de gérer cette maison sans heurts, sans drames, sans polémiques sans palinodies.
Le tout puissant Pierre Bergé s’aperçoit vite qu’il ne peut assumer la charge et qu’il faut revenir à une configuration traditionnelle conforme au statut de la maison, nomination d’un administrateur général,d’un directeur musical et d’un directeur de la danse.
Il y nomme deux personnalités jeunes (et donc théoriquement maniables), dont une qu’il débauche au Châtelet, Jean-Marie Blanchard le conseiller artistique de Lissner. En 1992 naît donc le ressentiment que Lissner nourrit contre Blanchard, qui ne se démentira jamais. Eine pariser Tragödie.
Et comme directeur musical, Bergé impose à la place de Daniel Barenboim Myung-Whun Chung, qu’on sait aujourd’hui être un des grands chefs d’opéra, mais qui à l’époque apparaissait un chef de qualité, mais sans expérience.
C’est enfin Brigitte Lefèvre qui devient directrice de la Danse, un poste essentiel à un moment où dans le projet général, Garnier devient un théâtre exclusivement dédié au ballet. Elle traversera toutes les majorités et restera en poste sous cinq administrateurs/directeurs généraux, Blanchard, Gall, Mortier, Joel, Lissner (pour deux mois), un miracle dans une maison aussi consommatrice de ses cadres dirigeants.
Et la maison repart, avec un directeur général ( à l’époque c’est le directeur général qui gère l’administratif dans la maison) du nom de Jean-Paul Cluzel, très intelligent, assez malin, et surveillant général des dérives financières éventuelles, sorte de Hudson Lowe auprès de Napoléon (il aura une très belle carrière et deviendra Président de Radio France)
Mais entre-temps la majorité politique change. Les socialistes sont vaincus aux élections de 1993, et c’est Édouard Balladur qui devient premier ministre avec Jacques Toubon comme Ministre de la Culture. Voilà qui fragilise l’équipe en place, qui ne démérite pas (certaines de ses productions ont duré jusqu’en 2016…), mais qui n’a plus le soutien politique nécessaire.
Jacques Toubon procède méthodiquement par la commande à Hugues Gall d’un rapport sur la situation de l’Opéra, qui va aboutir
- À une redéfinition du cadre des organisations
- À la fin du mandat de Jean-Marie Blanchard, remplacé pour un court intérim par Jean-Paul Cluzel, directeur général « méritant » qui avait savamment observé et un peu gêné Blanchard…
- À la fin du mandat de Myung-Whun Chung
- À la nomination d’Hugues Gall au poste de Directeur général
On ne s’ennuie jamais à l’Opéra, mais la maison peut écrire désormais « Ici commence le court bonheur de ma vie », un court bonheur qui va durer quand même 14 ans le temps des mandats de Hugues Gall de 1995 à 2004, et de Gerard Mortier, de 2004 à 2009.
Prince Chirac
Le Prince Chirac ne s’intéresse pas à l’Opéra et laissera toujours faire, il sait que l’Opéra est désormais solidement encadré.
Aussi bien Gall que Mortier sont les héritiers (très différents) de Rolf Liebermann avec qui ils ont appris le métier : l’un a un profil d’organisateur et de grand gestionnaire, l’autre un profil plus nettement artistique et plus inventif. Mais l’ordre dans lequel ils sont nommés a son importance.
Jacques Toubon est un ministre avisé, très au fait de la chose culturelle et il est méthodique. Comme quoi un Ministre de la Culture qui a du poids et de l’intelligence, ça compte. Aussi Chirac et Juppé en font-ils leur Garde des Sceaux, et à la Culture ils placent Philippe Douste-Blazy. Aucune conséquence pour l’opéra, puisque Toubon avait bien fait le boulot.
Le travail de Gall, dans un théâtre conçu pour une alternance serrée – et un système de répertoire et de troupe ! -, était de construire un répertoire pour Bastille, une tâche dont il s’acquitta avec efficacité.
Construire un répertoire, c’est d’abord choisir des productions durables qu’on pouvait reprendre facilement, et donc pas forcément des grands gestes artistiques, des mise en scène qui secouent, mais assurer des arrières que le théâtre n’avait pas, puisque les scènes de Garnier et de Bastille n’avaient pas les caractéristiques qui permettaient de reprendre à Bastille des spectacles de Garnier (encore une incohérence dans la préfiguration) : seule exception le Faust de Lavelli (vu de 1975 à 2003), mais qui était encombrant à remiser, la fameuse verrière ayant été rendue indémontable pour des questions de poids et de sécurité.
L’autre exception serait Le Nozze di Figaro de Strehler, mais en réalité Le Nozze de Strehler qu’on voit à Bastille ne sont pas celles de Garnier (1973), mais la production de 1981 de la Scala.
Quand Gall quitte la direction en 2004, il peut dire « mission accomplie », période à peu près calme, et répertoire consolidé. Il a donné au théâtre ses fondations. On discutera à l’infini de ses choix esthétiques, mais ce n’était pas la priorité de la mission, son travail a été une garantie pour l’avenir et en tant que tel, il faut le saluer.
Ainsi, Gerard Mortier, nommé par la gauche encore au pouvoir, peut arriver pour promouvoir une autre politique : il sait qu’il a un théâtre en état de marche, c’est un habile négociateur avec les personnels. Sa programmation en dépit des critiques et des polémiques (qu’il allume quelquefois lui-même) reste plus de dix ans après son départ, une référence en matière d’inventivité et de grands souvenirs.
Prince Sarkozy
Le Prince Sarkozy n’en a rien à faire de l’opéra, la majorité en place subit Gerard Mortier dont le prestige international fait qu’on ne peut le chasser et attend patiemment son heure. Mortier sent la fin de mandat proche et donc prend les devant en se faisant nommer au New York City Opera (un poste qu’il n’occupera pas puisque le NYC Opera fermera).
La suite est connue : Nicolas Joel, arrive à la tête de la maison poussé par une jolie campagne du type enfin les chanteurs reviennent, enfin le répertoire français revient, on va voir ce qu’on va voir. Et c’est le flop qu’on connaît, à tous niveaux. La maison distille l’ennui, le conformisme, le plan-plan avec des choix souvent pitoyables. Une des périodes artistiquement les pires de ces dernières décennies, parce que même quand la crise de gouvernance était à son comble, la programmation de l’Opéra a continué à garder une certaine tenue.
Dans ces conditions, la période Mortier par comparaison apparaît phénoménale (elle ne le fut pas, même si elle fut solide et qu’elle laissa de très grands spectacles), et Stéphane Lissner, en poste à la Scala où il commençait à avoir des ennemis, semble le successeur presque naturel (même si, déjà, Serge Dorny auréolé de sa réussite lyonnaise était candidat à la succession de Nicolas Joel).
Prince Hollande
Pas plus que les autres, le Prince Hollande ne s’intéresse à l’opéra. Il ne veut pas d’ennuis ni de problèmes, c’est tout..
Après les cinq ans ternes de Nicolas Joel, il n’était pas difficile de faire mieux. Et Lissner est donc appelé pour remonter artistiquement la maison, parce que le théâtre pour le reste est en état de marche. La période Joel ayant été une période de gestion prudente et pépère.
Brigitte Lefèvre arrivant à la limite d’âge, elle quitte la direction de la danse et Lissner, fort habilement, nomme pour lui succéder Benjamin Millepied, qui, sans mauvais jeu de mots, met le pied dans un nœud de vipères bien orchestré.
La politique de Lissner quel que soit le poste, est toujours à peu près la même, il a dirigé le Châtelet, le Teatro Real, le Festival d’Aix-en-Provence, les Wiener Festwochen, la Scala de Milan où il arrive presque in extremis dans une situation de crise énorme. Bref, il a l’expérience, les réseaux, les recettes, il sait humer les parfums du temps. Même si ce n’est pas un homme d’opéra, c’est un grand manager, très malin, très charmeur, qui a beaucoup d’amis, et donc aussi une flopée d’ennemis. Mais je continue à penser qu’après Joel, Lissner était une chance pour l’Opéra de Paris. Il a d’ailleurs comme on dit fait le job à Paris, le seul échec patent – mais de taille – est le départ rapide de Millepied du ballet, qui l’a contraint sans doute sous la pression et sans doute pas volontiers à nommer Aurélie Dupont comme directrice de la danse. Il s’est d’ailleurs depuis désintéressé de la question. Nous avons ailleurs traité de la situation désastreuse du ballet de l’Opéra, mécontent de l’ambiance instillée par Madame Dupont, ce qui est très problématique, parce que le ballet est une troupe, et en tant que telle, salariée de l’institution… un autre mur qui se lézarde en somme, et qui a semblé perdre son envie de danser (en décembre et janvier derniers notamment). Du point de vue du lyrique avec des hauts et des bas, les choses ne se sont pas si mal passées.
La situation à l’arrivée du Prince Macron (2017)
Il paraît que le Prince Macron aime l’opéra, et Rossini en particulier. Après 3 ans d’exercice du pouvoir, on tarde à en voir les effets et notamment ces derniers mois… La culture c’est la grande muette dans ce gouvernement.
Nous constatons donc, que depuis les années Liebermann, l’Opéra notamment quand il est en crise, et souvent par la faute de l’État« coûte trop cher », au nom du vieux principe de qui veut noyer son chien l’accuse de la rage (un principe qui ces jours-ci a refait surface au Ministère de la Culture, et l’Opéra constitue dans les grandes institutions l’une des moins faciles à piloter, notamment à cause de l’absence de politique claire et de véritable dessein), mais au moins l’Opéra vit depuis 1995 avec le statut Toubon, et n’a pas l’air d’en souffrir.
La question des successions
Depuis quelques années cependant, les successions se sont passées de manière chaotique dans quelques théâtres :
Déjà en 2014 à la Scala, Lissner est parti par anticipation, pour prendre les fonctions laissées à Paris par Nicolas Joël, profitant de ce que son successeur à Milan Alexander Pereira, n’était plus en odeur de sainteté à Salzbourg : jeu de chaises musicales. Pereira parti, Salzbourg a eu un intérim, il arrive à Milan un an avant la date normale, ce qui permet à Lissner de laisser Milan pour anticiper son arrivée à Paris.
Voilà sans doute ce qui a permis de penser au Ministère de la Culture, souvent en retard d’un train, que ce qui avait été possible pour Lissner en 2014 le serait pour Neef en 2020 ou 2021. Seulement Lissner arrivait à Paris dans un théâtre en état de marche (on peut faire des reproches artistiques à Joel, mais pas celle d’avoir mal géré la machine). Neef arriverait dans un théâtre qui aura été fermé plus ou moins six mois (dec-janv 2019-2020 et mars-juillet 2020) et qui plus est en travaux jusqu’à novembre ou décembre 2020 (au total presque un an sans activité). On pourrait rêver mieux pour arriver dans un nouveau poste… Le Théâtre est sous coma artificiel et l’État ne rêve que de se défausser sur le directeur, avant même qu’il puisse faire lever le premier rideau.
Plus près de nous, Alexander Pereira a quitté la Scala pour son nouveau poste (Florence) fin décembre dernier, mais Dominique Meyer ne pouvait rejoindre Milan qu’en fin de saison 2019-2020, et la Scala s’est retrouvée sans Sovrintendente dès janvier 2020. Le confinement a arrêté ensuite comme partout la machine, Dominique Meyer était confiné à Vienne, Milan ayant été l’un des villes les plus atteintes par le Covid-19, tout y était arrêté et bloqué en mars et avril, il était inutile de bouger. Il vient de reprendre les rênes à Milan.
La succession parisienne
La situation parisienne, qui a l’air de tant agiter le petit milieu et la presse, n’a donc rien d’exceptionnel. Et c’est même un jeu de dupes.
Puisque Rosanna Purchia a quitté son poste à Naples le 30 mars 2020, Lissner a été installé Sovrintendente en titre au 1er avril 2020, selon ce qui était prévu: il suffit de consulter l’organigramme sur le site du San Carlo.
Lisons aussi ce journal italien en ligne (il denaro.it):
Dal primo aprile Stéphane Lissner si insedia ufficialmente come sovrintendente del Teatro di San Carlo, a Napoli. L’ormai ex direttore dell’Opéra national de Paris prende il posto di Rosanna Purchia.
Traduction: Au premier avril, Stéphane Lissner prend ses fonctions comme sovrintendente del Teatro di San Carlo à Naples. Le désormais ex-directeur de l’Opéra National de Paris succède à Rosanna Purchia.
Notons comme le signalent Le Monde et La Croix du 8 octobre 2019 qu’il était initialement prévu que Rosanna Purchia soit prolongée d’un an pour permettre à Lissner de terminer son mandat parisien.
Visiblement, les choses se sont accélérées et ne se sont pas passées ainsi… Lissner ulcéré par l’attitude de l’État à son endroit n’a cessé les dernières semaines de dire sans ambages quelle était la situation et d’accuser le Ministère de l’avoir laissé choir. De plus la manière dont il n’a pas été prolongé (une erreur à mon avis) l’incite à ne pas faire de cadeaux. Il sait aussi comment Millepied a été traité lorsqu’il est parti (la liste est d’ailleurs longue de cas semblables, Barenboim par exemple…).
Il est donc aujourd’hui officiellement à la fois Sovrintendente de Naples et Directeur général à Paris. Ayant fermé la Grande Boutique pour travaux cet automne, et celle-ci ayant ses rideaux baissés depuis mars, il n’avait aucune raison de ne pas se tourner vers la préparation des saisons de Naples. C’est pourquoi j’avoue ne pas comprendre cette agitation médiatique et ministérielle qui semble découvrir ce que tout le monde peut lire et savoir en regardant un site internet ou les journaux, y compris français et ce que tout le monde, connaissant Lissner, pouvait deviner. Y compris Alexander Neef qui en digne successeur de Mortier ne se fait sans doute aucune illusion sur les pratiques du milieu.
Ou bien les hauts fonctionnaires du ministère de la Culture sont des ignorants et ne préparent pas leurs dossiers, ou bien ils jouent à la « pâle effarouchée », histoire de se dédouaner et de faire comme si…
On sentait bien que Lissner ne ferait pas de cadeau, et qu’il n’irait pas au bout de son mandat quand on a su que Rosanna Purchia laisserait officiellement la charge le 30 mars 2020, sans prolongation. Il y a fort à parier qu’il a eu arrangement pour arriver à cette situation.
Mais en plus, il est clair que Lissner même en restant à Paris ne pouvait gérer une situation dont il ne maîtriserait pas le futur, en cas d’échec il aurait porté le chapeau, et en cas de réussite, elle aurait profité à un autre… Pas folle la guêpe…
Or on sait qu’à l’opéra les délais sont d’au moins trois ans pour construire une programmation où artistes et chefs intéressants sont réservés trois à quatre ans à l’avance. Il faut donc nommer au moins trois ans à l’avance (Serge Dorny a été nommé à Munich en mars 2018 pour septembre 2021)
Les choses se passent de manière plus délicate quand les délais sont plus serrés, ce qui a été le cas pour Lissner à Naples, pour Meyer à Milan, pour Pereira à Florence. Bien heureusement tout cela se passe en Italie où les saisons sont souvent (au moins pour le tout-venant) préparées très tardivement.
À Paris, on se souvient la longue procédure de nomination du successeur, les hésitations du Ministère de la Culture quant à la prolongation du mandat de Lissner qui faisait venir des crises d’urticaire à ses ennemis (y compris à l’Élysée) et pour achever le tout, de l’intervention finale du Prince qui a fini par décider tout seul. À l’Opéra, le Prince n’est jamais loin, sans doute un souvenir des descentes baroques du Dieu sur son nuage, ce Deus ex machina qui vient tout résoudre à la fin. C’est pathétique mais c’est comme ça.
L’arrivée d’Alexander Neef
C’est finalement en juillet 2019 qu’Alexander Neef est officiellement nommé « Directeur préfigurateur de l’Opéra de Paris », voici son cahier des charges :
Alexander Neef devra faire rayonner l’Opéra national de Paris à l’international en s’appuyant sur toutes les forces et les potentiels de l’établissement. Il développera un projet lyrique ambitieux, qui accordera une place importante au répertoire français, et conjuguera le maintien d’un haut niveau artistique avec les enjeux de la démocratisation, de la recherche de nouveaux publics et du développement de l’éducation artistique. Il développera une offre culturelle et artistique novatrice pour la Salle Modulable de l’Opéra Bastille. Avant de prendre les rênes de l’établissement à l’automne 2021, Alexander Neef aura deux ans, en sa qualité de directeur préfigurateur, pour préparer ses premières programmations. Il participera en outre aux chantiers d’organisation conduit par Stéphane Lissner qui quittera ses fonctions à l’été 2021.
Juillet 2019 pour prendre des fonctions en septembre 2021, c’est très juste pour conduire une pareille maison, la plus grosse du monde, et établir une programmation y compris pour la salle modulable…
Alexander Neef s’est donc bien gardé d’intervenir dans la récente agitation, sinon pour rappeler simplement les termes de son contrat et faire dire qu’il ne fallait rien précipiter.
Et voilà que jeudi dernier 11 juin, le Ministre de la culture fort inopportunément fait rajouter une apostille à son cahier des charges, déjà bien fourni… Nous en rappelons les termes, déjà évoqués au début de ce texte. Neef aura pour mission de « revisiter le modèle économique, social et organisationnel » de l’Opéra de Paris afin « d’assurer les conditions d’une exploitation équilibrée ».
Les choses sont dites dans les termes galants de l’énarchie qui nous gouverne et méritent d’être décodés, car on y dit beaucoup en peu de mots.
« Revisiter le modèle économique» signifie en clair faire en sorte que l’État baisse encore ses subventions et donc que l’opéra trouve encore plus que 60% de recettes propres (ou opère une refonte du niveau de ses charges…). Cela pourrait vouloir dire transformer le statut public d’EPIC (Etablissement Public à caractère industriel et commercial) en Fondation de droit privé, et donc du même coup changer les statuts des personnels (avec les conséquences sociales et syndicales qui s’ensuivraient dans une maison familière des mouvements dits sociaux) grosso modo privatiser comme on l’a fait pour la Poste ou France Télécom.
C’est le système qui a été appliqué pour les Opéras en Italie, il marche pour les grands théâtres (Scala, Rome), c’est une catastrophe pour les plus petits, financés en réalité par des organismes semi-publics parce qu’ils trouvent peu de sponsors.
Le rêve de l’État énarchique, c’est de « faire mieux avec moins » et c’est bien ce qui est en filigrane dans cette apostille perfide.
On comprend ce qui pourrait se trouver derrière le modèle « social », il pourrait s’agir de faire diminuer la masse salariale, et sans doute inventer des souplesses en augmentant le nombre d’intermittents… Pour ces réformes de structure on fera porter le chapeau au Directeur général. On gardera au moins les mains propres.
Je ne pense pas exagérer quand je lis ces phrases, la dernière étant la plus infecte. L’impéritie élevée au rang d’art.
La dernière phrase « d’assurer les conditions d’une exploitation équilibrée » est un souhait évidemment partagé. Mais si les théâtres d’opéra sont la plupart du temps équilibrés, ils le sont aussi quelquefois au prix de la réduction des frais variables, c’est à dire les frais artistiques, parce qu’il y a des frais fixes impossibles à diminuer, entretien des bâtiments (Bastille a été terminée à l’économie, rappelons aussi comment Nouvel a été éloigné de la construction de la Philharmonie …), paiement des salaires etc.
La part variable, c’est les productions, on peut en enlever une ou deux par an pour permettre d’équilibrer… On voit la perversité du système: faire moins avec moins…
De toute l’histoire du spectacle vivant, le genre opéra est le plus coûteux, et la littérature sur l’économie (ou l’utilité) de l’opéra est abondante, et parce qu’il est coûteux, il est aussi fragile, parce qu’il dépend depuis le XVIIe du Prince et de ses caprices (on l’a vu plus haut) parce que l’on a souvent l’impression que les dépenses sont inutilement somptuaires. Il est vrai que dans un système de stagione serrée comme Bastille, il n’y a pas que de bons exemples, un certain nombre de spectacles coûteux ont été représentés une saison et n’ont jamais été repris, et certains même détruits après.
Mais indiquer au futur directeur général qu’il aura à « revisiter le modèle économique, social et organisationnel » afin « d’assurer les conditions d’une exploitation équilibrée » c’est instiller l’idée que tout n’a pas été fait (et donc un petit coup de griffe à Lissner) qu’il y a trop de grèves (c’est vrai, mais qui, depuis 1973 a su les arrêter et obtenu la paix sociale totale ?).
Tout cela n’est pas neuf, mais sent ici sa menace, l’année même où l’Opéra a souffert dans sa chair d’une des pires crises jamais traversées, mais où le Directeur Général n’était pour rien : la réforme des retraites, c’est l’État et la fermeture due au confinement, c’est la Pandémie.
Que l’attitude de certains personnels pendant la grève ait été exagérée, critiquable, au-delà du raisonnable, notamment en persistant quand tout le monde ou presque avait repris, c’est évident, mais pour quelques individus identifiables, le Ministère ajoute ces éléments au pire moment pour montrer les dents (cariées) et faire de l’autoritarisme à défaut d’avoir de l’autorité, c’est vraiment pour le moins malhabile, et c’est bien ne rien comprendre au monde de l’Opéra que de procéder de la sorte.
Alexander Neef ne s’y trompe pas : dans l’interview accordée à France Musique le 15 juin, interrogé sur cette apostille, il s’en sort par une généralité : à tout projet artistique correspond un « projet économique, social et organisationnel » spécifique. Il évoque même la possibilité de créer une troupe, manière de revoir effectivement le « projet économique, social et organisationnel » qui d’ailleurs correspondrait au modèle initial prévu pour Bastille comme nous l’avons précisé plus haut, et au modèle commun pratiqué en Allemagne, dont Alexander Neef est originaire. Le Blog du Wanderer défend depuis longtemps la question des troupes à l’opéra, garantes de continuité et d’alternance serrée. Attendons.
Il confirme par ailleurs qu’il a bien l’intention de venir à Paris : à ce niveau, relever le défi que constitue la prise en main de la maison est pour lui un titre qui n’est pas négligeable pour un néo-directeur d’une grosse institution aussi blessée. Mais lui poser la question, c’est aussi souligner la manière peu opportune dont le Ministère de la Culture a édicté ses dernières exigences, et Neef non sans ironie, glisse dessus prudemment.
Enfin sur la question de sa venue, il laisse la porte entrebâillée, demande du temps pour régler la situation à Toronto, et notamment la nomination de son successeur, non encore nommé. Cela signifie évidemment pour lui aussi quelque acrobatie, mais au détour d’une phrase, on sent qu’il veille déjà à l’exécution de la saison 2020-2021, celle que Lissner devait assumer… et qu’il est de loin, déjà là.
Tout cela est un jeu de masques, assez amusant, où l’État ne fait pas bonne figure, nommant trop tard, agissant ensuite à contretemps, sans qu’il joue un vrai rôle de tutelle, qui est aussi un rôle de protection.
Victime de la configuration qu’il a lui-même créée à l’Opéra de Paris, l’État traîne l’Opéra comme le sparadrap du capitaine Haddock, parce qu’il y a en haut lieu peu de défenseurs de ce genre, qui coûte sans jamais rapporter (le foot au moins…) et qui reste un genre socialement marqué, sans que jamais l’État ne se soit coltiné vraiment le problème… On l’a bien vu en décembre et janvier derniers, qui a pleuré sur cette maison ?
Il est évident que l’organisation de l’Opéra de Paris et ses coûts ont besoin d’être regardés et contenus. Mais il n’est pas certain que ce soit la question des coûts où le bât blesse. Certes, l’Opéra de Paris a le plus gros budget d’Europe (autour de 200 m/€ en 2015) mais le MET avec une seule salle le dépasse (266m/€), et l’Opéra de Paris a deux salles à gérer qui sont comme deux opéras ordinaires puisque le Palais Garnier seul est une salle comparable à Londres, Vienne, Munich ou la Scala
Avec 200 m/€ de budget, l’Opéra de Paris offre en théorie chaque soir 4700 places, tandis que Londres offre 2000 places avec un budget de 160m/€ environ. Comparaison n’est pas raison, mais tout de même.
Au niveau du taux d’autofinancement, l’Opéra de Paris (60%) se trouve dans le peloton de tête (après Londres, Madrid et Barcelone, la Scala) bien plus que les grands opéras allemands qui atteignent à peine 20% d’autofinancement (Munich, le plus autofinancé atteint un taux d’environ 36%).
De ce point de vue, la situation parisienne n’a cessé de voir son autofinancement consolidé. Donc là aussi, la situation est loin d’être critique et en tout cas plutôt raisonnable.
Alors bien sûr, on peut toujours chercher à augmenter le taux d’autofinancement, et donc chercher les sponsors, avec les conséquences sur les compensations (places à mettre à disposition, events etc…) et les conséquences éventuelles sur les choix de programmation : on est loin de l’opéra populaire mais pas toujours de l’opéra populiste quelquefois…
Personnellement, je suis sans doute ancien monde et naïf, mais le financement public reste pour moi la garantie d’une politique artistique libre et audacieuse.
Là où les choses sont à revoir, c’est sans doute du point de vue des organisations internes et des charges en personnel, comme l’importance excessive de l’encadrement administratif à tous niveaux par exemple, qui en fait une machine un peu bureaucratique, mais aussi certains aspects artistiques : Alexander Neef évoquait la possibilité d’une troupe. Paris en a une, c’est le ballet, composé de 154 membres qui au total dansent peu, parce que la politique de la maison délaisse les productions des grandes formes qui occupent du monde au profit des petites, qui en occupent moins. Mathématiquement : les danseurs dansent peu, avec les conséquences prévisibles sur la préparation, le maintien en forme et globalement la qualité technique et artistique de l’ensemble.
A titre de comparaison, le Royal Ballet de Londres a 100 membres et une troupe d’excellence bien plus prestigieuse que Paris et la plupart des autres compagnies ont de 70 à 80 danseurs. Les compagnies russes (Bolchoï et Mariinsky) sont plus nombreuses, mais développent une activité autrement plus dynamique et peuvent danser dans plusieurs endroits à la fois et plusieurs fois dans la journée (il est fréquent qu’il y ait deux représentations sur la même journée)
Enfin occuper le ballet plus qu’il ne l’est, c’est aussi du point de vue économique remplir des soirées qui rapportent beaucoup et qui coûtent peu: Une manière de « revisiter le modèle économique »…
Je ne suis donc pas sûr que l’Opéra de Paris coûte si cher au total quand on observe ses charges de fonctionnement qui d’ailleurs ne manqueront pas d’augmenter avec l’ouverture éventuelle de la salle modulable. C’est le plus cher en Europe, mais c’est le plus gros, et ce n’est ni le plus cher au monde, ni le plus cher en absolu, même si c’est sans conteste la plus grosse maison du monde. Revenir sans cesse sur les coûts, c’est simplement mentir.
C’est pourquoi les polémiques incessantes, provoquées par les maladresses ou le manque de vision de l’État, par un Ministère de la culture incapable d’exister (on le constate en ces temps de confinement où le monde culturel est sacrifié) et qui se tourne vers le Prince quand il faut décider, des Princes qui pour la plupart n’en ont rien à faire, tout cela aboutit à des situations délétères, à une démobilisation des personnels, à la lassitude de tous, et quelquefois, à la désertion du public, qui est un fait patent dans bien des salles qu’il faudra bien un jour affronter..


 Il y avait en Italie deux foyers référentiels pour l’Opéra au XVIIIe, Venise avec ses théâtres actifs depuis le XVIIe et Naples dont le San Carlo fut construit en 1737 (Architecte Medrano), rénové plusieurs fois (notamment par Ferdinando Fuga en 1767) et reconstruit après un incendie en 1817 : il reste néanmoins l’un des plus anciennes salles d’Europe. Il Gran Teatro La Fenice (Architecte Selva) inauguré en 1792 est bien postérieur, y compris à la Scala (Architecte Piermarini) inaugurée en 1778.
Il y avait en Italie deux foyers référentiels pour l’Opéra au XVIIIe, Venise avec ses théâtres actifs depuis le XVIIe et Naples dont le San Carlo fut construit en 1737 (Architecte Medrano), rénové plusieurs fois (notamment par Ferdinando Fuga en 1767) et reconstruit après un incendie en 1817 : il reste néanmoins l’un des plus anciennes salles d’Europe. Il Gran Teatro La Fenice (Architecte Selva) inauguré en 1792 est bien postérieur, y compris à la Scala (Architecte Piermarini) inaugurée en 1778.
 Sauve qui peut.
Sauve qui peut.