
Bientôt 20 ans que je suis le Mahler Chamber Orchestra, fondé par Claudio Abbado et un groupe de musiciens du Gustav Mahler Jugendorchester en 1997. C’est évidemment un orchestre qui signifie pour moi bien plus qu’une phalange de plus et qu’un concert de plus, le Mahler Chamber Orchestra est un orchestre que je ne consomme pas (du genre, hier j’ai fait le Gewandhaus et demain je fais les Wiener), mais que je déguste. Cet orchestre, même s’il s’est profondément transformé en 20 ans, reste quand même étonnamment le même, au sens où c’est un orchestre d’adhésion, toujours jeune, qui a choisi d’être ensemble pour quelques sessions dans l’année, pour le plaisir de jouer, pour, comme aurait dit Claudio Abbado zusammenmusizieren, faire de la musique ensemble. Chaque musicien appartient à une ou plusieurs autres phalanges, à des ensembles de musique de chambre, et chacun vient à la Mahler pour sentir un esprit, l’esprit MCO. Il y a en effet un esprit MCO et un esprit des lieux MCO, dont Ferrare à coup sûr et dont Turin dans une moindre mesure. L’esprit MCO, c’est l’âme de son fondateur, Claudio Abbado, qui n’est plus, mais qui a laissé à l’orchestre et à ces deux lieux un esprit, une mémoire, une âme.

L’auditorium du Lingotto à Turin, personnifié depuis les origines par Francesca Camerana, qui préside aux destinées de Lingotto Musica est un lieu que Claudio Abbado a porté sur les fonts baptismaux, où il a donné bien des concerts, dans cette belle salle conçue comme le reste par Renzo Piano.
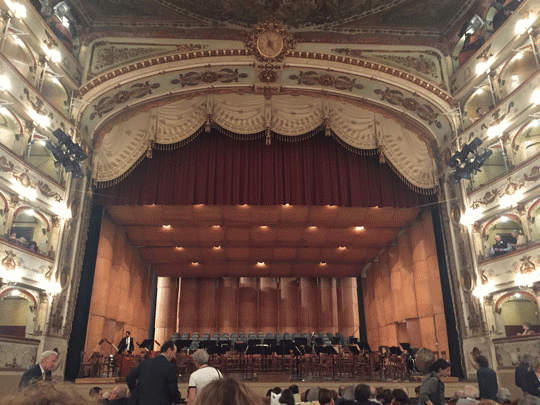
Et Ferrare, c’est Ferrara Musica, fondé par Claudio Abbado avec l’aide de la municipalité d’alors pour servir de résidence à un orchestre de jeunes musiciens, le Chamber Orchestra of Europe de 1989 à 1997 (et de nouveau à partir de 2007), puis le Mahler Chamber Orchestra dès 1998. Aujourd’hui les deux orchestres (chacun enfants de Claudio Abbado) se partagent grande part des projets de la saison. Alors, chaque retour à Ferrare du Mahler Chamber Orchestra est quelque chose de fort, notamment pour les musiciens qui sont dans l’orchestre depuis les origines, et qui restent garants de son esprit. Avec Abbado soit COE, soit MCO ont travaillé des programmes très divers, mais aussi des opéras, et grâce à Abbado, le MCO est le creuset du LFO, du Lucerne Festival Orchestra dont il constitue le terreau (les tutti de l’orchestre). Qu’on se tourne vers l’histoire ou même la géographie, mais qu’on se tourne aussi vers l’âme ou vers l’esprit, on rencontre Claudio Abbado, qui trône d’ailleurs avec Maurizio Pollini sur la home page de Ferrara Musica. Comment pourrais-je l’oublier ?

Alors, ce week-end au Lingotto et à Ferrare, indépendamment de tout programme, avait pour moi le parfum du souvenir, des souvenirs intenses et ardents d’une des plus belles périodes musicales de ma vie, une période où l’enthousiasme était toujours au rendez-vous, à Turin comme à Ferrare, mais où il y avait à Ferrare en plus, la ville est petite, un intense parfum d’amitié, de rencontres, d’échanges.
Cet heureux temps n’est plus, et les choses changent , mais certaines traces perdurent, certaines ambiances, ce parfum dont je viens de parler, on le retrouve, on le ressent, on en sent des effluves, parce que le MCO reste enthousiaste, et reste surtout une phalange d’une incroyable qualité, qui sait aller là où le mènent les chefs les plus sensibles à l’art de faire de la musique ensemble.
Alors, oui, j’ai passé un merveilleux week-end, parce que les souvenirs, l’amitié et la joie étaient au rendez-vous, mais surtout la musique, qui a lié tout cela ensemble. Oui, l’Hymne à la Joie était bienvenu car ce week-end du 27-29 mai fut un hymne à la joie.
Toute cette fête de la sensibilité a évidemment un liant, au-delà de Claudio Abbado, c’est la musique. Rien ne serait réveillé sans elle, et sans le rapport entretenu avec elle. Il n’est même pas concevable pour moi d’aller à Ferrare sans concert à la clef.
Ce week-end, le MCO vient d’annoncer la nomination de Daniele Gatti comme conseiller artistique. Il entretient depuis 2010 un excellent rapport à l’orchestre, avec qui il a entrepris une intégrale des symphonies de Beethoven sur deux saisons dont c’est le dernier programme, avec le couple symphonie n°8 et symphonie n°9, un programme où la joie tient le haut du pavé, aussi bien dans la la 8ème que la 9ème ! Le mini-tour de l’Italie du Nord comprend Turin (Lingotto), Ferrare (Teatro Comunale), Bergame (Teatro Donizetti) et Brescia (Teatro Grande) et entoure Milan sans y entrer. Les musiciens du MCO ont travaillé sans le chef et l’ont retrouvé pour un temps fort court de répétitions, déjà préparés. Ils ont pourtant rarement joué la 9ème, seulement une fois avec Daniel Harding.
La symphonie n°8, assez courte (27 minutes environ) est considérée comme l’une des plus légères de Beethoven, notamment à cause de l’absence ou quasi de mouvement lent : l’allegretto du 2ème mouvement, au style presque italien, presque rossinien, même si Rossini passera à Vienne une dizaine d’années plus tard fait office de mouvement lent – un peu comme l’allegretto de la 7ème qu’on joue souvent de manière si lente. C’est bien ce qui frappe dans cette 8ème, l’une de mes préférées. Je me souviens de la manière d’Abbado si fluide et si chantante, notamment dans ses dernières exécutions à Rome et Vienne en 2001.
Gatti privilégie autre chose : il cherche dans ces pièces d’abord la dramaturgie, le choc des ambiances, les contrastes. Il y recherche quelque chose du théâtral : ne pourrait-on pas penser que la forme sonate est une forme théâtrale ? Alors Gatti privilégie dans sa recherche formelle quelque chose qui va faire drame (au sens « théâtre » du terme), quelque chose qui se heurte, et cette symphonie qui pourrait être si souriante et si légère se teinte alors de nuages, de quelque chose de rugueux, de râpeux, de rude presque. Il y a quelque chose de brahmsien dans cette approche. C’est Beethoven lu à l’aune de l’univers de la symphonie qui va le suivre, comme portant en lui quelque sorte son futur. Je l’avais déjà remarqué dans son approche de la Fantastique de Berlioz: Gatti privilégie les rencontres des masses, sans jamais être massif. Son approche est d’une clarté incroyable, avec une transparence des différents niveaux et pupitres, mais aussi et toujours avec une tension palpable.
Le MCO lui répond parfaitement. La clarté dont il est question, elle apparaissait à Turin dans une salle vaste à la réverbération marquée sans risquer cependant de provoquer la confusion des sons. La salle du Lingotto permet l’analyse sonore et garde aux différents pupitre une vraie lisibilité. Le lendemain à Ferrare, l’acoustique est radicalement opposée, très sèche, et plutôt proche. Le son est là, présent, presque touchable, et l’on découvre encore plus de moments étonnants qu’on ne soupçonnait pas, on sent aussi les rugosités notamment dans les bois extraordinaires dont certains sonnent presque comme des instruments anciens. On entend d’ailleurs dans l’ensemble une couleur ancienne, un peu brutale, sans fioritures ni complaisance.
Le 2ème mouvement si dansant, si léger, fait contraste avec le 1er très coloré, très kaléidoscopique où l’impression domine de sons qui se génèrent l’un l’autre, de manière impétueuse, tempétueuse même (qu’on retrouve au dernier mouvement, magistral), mais en même temps quelque chose d’ouvert, qui respire, comme ces interventions des cuivres dans la partie finale et cette suspension qui clôt le mouvement, comme pour indiquer un discours jamais fermé. Mais ce qui me frappe, c’est à la fois la finesse extrême des parties piano, et de manière concomitante les appuis, les interventions-scansion sèches des percussions (timbales baroques), le rythme marqué, et malgré tout la continuité du discours.
Car ces heurts, ces aspects rugueux ne sont pourtant jamais brutaux au sens où on pourrait le craindre en lisant ces lignes : cela reste fluide, cela reste élégant, et c’est profondément pensé.
L’allegretto scherzando du 2ème mouvement est un des sommets de cette exécution, scandé par les cordes qui rythment l’ensemble et en font la colonne vertébrale. Bien sûr on entend Haydn, Mozart, mais on entend aussi par le rythme quelque chose d’un Rossini futur, en un dialogue cordes-bois d’une particulière légèreté. C’est là qu’on touche la joie qui se termine là aussi presque en suspension.
Le 3ème mouvement, tempo di minuetto, renvoie aussi à l’univers de Haydn, avec cette scansion aux percussions et ce jeu tressé des bois magistraux du Mahler Chamber Orchestra. Bien sûr la danse domine, en un menuet énergique, mais en même temps jamais sombre, qui – oserais-je ? – me fait penser à quelque chose des danses paysannes qu’on va trouver dans Mahler, une sorte de rugosité, une joie simple non dépourvue de brutalité, mais non dépourvue de la même manière de raffinements marqués. Un menuet dialectique et presque ironique en quelque sorte.
Le dernier mouvement naît des trois autres, et on comprend du même coup ces mesures finales suspendues, de manière répétée. Des parties finales qui ne sont jamais clôture, mais toujours suspens, laissant ouvertes les suites possibles, et ce son qui jamais ne se ferme conduit inévitablement à ce dernier mouvement dont l’esprit va reprendre chaque moment qui précède, la danse, l’élégance, la scansion rude, tout est là, avec une dynamique nouvelle de l’énergie accumulée des trois autres mouvements. Le début à ce titre est emblématique, rappelant par sa légèreté initiale le 2ème mouvement, puis à la reprise le 1er, en deux tons différents, quand tout l’orchestre s’investit, scandé par des percussions sèches comme dans les interprétations baroques, et ce n’est que discours alternant de manière virtuose deux ambiances : les bois à leur sommet (la flûte !!), avec des renvois à d’autres univers beethovéniens (de manière fugace la Pastorale !), et une science des rythmes qui bluffe et donne une joie irrésistible à l’ensemble. Le tout emporte l’auditeur sans lui laisser de respiration : les alternances cordes aiguës et plus graves, la clarté des cuivres, pourtant discrets et la permanence des percussions en arrière-plan construisent un cadre dramaturgique, soutenu par les quelques silences marqués entre les divers moments, qui s’élargissent en de merveilleux crescendos , comme si on s’amusait à faire tournoyer le son en un tourbillon joyeux qui s’élargit, sans jamais oublier cette alternance de brutalité et de légèreté qui rend cette interprétation si impertinente au bon sens du terme, si impétueuse et si jeune, c’est à dire inattendue, souriante et rude, énergique et tendre, de cette tendresse directe qui va directement au cœur, sans chichis, sans détours, sans artifice.
Même si la Neuvième, c’est d’abord et pour tous l’hymne à la Joie, Gatti et l’orchestre nous imposent une vision d’abord grave et tendue, comme si le récitatif qui ouvre le dernier mouvement était en quelque sorte, une reprise des trois autres, pour l’ambiance qu’ils installent. Quand j’étais jeune, la neuvième n’était qu’une attente du dernier mouvement, et je trouvais même ces trois mouvements un peu longs à vrai dire, comme s’ils retardaient le moment tant recherché et tant attendu du dernier.
En écoutant le Mahler Chamber Orchestra et Daniele Gatti ces deux soirs, c’est en quelque sorte l’impression inverse qui a prévalu, tellement ce que j’entendais était riche et nouveau. Riche parce que l’orchestre est apparu vraiment multicolore, aux mille reflets cristallins, d’une lisibilité étonnantes. On y entend en effet des moments ou des phrases que jamais on a pu entendre : légers pizzicatis, mouvements à peine esquissés des violoncelles, bois tourneboulants. Mais la clarté n’est rien s’il n’y a pas de propos, s’il n’y pas de discours.
Or c’est bien là la surprise, la surprise de la découverte d’une 9ème plus sombre, plus rude, même si pas vraiment heurtée, et, un peu comme la huitième qui précède, Gatti nous propose une vision dramatique, pleine de relief, qui construit de manière passionnante la préparation du dernier mouvement. La joie arrive au bout d’une sorte de « tunnel » plutôt tendu ou nostalgique, d’où une vision dialectique où la tension répond à la joie, où la joie explose et fait respirer une ambiance qui était tantôt sombre, tantôt particulièrement mélancolique. J’avais écouté deux mois auparavant la Neuvième avec les Berliner et Simon Rattle et j’avais exprimé à la fois l’admiration pour le phénoménal orchestre, mais aussi une relative déception interprétative car le merveilleux instrument fonctionnait à creux. Rien de tel ici où il y a comme on dit une idée par minute où la profondeur de la lecture étonne, avec un orchestre complètement dédié aux demandes du chef, d’une concentration et d’une énergie extrêmes.
La premier mouvement allegro ma non troppo, un poco maestoso, qui commence si mystérieusement, presque en sourdine, s’affirme très vite par un rythme très marqué, scandé par les percussions qui tout au long de la symphonie, vont accompagner et marquer les rythmes tantôt au premier plan, tantôt en arrière-plan comme indicateurs d’une ambiance sourde ; l’alternance d’un son très retenu, voir mystérieux, et d’explosion indique une tension forte, marquée, avec un jeu de contrastes d’où s’isolent quelques traits de flûte presque rupestres (flûte baroque, elle aussi). Il n’y rien de policé dans cette approche, mais quelque chose d’urgent, d’une énergie presque primale alternant avec une infinie tendresse et une évidente sensibilité. Le jeu des bois est particulièrement passionnant, qui sonnent si rugueux, un son à la fois sans raffinement et en même temps particulièrement maîtrisé et déchirant. Derrière ce travail j’entends obstinément une couleur pastorale, et cette impression va me poursuivre jusqu’au troisième mouvement.
L’orchestre est tenu sur un tempo assez vif, mais toujours tendu et rythmé, avec un sens du crescendo et une affirmation de soi incroyablement marqués, et donnant une impression de lacération. Rarement début de neuvième n’a autant marqué d’émotion, les sons aigus des violons repris par les bois et scandés par les percussions bouleversent et surprennent. Il n’y a jamais déchainement mais un discours continu et énergique, dramatique, comme un déploiement de forces qui se côtoient, se heurtent mais s’interpénètrent aussi d’une manière si prenante et si peu traditionnelle, avec un sens des enchainements incroyables qui, malgré les chocs et la rugosité, garde une fluidité stupéfiante car tout s’enchaine avec à la fois la logique d’un drame et celle d’une infinie tendresse, et d’une sensibilité farouche. C’est peut-être là le mot qui me manquait : cette interprétation est farouche, celle d’un tendre qui n’oserait être soi que par moments. Bouleversant, étonnant. Le crescendo final, comme venu des profondeurs du son, frappe au cœur, ainsi que l’accord final, à la fois brutal et comment dire ?- très légèrement attendri dans la note finale. On a peine à réaliser ce qui s’offre à nous, encore plus peut-être à Ferrare, à cause de la proximité de l’orchestre.
Le deuxième mouvement molto vivace, frappe immédiatement par la même brutalité, la percussion imposante, puis le rythme haletant des cordes, scandé une fois de plus par la timbale et s’achevant par une sorte de danse au rythme de la flûte, magnifique, de Chiara Tonelli, c’est peut-être dans ce mouvement que la multiplicité des couleur est la plus grande, la variété des rythmes donne une vie étourdissante et neuve, une incroyable jeunesse à une œuvre qui semble être écoutée ici pour la première fois. L’approche est si claire qu’on entend des sons totalement inconnus, même à la timbale : « l’art gradué de la timbale » existe, tant les coups de timbale sont très dosés en crescendo, et rythment le mouvement général. Une approche claire et lumineuse, qui invite à découvrir encore des secrets à une partition qu’on croyait connaître, où l’on découvre des phrases qu’on ne soupçonnait pas , et qui en même temps interroge sur le sens voulu à ces mouvements qui n’ont rien de joyeux, mais qui se raidissent, qui s’imposent, qui se succèdent en moments de tendresse, et de majesté comme si Beethoven exposait là non pas une unité, mais un tissu contradictoire d’affirmations. Gatti propose ici une vision très contrastée, tressée des contradictions dans les tons de l’œuvre, comme écartelée entre divers horizons (on entend même mon cher Cherubini par moments). En tous cas, entrer dans ce labyrinthe est passionnant, d’autant plus que l’orchestre à son sommet fait entendre l’excellence de chaque pupitre : quels cuivres ! quels bois ! quelles cordes aussi ! quelle respiration ! et surtout quel engagement ! C’était si tendu que l’on a senti la salle se détendre à l’intervalle. Il le fallait tant le troisième mouvement fut miraculeux
Le troisième mouvement, adagio molto e cantabile, est peut-être en effet le plus bouleversant de tous, et pour moi à l’orchestre, le plus réussi : à Ferrare, ce fut un sommet d’émotion. L’apaisement après l’agitation précédente s’accompagne d’un écho large qui s’allège et s’attendrit. J’évoquais précédemment une couleur de Pastorale, et nous y sommes : l’orchestre est séraphique, d’une incroyable sensibilité, avec des reprises de violons incroyables, d’une fluidité et d’une légèreté bouleversantes. Basson, clarinettes et cors sont exceptionnels, présents, et en même temps discrets, avec les échos phénoménaux des coups d’archets qui soutiennent. Je n’ai jamais entendu une telle « ambiance », où les voix se reprennent sans jamais abuser du rubato ; la symphonie de couleurs est tellement vivante, tellement tendre, tellement apaisée et bouleversante et la musique s’élargit et respire tellement en fin de mouvement (avec quelques rythmes viennois…et toujours cette timbale qui continue en arrière-plan à rythmer, et que je n’avais jamais remarqué avec cette présence intense…et dans la douceur) qu’on va avoir peine à entendre le récitatif initial et tendu du quatrième mouvement.
J’ai employé le mot miraculeux, et je pense que c’est l’expression juste, tant le temps fut suspendu, tant la poésie fut intense, où jamais expression de l’apaisement ne fut plus ressentie, notamment dans ces notes finales qui s’échappent comme vers le ciel.
D’où évidemment le contraste avec le début du quatrième mouvement, tant attendu habituellement, et ici qu’on attendait plus tant ce qui précédait était en lui-même unique.
Le drame est là, marqué, scandé, sombre, avec des contrebasses et des violoncelles en premier plan, mais en même un discours des flûtes en dialogue qui marquent évidemment l’attente de ce qui va exploser. Gatti, en maître du théâtre qu’il est, prépare soigneusement l’entrée des voix, il « ménage l’effet » car une clef possible pour comprendre son approche est de faire de la symphonie un univers théâtral avec ses espaces, ses premiers plans, ses heurts ses émotions. Chaque moment est dramatique, ou répond à un petit drame. Ici dès que la musique de l’hymne à la joie s’épanouit, avant l’entrée des voix, c’est le jeu des cordes et des bois et des cuivres discrets qui fait rencontre et drame, jusqu’à l’explosion qui prélude à l’entrée de la voix de basse (Steven Humes), en un crescendo incroyable de tension.
Les voix ne chantent que sept minutes, et ce sont sept minutes pour basse, ténor, et soprano (moins pour la mezzo) qui sont écrites de manière puissante et tendue, exigeant des aigus marqués (la basse !) de la puissance (le ténor) et une tension à l’aigu, tout en rondeur cependant pour le soprano. Il est en réalité très difficile de trouver les voix idéales, et il n’est pas sûr que des voix wagnériennes soient suffisamment ductiles pour les exigences beethovéniennes. Il faut des voix à la fois puissantes, qui aient la rondeur et la souplesse gluckiste : des voix qui feront le bonheur futur du grand opéra français. Fort, mais jamais fixe, souple, mais bien projeté. En bref impossible. Mais on sait depuis Fidelio que Beethoven n’était pas tendre avec les voix…Christiane Oelze qui a eu des problèmes de justesse à Turin était moins métallique et plus « ronde » et souple à Ferrare, Torsten Kerl après ses Tristan parisiens a donné une preuve supplémentaire de souplesse et de puissante et Steven Humes, le Roi Marke du Tristan parisien très sollicité à l’aigu, et à découvert, était lui aussi très en forme. Le quatuor (avec Christa Mayer comme mezzo) était particulièrement impliqué à Ferrare, un peu plus en voix qu’à Turin.
Le chœur, composé de l’Orfeó Català et du Cor de Cambra del Palau de la música catalana, et dirigé par Josep Vila i Casañas est puissant, avec une diction claire et une présence énergique et engagée, magnifique à tous points de vue, et une fois de plus, l’orchestre a été phénoménal, au point qu’il a mobilisé mon attention là où on est habituellement tendu vers le chœur ou les voix. Avec des dernières mesures menées à un train d’enfer dionysiaque digne d’un final de Septième, ce fut l’explosion du public debout à la fin de l’exécution ferraraise. Une musicienne de l’orchestre m’a dit « c’est l’esprit du lieu »…L’esprit soufflait en tous cas sur ce Beethoven à la couleur inhabituelle, par certains côtés brahmsienne, d’une tension et d’une humanité bouleversantes. Voilà ce que peuvent un orchestre et un chef qui travaillent ensemble par adhésion et pour faire de la musique et non donner simplement un concert. Ce fut une des grandes soirées de concert de ces dernières années, ce fut un immense Beethoven.
Il y aura d’autre concerts avec le Mahler Chamber Orchestra et Daniele Gatti, il s’agira de ne pas les manquer : le printemps fut lumineux et la vie fut belle à Turin et Ferrare en ce mois de mai finissant.[wpsr_facebook]


































 Le Mime de Wolfgang Ablinger-Sperrhacke , qui est en train de devenir le Mime de référence, comme Heinz Zednik en son temps: je trouve cependant que la voix manque de couleur et n’est pas si expressive, alors qu’au contraire la composition de l’acteur, en “ménagère allemande de plus de cinquante ans” est à la fois magnifiquement décalée et désopilante. La prestation globale reste très impressionnante. Seule faiblesse dans l’ensemble des hommes, l’Alberich de Peter Sidhom, très fade, sans expression, qui me semble loin d’être à la hauteur du reste de la distribution.
Le Mime de Wolfgang Ablinger-Sperrhacke , qui est en train de devenir le Mime de référence, comme Heinz Zednik en son temps: je trouve cependant que la voix manque de couleur et n’est pas si expressive, alors qu’au contraire la composition de l’acteur, en “ménagère allemande de plus de cinquante ans” est à la fois magnifiquement décalée et désopilante. La prestation globale reste très impressionnante. Seule faiblesse dans l’ensemble des hommes, l’Alberich de Peter Sidhom, très fade, sans expression, qui me semble loin d’être à la hauteur du reste de la distribution. Le premier acte présente une grotte de Mime sous l’escalier monumental montant au Walhalla, bien connu depuis l’Or du Rhin. Un ascenseur monte vers les cintres (l’ours l’utilise)et en fait Mime est une sorte de travesti (perruque blonde, habits de ménagère allemande) qui cultive son jardin (plantes, géraniums, nains de jardin etc… et même un ensemble de Cannabis éclairé par des lampes rouges comme dans une serre: Mime est un petit trafiquant. Une atmosphère ridiculement familiale, où Siegfried est un ado qui boit du Coca et mange du Nutella. L’attitude de Siegfried semble bien proche d’une manifestation de crise d’adolescence, engoncé dans une salopette trop juste de qui a grandi trop vite. Bonne idée aussi que l’apparition du Wanderer dans un costume de vagabond qui ressemble un peu au costume endossé par Wotan dans la première production de Siegfried à Paris il y a bien longtemps. Un seul point pénible: lors du chant de la forge, des soldats(?) en arrière fond esquissent comme des pas de marche militaire. Pourquoi?
Le premier acte présente une grotte de Mime sous l’escalier monumental montant au Walhalla, bien connu depuis l’Or du Rhin. Un ascenseur monte vers les cintres (l’ours l’utilise)et en fait Mime est une sorte de travesti (perruque blonde, habits de ménagère allemande) qui cultive son jardin (plantes, géraniums, nains de jardin etc… et même un ensemble de Cannabis éclairé par des lampes rouges comme dans une serre: Mime est un petit trafiquant. Une atmosphère ridiculement familiale, où Siegfried est un ado qui boit du Coca et mange du Nutella. L’attitude de Siegfried semble bien proche d’une manifestation de crise d’adolescence, engoncé dans une salopette trop juste de qui a grandi trop vite. Bonne idée aussi que l’apparition du Wanderer dans un costume de vagabond qui ressemble un peu au costume endossé par Wotan dans la première production de Siegfried à Paris il y a bien longtemps. Un seul point pénible: lors du chant de la forge, des soldats(?) en arrière fond esquissent comme des pas de marche militaire. Pourquoi? Le deuxième acte est totalement raté à mon avis: tout mystère, toute poésie en sont effacés. Le lever de rideau laisse voir à gauche Alberich et à droite Wotan (ou l’inverse) habillés à l’identique (merci Chéreau à qui l’idée est prise) qui veillent sur l’antre de Fafner vers laquelle se dirigent des esclaves-soldats nus portant des caisses marquées “Rheingold”, renfermant des armes qu’ils vont pointer sur tout ce qui s’approche de la grotte. Fafner n’est jamais un Dragon, mais un roi à la couronne de carton pâte(personnage à la Ionesco, qui porte la même couronne que Mime à la fin du premier acte lorsqu’il se voit déjà, telle Perrette et son pot au lait, détenteur de tous les pouvoirs). L’oiseau n’est pas un oiseau mais un jeune personnage que Siegfried suit (pourquoi le faire doubler alors par la chanteuse? Celle-ci pouvait parfaitement jouer et chanter..)
Le deuxième acte est totalement raté à mon avis: tout mystère, toute poésie en sont effacés. Le lever de rideau laisse voir à gauche Alberich et à droite Wotan (ou l’inverse) habillés à l’identique (merci Chéreau à qui l’idée est prise) qui veillent sur l’antre de Fafner vers laquelle se dirigent des esclaves-soldats nus portant des caisses marquées “Rheingold”, renfermant des armes qu’ils vont pointer sur tout ce qui s’approche de la grotte. Fafner n’est jamais un Dragon, mais un roi à la couronne de carton pâte(personnage à la Ionesco, qui porte la même couronne que Mime à la fin du premier acte lorsqu’il se voit déjà, telle Perrette et son pot au lait, détenteur de tous les pouvoirs). L’oiseau n’est pas un oiseau mais un jeune personnage que Siegfried suit (pourquoi le faire doubler alors par la chanteuse? Celle-ci pouvait parfaitement jouer et chanter..) La scène entre Wotan et Erda, non dénuée d’intensité et de violence se déroule sur et autour d’une table, et finalement n’est pas si mal réussie, la tension que Wotan crée n’y est pas étrangère. Le rideau d’avant-scène, celui qu’on avait déjà vu au premier et second acte, portant les traces de mots inscrits à la craie (Riesen, Nibelung, Notung, résultats des devinettes posées à Mime par le Wanderer) ou le mot “Fürchten”: “avoir peur” qui est ce qu’ignore Siegfried jusqu’à la vue de Brünnhilde, tombe à nouveau pour isoler Wotan et Siegfried, la scène se déroule selon les canons habituels, et Siegfried, brisant la lance se précipite vers le rocher, en fait l’escalier immense et raide qui monte vers le Walhalla, au centre duquel gît Brünnhilde. Près d’elle, Wotan écroulé, vaincu, face contre terre, en haut à droite une armée d’anges gardiens, chœur muet, qui attendent sans doute le Dieu. Un peu en contrebas Siegfried qui va monter jusqu’à Brünnhilde pour la réveiller. Peu de mouvements possibles sur cette pente abrupte, sur ces marches assez raides à la maigre surface, d’où quelques images fortes sans grands mouvements possibles, par exemple Brünnhilde qui dort au milieu des personnages qu’on vient de décrire, avec des débris de la gloire d’antan, bouclier, table renversée, lettres GER de Germania abandonnées.
La scène entre Wotan et Erda, non dénuée d’intensité et de violence se déroule sur et autour d’une table, et finalement n’est pas si mal réussie, la tension que Wotan crée n’y est pas étrangère. Le rideau d’avant-scène, celui qu’on avait déjà vu au premier et second acte, portant les traces de mots inscrits à la craie (Riesen, Nibelung, Notung, résultats des devinettes posées à Mime par le Wanderer) ou le mot “Fürchten”: “avoir peur” qui est ce qu’ignore Siegfried jusqu’à la vue de Brünnhilde, tombe à nouveau pour isoler Wotan et Siegfried, la scène se déroule selon les canons habituels, et Siegfried, brisant la lance se précipite vers le rocher, en fait l’escalier immense et raide qui monte vers le Walhalla, au centre duquel gît Brünnhilde. Près d’elle, Wotan écroulé, vaincu, face contre terre, en haut à droite une armée d’anges gardiens, chœur muet, qui attendent sans doute le Dieu. Un peu en contrebas Siegfried qui va monter jusqu’à Brünnhilde pour la réveiller. Peu de mouvements possibles sur cette pente abrupte, sur ces marches assez raides à la maigre surface, d’où quelques images fortes sans grands mouvements possibles, par exemple Brünnhilde qui dort au milieu des personnages qu’on vient de décrire, avec des débris de la gloire d’antan, bouclier, table renversée, lettres GER de Germania abandonnées.



