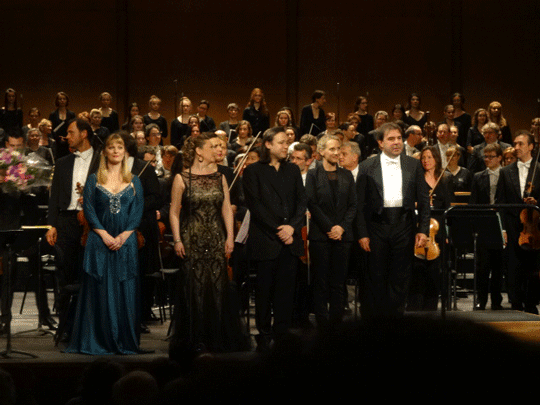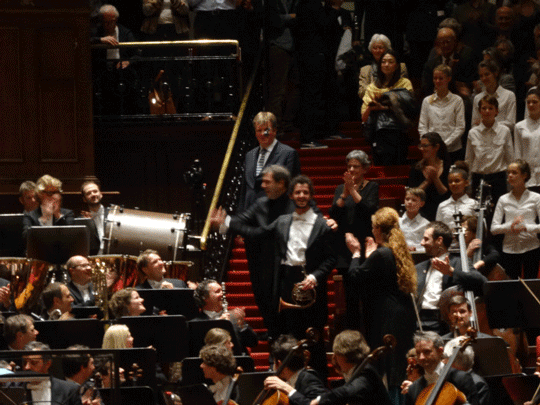Beaucoup d’abbadiens ne sont pas encore revenus à Lucerne après la disparition d’Abbado: certains pour des raisons économiques, ils consentaient un effort important parce qu’ils avaient la garantie d’un concert de toute manière exceptionnel et de la présence d’Abbado, d’autres pour des raisons plus affectives, ils n’ont pas encore le courage de revenir dans ces lieux où a soufflé son esprit pendant dix ans. Il en va ainsi de cette relation étrange (et assez unique) que Claudio Abbado a tissé, sans rien faire pour, avec de nombreux musiciens qu’il a dirigés et une partie du public.
Pour ma part, même si il a accompagné et avec quelle intensité 40 ans de ma vie de mélomane, même si j’ai participé à la création de cette association étrange , le Club Abbadiani Itineranti (CAI) – nom inventé dans les années 80 quand il a quitté Milan- d’environ 400 membres qui suivaient ses concerts depuis des lustres et qui ont constitué l’archive (documents papiers et sonores) le plus riche sur sa carrière, j’ai toujours considéré qu’il ne fallait en aucun cas s’arrêter d’écouter de la musique avec les orchestres qu’il a fondés et dans les lieux symboliques de sa vie, et notamment Lucerne, qui fut la dernière et grande « aventure » de sa carrière. Au contraire, il faut continuer à encourager « l’esprit Abbado » en soutenant les musiciens qu’il aimait et les initiatives qu’il a prises, notamment l’académie de Bolzano qui essaie de créer l’embryon d’un « sistema » à la vénézuélienne ou l’association Mozart, avec les projets Papageno et Tamino de musique dans les prisons et dans les hôpitaux. La meilleure manière de continuer à faire vivre Abbado, c’est non seulement d’écouter ses nombreux enregistrements, mais bien sûr entendre les orchestres qu’il a créés , se rendre aux concerts, et notamment ceux du Lucerne Festival Orchestra.
Cet orchestre est particulier car appuyé sur des relations d’amitié et d’admiration, c’est un orchestre réseau: formé du Mahler Chamber Orchestra qu’Abbado a encouragé à partir de l’initiative des jeunes du Gustav Mahler Jugendorchester qui l’ont constitué et de solistes de renom, ainsi que de musiciens venus d’horizons divers, c’est un orchestre qui a fonctionné « à l’affectif » partageant avec Claudio Abbado l’envie de «Zusammenmusizieren ». C’est un orchestre qui à mon avis disparaîtra s’il devait devenir « ordinaire », car il y a de nombreux orchestres magnifiques qui passent d’ailleurs tous à Lucerne, mais qui ne sonne pas comme celui-là les grands soirs. L’expérience du Lucerne Festival orchestra est non seulement l’expérience de l’excellence musicale, mais de l’engagement pour faire de la musique ensemble autour d’un chef : le concert hommage bouleversant du 6 avril 2014 en est la preuve la plus éclatante.
Ainsi est-on tiraillé entre l’envie que cet orchestre continue de vivre selon les mêmes principes, et le doute que cela soit possible avec tous les chefs…Il y a la logique du Festival, attirer le public de nouveau sur un nom, et la logique de l’orchestre, que ce nom soit admiré et aimé et surtout qu’il soit un chef qui partage quelque chose avec ses musiciens. Et il est possible que ces logiques ne se croisent pas tout à fait.
Personnellement, j’ai écrit que la venue de Riccardo Chailly est un choix de raison. Ce n’est pas un choix d’adhésion et, c’est vrai, je nourris quelques craintes pour l’évolution de l’orchestre. Mais il n’y avait guère d’autres solutions vu qu’Andris Nelsons, pressenti et désiré (élément essentiel) ne pouvait au mois d’août cumuler Tanglewood et Lucerne et que sa présence aurait obligé à des réorganisations trop lourdes pour le Festival.
Cette année, après une année 2014 difficile (les concerts de l’été dernier étaient tendus), c’est une année « normale » où nous pouvons nous rendre compte à la fois de l’état des troupes et voir si Lucerne a toujours sa magie propre.
Déjà, cette année, une rupture de l’habitude : alors que les concerts du LFO à Lucerne étaient concentrés sur le Week end (vendredi et samedi), cette année, pour des raisons d’agenda de Nelsons, le deuxième programme est prévu un mercredi et jeudi.
Mais le festival a quand même ouvert alla grande par un concert exceptionnel dirigé par Bernard Haitink, 86 ans, vétéran des grands chefs de ce temps, et un fidèle de Lucerne, où il anime des Master’s Class de direction d ‘orchestre passionnantes, et où il vient régulièrement avec le Chamber Orchestra of Europe, autre orchestre fondé par Abbado.
La présence de Haitink à la tête du LFO pour l’ouverture du Festival (avec un discours d’Alfred Brendel) était un juste retour des choses : Haitink a dirigé l’Orchestra Mozart en 2014 remplaçant Abbado malade, et a aussi remplacé à Lucerne Abbado à la tête des Berlinois lors de sa première opération en 2000 (Bruckner 7).

En l’observant diriger, je me souvenais des conseils qu’il dispensait aux jeunes chefs venus à sa classe de maître, sur le geste et les mouvements du chef ; il ironisait sur ses jeunes collègues qui se déhanchent en mouvements divers sur le podium, en disant qu’aujourd’hui on aimait bouger, et montrait à ses élèves qu’avec un regard et un minimum de mouvement, on pouvait arriver au même résultat, sinon encore meilleur, et que le geste excessif n’ajoutait rien dans la relation à l’orchestre, mais qu’il concernait l’effet sur le public.De la com en fait…
Haitink semble impassible sur le podium, un regard fixe (certains disent même qu’il ne vaut mieux pas être placé derrière l’orchestre parce que son visage a une impassibilité glaçante), un geste limité, et notamment une main gauche peu expressive (au contraire d’Abbado), en bref une rigidité qui peut décevoir ceux qui pensent que le geste du chef est une traduction visuelle des mouvements de la musique. Et pourtant, cet homme réservé et peu expansif est capable de déchaîner des orages : je me souviens d’un Tristan inoubliable à Zürich qui fut le Tristan le plus énergique, le plus haletant, le plus tempétueux de ma vie de mélomane.
Peu médiatique, la carrière d’Haitink fut sûre, à la tête des plus grands orchestres, dont 25 ans à la tête du Concertgebouw, et dans un répertoire varié mais essentiellement romantique et postromantique. Il n’a pas beaucoup dirigé à l’opéra ces dernières années, mais tout de même, il a été directeur musical de Covent Garden pendant une quinzaine d’années et aussi à Glyndebourne (comme me l’a opportunément rappelé un lecteur que je remercie), et dans ses enregistrements, il a notamment à son actif un Ring magnifique au disque. Par ailleurs on se souvient de son Pelléas au TCE à Paris.
Dans un thème général du Festival consacré à l’humour en musique, le programme combinait la Symphonie en ut majeur Hob.I : 60 « Le distrait » de Haydn et la Symphonie n°4 en sol majeur de Mahler.
La symphonie n°60 date de 1774, Haydn a 42 ans, il est en pleine période créatrice, en pleine maturité à une époque où 42 ans est déjà un âge avancé . Il mourra en 1809, à 77 ans.
Ce n’est pas une symphonie à proprement parler (6 mouvements !), mais un ensemble musical composé pour accompagner la représentation du Distrait de Regnard au château Eszterháza , une comédie créée à la Comédie Française en 1697 mais qui a connu un grand succès plus tard, à l’ère des Lumières au point d’être traduite en allemand (Der Zerstreute). Haydn compose une musique qui va ouvrir la comédie et s’intercaler entre les cinq actes.
Sans suivre exactement la trame de la pièce (une aventure qui commence sur un mariage arrangé où finit par triompher le véritable amour), Haydn accentue les effets de surprise, on passe brutalement de l’énergie au pianissimo, on change brutalement de tonalité, le clou étant un effet de désaccord des violons au 6ème mouvement qui fait glousser la salle. Toutes opérations conçues pour représenter les aléas de la distraction, les retours brutaux à la réalité, les coups de théâtre.
L’orchestre de Haitink est vif, jamais ennuyeux (quelquefois, je dois avouer qu’Haydn m’ennuie un peu), toujours en tension avec une grande clarté dans les différents niveaux, avec des effets de contraste de couleur et de rythmes, avec une vie réelle et souriante, qui cadre parfaitement avec le thème du Festival. Les violons sont stupéfiants (de vélocité et de chaleur en même temps, comme d’habitude,) notamment au cinquième mouvement et j’ai particulièrement aimé le dialogue entre cor, hautbois et cordes à l’andante du deuxième mouvement . Mais ce qui frappe surtout, c’est que même dans les parties un peu plus pompeuses (début du 1er mouvement), l’orchestre de Haitink n’est jamais démonstratif, toujours fluide et naturel, sans pathos, mais sans froideur. Du grand art.
La quatrième symphonie de Mahler a été jouée par Abbado à Lucerne en 2009 avec comme soliste Magdalena Kožená. Je n’ai pas l’intention de me lancer dans une comparaison : les maniaques se référeront et à l’enregistrement radio du présent concert par la SRF, et au DVD du concert d’Abbado (EuroArts).
Il est clair que Haitink propose une interprétation prodigieusement vivante de cette symphonie, peut être la plus souriante de Mahler (qui prend donc sa juste place dans le thème de l’année du Festival), la plus insouciante, la moins marquée par la douleur ou la tragédie. Tout en gardant sa relative immobilité, Haitink n’offre pas du tout une interprétation froide, on retrouve en effet les qualités qui font de cet orchestre un objet musical tout particulier, des cordes d’une grande ductilité, des instruments solistes (cor, trompette, flûte, hautbois) d’un niveau prodigieux, d’une homogénéité et d’une chaleur de son quasiment uniques, servies par l’acoustique de la salle, précise, jamais trop réverbérante, mais très chaleureuse et très précise. On retrouve un orchestre aux couleurs variées, des équilibre sonores soignés, une certaine légèreté, mais tempérée notamment dans les deux premiers mouvements, avec une très belle intervention de Gregory Ahss, le premier violon au deuxième mouvement.
Mais c’est dans l’adagio qu’on retrouve peut-être l’ivresse sonore que toujours cet orchestre a su donner : Haitink, sans jamais insister, sans jamais exagérer, sans jamais aller au-delà des notes, mais avec un soin tout particulier aux enchainements et à la respiration, nous propose avec l’orchestre un de ces moments extatiques qui font battre les cœurs et s’élever les âmes. Ce fut immense et à la fois presque simple, sans effet dérangeant, sans démonstration aucune : la grandeur simple d’un moment d’une intensité réelle mais jamais dramatisé, naturel dans son crescendo. Il y a chez Haitink cette capacité rare à rendre la musique vraie, sans décoration inutile, sans manière, et toujours dans une grande limpidité. Sans bruit, le chef d’œuvre s’impose.

On descend sans doute d’un cran dans le dernier mouvement, conçu antérieurement, comme on le sait, et devant être intégré initialement à la 3ème symphonie. Si l’enchainement entre l’adagio et le Lied du Knaben Wunderhorn « Wir geniessen die himmlischen Freuden » est parfaitement mis en place par l’orchestre, puisque l’ensemble de la partie « symphonique » prépare ce finale, j’ai trouvé le chant d’Anna-Lucia Richter, avec une voix de soprano légèrement acidulée, un peu maniéré pour le style de l’interprétation générale de Haitink, on avait besoin de plus de naturel. La voix porte bien, la diction est assez claire, compte tenu d’une salle où la voix a quelque difficulté parfois, mais la chanteuse abuse un peu d’effets comme des portamenti à répétition. Il est vrai que c’est un moment plus délicat qu’il n’y paraît: ni Fleming avec Abbado et les Berlinois, ni Kožená avec Abbado et Lucerne ne m’avaient totalement convaincu. J’attends là-dedans une voix plus fraîche, plus jeune et plus naïve, pourquoi pas une Hanna-Elisabeth Müller ?
Il reste que l’ensemble est un grand moment mahlérien et nous rassure : l’orchestre reste l’orchestre d’Abbado avec ses qualités et son engagement légendaires. L’autorité réelle de Bernard Haitink, sa rigueur, sa précision et sa simplicité auront fait le reste. Ce fut un concert magnifique, et des retrouvailles émouvantes de Lucerne avec Mahler (les derniers Mahler étaient l’adagio de la Symphonie n°10 en 2011, et surtout la Symphonie n°9 en 2010). C’est Mahler qui a fait la réputation de l’orchestre, et cette nouvelle rencontre le confirme : cet orchestre est unique. [wpsr_facebook]