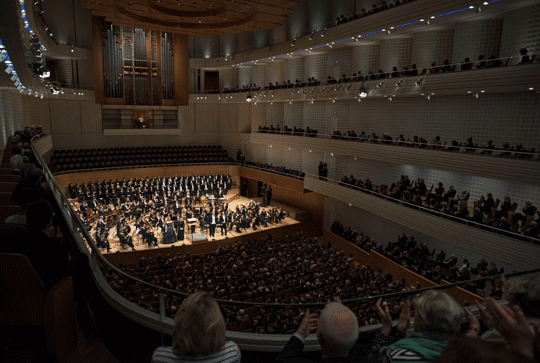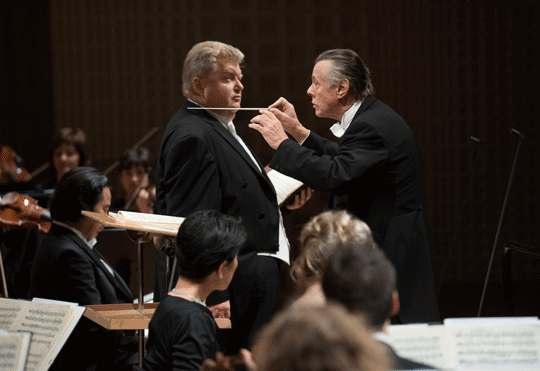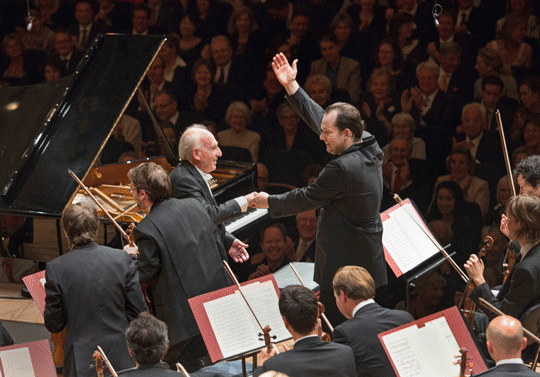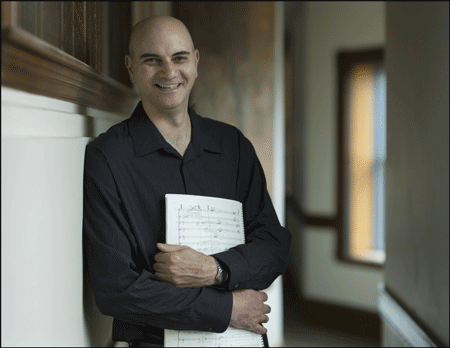Priska Ketterer Luzern
On s’interrogeait sur le devenir du Lucerne Festival Orchestra après la disparition de Claudio Abbado. Cet orchestre était tellement lié à la personnalité de son chef, il y avait un échange tel entre chef et musiciens, une affection tellement évidente que la question devait inévitablement se poser et qu’elle serait difficile.
Michael Haefliger a pris son temps et par ce festival 2015, il a donné la première réponse : le LFO continue. Les deux programmes dirigés l’un par Bernard Haitink le vétéran (classe 1929) et l’autre par Andris Nelsons (le benjamin des très grands) voulaient montrer que Mahler est le compositeur structurel de cet orchestre dont ses exécutions légendaires désormais ont fait la gloire, mais aussi que il devait désormais y avoir une vie après Abbado, sans doute avec une plus grande diversification.
La présence d’Haitink à Lucerne est régulière, celle de Nelsons aussi, mais il était pris par Tanglewood et par le Boston Symphony Orchestra pendant les premiers jours d’août. Haitink a été celui qui souvent remplaça Claudio Abbado pendant des jours sombres (avant même l’existence du LFO) pour que le Festival lui offrît pour une fois la tribune de l’inauguration 2015 du Festival. C’est mérité, c’est justifié, et a posteriori, ce fut une excellente idée car les deux concerts furent de très grands moments.
C’était aussi sans doute une volonté d’Abbado que de voir le LFO consolidé : il n’aurait sûrement pas aimé voir cet orchestre disparaître après lui, il suffit déjà de l’Orchestra Mozart, né dans une Italie en crise économique et culturelle, et mort par manque d’argent et de volonté politique.
Mais le LFO consolidé, il restait à savoir avec qui faire la suite du chemin, et donc sûrement aussi de sonder d’éventuels successeurs.
En fait la succession d’Abbado est évidemment difficile en soi, mais aussi difficile parce que la période est marquée par de nombreuses transitions à la tête des orchestres internationaux et qu’il fallait trouver un fil qui lie en quelque sorte le grand chef disparu et son successeur. Et alors le choix se raréfiait.
Ce n’est pas une question de disponibilité : le LFO prend à un chef moins de trois semaines en août et une quinzaine de jours en automne pour la tournée annuelle.
Ce n’est pas une question d’argent : nous sommes en Suisse et Lucerne n’est pas un Festival pauvre.
C’est d’abord une question de politique artistique : La refondation du Lucerne Festival Orchestra (ex-Schweizer Festspielorchester) fut avec la Lucerne Festival Academy de Pierre Boulez, la grande initiative du règne de Michael Haefliger, qui ne réussit pas à imposer ou à trouver les fonds pour sa troisième initiative, la salle modulable. Or il vient de prolonger son contrat et doit trouver et de nouvelles idées et de nouveaux objectifs: Abbado est mort et Boulez ne dirige plus. Il a besoin de donner un signe fort qui ne fasse pas de Lucerne un garage pour orchestres de luxe en tournée.
C’’est aussi une question d’image et de public : Le LFO est devenu le prince des orchestres au vu des moments exceptionnels qui ont été vécus à Lucerne de 2003 à 2013; bien sûr Abbado en est la raison essentielle, mais l’orchestre s’est toujours surpassé, et il en est résulté une période dont l’intensité peut difficilement être niée, mais qui peut tout aussi difficilement être répétée ou prolongée telle quelle. On ne reprend pas une histoire d’amour et d’adhésion construite sur des années avec un chef, avec un autre sans aucune transition.
Il faut pourtant que cet orchestre reste le porte drapeau d’un Festival international dont le gène est la musique symphonique et de chambre et il faut donc que les dix premiers jours affichent systématiquement l’orchestre du Festival en formation symphonique ou en formation de chambre, avec des « noms » susceptibles d’attirer le public, et un public international qui hésite à aller en Suisse actuellement pour des raisons financières compréhensibles vu le niveau du Franc suisse: on peut lui préférer Salzbourg où la plupart des orchestres qui passent à Lucerne se retrouvent aussi. Cette année, Haitink, Isabelle Faust, Nelsons, sont des noms prestigieux et pourtant les salles ne sont pas pleines à 100%.
Il faut à la tête de cet orchestre un chef qui soit parmi les tout premiers du top 10, et qui soit en même temps disponible. Jansons limite ses activités, Haitink a 86 ans, Gatti commence en 2016 avec le Concertgebouw et peut difficilement la même année prendre deux orchestres, Nelsons est pris par Tanglewood en été jusqu’à la mi-août. Le paysage se rétrécit alors singulièrement.
On aurait pu supposer que l’orchestre pouvait être dirigé par des chefs de prestige chaque année différents, une sorte de formule « carte blanche de l’année à… » ou un « chef d’orchestre étoile » comme il y a un artiste étoile chaque année, mais Michael Haefliger, réfléchissant à l’histoire de cet orchestre et à la personnalisation dont il a fait l’objet à travers Abbado, a préféré appeler un directeur musical fixe : c’est en terme d’images un élément bien plus significatif. Il s’est finalement résolu à la solution d’un vrai chef, pour installer aussi une tradition post-abbadienne, avec la différence que ce ne sera pas le chef exclusif, comme ça le fut (à de rares exceptions motivées par la maladie) pour Claudio Abbado, et pensant à l’importance des chefs italiens dans l’ histoire de l’orchestre (fondation par Toscanini et refondation par Abbado), il s’est ainsi tourné vers Riccardo Chailly, inattendu, mais intéressant d’avoir à Lucerne pour plusieurs raisons :
- son contrat au Gewandhaus de Leipzig (dont le premier violon Sebastian Breuninger, est aussi le premier violon du LFO, ce qui n’est pas négligeable) se termine en 2017, c’est pour lui une manière de rebondir avec un orchestre à très grande réputation et c’est pour Lucerne important d’avoir un chef qui est l’un des plus prestigieux du paysage d’aujourd’hui.
- il est un des chefs en activité qui a le plus enregistré (il termine une intégrale Mahler chez Accentus en DVD et son intégrale Brahms chez DECCA a reçu des prix)
- il a un répertoire voisin de celui d’Abbado : Mahler, répertoire romantique allemand, mais aussi XXème (Varèse) c’est à dire le répertoire même installé pour l’orchestre.
- il peut aussi faire des opéras en version de concert, étant directeur musical de la Scala et chef d’opéra assez réputé.
- Kapellmeister du Gewandhaus de Leipzig, et assez respecté en Allemagne, il peut attirer un public allemand, directeur musical de la Scala et milanais, il peut attirer un public italien qui peut faire l’aller et retour dans la journée (Lucerne est à 3h de Milan environ). Le contingent italien était très important dans les dix dernières années.
- Enfin, il a été l’assistant d’Abbado ce qui représente, au moins pour la communication, un argument fort, bien qu’il n’ait pas eu de relation amicale aussi suivie avec Abbado que d’autres chefs comme Mehta, Barenboim ou Kleiber.
Ainsi s’explique le choix de la Huitième de Mahler comme premier programme 2016, à laquelle Abbado avait renoncé pour des raisons artistiques personnelles d’absence d’affinité avec cette œuvre, et qui permettra enfin de boucler le cycle Mahler de l’orchestre et de créer un événement. Sans doute aussi la présence de Chailly permettra-t-elle par ailleurs de boucler plus tard les symphonies de Bruckner en cours.
Il restera à voir quel rapport Chailly va installer avec l’orchestre et en combien de temps. Il faudra sans doute au moins deux saisons avant que les uns et les autres ne se calent. Mais Mahler VIII est un excellent galop d’essai et c’est une symphonie qui ira sans doute très bien à Chailly.
L’intérêt bien compris du Festival de Lucerne, mais aussi de l’orchestre est de tourner rapidement la page, désormais, pour permettre à l’orchestre de laisser les souvenirs et les émotions et d’embrasser un avenir nouveau. Déjà cette année, il ne faudra pas chercher, dans telle ou telle interprétation un souvenir d’autres moments. Le Roi est mort, la période de deuil est close. Vive le Roi. [wpsr_facebook]