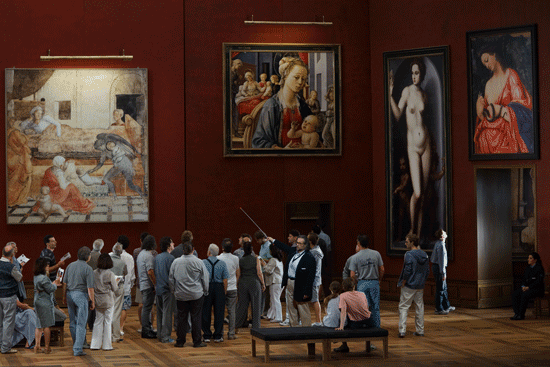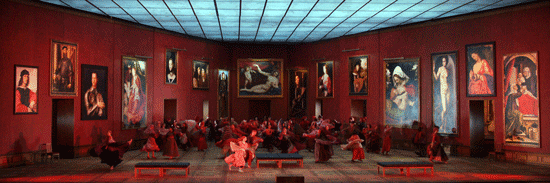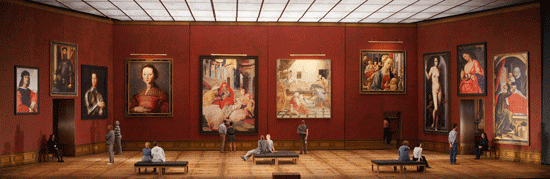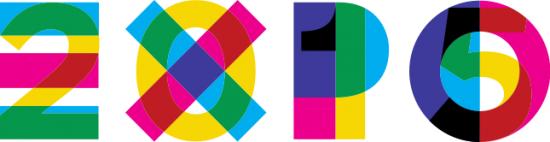La nouvelle est tombée vendredi 3 octobre : Daniele Gatti succède à Mariss Jansons à la tête de l’Orchestre du Concertgebouw, c’est une excellente nouvelle qui tombait à point nommé, puisque j’étais en train d’écrire le présent compte rendu du Roméo et Juliette de Berlioz proposé le 18 septembre dernier en ouverture de saison de l’Orchestre National de France au théâtre des Champs Elysées.
Pour avoir l’an dernier assisté à Lucerne à une IXème de Mahler assez mémorable (ma première IXème non dirigée par Abbado) , avec l’Orchestre du Concertgebouw dirigé par Daniele Gatti, je peux attester qu’on sentait immédiatement une sorte de feeling avec l’orchestre, dans un répertoire qui fait partie de son histoire , voire de ses gènes et que Gatti affectionne tout particulièrement. Ce fut même un concert vraiment spécial. J’avais alors écrit que Gatti était un chef « de tête », « de concept », et un chef que je disais « chtonien » et non éthéré. C’est un chef qui prend à revers, qui surprend, et donc qui est rarement là où on l’attend, même si pour certains, c’est à chaque fois une sorte de mauvaise surprise. Car Daniele Gatti est discuté, quelquefois violemment, et notamment à Paris. Il suffit de lire les réactions à sa nomination à Amsterdam. Dans le genre mi-figue, mi-raisin, dans la manière de dire que c’est une bonne nouvelle tout en sous-entendant que c’est un choix par défaut (Jansons quittant l’orchestre à cause de sa santé), certains ont déployé les plus grands trésors de la rhétorique française la plus hypocrite pour lui souhaiter un « bon voyage ! » sous lequel on ne pouvait s’empêcher de lire « bon débarras !».
Je ne comprends pas ces réactions, car, on l’a encore entendu cet été dans Trovatore à Salzbourg, Daniele Gatti est un chef qui va jusqu’au bout de ses lectures, de ses convictions, et qui prend le risque d’aller ailleurs, d’explorer des territoires autres, y compris sur des partitions rebattues où l’oreille a fini par être formatée, voire endormie. C’est un chef qui a une vraie lecture des œuvres, approfondie, une approche intellectuelle et conceptuelle, et surtout une volonté farouche de faire comprendre. On lui reproche souvent de ne pas être un « communicant », certes, ce n’est pas un showman à la Rattle ou à la Dudamel, mais c’est un musicien incontestable, et ses lectures des œuvres communiquent une vision claire, nette, sans concession et souvent inattendue.
Il en va ainsi pour ce Roméo et Juliette de Berlioz, le premier Berlioz qu’il aborde, sans doute parce qu’il ne pensait pas avoir d’affinités avec cet univers; mais, directeur musical de l’Orchestre National de France, il est difficile d’échapper un jour à Berlioz, comme échapper à Mahler à Amsterdam, Strauss à Munich ou Mozart à Vienne.
Et je crois que Daniele Gatti a été à son tour pris à revers par cette partition et par Berlioz. Car il est facile de se laisser piéger par le gigantisme et par le son berlioziens, par cette sorte d’image de romantisme échevelé certes, qui en deviendrait un autre conformisme.
Or, Berlioz prend systématiquement lui aussi à revers et notamment dans Roméo et Juliette.
Dans un XIXème siècle où l’histoire de Shakespeare avait déjà fait l’objet d’un Singspiel de Georg Benda à la fin du XVIIIème, d’un opéra de Nicola Vaccaj, Giulietta e Romeo en 1825, d’un opéra de Bellini I Capuleti e i Montecchi (sur le même livret de Felice Romani) en 1830, et où Berlioz avait vu Harriet Smithson dans la pièce de Shakespeare (version Garrick) en 1828, Berlioz ne propose pas un autre opéra, un opéra de plus mais va labourer ailleurs, vers un genre inconnu et spécialement créé pour l’occasion, une symphonie dramatique, où les voix (sauf le père Laurence) sont anecdotiques, et où le livret est surtout un récit, qui s’entremêle avec la musique. La présence de voix de mezzo, ténor et baryton pourrait laisser croire à un dialogue, à des rôles, à une théâtralisation : or le théâtre n’est pas dans les voix, mais dans la musique. De plus les formes comme le mélodrame ou mélologue sont assez populaires depuis la fin du XVIIIème (souvenons-nous du Pygmalion de Rousseau, repris par Donizetti, sa première œuvre), c’est à dire que là où on attend théâtre, voire opéra, Berlioz répond, symphonie et même symphonie dramatique, c’est à dire une symphonie mise en drame, mise en voix, mais non mise en scène.
Autre manière de prendre à revers, Berlioz (et c’est aussi audible dans bien d ‘autres œuvres) dissimule dans des détails de la partition (le diable se cache toujours dans les détails) des dissonances, des phrases musicales très hardies qu’on retrouvera plus habituellement dans des œuvres du futur même lointain, comme s’il faisait des tentatives, comme si cette musique, bien loin d’être échevelée, avait quelque chose de rigoureux et d’expérimental. Comme si cette musique avait un programme caché. Je me souviens comme Abbado traitait de manière surprenante certains moments de la Fantastique (notamment dans son hallucinante interprétation de 2013 à Berlin) et comment il nous indiquait l’innovation et la surprise et aussi souvent, comment il nous montrait par exemple derrière la chevelure berliozienne les lunettes mahlériennes.
La première fois que j’entendis Gatti (1991, Bologne), nous le retrouvâmes par hasard au restaurant après la représentation (Moïse de Rossini) et nous entamâmes un brin de conversation avec lui. Il nous confia déjà à l’époque (il avait 30 ans) que son rêve était de diriger Berg. Cette déclaration m’avait beaucoup marqué et j’ai toujours écouté ensuite Gatti avec ce souvenir bien ancré en moi : il a cette approche de la musique qui convient si bien à une lecture d’un Wozzeck ou d’une Lulu (œuvres qu’il dirige d’ailleurs remarquablement, à la fois de manière très analytique et sensible) une lecture appuyée sur les formes traditionnelles, revues, relues, et avec un son, qui produit quant à lui des agencements surprenants, des dissonances, des ruptures, une certaine brutalité et en même temps un certain lyrisme, tout en laissant peu de place à la complaisance. Ce qui frappe quand on entend Berg c’est que l’attention est décuplée par l’incroyable richesse de la « concertation », qui oblige à s’attacher à chaque détail. Je suis très impatient d’entendre son Pelléas et Mélisande à Florence parce que je suis sûr que l’univers de Debussy sous ce rapport lui conviendra parfaitement.
Je me trompe peut-être, mais je suis sûr qu’en se plongeant dans la partition de Berlioz, c’est cette richesse-là, ces détails là, que Gatti a notés, ces petites choses que Berlioz sème çà et là, et qui sont des tentatives d’aller vers un ailleurs qui n’a rien à voir avec la musique du temps, ces petites choses qui devaient bien intéresser notre auteur de la musique de l’avenir, Richard Wagner ces petites choses qui obligent à une écoute très attentive et très fouillée.
Alors Daniele Gatti nous a fait entendre cette petite musique-là, cette musique de l’avenir : voilà une œuvre au thème rebattu, à la forme surprenante, presque un hapax, et voilà au total un Berlioz qui ouvre des univers nouveaux. Un orchestre et un chœur retenus, un souci de faire entendre des détails très raffinés et rarement relevés.
Le dernier Roméo et Juliette auquel j’avais assisté, c’était Salonen à Lucerne, très beau concert qui m’avait convaincu, mais ici j’ai l’impression d’aller encore plus loin dans la direction résolue de la lecture.
Gatti fouille le tissu textuel et non seulement révèle des détails surprenants, mais aussi colore de manière particulière les moments qui rappellent ou Les Troyens, ou Benvenuto Cellini, voire la Fantastique, il met en place une sorte de réseau référentiel, mais en même temps le traite presque avec distance, tenant résolument à travailler d’abord une couleur, à retenir le son de cette énorme machine, qu’il arrive (une gageure) à rendre presque intime quelquefois, tout en laissant la place aux moments plus spectaculaires (les cuivres de l’Orchestre National sont en grande forme), mais sans excès, avec éclat, mais sans clinquant : il révèle les contrastes, mais dans un cadre très contenu, assez contraint où finalement se révèle alors une autre dimension peut être plus profonde de Berlioz. Son souci permanent de clarté, sa volonté de faire apparaître les architectures l’amène à mettre en valeur les pupitres et notamment les bois, excellents , mais aussi les cordes, et notamment les violoncelles et les contrebasses ce qui est absolument nécessaire pour faire que les masses orchestrales et chorales puissent être parfaitement lisibles et donner la couleur à chaque partie. Les contrastes sont en effet nombreux, et presque systématiques entre les moments très retenus murmurés, voire presque parlés et les grands moments choraux, inspirés de la 9ème de Beethoven que Berlioz avait entendu une dizaine d’années plus tôt. Le chœur de Radio France est d’ailleurs vraiment remarquable de subtilité, de maîtrise, de clarté: on comprend chaque mot, chaque inflexion. Un très beau travail de préparation de Howard Arman.
Ainsi a-t-on l’impression d’entendre et de distinguer chaque note, comme si on se concentrait sur une œuvre de musique contemporaine, et en même temps de voir révélée une architecture, un peu comme la lecture d’un plan détaillé, d’une architecture au style plus dorique que ionique, sans volutes mais avec des lignes et des arêtes, quelquefois aiguisées, en somme une approche essentielle, et non décorative. Gatti ne s’attarde jamais sur le décoratif, il est trop direct pour cela et il met l’auditeur à l’épreuve en l’obligeant à une audition dynamique et presque participative là où quelquefois on aurait tendance à se laisser aller passivement. En faisant un (très mauvais) jeu de mot, c’est un Ber(g)lioz qui nous est posé ici, un Berlioz lu au prisme des débuts du XXème siècle, un Berlioz qui s’insère dans une histoire musicale où on ne pense pas forcément à lui, et ce faisant, Gatti donne une profondeur insoupçonnée à cette partition.
La place des voix dans cet immense dispositif reste latérale. Placés dans l’orchestre, à peine visibles, les solistes deviennent presque des parties instrumentales. Marianne Crebassa a peu de temps pour nous laisser entendre son beau mezzo, sa diction parfaite et sa projection impeccable. Je me souviens de sa prestation remarquable dans Tamerlano de Haendel à Salzbourg. Elle garde dans sa partie sa distance récitante, mais fait entendre en même temps une couleur chaude et une belle intelligence musicale. Elle s’impose beaucoup plus que Christiane Stotijn à Lucerne en 2013. Paolo Fanale est un choix surprenant. Pourquoi aller chercher un italien (talentueux certes) pour une partie que bien des ténors lyriques français pouvaient tenir. C’est que Paolo Fanale semble s’être fait une spécialité des rôles en français, on l’a vu à Genève dans Mignon, on l’a vu aussi dans Les Troyens à la Scala (Iopas), on le voit brièvement apparaître dans ce Roméo et Juliette, avec son timbre très lyrique et velouté, et un zeste de raideur qui finalement peut convenir à cette récitation, même s’il reste pâle et si on préfèrerait plus de souplesse.
La plus grande surprise vient d’Alex Esposito, qu’on a bien plus l’habitude de voir dans des rôles rossiniens ou mozartiens (c’est un notable Leporello, un remarquable Figaro) où il démontre un grand engagement et vocal et physique. L’entendre dans un répertoire inattendu et dans un rôle de récitant est une surprise: il est vrai que le père Laurence est le seul récitant-personnage de l’œuvre, il assume à la fois la distance du récit et l’implication du personnage. Sa belle voix claire, sonore, bien projetée, est immédiatement convaincante dans un style très différent de celui de Gérard Finley à Lucerne, avec de menus accidents de diction mais dans un ensemble tout de même très soigné. Il donne une vraie présence et en même temps une véritable humanité à son intervention. Un très beau moment.
Une conclusion s’impose, ce premier Berlioz de Daniele Gatti est une réussite et cette manière de l’aborder est pleinement convaincante. Il en propose une lecture passionnante et assez novatrice, et débarrasse ce Roméo et Juliette de tout ce qu’il pourrait avoir de convenu d’attendu et de superflu. Le public, et semble-t-il l’orchestre ont bien senti la qualité de ce moment.
[wpsr_facebook]