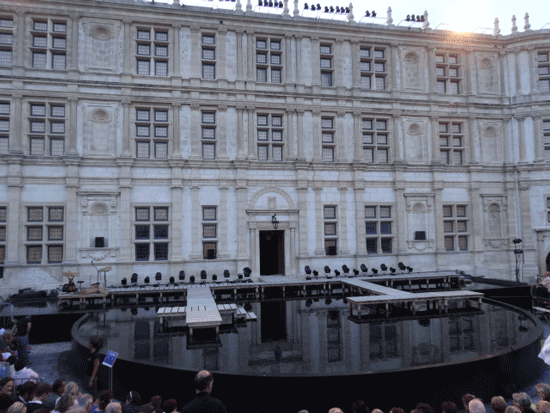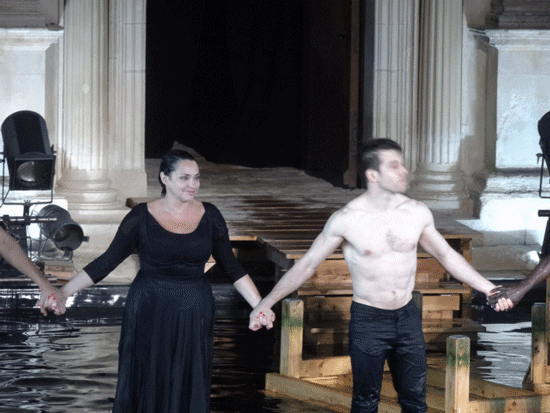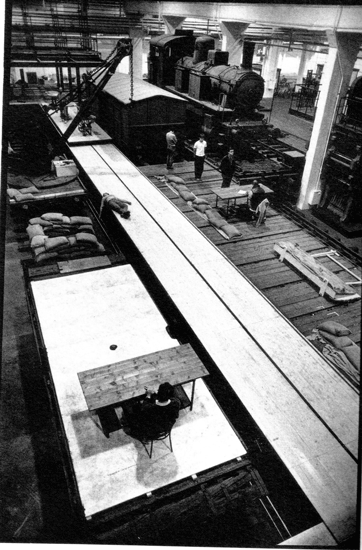- La cueillette des Lettres, ce “sang des familles” © Monika Rittershaus
Salzbourg 2014 (Théâtre) : après le relatif échec des Derniers jours de l’humanité (Georg Schmiedleitner), et les discussions de la critique autour de Forbidden Zone (Katie Mitchell), le projet autour de la première guerre mondiale construit par Sven Eric Bechtolf, le directeur de la programmation théâtre qui prend l’interim du festival après le départ de Alexander Pereira, a affiché Don Juan revient de la guerre, de Ödön von Horváth dans une mise en scène de Andreas Kriegenburg.
La pièce de Horváth, qui soit dit en passant, est à l’affiche de l’Athénée en 2014-2015 dans une mise en scène de Jacques Osinski, est passionnante pour trois motifs :
– c’est une pièce sur la guerre et sur son influence sur l’évolution des êtres, voire leur destruction et à ce titre une très violente dénonciation.
– c’est une pièce sur la femme, sur sa liberté ses désirs et ses choix, et sur son passage d’objet à sujet.
– c’est une pièce sur Don Juan, qui revient de la guerre avec un désir de changement, un sujet qui risque de devenir objet, mais qui retrouve peu à peu les vieilles lunes, dans l’écartèlement des désirs contradictoires.
Cette fois, aucune erreur dans le choix des lieux : c’est à Perner Insel, à Hallein (à une dizaine de km de Salzbourg) sur cette scène magnifique située dans une friche industrielle inventée par Gérard Mortier et Peter Stein, où je vis Les géants de la Montagne (Ronconi) et en 1999 ce spectacle inoubliable de Tom Lanoye et Luk Perceval, Schlachten ! (Batailles) à partir des pièces de Shakespeare traitant de la Guerre des deux roses, qui durait environ 9h et qui m’a à jamais marqué.
En pensant à Don Juan revient de la guerre, je me suis dit que tout enseignant travaillant avec ses élèves Don Juan de Molière (passage obligé, rituel, de tout enseignement de littérature en lycée) pourrait rompre le train-train donjuanesque en proposant en lecture-miroir cette extraordinaire pièce de Horváth, qui pose la question du Donjuanisme en des termes particulièrement aptes à faire comprendre le sens du mythe.
Pourtant, malgré l’enthousiasme devant ce travail, ce n’est que près de trois mois après que je me décide à écrire…
Je me suis demandé pourquoi j’avais tant tardé.
Sans doute une hésitation. Sans doute aussi parce que j’ai tenu à relire la pièce en traduction française, dans la belle traduction de Hélène Mauler et René Zahnd parue aux éditions de l’Arche, et que peu à peu l’urgence de l’écriture s’est atténuée, pour se transformer en souvenirs, en éléments de réflexion, en moments qui régulièrement reparcouraient les labyrinthes de ma mémoire.
Alors je suis revenu sur le métier.
D’abord parce que la pièce est tout à fait extraordinaire et que j’engage les parisiens (et les autres) à courir à l’Athénée en avril 2015. Ensuite à cause du travail d’Andreas Kriegenburg, qu’on connaît peu en France. Il m’avait séduit aussi bien dans son Ring que dans Die Soldaten à Munich que je viens de revoir il y a deux semaines. J’étais curieux de voir du théâtre, car à distance de plusieurs mois, des images profondément ancrées me restent de ce travail que je voudrais communiquer.
Enfin, peut-être parce que d’une certaine manière, j’ai confusément ressenti une gêne à parler d’une pièce sur la femme, sur les femmes qui regardent un homme et qui projettent leurs désirs plus ou moins fantasmés sur un homme.
Et si une femme pouvait mieux ressentir que moi ce travail ? Je me suis vraiment posé la question, parce que la polyphonie féminine (il y a 35 femmes dans la pièce) est ici traitée comme un thème et ses variations, et que ces variations finissent pas créer un tableau psychologique extraordinaire, d’une très grande sensibilité et sans doute aussi d’une grande justesse.

Mais il y a tant de choses diverses dans la pièce, que finalement je prends la plume ou plutôt le clavier. Il y a des idées et des profils, une atmosphère si particulière, peut-être unique dans le théâtre de Horváth ou au moins ce que j’en connais. On y ressent avec une grande violence la guerre et les transformations psychologiques et sociales d’un monde bousculé, l’Allemagne au lendemain d’un conflit terrible qui l’a laissée au tapis, mais on n’y imagine pas Don Juan, trop singulier et trop superbe pour être un anonyme dans les millions de soldats engagés, et presque incongru dans un monde guerrier essentiellement masculin. Et pourtant, il est bien là; et la guerre lui a enlevé sa singularité : il dit lui-même dans l’une des premières scènes « je ne suis rien du tout »: il fuit (il dit fuir…) donc son personnage et ce qu’il traîne après soi. Un Don Juan d’après, qui va être contraint de revenir à celui d‘avant contre lui-même (et un peu par lui-même) et par les autres, voilà grossièrement résumé le sujet de la pièce.
La question de Don Juan, notamment chez Mozart et Da Ponte, c’est la question des femmes : les hommes chez Mozart sont soit des répliques de Don Juan en creux (Leporello), soit un mal aimé un peu perdu qui va dans le mur (Ottavio) soit un benêt qui sans doute portera les cornes toute sa vie, comme le jour de son mariage (Masetto). Les femmes au contraire sont toutes trois passionnantes et ambiguës : Da Ponte avait déjà compris ce qu’Horváth a décidé de faire. Car Horváth prend acte de cette domination théâtrale des femmes pour nous dire : Don Juan, c’est d’abord une question de femme(s).
Ce qu’il ajoute, qui est à mon avis génial, c’est la question de la guerre : elle lui permet non seulement de dépeindre une Allemagne groggie au lendemain de la défaite, retrouvant les plaisirs et la vie, mais s’engouffrant dans un tunnel qui mènera où l’on sait. En montrant les effets de la guerre et de cette guerre là à travers le parcours de Don Juan sur les évolutions sociales, et notamment sur le statut de la femme, restée à l’arrière et ayant assumé l’absence des hommes en les remplaçant, il montre ce qu’elle a gagné en liberté et en autonomie. Inévitablement le retour de l’homme se fait dans un autre contexte. Mais il montre aussi que la femme retombe dans les filets de Dom Juan, malgré qu’elle en ait, et donc que les choses ne sont pas aussi changées qu’on le croit.

Que cet homme emblème soit Don Juan crée un double postulat :
– Don Juan a changé parce qu’il a vécu la guerre, et qu’il n’est plus Don Juan ou du moins se refuse à l’être. La guerre lamine, y compris les grands-seigneurs-méchants-hommes, mais il n’est pas dit qu’il ne soit pas encore Don Juan…
– Les femmes ont changé parce qu’elles ne sont plus des instruments dans ses mains, mais tout en ayant changé, elles le réclament…
Or, la pièce nous montre que tout a changé et que rien n’a changé, elle raconte l’histoire de la renaissance du Don Juanisme et de l’irrésistible montée du désir, et du mécanisme de projection qui replace Dom Juan au centre des mailles du filet.

Mais elle montre aussi que tout a changé parce que cette fois, Don Juan est vraiment devenu homme-objet qui ne peut plus rien contre le cheminement de son destin..
Le dispositif inventé par le metteur en scène (et décorateur) est un espace ouvert, sur lequel il ne cesse de neiger, et au centre un arbre auquel pendent des lettres, vision automnale, hivernale, une vision en tout cas profondément mélancolique dès le départ, mais une vision extraordinairement poétique d’une réalité de l’arrière et des familles restées loin du front, imaginée métaphoriquement par un arbre où pendent les lettres que les femmes vont cueillir. Cela m’a rappelé l’expression de Michelle Perrot appelant les lettres du front « le sang des familles » : l’arbre, avec sa sève, symbole de vie, alimente les familles qui cueillent les lettres comme des fruits : une relation alimentation/nourriture, mais aussi une relation rituelle comme un rite ancien (rites de fertilité, de renaissance naturelle etc..) qui définit la vie passée en guerre à la fois nouvelle, rituelle, et nourricière, et les relations à la fois proches et quotidiennes, mais aussi lointaines et fragiles, des hommes au front et des femmes restées à l’arrière. Une image qui présente d’une manière simple et évidente, d’une stupéfiante poésie et d’une très grande justesse, la manière dont la femme a vécu pendant les années de guerre.
En ce sens, Don Juan revenant de la guerre, c’est évidemment l’homme revenant de la guerre, comme tous ces hommes qui reviennent dans leur famille où des habitudes et des rituels se sont installés qu’ils vont, reprenant leur place, totalement bousculer.
Don Juan est donc à la fois Don Juan et tous les hommes, il devient l’emblème d’un retour qui est aussi malaise, un malaise partagé par tous, et qui bouscule la société.
Kriegenburg va proposer une esthétique assez simple, laissant les personnages remplir l’espace, limité pour chaque scène à des déplacements de praticables, de tissus, de fenêtres, de cloisons légères, qui installent aussi grâce aux éclairages une ambiance à chaque fois différente. Mais où les personnages féminins sont presque interchangeables malgré leur variété : 35 femmes jouées par 9 actrices, selon le conseil donné par Horváth lui même « ces trente-cinq femmes non seulement peuvent, mais doivent êtres interprétées par beaucoup moins de comédiennes, de sorte que presque chaque comédienne a plusieurs rôles à jouer ». Et les rôles ne sont pas personnalisés dans la distribution donnée dans le programme : il y a Don Juan et « Les femmes », même si leurs costumes, d’une très grande élégance et légèreté (Andrea Schraad) donnent à chacune un profil…femmes et variations.

La première image est avec la dernière, la plus puissante de toute la pièce. Elles suffisent à elles deux à alimenter le livre des images les plus merveilleuses du théâtre occidental.
Le rideau de tulle blanc est tendu, et du sol, émergent 18 mains, sorte de renaissance , d’une vie souterraine, qui commencent à bouger, comme réclamant quelque chose : ces mains émergentes se transforment peu à peu en corps qui saisissent le rideau et l’enroulent et s’en enroulent, en un groupe compact et solidaire qui se met à chanter en chœur. Extraordinaire moment où les femmes, aux visages recouverts de céruse, vivent le groupe. On comprend immédiatement que les scènes individuelles ne seront que part de ce collectif, qui commence par la magnifique cueillette collective des lettres, pendues à un arbres comme autant de feuilles d’automne, des lettres des soldats qui vont revenir (ou non) du front.
Immédiatement après, bruits de bottes, d’obus, de guerre et Dom Juan arrive, visage masqué par le masque à gaz et encore casqué, défait par le front, exténué, courant dans tous les sens. Il sera l’homme, le seul homme de la pièce. Il est vrai qu’il se suffit à lui-même. Blessé, il va séjourner à l’hôpital, autre monde de femmes, où les femmes soignent et où les hommes sont blessés, et où il se crée un étrange rapport (qu’Herheim avait aussi traité d’une manière presque voisine dans le second acte de Parsifal à Bayreuth).

Don Juan, c’est Max Simonischek (le fils du très grand acteur allemand Peter Simonischek), 32 ans, voix douce, modulée, épuisée, corps qui porta sans doute bien, un jour, devenu un être ordinaire qui vient de la guerre, sans argent, sans fierté, sans dieu. Que vaut Don Juan dans un monde sans Dieu ?
Max Simonischek réussit grâce à la voix, grâce à la tenue, à donner du personnage une image neutre et sans vrai caractère, une sorte de zombie qui traverserait un monde qui lui devenu étranger. Presqu’un enfant perdu, et ce personnage qui n’a plus rien du « grand seigneur méchant homme » garde malgré lui et malgré sa volonté, sa puissance de séduction, d’abord potentielle, puis réelle, dont il va finir par user à nouveau comme aimanté par son destin destructeur de soi et des autres. Le ton qu’il emploie évite la plupart du temps le relief, le grand style, il reste dans une sorte de conversation presque blanche, et pourtant, le jeu femme-homme se reconstruit peu à peu, et même dès le départ, là où il passe, il laisse, pour parodier Da Ponte une odore di uomo qui réveille le désir féminin.
Pourtant, il va sans cesse être à la recherche de son dernier amour, ou de sa dernière conquête d’avant: avec le souvenir, avec la guerre, avec le retour, il voudrait revenir à cette femme qui l’a abandonnée, comme les autres : elle a fui, elle en est morte deux ans plus tôt

C’est une sorte de jeune Lolita qui va peu à peu le ramener vers lui-même dans son éternité symbolique, une toute jeune fille qui fait du patinage (extraordinaire Elisa Plüss).
Dans ce parcours de Don Juan qui se révèle bientôt une course vers la mort, parce que Don Juan ne peut qu’être porteur de mort. Certaines scènes demeurent fixées dans la mémoire, les scènes avec la jeunes patineuse dont on vient de parler, la scène traitée de manière désopilante de la loge à l’opéra où l’on donne le Don Giovanni de Mozart( !) et comme par hasard le La ci darem la mano, la scène des dames chez le profiteur de l’inflation, qui témoigne de la volonté de Horváth d’inscrire ce Don Juan dans l’histoire, au moment de l’inflation galopante qui fait à la fois des profiteurs et des victimes. Les deux histoires celle de l’Allemagne et celle de Don Juan, vont chacune vers le gouffre et vers l’aporie. Il faudrait aussi souligner le travail époustouflant que Kriegenburg a imposé aux voix, dont la variété va pratiquement de la voix de dessin animé (à la Mickey) à celle de la voix d’opéra, accompagné par une vraie recherche sur les ambiances sonores. On nous montre là quelque chose d’un opéra glacé.
Finalement, Don Juan comprend l’aporie d’un destin auquel il ne peut échapper : apprenant la mort dans un asile d’aliénés de celle qu’il voulait retrouver, qu’il a rendu folle, il s’éloigne dans le froid, seul, sans commandeur, sans enfer, sans flammes.
Au lieu des flammes de l’Enfer, Don Juan va mourir pétrifié par le froid (le troisième acte s’appelle Le bonhomme de neige) : les femmes apportent autour de lui chacune son écot en pains de glace qu’elle vont briser autour de son corps, tels les héros du Crime de l’Orient Express , vision stupéfiante de ces femmes qui à l’aide de piolets brisent cette glace en morceaux, comme si elles brisaient en même temps et leur vie et leur fantasme, en une scène ritualisée d’une force saisissante. Comme toujours, en disparaissant Don Juan laisse femmes désemparés, vies brisées, monde en friche. Le mythe est toujours là, mais sublimé par une de ces images inoubliables que le théâtre sait donner.

Magnifique spectacle, qu’on aimerait revoir. Il serait trop injuste que seules ces 8 représentations rendent justice à ce théâtre et à ces acteurs phénoménaux : autour de Max Simonischek, Sonja Beisswenger, Olivia Grigolli, Sabine Haupt, Traute Hoess, Elisa Plüss, Nele Rosetz, Janina Sachau ? Natali Seelig, Michaela Steiger. Quant au travail d’Andreas Kriegenburg, c’est à la fois son apparente simplicité, sa lenteur, et cette succession de scènes brèves qui chacune réinsèrent Don Juan dans son mythe, mais aussi ces femmes dans leur tissu de contradictions faites de méfiance et d’attirance, de refus et de désir, de volonté de protection et de goût pour le risque et la mort, au milieu d’un monde qui se décompose à coup de millions de milliards de Marks. À travers Don Juan, Horváth montre les mécaniques inéluctables au travail, mécaniques individuelles, sociales, historiques, un peu comme ces énormes rouleaux bien visibles au-dessus du plateau qui versent une sorte de neige éternelle, rouleaux qui distribuent l’ineffable et le presque rien d’un flocon singulier mais qui finit en épaisse couche qui fixe et pétrifie le monde, mais qui sont aussi des rouleaux compresseurs qui écrasent et laminent.
Le monde d’après guerre continue d’être peuplé de somnambules.
[wpsr_facebook]