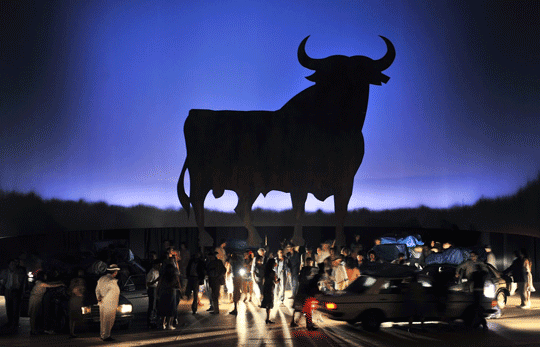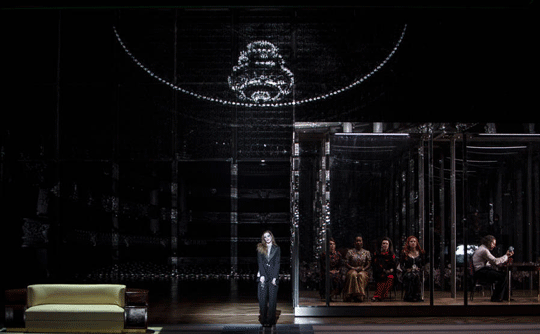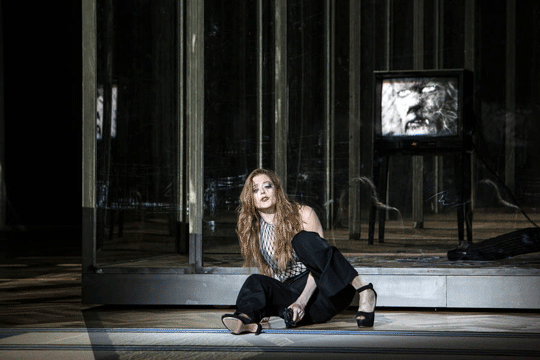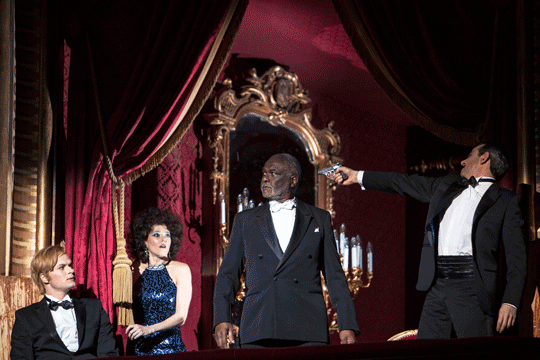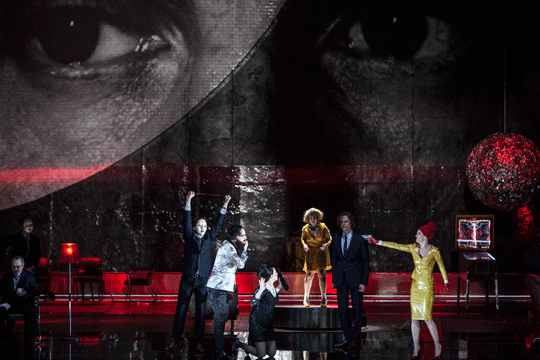Sel, poivre, huiles et vinaigres, et un peu de piment
A tout seigneur tout honneur, l’Opéra National de Paris est l’un des premiers à présenter sa saison, et je vais essayer d’en rendre compte loin après la découverte et les commentaires, en posant d’abord quelques éléments propédeutiques.
Il est de bon ton de critiquer notre première scène lyrique, et je n’y échappe évidemment pas, mais il faut aussi rendre à César ce qui lui appartient. On dit que son budget est énorme : de fait, mais seul l’Opéra de Paris a deux grandes scènes à programmer, le Palais Garnier à lui seul est une maison équivalente en jauge et en organisation à Covent Garden, ou à la Scala. Si on lui ajoute Bastille et ses 2700 spectateurs, c’est une jauge (presque)au quotidien de 4700 spectateurs et deux théâtres complexes que l’Opéra de Paris doit remplir et c’est une double programmation qu’il faut garantir. Le projet d’origine devait faire de Bastille un théâtre de répertoire avec une troupe, et Garnier un théâtre de prestige en stagione. Il y a à Paris une troupe qui est celle du ballet, mais on a renoncé à l’opéra de troupe. Depuis la fin des années soixante, le théâtre de répertoire a été abandonné à Paris, qui rappelons-le avait une troupe fixe jusqu’au seuil de 1970. C’est Rolf Liebermann qui a inauguré le système stagione, en 1973. Discussion infinie, vexata questio que la question du système, mais c’est clair, Bastille a été conçu au départ pour un système d’alternance serrée, de troupe sur le modèle allemand et est devenu une théâtre de stagione avec une vingtaine de production annuelles, soit la moitié environ des théâtres de répertoire comparables.
Le système actuel est hybride :
- Le Palais Garnier pour le ballet, et pour l’opéra baroque et les « petits » Mozart parce que Garnier est plus « intime » dit-on quand en 1974 on critiquait un Cosi fan tutte (Ponnelle) perdu dans un si grand vaisseau, ainsi que certaines créations (on ne remplit pas toujours Bastille avec l’opéra contemporain…).
- L’Opéra-Bastille essentiellement pour l’Opéra et les grands ballets classiques qui vont drainer du public.
C’est un système inauguré par Hugues Gall, qui n’a pas été retouché depuis et qui doit gérer plus de 500 levers de rideau annuellement.
Je ne traite pas du ballet, car je suis incompétent, mais j’ai cru comprendre qu’après le départ de Brigitte Lefèvre il y avait eu quelques soubresauts : le ballet est internationalement le Porte-drapeau de l’Opéra de Paris, très lié à l’histoire et à la tradition séculaire de la maison, sans doute plus que le lyrique, parce que les tribulations de l’Opéra à Paris, la diversité des théâtres, mais aussi un Palais Garnier où peu d’œuvres ont été créées (alors qu’à l’Opéra Comique…) on émaillé une histoire riche, mais qui n’a pas réussi à asseoir une tradition, ou du moins la faire connaître.
L’Opéra-Bastille souffre d’un problème d’identité, d’une architecture efficace sans doute pour les espaces de travail, mais peu inventive et malcommode dans les circulations des espaces publics et les foyers, d’une esthétique aéroportuaire et impersonnelle que personne depuis son ouverture n’a essayé de réchauffer quelque peu. Je sais que cette maison a besoin de rentrées publicitaires, mais tout de même, je trouve singulier de devoir suspendu un grand calicot d’une marque d’automobile dans le foyer, quelques pubs sur des montres ou des parfums, et pas une seule affiche historique, issue des fonds de la bibliothèque de l’Opéra, pas une seule photo de chanteur, pas une seule photo de chef ayant dirigé à Paris. Les espaces de Garnier qui s’y prêteraient tout autant et mieux encore sont tout aussi pauvres. Presque tous les grands théâtres internationaux valorisent leur patrimoine matériel et immatériel dans les espaces publics : Paris n’y pense pas et n’y a jamais pensé. Le présent est sans doute tellement brillant qu’il n’est point besoin d’évoquer le passé.
À Paris on n’affiche pas sa mémoire, on préfère afficher Citroën. Il y a des années que ça dure, et imperturbablement, on continue une politique à mon avis imbécile qui ne favorise pas l’identification du public à un théâtre et qui affiche une identité de garage de luxe, ou d’aéroport comme je l’ai dit plus haut où le spectacle du soir remplace les 747 en attente de passagers.
Garage de luxe c’est un peu l’impression donnée par une programmation riche, pas dépourvue d’idées ou d’offres séduisantes, mais sans ligne sinon celui de l’assaisonnement, sel, poivre, huiles et vinaigres divers sans oublier un peu de piment qui est en quelque sorte la loi du genre pour des institutions comme le Royal Opera House à Londres, ou le MET à New York, ou Paris, qui ont à peu près les mêmes obligations et les mêmes soucis. Une ligne, ce pourrait être une thématique, un moment festivalier, un metteur en sècne résident. On voit bien que Stéphane Lissner essaie de proposer des opéras du grand répertoire français: Samson et Dalila, la Damnation de Faust, Benvenuto Cellini, Don Carlos, et les Huguenots prévus je crois la saison prochaine, pourquoi ne pas valoriser l’entreprise, de manière qu’elle soit vraiment identifiée. Des axes de programmation bien identifiées construiraient mieux un public.
En 2017-2018, l’Opéra de Paris propose dix nouvelles productions, ce qui est un nombre très respectable, reconnaissons-le, même si elles ne sont pas toutes nouvelles dans la réalité :
Octobre/novembre :
- Don Carlos de Verdi, dans sa version française originale de 1867, mais sans le ballet. La question de l’édition, de la version est une question sans solution pour l’œuvre de Verdi, la question du ballet si liée à la tradition parisienne est en revanche discutable parce que Don Carlos a été créé en 1867 avec le ballet, même si Verdi n’avait pas prévu le ballet au départ.
Soyons généreux, si la version est vraiment complète et si l’on entend des musiques jamais entendues depuis sur la scène de l’Opéra de Paris, un grand pas aura été fait. Et reconnaissons que tout est fait pour attirer la curiosité et le public, - la présence de Jonas Kaufmann en Don Carlos, et en français (on connaît bien son Don Carlo en italien).
- celle de Sonia Yoncheva en Elisabeth, même si il y aurait peut-être des voix plus conforme au rôle, est un gage complémentaire.
Une distribution B avec Pavel Černoch et Hibla Gerzmava en novembre
- Ildar Abdrazakov comme Philippe II, à entendre.
- Un jeune inquisiteur, Dmitry Belosselskiy
- Un Rodrigue d’exception, Ludovic Tézier, qui est sans doute avec Kaufmann le grand atout de cette distribution.
- Eboli sera en distribution A (jusqu’au 28 octobre) Elina Garança et en B Elkaterina Gubanova (du 31 oct au 11 novembre), du luxe
- Notons Eve-Maud Hubeaux, en Thibault, qui prépare Eboli pour Lyon, et qui sera sans doute une possible couverture.
La mise en scène assurée par Krzysztof Warlikowski avec les décors de Małgorzata Szczęśniak ne manquera pas de susciter quelques remous dans le public si sensible de Paris, et la direction de Philippe Jordan, obligée eu égard à son statut de directeur musical pour une première si importante pour la maison fera l’unanimité, même s’il ne m’a jamais convaincu dans Verdi.
C’est un must, à ne pas manquer, une grande date pour Paris dont il faut rappeler quand même que la version française avait aussi été programmée par Massimo Bogianckino et proposée en septembre 1986 avec Georges Prêtre en fosse, sans compter celle du Châtelet (Lissner, déjà) avec Pappano en fosse en 1996. Mais après 31 ans, Don Carlos, une oeuvre écrite et faite pour Paris, que beaucoup de grands chefs italiens considèrent meilleure que sa traduction italienne, retourne au bercail, et c’est un événement considérable.
En novembre, deux autres nouvelles productions,
- La Ronde de Philippe Boesmans, avec les forces de l’académie de l’Opéra de Paris, et l’orchestre-atelier Ostinato, orchestre de jeunes musiciens dans une mise en scène de Christiane Lutz et une direction musicale de Jean Duroyer. Le spectacle sera présenté dans l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille pour 6 soirées entre le 2 et le 11 novembre 2017.
- De la maison des morts, de Leoš Janáček du 18 au 29 novembre 2017 pour cinq représentations .
Voilà l’exemple de la fausse nouvelle production, puisqu’il s’agit de la production d’Aix en Provence de Patrice Chéreau et Pierre Boulez présentée au cours du festival 2007; la production a fait le tour de grands théâtres, le spectacle est magnifiquement distribué (Willard White, Peter Mattei, Stefan Margita, Peter Hoare et Heinz Zednik entre autres) et dirigé par Esa Pekka Salonen, autant dire une garantie..
La mise en scène de Patrice Chéreau est reprise par ses assistants dans les décors de Richard Peduzzi et avec les costumes de Caroline de Vivaise. - Un spectacle à voir, pour garder la mémoire vive d’un des grands moments lyriques des quinze dernières années qu’il faut dédier à la mémoire de Patrice Chéreau et Pierre Boulez, couple fondateur de l’opéra de la fin du XXème siècle.
En décembre 2017, pendant tout le mois, une nouvelle production qui va faire couler de l’encre et peut être des larmes :
- La Bohème, de Puccini, dans la mise en scène de Claus Guth.
La Bohème est l’exemple même d’opéra tiroir-caisse, et peu de maisons changent fréquemment de production, tant l’une est la copie de l’autre. C’est même le type d’œuvre où on laisse une mise en scène classique vieillir silencieusement, c’est le cas à Vienne et à la Scala, avec celle de Zeffirelli depuis plus de cinquante ans.
Stéphane Lissner reproduit l’opération Rigoletto, confiée à Claus Guth, appelant ainsi pour des grands standards populaire un metteur en scène contesté et cérébral, après la production du très tranquille Jonathan Miller qui a duré quand même une vingtaine d’années. Si c’est une volonté affichée pourquoi ne pas alors confier à Guth quelques autres standards, pour faire série et donner une couleur.
Dans les chanteurs, Sonia Yoncheva, plus Mimi qu’Elisabeth à mon avis, et le jeune brésilien Atalla Ayan, bon ténor au timbre clair qui devrait convenir à Rodolfo, ils alterneront dans les deux rôles avec l’excellente Nicole Car, et Benjamin Bernheim, non moins excellent, le reste de la distribution étant très honorable (Artur Ruciński, Alessio Arduini, et Aida Garifullina en Musetta).
En ce mois de Noël et donc de haute fréquentation lyrique, un titre populaire sur 12 représentations avec au pupitre pour 7 représentations Gustavo Dudamel, qui est assez familier du titre dirigé notamment à Berlin et à la Scala et pour les 5 autres Manuel López-Gómez .
A voir et à entendre, évidemment. Mais pas un must.
En janvier 2018,
- Jephta de Haendel au Palais Garnier pour 8 représentations dans une mise en scène ( encore!) de Claus Guth (et décors de Katrin Lea Tag), ainsi ceux qui auront hurlé en décembre pour Bohème pourront s’y remettre en janvier, à moins qu’ils ne soient séduits par l’un des metteurs en scène les plus fins et les plus réfléchis du moment.
L’œuvre, dirigée par William Christie, sera interprétée par l’orchestre et les chœurs des Arts Florissants, et la production est coproduite par le De Nationale Opera d’Amsterdam.
Parmi les chanteurs, de grands noms (Ian Bostridge, Marie-Nicole Lemieux) et des noms qui commencent une belle carrière (Philippe Sly, Valer Sabadus). Pour les amoureux de ce répertoire et pour les autres c’est immanquable.
En Janvier février, au Palais Garnier, une création française de Kaija Saariaho, co-commandée par l’Opéra de Paris et plusieurs autres théâtres européens et américains (Toronto, Amsterdam, Madrid, Helsinki), sur un livret d’Ezra Pound et Ernest Fenollosa
- Only the sounds remains, d’après deux pièces de théâtre Nô, pour 6 représentations entre le 23 janvier et le 7 février, dans une mise en scène de Peter Sellars dont on imagine ce qu’il peut en faire d’après ses dernières productions, et sous la direction d’Ernest Martínez, avec entre autres Philippe Jaroussky . Les éléments sont réunis pour un bon succès, encore faut-il savoir quand sera envisagée une reprise, c’est bien la question des créations.
En mars-avril, encore une « fausse » nouvelle production,
- Benvenuto Cellini, d’Hector Berlioz, deuxième production de l’œuvre à l’Opéra-Bastille qui l’avait déjà présentée en 1993 dans une mise en scène de Denis Krief.
Fausse nouvelle production (9 représentations du 20 mars au 14 avril) parce qu’on a vu ce travail (vraiment remarquable) de Terry Gilliam l’ex Monty Python, et Leah Hausman, à Londres (ENO), à Amsterdam, à Rome, et Barcelone.
Il faut y aller c’est une production somptueuse, désopilante, inspirée du dessin animé, et qui sera notamment chantée par John Osborn, devenu référence dans le rôle, et Pretty Yende, qui a séduit Paris dans Lucia di Lammermoor, mais aussi Michèle Losier, Maurizio Muraro etc…qui sera dirigée par Philippe Jordan.
Immanquable si vous ne connaissez pas, ou si vous considérez à tort que l’œuvre est injouable. Vous en redemanderez. J’en ai rendu compte dans ce Blog (Amsterdam) .
En avril-mai une vraie nouvelle production, du 27 avril au 23 mai pour 8 représentations
- Parsifal, de Richard Wagner. On se souvient de l’accueil houleux de la précédente production pourtant passionnante de Krzysztof Warlikowski, huée à chaque fois au troisième acte à cause de l’extrait de Allemagne année zéro (1) de Rossellini. Pour plaire à une poignée d’imbéciles, et pour affirmer une nouvelle ligne dont on a vu les résultats, le successeur de Gérard Mortier, Nicolas Joel fit détruire la production. Stéphane Lissner se devait de proposer une nouvelle production du chef d’œuvre de Wagner, et l’a confiée à Richard Jones, un choix tiède qui devrait éviter les hurlements des effarouchés – et encore. Musicalement, avec Philippe Jordan au pupitre, et Andreas Schager, Anja Kampe, Peter Mattei, Günther Groissböck entre autres sur le plateau, ce devrait être un beau moment wagnérien. Là aussi difficilement manquable : un Parsifal quel qu’il soit réunit un public nombreux.
(1) merci au lecteur qui m’avait signalé mon erreur sur le titre du film
En juin-juillet, c’est au tour du répertoire russe, plutôt bien servi à Paris en général pour :
- Boris Godunov, de Moussorgski, dans la version originale sans acte polonais, pour 12 représentations du 7 juin au 12 juillet.
Pour l’occasion, Stéphane Lissner appelle Ivo van Hove (enfin à Paris !) comme metteur en scène et le remarquable Vladimir Jurowski en fosse (qui alternera pour 5 représentations avec Damian Iorio). La distribution réunit la fleur des chanteurs russophones, bien connus désormais, avec Ildar Abdrazakov, Boris après avoir été Philippe II la même saison, Maxim Paster (Chuiski) qu’on a vu dans la Fille de neige cette saison (en Tsar Berendei), Dmitry Golovin, Ain Anger, Elena Manistina etc…
Sans aucun doute une production intéressante, et de bon niveau, avec la curiosité vive devant la mise en scène sans doute très politique d’Ivo van Hove (décors et lumières de Jan Versweyveld).
Dernière nouvelle production, estivale de la saison, au Palais Garnier, entre le 9 juin et le 12 juillet pour 12 représentations :
- Don Pasquale, de Donizetti, dans une mise en scène sans nul doute échevelée de Damiano Michieletto et des décors de Paolo Fantin son compère, dirigée par Evelino Pidò, très populaire en France. Spectacle estival et (presque) touristique, très bien distribué, avec Michele Pertusi (Don Pasquale), Nadine Sierra (Norina) et Lawrence Brownlee (Ernesto), mais aussi avec l’excellent Florian Sempey. Le tout en coproduction avec le Royal Opera House Covent Garden de Londres. Si on aime cette œuvre, on volera, si on adore Damiano Michieletto, le vol sera supersonique.
Dans ces dix nouvelles productions, on compte deux opéras italiens, deux grands opéras français, qui manquaient au répertoire, deux opéras contemporains, un opéra russe, un grand opéra allemand, un opéra tchèque et une œuvre baroque… sel, poivre, huiles et vinaigres divers sans oublier un peu de piment : l’Opéra de Paris en sauce diversifiée, et bien évidemment obligatoire étant donné son rôle de scène de référence. Avec des distributions et des chefs solides, et des metteurs en scènes intéressants ; pour les Wanderer qui écument les scènes européennes, il y a peu de vraies nouveautés, pour les mélomanes parisiens qui vont régulièrement à l’opéra, la saison offre de belles perspectives.
Du côté des reprises, 11 productions et 13 titres, là aussi diversifiés : une opérette (La veuve joyeuse), deux Mozart (Cosi fan tutte, La clemenza di Tito), quatre Verdi (Falstaff , Un ballo in maschera, La Traviata et Il Trovatore), un opéra français (Pelléas et Mélisande) deux soirées mixtes, l’une Hongrie/France (le château de Barbe Bleue/La voix humaine) l’autre France/Italie (L’heure espagnole/Gianni Schicchi) et un Rossini (Le barbier de Séville de Damiano Michieletto, tiroir caisse qui compense le même mois –janvier/février- une création).
Parmi les moments qui attireront les foules, trois représentations de Traviata avec Anna Netrebko, Placido Domingo et le jeune Rame Lahaj (21, 25, 28 février parmi 8 distribuées sur tout le mois avec Marina Rebeca et Charles Castronovo), le tout dirigé par Dan Ettinger. Plus classique le Trovatore de répertoire de fin de saison (jusqu’au 20 juillet) avec au moins deux dames passionnantes (Anita Rashvelishvili en Azucena et Sondra Radvanovski en Leonora) et trois ténors en alternance, Marcelo Alvarez (bof), Roberto Alagna (ah oui ! mais seulement pour deux soirs et sans les deux dames citées plus haut) et Yusif Eyvazov (ça sert d’être à la ville Monsieur Netrebko). Plus intéressant le Ballo in maschera avec les deux Amelia du moment Anja Harteros et Sondra Radvanovski, Simone Piazzola qui est un baryton intéressant et l’inévitable Marcelo Alvarez, au timbre encore magnifique, mais tellement routinier (en alternance avec Piero Pretti) , le tout dirigé par Bertrand de Billy et dans une mise en scène de Gilbert Deflo, sans grand intérêt.
Quant au Falstaff, il sera dirigé par Fabio Luisi, et c’est sans doute la reprise verdienne la plus intéressante des quatre, en tous cas la plus homogène, avec Bryn Terfel, Franco Vassallo Aleksandra Kurzak, Varduhi Abrahamyan (un peu jeune pour Quickly ?), Julie Fuchs en Nanetta et le vétéran Graham Clark en Cajus (7 représentations en octobre novembre) .
Retenons de La veuve joyeuse, en ouverture de saison, Véronique Gens, Thomas Hampson, et Alexandre Duhamel, Cosi fan tutte de Anna Teresa de Keerrsmaker qui n’avait pas trop convaincu, dont il faut retenir pour les 14 représentations la direction de Philippe Jordan pour 10 représentations (jusqu’au 8 octobre), et pour le quatuor Jacquelyn Wagner, Michèle Losier, Philippe Sly et Cyrille Dubois, la belle distribution du Pelléas de début de saison, dirigé par Philippe Jordan (5 représentations) avec Etienne Dupuis, Luca Pisaroni, Elena Tsallagova, mais aussi Anna Larsson et Franz Josef Selig.
La Clemenza di Tito, mise en scène Willy Decker et dirigée par Dan Ettinger, réunit une double distribution intéressante aussi Ramon Vargas/Michael Spyres, Amanda Majeski/Aleksandra Kurzak ou Stéphanie d’Oustrac/Marianne Crebassa pour 15 représentations (!) en novembre-décembre.
Le dyptique Bartok/Poulenc Le château de Barbe bleue/La voix humaine mise en scène de Krzysztof Warlikowski méritera le déplacement, pour revoir Hannigan, et bien entendu pour Ingo Metzmacher l’un des grands chefs du moment. L’autre dyptique, Ravel/Puccini (Heure Espagnole/Schicchi) est d’abord intéressant pour le chef Maxime Pascal, l’un des jeunes chefs français qui attirnt l’attention, et pour des chanteurs de la nouvelle génération dans la distribution des deux œuvres, Clémentine Margaine, Stanislas de Barbeyrac, Alessio Arduini, Elsa Dreisig, entre autres, sans oublier Vittorio Grigolo qui ténorisera dans Rinuccio.
Au total, une saison solide, équilibrée, diverse qui en donne pour tous les goûts, sans doute moins pimentée qu’attendu ou qu’espéré, mais qui attirera du public : 21 productions, avec cinq Verdi, deux Puccini, un Rossini et un Donizetti, deux Mozart, un Haendel, un Wagner, un Moussorgski, un Ravel, un Berlioz, un Debussy, un Lehar, un Bartók, avec aussi Saariaho et Boesmans, c’est un peu saupoudré, mais cela garde quand même de l’allure avec des distributions dignes et une dose de stars et de chefs intéressants. Pour les mises en scène, il faudrait peut-être se mettre à chercher des noms non encore vus à Paris encore, comme David Bösch ou David Hermann, Barrie Kosky ou Philipp Stölzl voire retrouver le chemin d’un Marthaler ou interpeller un Vincent Macaigne. Les autres scènes parisiennes complèteront. [wpsr_facebook]