
Voir Pelléas et Mélisande au milieu d’une série de Tristan une Isolde est riche d’enseignements pour le mélomane qui peut tisser des fils, créer des ponts, voir ce qui lie les deux œuvres et ce qui les différencie. Si j’ai parlé de doxa à propos de Tristan, il y a une doxa sur Pelléas de la même manière, dans la manière de dire les mots de Maeterlinck, dans la manière de diriger : il y a une idée de Pelléas, dans le dire, dans l’évocatoire, dans le rêve, et l’idée d’une identité française irréductible. Quant à moi, incurable wagnérien, je n’ai cessé de penser à Wagner en entendant ce Pelléas, les citations presque littérales de Parsifal (premier intermède), les références si nettes au duo de Tristan (final de l’acte 3), les lointains échos de Lohengrin. Wagner était bien une obsession française à la fin du XIXème.
Il y a aussi une doxa dans les mises en scènes, mais, à la différence de Tristan und Isolde, Pelléas, au nom du mystère, au nom du symbolisme , au nom d’une approche très éthérée de la musique, n’a quasiment droit qu’à un type d’approche. Déjà le travail très poétique et fouillé de Christophe Honoré à Lyon la saison dernière dérangeait le bel ordonnancement de certitudes scéniques que plus d’un siècle de tradition a fossilisées en France, mais après cette production de Dmitri Tcherniakov à Zürich, qui eût déchainé les passions si elle avait été proposée sur une scène parisienne, il est clair que la réflexion sur l’approche de l’œuvre s’est quand même un peu plus approfondie et surtout ouvre d’autres perspectives riches de potentialités. On connaît le travail de Dmitri Tcherniakov, sur les univers familiaux clos et leurs non-dits, sur la pesanteur bourgeoise, , on connaît aussi son faux réalisme, qui est lui-même un symbolisme, une sorte de concrétude trompeuse qui fit ulcérer le public de Milan à la vue d’Alfredo épluchant des patates. Dans Macbeth à Paris, dans Lulu ou Les dialogues des Carmélites à Munich, il échappait à la clôture bourgeoise pour créer une vision très synthétique d’une situation : dans Pelléas à Zürich, il créé un univers étouffant dans un espace blanc et luxueux, pur et clair, ouvert sur une nature luxuriante, et crée une Mélisande comme élément perturbateur d’une famille déjà bousculée mais qui cache ses plaies sous un bel ordonnancement lisse, représenté par l’espace très contemporain où vont évoluer les personnages : un espace qui se fracture par des rideaux de tulle translucides, laissant voir sans voir, et des cloisons qui se plient et déplient, d’où on entend sans voir, et des baies vitrées d’où on voit sans entendre. « Pelléas ton univers impitoyable » comme on le chantait naguère à propos du feuilleton Dallas. Univers bien plutôt insupportable ici. D’autant plus qu’il est chic et bien propre sur soi. Le malaise évident dans l’œuvre de Debussy mais dilué dans un Moyen âge légendaire et rêvé, « crève l’écran » dans cet univers proche de nous d’une famille d’aujourd’hui qui la plupart du temps se tait, en proie à des gestes rituels (boire de l’eau, une activité obsessionnelle tout au long de l’opéra) attablée en silence pendant que les êtres se déchirent.

Dans cette famille dominée par un Arkel qui ressemble au «Commendatore » de Don Giovanni, dictatorial et en même temps bousculé par le désir, Pelléas survient en bousculant les codes, tandis qu’Yniold parcourt les scènes en jouant, déguisé en joueur de football américain, en ourson, illustrant un malaise qui va en faire un double presque muet de Mélisande et que Geneviève est préposée à gérer la maladie du père de Pelléas. Dans cet univers tendu et silencieux du prélude, Golaud survient en ramenant une petite noiraude, vaguement gothique, qu’il présente rapidement à la famille et avec qui il entame une analyse, hors de son cabinet, aucoeur de la famille. C’est un cas clinique (ça, tout auditeur ou lecteur de Pelléas et Mélisande s’en doute) et la psychanalyse se déroule, sous l’œil de caméras qu’Yniold regarde sur l’écran plat accroché au mur, pendant que Mélisande est étendue sur des divans qui forment le premier plan du grand salon-salle à manger, ouvrant sur une forêt, qui sera le seul décor de la soirée. Cette psychanalyse de Mélisande va tourner à la tragédie quand Golaud va tomber amoureux de sa patiente. Un transfert en quelque sorte, mais dans le mauvais sens.
C’est une première vision, mais évidemment, et là se situe toute l’ambiguïté, rien ne nous dit que ce que nous voyons est aussi simple, nous aurions une transposition-transfert de la situation effective du drame de Maeterlinck, dans la famille d’un psychanalyste.
Mais rien ne nous dit que ce que nous voyons ne soit pas non plus un effet de « montées d’images » de Mélisande et que ce qui est vu ne soit pas une sorte de rêve, où elle s’inventerait dans le cadre même de sa psychanalyse, l’histoire même que le spectateur regarde. Vrai, faux, réel, rêvé, image mentale ou réalité : toute la difficulté est là pour le spectateur, et aussi toute la stimulation intellectuelle autour d’une mise en scène qui est ou bien représentation d’une psychanalyse qui tourne mal, ou une succession de signes cliniques internes à la psychè de Mélisande, voire une réalité perturbatrice d’une famille faussement ordonnée, où la présence de Mélisande devient un révélateur. Le spectateur navigue entre ces pôles, et il n’est pas mauvais qu’il navigue. Rien ne dit qu’une mise en scène doive forcément nous donner une réponse, elle peut être une glose de plus sur des questions qui agitent la critique littéraire ou musicale depuis plus d’un siècle. Et je trouve cette ambiguïté stimulante.
Il reste que dans ce cadre général, une fois de plus, les qualités de Tcherniakov apparaissent aveuglantes ; son travail est millimétré, avec une direction d’acteurs époustouflante : il arrive à obtenir des gestes, des mouvements d’une vérité stupéfiante, qui met même mal à l’aise quelquefois par sa dureté et sa violence. Le Golaud qu’il peint va beaucoup plus loin dans la violence et la dureté, dans la jalousie et la souffrance qu’aucun Golaud vu jusqu’ici sur une scène : il agresse physiquement Mélisande, la jette, la bouscule : il y a une scène de fauteuil à bascule où elle est projetée d’un bout de la scène à l’autre qui est bouleversante, alors que la jeune femme apparaît au départ « petit oiseau blessé » ne pas supporter qu’on la touche ou même qu’on l’effleure, une sorte de sauvagerie silencieuse et de peur structurelle de l’autre qui d’emblée étonne et bouscule. Et le Golaud de Kyle Ketelsen est formidable de vérité et de présence.

Mais le caractère de la mise en scène est d’être aussi distanciée et ironique, on entend souvent la salle secouée de petites rires, à certains moments : quand Arkel demande à Mélisande de lui donner un baiser en une scène très ambiguë (ou plutôt sans ambiguïté) et que survient Golaud, surprenant son père en une position peu équivoque, il y a un côté « ciel mon mari » qui fait rire bien des spectateurs.

Tcherniakov n’évite pas d’affronter les situations vaudevillesques et n’en fait pas un écueil, mais une facette supplémentaire du kaléidoscope, une image supplémentaire de la complexité, de même quand Yniold apparaît comme un double de Mélisande, ou même un double de son père Golaud et qu’il entame la psychanalyse (avec crayon et carnet) du père de Pelléas à qui il fait faire les gestes même de Mélisande, ou qu’il joue avec la fameuse bague perdue que Pelléas a en réalité ramassée et mise en poche lors de la scène de la fontaine.

L’amour de Pelléas lui même est-il amour réel ou projection de Mélisande ? Le doute est permis, notamment dans la manière dont Pelléas annonce son départ et disparaît, ou fuit, sans qu’on sache si Golaud l’a tué, comme si il fuyait lui aussi la famille, l’ambiance et même Mélisande. Quant à la scène finale, elle est elle aussi à la limite du supportable par la violence de Golaud, dans une scène qui rappelle, je l’ai d’ailleurs déjà signalé ailleurs, la scène de la mort du Prince de Clèves dans le roman de Madame de la Fayette où il accable sa femme de très violents reproches, et notamment de lui avoir dit la vérité, comme Mélisande la profère quand Golaud la questionne.

Il s’agit donc d’un travail fort, où le « mystère » de Mélisande est lu sous plusieurs angles, sous un prisme multiface qui met le spectateur quelquefois en peine, d’autres fois en malaise, mais qui ne laisse jamais indifférent. Aucune provocation, aucune exagération mais les attendus et les résultats du drame, sans que le drame ne soit effacé, mais aussi tout en effaçant quelquefois les conditions du drame et l’étendant à la famille étouffée par un Arkel dominant, même si les scènes finales me sont apparues moins finement travaillées que les trois premiers actes. On est aussi bien dans un drame de la jalousie vériste, une sorte de Tabarro debussyste, mais aussi dans Tristan, et par ricochet ou par reflet, toujours aussi dans Maeterlinck.
Dans un tel contexte, peut-on interpréter un Debussy « français » traditionnel, à la Désormières ? Comment la musique peut-elle entrer dans le rythme de cette mise en scène, qui isole les scènes en faisant le noir entre chaque tableau, en signalant les actes de manière précise par une projection sur le cadre de scène, comme si on était dans un parcours inexorable où chaque tableau est une station, soulignant aussi d’une manière pour moi neuve comment Maeterlinck et Debussy font du « Stationendrama» expressionniste, qui avance inexorablement vers une fin tragique. Cinq actes d’une tragédie, dans la tradition d’un XVIIème siècle bien français, mais plus des étapes scandées par les 15 tableaux, autant d’étapes d’une Passion qui dans ce travail est celle de Golaud.
Expressionniste : le mot est lâché et il y a quelque chose de cela aussi dans la belle direction musicale d’Alain Altinoglu.

En entendant la manière dont Altinoglu prend l’œuvre à revers, tout en lui donnant une couleur dramatique inconnue, j’ai pensé d’emblée « vérisme », mais un vérisme mâtiné de Debussy, un « vérisme » à la Zandonai. En approfondissant le propos et notamment par le travail qu’il suppose avec la mise en scène (Altiniglu et Tcherniakov viennent de travailler ensemble à Paris sur Iolanta et Casse-Noisette) car une telle mise en scène demande de la part du chef une adhésion, ne serait ce que pour le rythme, ou pour le tempo scénique : c’est une direction forte, énergique, dramatique et contrastée, qui tire vers un univers à la Zemlinski, ou à l’Hindemith de Sancta Susanna. Je crains la réaction du debussyste AOC, mais je trouve qu’Altinoglu, tout en proposant une lecture précise, très en place, même sans les raffinements de certaines lectures de cette partition en forme de tonneau des danaïdes, réussit à donner une couleur d’une violence et d’une crudité inhabituelles, quelquefois même un peu trop forte en volume, mais dans la salle de Zürich, douée d’une vraie proximité entre la scène et la salle, c’est souvent le cas. Oui j’avais tout de suite pensé « Puccini », mais c’est peut-être encore trop sage, et je pense qu’il faut faire jouer les systèmes d’écho en allant plus loin. Nous avons là une direction musicale inhabituelle du drame de Debussy, qu’on aurait accusé sous une baguette non française, de se tromper de répertoire. Mais Altinoglu est trop fin pour donner corps à un tel reproche. Il n’y pas de contresens, il y a adhésion à une vision, au nom de la cohérence fosse-plateau, et au nom d’un travail sans conteste prodigieusement intelligent. Avec un tel metteur en scène et pour une vision aussi iconoclaste et audacieuse, Altinoglu en vrai chef d’opéra a embrassé des voies là aussi inhabituelles et neuves : qu’il en soit remercié. Je serais curieux d’entendre quel Debussy il proposera à Vienne la saison prochaine, avec un autre metteur en scène et surtout un autre orchestre qui a épousé les raffinements debussystes avec Abbado il y a 27 ans…Il y a violence, relief, tension, en somme tous les ingrédients fréquents dans les opéras des trente premières années du XXème siècle.
Et l’ensemble de cette vision a trouvé dans cette distribution très inhabituelle (il n’y a pas un seul français) un ensemble d’artistes exceptionnels qui proposent un des Pelléas les plus maîtrisés et les plus justes de ces dernières années. Une distribution en tous points convaincantes, à commencer par la langue, si importante dans Pelléas. Tous ne sont pas au même niveau d’expression française, mais tous sont justes et expressifs et l’essentiel du plateau débutait dans l’œuvre, sauf Corinne Winters, Mélisande et le Pelléas de Jacques Imbrailo , jeunes artistes, qui sont chacun déchirants. Le Pelléas de Jacques Imbrailo n’a pas les raffinements d’autres, y compris de Paolo Fanale avec Gatti à Florence, ni ceux de Bernard Richter à Lyon, mais il a de la vaillance, il a de la présence, il a de l’émotion…et quand même quelques problèmes avec les nasales. C’est une jolie prestation qui n’a rien de vraiment problématique et qui donne à Pelléas un aspect en même temps adolescent, mais sur le chemin de la maturité, qui assume sa jeunesse en tous cas et son malaise, au contraire d’un Golaud plus mûr, aux cheveux grisonnants, à l’allure de quadragénaire en crise.

Il en est de même pour Corinne Winters, à la diction correcte sinon exemplaire, qui compose un personnage très expressif et lui aussi tout particulièrement émouvant, son jeu colle merveilleusement au personnage voulu par Tcherniakov et au texte de Maeterlinck, c’est une vraie découverte et une vraie performance scénique, même si vocalement elle ne domine pas complètement le rôle.
Yvonne Naef en Geneviève est tout simplement anthologique, une voix d’une incroyable présence, une diction exemplaire, et une humanité dans le jeu qui laisse rêveur, d’un personnage en général assez effacé elle fait une présence, une présence telle qu’à chacune de ses apparitions, nombreuses dans cette mise en scène alors que le personnage ne chante qu’au début de l’opéra, on a l’impression qu’elle va intervenir. C’est prodigieux de vérité et jamais lecture de lettre de fut plus profonde, plus sentie. Geneviève par antonomasie.
Même impression pour l’Arkel de Brindley Sherratt : à la présence physique et vocale impressionnante. Un Arkel lui aussi très puissant, doué d’une autorité scénique incroyable et d’une voix d’une profondeur et d’une justesse étonnantes. J’avais entendu Ghiaurov avec Abbado mais autant la voix était une légende, autant la prononciation française restait très problématique ; ici la voix est magnifique et le français parfait. Il répond parfaitement à la Geneviève de Naef : un couple exceptionnel, incroyable même parce que totalement inattendu d’une présence pesante et forte, qu’elle soit muette ou sonore..

Inattendu aussi le petit Yniold . Le choix de leur faire jouer et chanter par un enfant et pas comme souvent par une chanteuse travestie est évidemment à la fois un choix de mise en scène et un choix musical. Il faut évidemment avoir à disposition l’enfant qui pourra assumer un rôle qui dans cette mise en scène est long (puisqu’on le voit tout au long de l’œuvre), et qui pourra chanter en français. L’opéra de Zürich est allé droit au but et a affiché en alternance deux jeunes du très fameux Tölzer Knabenchor (ceux qui traditionnellement chantent notamment die drei Kinder de Zauberflöte. Ce soir c’était Damien Göritz, magnifique de vérité et de présence, dans ses différentes apparitions où il passait dans la pièce ou dans le parc derrière la baie vitrée, regardant l’intérieur, présence muette étrange et quelquefois insupportable tellement elle crée le malaise. Quand il se met à chanter (notamment au 4ème acte), il est très émouvant et juste, comme un double de Mélisande, dans un univers ennuyeux et pesant, tragique et violent.
Le docteur épisodique de Charles Dekeyser, membre de la troupe, n’appelle pas non plus de remarques désobligeantes, tant l’ensemble de cette distribution affiche un niveau plus qu’enviable et par certains côtés exceptionnel.
C’est bien le cas du Golaud de Kyle Ketelsen, un bon chanteur vu notamment à Aix , dans Don Giovanni (Mise en scène Tcherniakov) et dans le Figaro de Nozze di Figaro dans la mise en scène de Richard Brunel. Bon chanteur, certes, mais pouvait-on imaginer de voir sans l’ombre d’un doute le plus beau, le plus tendu, les plus intense, le plus violent des Golaud, avec un français impeccable à tous points de vue, et avec un jeu d’un confondant naturel. Époustouflant, il occupe la scène avec une présence inouïe, et diffuse en même temps une émotion incroyable dans un jeu d’attirance (l’homme qui souffre) et de rejet (l’homme qui doute, qui pressure, d’une rare violence) ; c’est totalement étourdissant. Jamais je n’ai vu en scène un Golaud aussi bouleversant et aussi engagé. Pour un tel Golaud, la production vaut le voyage, dans une mise en scène qu’il épouse et qu’il défend avec une vérité et une dureté incroyables.

Ainsi donc c’est un Pelléas inhabituel qui est présenté à Zürich, un Pelléas et Mélisande aux antipodes de la tradition, où l’équipe musicale joue le jeu de cette hyper dramatisation et de cette tension à la limite du supportable. Le contexte psychanalytique clôt le dernier tableau où Yniold allume l’écran plat avec la télécommande, pour voir la caméra qui filme les séances de psy de Mélisande, dont en quelque sorte nous, derrière le quatrième mur, nous sommes aussi les spectateurs voyeurs.
On sort de ce spectacle convaincu une fois de plus que Dmitri Tcherniakov est l’un des plus grands metteurs en scènes de la scène d’aujourd’hui, avec une direction d’acteurs inouïe dans sa précision et son naturel, même s’il poursuit un règlement de compte personnel contre les univers (aux ambiances diverses) des familles bourgeoises dont il égrène les chapitres; mais on sort aussi frappé par un Pelléas musicalement inhabituel : à l’audace du théâtre correspond l’audace de la musique, orchestrée par un Altinoglu inventif et courageux : il n’est pas sûr que son travail eût été accueilli avec compréhension en France où l’on est souvent si sourcilleux sur la « tradition » qui est d’ailleurs plus pour cette œuvre un combiné de l’idée qu’on en a , des enregistrements considérés comme fondateurs (Desormières) et des images symbolistes qui hantent les anthologies, à la Gustave Moreau. On est passé avec cette production de Gustave Moreau à un univers lumineux à la Frank Lloyd Wright, le célèbre architecte américain, meublé par les dernières trouvailles d’un design d’aujourd’hui, sous le rythme des jeux subtils des lumières de Gleb Filshtinsky qui accompagnent le drame, changeant la vision des espaces, les rendant oppressants ou inquiétants, ou rassurants tour à tour, tout comme la vision de la forêt extérieure, qui commence à l’été et finit en hiver, en passant progressivement par l’automne d’un déplaisir grandissant. Tout nous propose un parcours, un parcours dans des méandres dramaturgiques et psychologiques, autant d’images psychanalytiques aussi dont on est bien incapable de saisir dans les filets de l’imaginaire, que vous croyez saisir et qui vous échappent comme des anguilles : mais n’est-ce pas l’identité même de Pelléas et Mélisande que ce mystère-là ? Dans mon parcours personnel autour de cette œuvre, cette production fera sans aucun doute date.[wpsr_facebook]






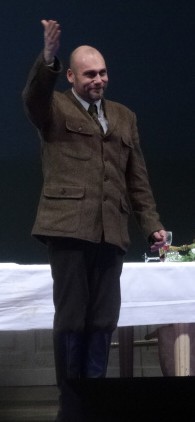

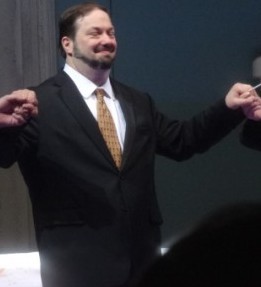


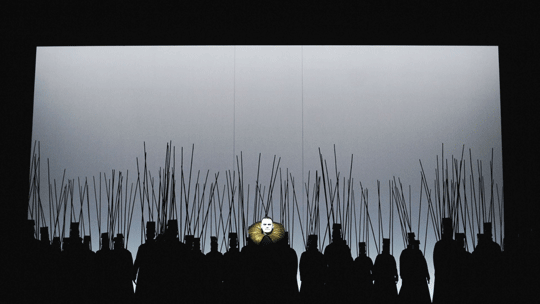
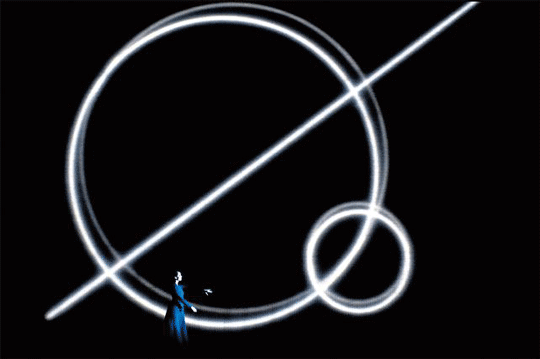



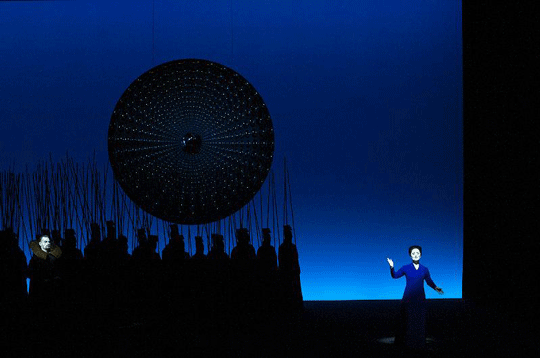




















 Salut de Ingo metzmacher
Salut de Ingo metzmacher Peter Seiffert (second plan Nina Stemme et Michael Volle)
Peter Seiffert (second plan Nina Stemme et Michael Volle)


 devenue lieu du couple, puis de la Liebestod, dans un décor très réaliste d’intérieur XIXème, et l’utilisation de cette même table pour en faire une sorte de Tribunal des deux amants. Intérieur impeccable au 1er acte,
devenue lieu du couple, puis de la Liebestod, dans un décor très réaliste d’intérieur XIXème, et l’utilisation de cette même table pour en faire une sorte de Tribunal des deux amants. Intérieur impeccable au 1er acte,  murs décrépis au dernier, où l’on passe tour à tour des des espaces “réels” ou “fantasmés”, l’excellente idée de remimer les soins apportés à Tristan, allongé sur le lit au milieu de bandages sanguinolents, tout cela montre un travail attentif et très rigoureux, non dénué de poésie (acte II) et dont les partis pris radicaux, parce qu’ils sont bien traduits sur scène, ne choquent absolument pas. Il en résulte une fluidité de l’action qui enlève tout statisme à l’ensemble. On voit quelquefois des Tristan statiques, voire ennuyeux: on a ici à la fois une direction musicale très dynamique, incroyablement jeune et vigoureuse, et une traduction scénique là aussi tout en mouvement et prodigieusement stimulante. Tout ennui est banni, et on n’a qu’une envie après cinq heures de spectacle que de recommencer l’expérience a plus vite. Pour Haitink d’abord et avant tout, pour le reste du spectacle ensuite, à ne manquer sous aucun prétexte dès que ce sera repris.
murs décrépis au dernier, où l’on passe tour à tour des des espaces “réels” ou “fantasmés”, l’excellente idée de remimer les soins apportés à Tristan, allongé sur le lit au milieu de bandages sanguinolents, tout cela montre un travail attentif et très rigoureux, non dénué de poésie (acte II) et dont les partis pris radicaux, parce qu’ils sont bien traduits sur scène, ne choquent absolument pas. Il en résulte une fluidité de l’action qui enlève tout statisme à l’ensemble. On voit quelquefois des Tristan statiques, voire ennuyeux: on a ici à la fois une direction musicale très dynamique, incroyablement jeune et vigoureuse, et une traduction scénique là aussi tout en mouvement et prodigieusement stimulante. Tout ennui est banni, et on n’a qu’une envie après cinq heures de spectacle que de recommencer l’expérience a plus vite. Pour Haitink d’abord et avant tout, pour le reste du spectacle ensuite, à ne manquer sous aucun prétexte dès que ce sera repris.