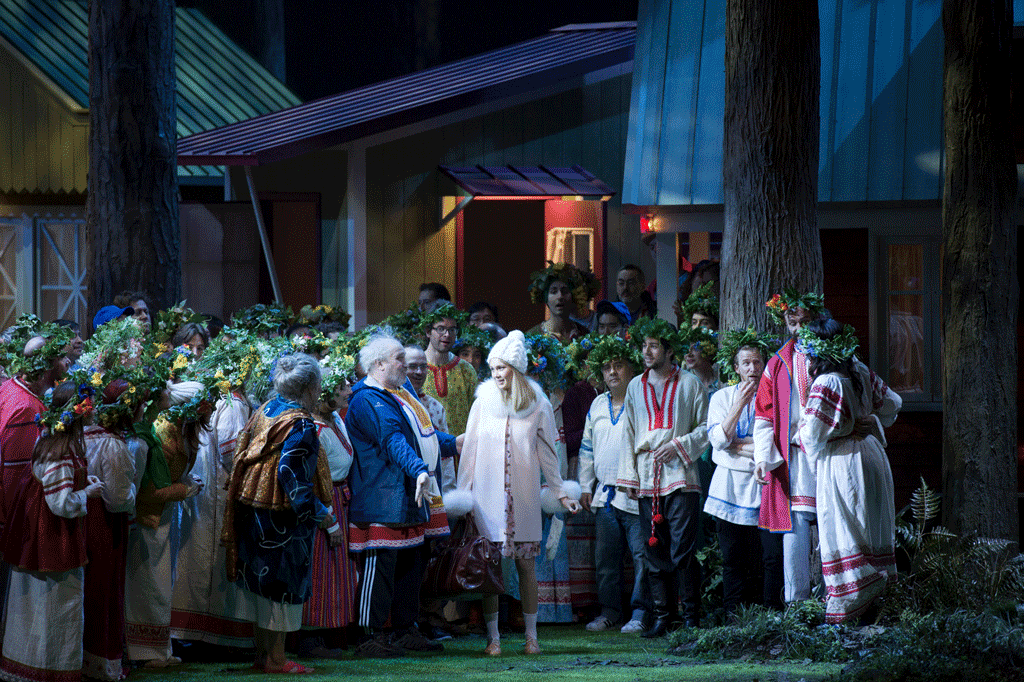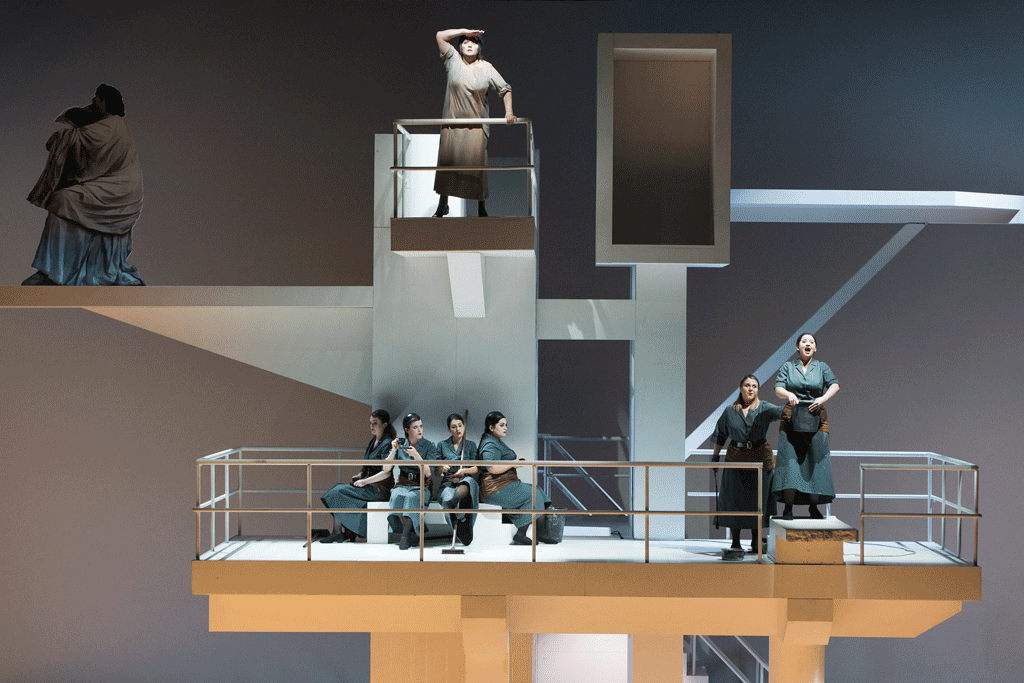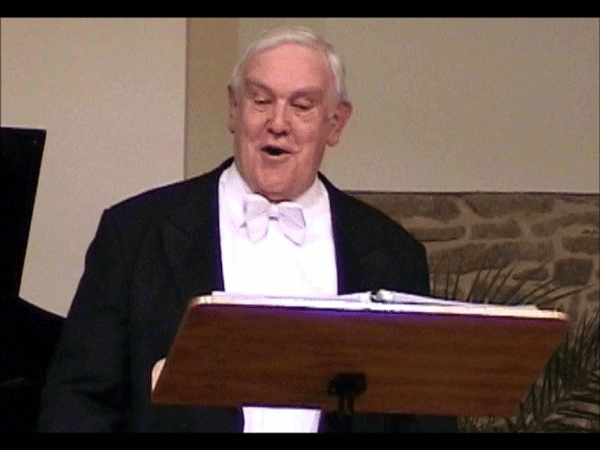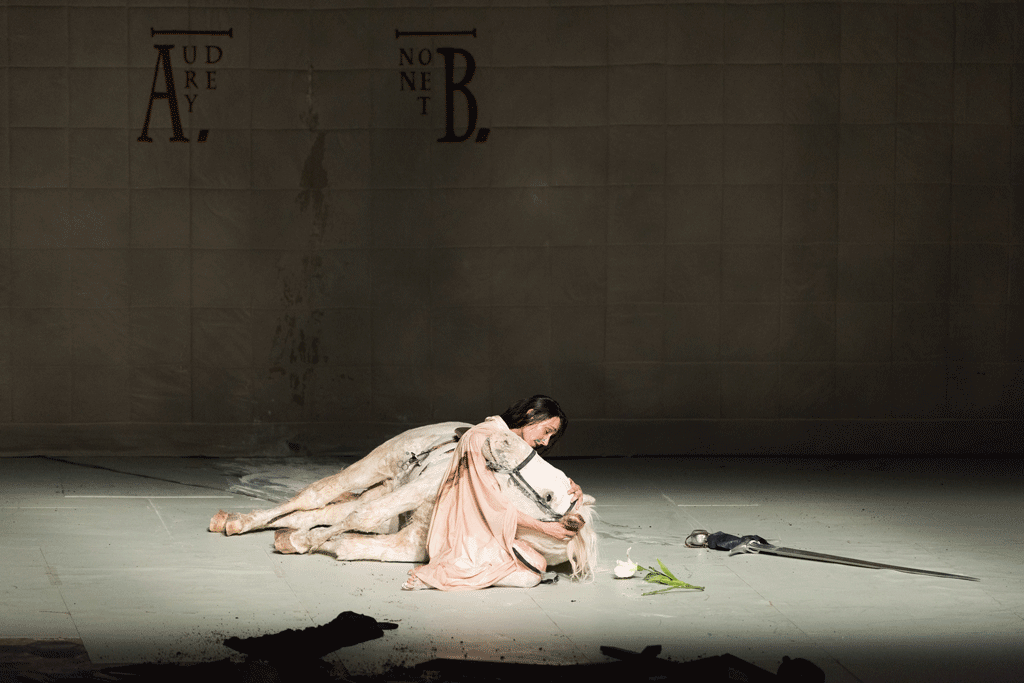Après Paris et Lyon, à la faveur de la publication récente du programme de la Scala, j’ai pensé qu’il était intéressant de s’interroger à partir de cette nouvelle saison, sur la situation de ce théâtre emblématique entre tous, pour deux raisons:
- La Scala a souvent utilisé implicitement ou non le statut supposé de « Mecque » de l’opéra pour sa communication « (le plus grand théâtre lyrique du monde »), ce n’est pas neutre et cela a déterminé des décisions qui d’ailleurs lui ont quelquefois nui.
- Elle connaît actuellement des difficultés de public et de pilotage, et la saison est un élément déterminant pour lire une politique.
Milan n’était pas une ville trop touristique il y a seulement 20 ans, elle l’est devenue, à la faveur des foires qui se sont fortement developpées, qui ont été couronnées par EXPO2015. Les touristes parcourent Milan désormais, et évidemment passent par la Scala, qui est une marque de la ville (« marchio Scala » entend-on dire: on le sent par la manie du selfie qui y règne, signe d’une « simple visite » dans ce théâtre dont la programmation est moins importante que « d’y être ».
En effet, je l’ai souvent écrit le public de la Scala est double,
- d’une part ce public touristique dont je viens de parler (il y a des années déjà, des agences de voyage louaient une loge et les voyageurs y séjournaient pendant un acte à tour de rôle)
- d’autre part un public local, la majorité, ce qui faisait dire à Stéphane Lissner que la Scala recrutait dans un rayon de deux kilomètres autour du théâtre, avec des réactions de théâtre local, d’endroit où l’on se retrouve, au système d’abonnement très traditionnel que Lissner a d’ailleurs essayé de modifier, un « salotto » chic qui en fait de ce que j’ai appelé quelquefois non le plus grand théâtre lyrique du monde mais le plus grand théâtre lyrique de province du monde. Ceux qui ont vécu à Milan et qui adorent cette ville (j’en suis), savent que c’est une ville un peu schizophrène, entre une ouverture internationale réelle et des réflexes de ville de province. Dans ce public, une proportion de mélomanes très avertis à qui on ne l’a fait pas, parmi lesquels quelques d’extrémistes hueurs.
Avoir la Scala sur son territoire, c’est évidemment aussi en exploiter le prestige, d’autant que sa reconstruction en 1946 après un bombardement (américain) fut le symbole de la reconstruction et de la renaissance de l’Italie, marquée par un concert mythique dirigé par Arturo Toscanini.
La Scala par ailleurs est le dernier survivant historique des grands théâtres italiens mythiques du XIXème, puisque les deux autres, La Fenice de Venise ou le San Carlo de Naples ont perdu le statut emblématique qu’ils avaient, tandis que les grands théâtres italiens des 50 dernières années, comme Bologne ou Florence, se débattent aujourd’hui dans des difficultés financières notables. Dans le paysage italien du jour, la Scala, Turin, et Rome sont pour des raisons diverses les seuls théâtres à peu près sains de la péninsule. Rome parce que c’est le théâtre de la capitale, depuis deux ans dirigé de main de maître par Carlo Fuortes qui se révèle être un intendant hors pair, et Turin, avec une politique artistique intelligente, un directeur musical de grande valeur, Gianandrea Noseda, et un solide intendant, Walter Vergnano.
D’où viennent donc les difficultés actuelles de la Scala ?
Elles tiennent à des causes historiques et des causes contingentes externes et internes.
- Les causes historiques, on les a évoquées un peu plus haut, c’est notamment deux périodes éminemment brillantes,
- les années 50 où le théâtre fut le champ clos des rivalités des personnalités lyriques Callas/Tebaldi par exemple mais où tous les grands chefs de l’époque passaient, Karajan en premier lieu, mais aussi Mitropoulos, Cantelli, Serafin, Furtwängler…les noms parlent d’eux-mêmes et les représentations mythiques ont fait l’objet d’enregistrements officiels ou pirates fameux.
- Les années Abbado (dès 1968), grâce à l’action de Paolo Grassi dans les années 70, et dans une moindre de mesure de Carlo Maria Badini jusqu’en 1986, année du départ d’Abbado qui sans rien renoncer de la magnificence vocale et musicale (Kleiber, Böhm, Sawallisch), ont été marquées par une ouverture du répertoire et l’appel fréquent à des metteurs en scène plus modernes (Ronconi, Ponnelle, Strehler(même si Strehler était déjà dans le circuit avant Abbado), Chéreau, Lioubimov, Vitez).
A tort ou à raison, les périodes qui suivent où se sont succédés Carlo Fontana (avec Muti), Lissner (avec Barenboim), et maintenant Pereira (avec Chailly) ne sont pas considérées comme des grandes périodes de référence. Certes les équipes en place ne sont jamais des références, face aux âges d’or du passé, sans cesse rappelés mais il reste que ni Lissner (qui paie un peu son statut de premier étranger dans la place) ni Fontana (et Muti), qui ont dû partir suite au refus des personnels de leur faire confiance n’ont laissé chez le public mélomane local de traces artistiques profondes, en dépit de productions notables et de moments tout de même exceptionnels.
La période Lissner, qui a remis le théâtre à flot dans des conditions difficiles, a élargi le répertoire, ouvert à des chefs plus jeunes, très divers, rarement contestés, et a imposé un style de mise en scène qu’on avait oublié dans ce théâtre très marqué par la tradition. Mais si les spectacles de répertoire non-italien ont été souvent triomphaux (les Wagner de Barenboim par exemple), Lissner n’a pas réussi à pacifier le théâtre sur le répertoire italien, assez mal servi en général, et obéré par une crise notable de l’école italienne de chant, notamment pour Verdi, le compositeur maison.
– Les éléments internes sont nombreux également : le système qui régit le théâtre est la Stagione, qui comme on sait, valorise les nouvelles productions, avec des reprises en nombre limité, et des distributions de qualité, choisies et normalement dignes de la réputation du théâtre.
Or sous l’emprise de l’idée selon laquelle il n’y avait pas un nombre de représentations suffisant, que le public se pressait (de fait dans les années 80 ou 90, il était difficile de trouver des places et le marché noir a toujours été actif), et à la faveur de la restructuration du théâtre du début des années 2000, qui en a sans doute abîmé l’acoustique de manière notable, mais en même temps modernisé la machinerie théâtrale favorisant une alternance plus serrée, dans un théâtre resté jusque-là avec ses machineries du XVIIIème , on a augmenté le nombre de productions de manière considérable : alors qu’il était jusqu’alors le plus souvent d’une dizaine de décembre à juillet, sans productions d’automne, réservées à la saison symphonique jusqu’en 2000, on trouve cette année une quinzaine de titres couvrant la saison qui va de décembre à novembre de l’année suivante, sans compter le ballet, les concerts, les récitals, la programmation pour les enfants. Une diversité qu’il faut saluer, mais qui en même temps bouscule un théâtre au public comme on l’a dit, limité et habitudinaire. L’offre est large, mais trop large sans faire d’effort pour élargir le public et aller le chercher par des incitations attractives, parce que la Scala n’a pas cette tradition, habituée qu’elle est à un afflux régulier et à son public captif. Quand le public vient, on ne songe pas à le construire ou à le travailler dans la mesure où il ne manque pas.
Donc le format actuel est trop large pour la demande réelle de la cité. Mais un autre motif non indifférent, ce sont des prix sont devenus dissuasifs dans un pays en crise : le tarif opéra le plus élevé culmine à 250 €, sur toute la Platea (fauteuils d’orchestres) et tous les premiers rangs de loge du premier au quatrième étage, et la galerie (1ère galerie) est à plus de 100 €. A ces tarifs, le spectacle a intérêt à être réussi. Et le niveau actuel des productions ne correspond pas vraiment aux tarifs demandés. A Munich, hors festival (où les prix augmentent) le prix maximum est de 163 € ou 132 € selon l’œuvre (Milan, 250 € et 230 €), et Munich actuellement a une offre autrement plus séduisante dans un pays au pouvoir d’achat important et dans une région prospère que Milan.
Enfin, dernière cause, et la plus récente, la direction musicale de Riccardo Chailly, au-delà de la qualité intrinsèque du chef, incontestable, manque de lisibilité. Riccardo Chailly aime à excaver des œuvres inconnues, des éditions jamais jouées, des détails scientifiquement passionnants de la musicologie, mais en dirigeant seulement deux productions dans l’année, le choix 2017-2018 de Andrea Chénier et Don Pasquale étonne. On attendrait d’un chef au répertoire aussi large et à l’imagination si notable des choix moins ordinaires et un rôle plus dynamisant qu’il n’a pas.
L’observation de la saison 2017-2018 confirme malheureusement cette impression d’absence d’idées, de recours à des recettes sans génie et surtout de manque de phares qui drainent les foules.
- Andrea Chénier, d’Umberto Giordano, 9 représentations du 3/12/2017 au 5/01/2018, dont la représentation pour les jeunes (le 3 décembre) et l’inauguration du 7 décembre (à 2500 € la place d’orchestre).
Première source d’étonnement, l’ouverture de saison par un Andrea Chénier, certes populaire, et qu’on voit un peu partout en Europe, Londres ou Munich par exemple, mais dont le relief musical ne correspond pas tout à fait à une production inaugurale, qui doit faire le point sur l’état de toutes les forces du théâtre (chœur, orchestre, et même ballet) dans une œuvre incontestée du grand répertoire. Selon une recette aujourd’hui dépassée, c’est Anna Netrebko dans Madeleine de Coigny qui en est la motivation, comme si une hirondelle faisait le printemps. La mise en scène est confiée à Mario Martone, certes un des bons metteurs en scène italiens, très propre, très consensuel et donc un peu fade. Quant au ténor, c’est Monsieur Netrebko à la ville, Yusif Eyvazov, qui n’est pas jusqu’ici connu comme une référence. Nul doute qu’il sera attendu au tournant par un public (notamment au Loggione) qui ne pardonne rien, et c’est un risque et pour le théâtre, et pour lui et pour Netrebko. Je voudrais rappeler qu’en son temps, Rolf Liebermann s’était refusé à engager Joan Sutherland à Paris parce que la condition était la présence en fosse de Richard Bonynge. Enfin c’est comme à Munich Luca Salsi qui sera Gérard. Quand on évoque justement le triomphe incroyable de l’Andrea Chénier de Kaufmann/Harteros munichois que le public parisien a pu entendre, on se demande la plus-value de la Scala
- qui se soumet au désir de la chanteuse d’avoir Monsieur à ses côtés,
- qui propose une mise en scène plutôt attendue .
Il y a fort à parier que cela va encore alimenter l’opposition sourde qui se fait jour au pilotage d’Alexander Pereira qui en l’occurrence prend un peu le public pour des gogos.
Et même la présence de Chailly en fosse dans cette œuvre, garantira certes une direction de grand niveau, mais ne transformera pas forcément le tout en or. Beaucoup de doutes sur cette inauguration, emblème d’une politique artistique un peu erratique. Certes, d’une manière un peu racoleuse, on affiche une volonté d’italianità, un retour aux sources qui répétons-le à l’envi, n’est que mythe : au XXème siècle, Toscanini le directeur musical légendaire de la Scala dont le buste trône dans le foyer et dont on évoque les mânes à l’envi, a inauguré avec Wagner de nombreuses fois et a ouvert le répertoire plus qu’aucun autre directeur musical, il y a un siècle….
Il y a une trentaine d’années, la Scala affichait en décembre une deuxième production face à celle de l’inauguration, pratique aujourd’hui disparue sans doute au nom du marketing dû à l’exclusivité de la Prima. Et la deuxième production prévue dans la saison eût pu plus qu’une autre prendre place en cette période festive. Mais ce sera en janvier, après la fête…
- Die Fledermaus, de Johann Strauss sera affichée pour 8 représentations du 19 janvier au 11 février. C’est pourtant une tradition germanique de Pereira connaît bien que Fledermaus en fin d’année, mais sans doute les questions de disponibilité artistique, et le désir de laisser comme seule production lyrique celle de la Prima en décembre ont-ils été déterminantes.
La production qui sera dirigée par Zubin Mehta, est mise en scène par l’acteur Cornelius Obonya et son épouse Carolin Pienkos, le premier acteur du Burgtheater de Vienne et la seconde qui y a été assistante, dans des décors d’Heike Scheele, la décoratrice du Parsifal de Stefan Herheim autant dire garantie de spectaculaire.
Leur connaissance de Vienne, et le fait que Cornelius Obonya (qui vient d’interpréter au festival de Salzbourg pendant plusieurs années le rôle-titre de Jedermann, une référence pour un acteur germanique) soit en l’occurrence aussi un notable Frosch, le geôlier du troisième acte de Fledermaus à l’accent viennois à couper au couteau garantit quelque chose d’idiomatique. Il reste que les dialogues seront sans doute en italien, puisque Frosch sera Nino Frassica, acteur et homme de télé très connu en Italie et Rosalinde l’italienne Eva Mei. Eisenstein est interprété par Peter Sonn, excellent ténor que les milanais ont vu dans David des Meistersinger, et Adele sera Daniela Fally, pilier de l’opéra de Vienne et interprète de tous les rôles de soprano aigu (Fiakermilli, Zerbinetta…). Triste à dire, mais c’est plus excitant et mieux construit que la production inaugurale. Pour un peu on aurait pu faire l’échange…
Pour la troisième production de la saison, et première reprise, un Verdi mythique dans cette salle :
- Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi, pour 8 représentations de 8 février au 4 mars, dans la mise en scène de Federico Tiezzi et les décors de Pier Paolo Bisleri. La production de l’ère Lissner était suffisamment médiocre pour qu’on en ait refait les décors de Maurizio Balo’ en coproduction avec Berlin. C’est dire…
Ce qui frappe encore plus, c’est que cette production médiocre a été créée en 2009/2010, reprise en 2013/2014, puis en 2015/2016, soit la saison dernière. Or Simon Boccanegra est l’un des opéras phares de la Scala à cause de la production Abbado/Strehler, longtemps carte de visite mondiale du théâtre qui choisissait ce titre dans toutes ses tournées.
Une idée : au moment où on aime les reconstitutions de productions historiques, ne vaudrait-il pas mieux réinvestir dans une reconstitution de la production Strehler dont on a plusieurs vidéos que de subir une production d’un niveau tout au plus moyen, et en tous cas oubliable d’un titre aussi emblématique.
Attraction de la saison, Krassimira Stoyanova dans Amelia, sans nul doute l’une des titulaires les plus intéressantes aujourd’hui. Simon sera Leo Nucci, grandissime artiste certes, mais la Scala pourrait appeler au moins en alternance des barytons en pleine carrière, Fiesco est le solide Dmitry Belosselsky, et Fabio Sartori sera Gabriele Adorno . La direction est assurée par Myung-Whun Chung, qui a laissé un excellent souvenir cette saison dans Don Carlo. Remarquons néanmoins que Riccardo Chailly a dirigé Boccanegra (je l’avais entendu à Munich) et que cette reprise aurait pu lui échoir, ce serait pleinement dans son rôle.
Venue de Covent Garden, une production de John Fulljames (bien connu des lyonnais où il a signé notamment Sancta Susanna) dans des décors de Conor Murphy et une chorégraphie de Hofesh Shechter, d’un opéra de Gluck vu souvent à la Scala mais en version italienne :
- Orphée et Eurydice, pour 7 représentations du 24 février au 17 mars, dirigé par le remarquable Michele Mariotti qui ne nous a pas habitués à ce répertoire, mais qui pour l’occasion va travailler avec un chanteur qu’il connaît en revanche parfaitement dans un autre répertoire, Juan Diego Florez en Orphée. Ce sera l’attraction de cette série de représentations, aux côtés de l’Eurydice de Christiane Karg (moins connue en Italie qu’en Allemagne) et l’Amour de Fatma Saïd. C’est la première fois que la version française est donnée à la Scala, et la distribution et le chef garantissent un très haut niveau.
De la tragédie lyrique gluckiste au bel canto bouffe , la production qui suit est confiée au directeur musical Riccardo Chailly :
- Don Pasquale, de Gaetano Donizetti pour 8 représentations du 3 au 28 avril, mise en scène de Davide Livermore, habitué de Pesaro, mais aussi de Turin dont il est originaire, et intendant et directeur artistique du Palau de les Arts de Valence. Outre Riccardo Chailly, la distribution réunie autour du Don Pasquale de Ambrogio Maestri est composée de la Norina de Rosa Feola (la Ninetta de La gazza ladra cette saison) ainsi que de l’Ernesto de René Barbera et le Malatesta de Mattia Olivieri. Production solide sans doute, mais de là à exciter la passion…
Retour sur la scène italienne d’une rareté pour 9 représentations du 15 avril au 13 mai.
- Francesca da Rimini, de Riccardo Zandonai, dans une mise en scène de David Pountney, des décors de Leslie Travers. L’unique opéra dont on se souvienne parmi la douzaine du compositeur originaire de Rovereto près de Trento est néanmoins peu représenté, malgré une musique d’un grand intérêt. On le croit un post-vériste, alors qu’il est quelque part entre le post wagnérisme et le post-debussysme. La distribution, dirigée par Fabio Luisi qui devrait être très à l’aise dans ce répertoire comprend Maria-José Siri (Butterfly cette saison à la Scala), Roberto Aronica (la voix sera là, oui, mais la subtilité ? on pense avec regrets à Alagna il y a quelques années à Paris) et Gabriele Viviani. Ceux qui ne connaissent pas l’œuvre ont à peu près la garantie qu’elle sera bien dirigée et chantée. Du solide là-aussi, sans être exceptionnel.
Pour célébrer les 95 ans de Franco Zeffirelli et pour 7 représentations du 8 mai au 3 juin :
- Aida dans la production de Franco Zeffirelli (apparemment celle de 1963, « Zeffirelli 1 » dans les magnifiques décors de Lila de Nobili si l’on en croit l’illustration du site de la Scala et non celle de 2006, « Zeffirelli 2 »un ratage).
Si on fait le compte, on a vu Aida en 2006/2007 (Zeffirelli 2, Chailly), 2008-2009 (Zeffirelli 2 , Barenboim), 2011/2012 (Zeffirelli 1, Omer Meir Wellber), 2012/2013 (Zeffirelli 2, Noseda), 2014/2015 (Peter Stein, Mehta). C’est donc la sixième fois qu’on va afficher le titre, à peu près une fois tous les deux ans avec des fortunes et des productions diverses, mais sur la trentaine de titres de Verdi, il semble que ce soit quelque peu excessif…
Cette fois-ci, la distribution comprend Krassimira Stoyanova en Aida et Violeta Urmana redevenue mezzo en Amneris : c’est du dur ! Fabio Sartori en alternance avec Marcelo Alvarez en Radamès, George Gagnidze en Amonasro et Vitali Kowaljow en Ramfis complètent. Intéressant pour les dames, moins pour les messieurs. La direction musicale est assurée par un très vieux routier, ami de Pereira qui l’a souvent appelé à Zürich, Nello Santi qui aura alors 87 ans.
On sort un peu de l’ordinaire et beaucoup du rebattu du 5 au 30 juin avec
- Fierrabras de Schubert, pour 7 représentations, dans la production du Festival de Salzbourg de Peter Stein (voir Blog Wanderer) de 2014. Une production « classique » non dépourvue ni de finesse, ni d’élégance, très critiquée en 2014 à Salzbourg, et qui ne mérite pas cette indignité.
L’appel à Daniel Harding pour la direction musicale (à Salzbourg, c’était Ingo Metzmacher) est aussi une bonne idée, Daniel Harding étant revenu au premier plan depuis quelques années. Sans être exceptionnelle, la distribution est très solide, dominée par Anett Fritsch et Dorothea Röschmann et avec Marie-Claude Chappuis, Bernard Richter, Tomasz Konieczny, Markus Werba et Peter Sonn.
En ce début d’été, retour d’une des dernières productions de l’ère Lissner/Barenboim, non sans lien avec celle qui précède :
- Fidelio, de Beethoven, dans la mise en scène maison de Deborah Warner pour 7 représentations du 18 juin au 7 juillet dirigé par Myung-Whun Chung, deuxième présence au pupitre de la saison (serait-il un premier chef invité in pectore ?), avec l’excellent Stuart Skelton en Florestan et Simone Schneider en Leonore. Cette dernière, en troupe (Kammersängerin) à Stuttgart, commence à chanter un peu partout en Allemagne, des rôles comme Sieglinde, Rosalinde, Chrysothemis, Elettra, l’impératrice. Elle chantera aussi Leonore avec Nagano à Hambourg en 2018. Notons aussi dans la distribution Eva Liebau en Marzelline, jeune soprano qu’on va voir à la Scala dans Ännchen de Freischütz en fin de saison. Rocco sera Stephen Milling, Pizzaro le méchant sera l’excellent Luca Pisaroni dans un rôle inattendu (on l’entend plutôt dans des Mozart ou des Rossini). La distribution est complétée par Martin Gantner en Fernando et Martin Piskorski en Jacquino. On dirait à Munich ou à Vienne « très bonne représentation de répertoire ».
Retour au répertoire italien pour clore la première partie de la saison, avec un titre rare de bel canto.
- Il Pirata, de Bellini, dirigé par Riccardo Frizza pour 8 représentations du 29 juin au 19 juillet. On sait que les six premières seront confiées à Sonya Yoncheva qui chantera lmogene, Gualtiero sera Piero Pretti, un des ténors qui commencent à émerger un peu partout, tandis qu’Ernesto sera l’excellent Nicola Alaimo. La mise en scène déchainera sans doute l’ire du Loggione et de la platea, puisqu’elle sera signée Christof Loy, maître ès Regietheater (un Mistigri à la Scala) dans des décors de Raimund Voigt. L’œuvre est si rare qu’elle vaudra sans doute le déplacement.
La saison se poursuit après la pause estivale avec cinq productions et non des moindres.
- Ali Babà e i 40 ladroni, de Luigi Cherubini. Retour de Cherubini à la Scala pour une œuvre rarissime. Ali Babà et les quarante voleurs est une tragédie lyrique en 4 actes créée à Paris en 1833, dernier opéra de Cherubini. Très peu représentée (on l’a vue en version digest pour enfants interprétée par les artistes de l’Opéra – Studio de l’Opéra du Rhin en 2010). À la Scala, la version italienne sera confiée à la direction de Paolo Carignani, bien connu des scènes allemandes pour tout l’opéra italien, et aux chanteurs de l’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala. La nouvelle production de l’œuvre qui manque à la Scala depuis 1963 est mise en scène par Liliana Cavani dans des décors de Leila Fteita. Cela ne garantira pas un spectacle échevelé ni révolutionnaire, mais garantira aux jeunes artistes de l’académie un vrai travail scénique avec une très grande professionnelle. Pour l’œuvre cela vaut sans doute le déplacement des spectateurs curieux (il y en a), amoureux de Cherubini (il y en a moins, mais j’en suis).
Un grand Verdi qu’on n’a pas vu à la Scala depuis l’ouverture de la saison 1982/1983,
- Ernani de Giuseppe Verdi, alors dirigé par Riccardo Muti, dans une mise en scène de Luca Ronconi qui n’a jamais été reprise après les 8 représentations de décembre 1982, et qui était alors interprété par (rêvons un peu) Mirella Freni, Placido Domingo, Renato Bruson, Nicolaï Ghiaurov.
Fallait-il donc une nouvelle production si le décor monumental de Ronconi subsistait – on peut certes en douter, pour un spectacle âgé de 35 ans – ? Certes, c’est loin d’être un de ses meilleurs spectacles, mais je doute qu’une nouvelle production de Sven Eric Bechtolf, même avec des décors/costumes de Julian Crouch, soit meilleure, connaissant son travail habituellement sans imagination.
Pour la direction musicale, Pereira a appelé l’excellent musicien qu’est Adam Fischer, plus wagnérien – remarquable – que verdien, dans un opéra évidemment fait pour un Michele Mariotti…Mais Fischer n’est pas contestable comme chef. Et dans la distribution, on trouve comme Elvira Aylin Perez, jeune, très en vue actuellement, et comme Ernani Francesco Meli…évidemment sans commentaire, tandis que Don Carlo sera Simone Piazzola, et Silva Ildar Abdrazakov. Bon cast, sans nul doute. On ira, parce qu’Ernani est une œuvre magnifique et inconnue au bataillon en France. Vous pouvez traverser les Alpes. (8 représentations du 29 septembre au 25 octobre)
Mozart au rendez-vous automnal avec là aussi une rareté à la Scala (la dernière fois, elle fut représentée à la Piccola Scala qui n’existe plus, c’est dire) pour 7 représentations du 8 au 29 octobre :
- La Finta giardiniera, dirigée par le baroqueux Diego Fasolis, l’un des meilleurs dans la sphère italophone (il est suisse né à Lugano), dans une mise en scène (venue de Glyndebourne, c’est une location) de Frederic Wake-Walker et des décors d’Antony Mc Donald, très réjouissante et qui a remporté un très grand succès à Glyndebourne.
Belle distribution également, avec les noms de jeunes chanteurs excellents de la nouvelle génération mozartienne, Bernard Richter, Hanna Elisabeth Müller, Kresimir Spicer, Anett Fritsch. Une initiative intéressante qui peut valoir un petit voyage.
Une reprise de prestige en fin de saison, qui ne s’imposait peut-être pas :
- Elektra, mise en scène de Patrice Chéreau dans des décors de Richard Peduzzi et des costumes de Caroline de Vivaise.
Cela ne s’imposait pas, parce qu’un spectacle où seule Waltraud Meier demeure de la distribution originale, celle qui a travaillé avec Chéreau, n’est plus un spectacle de Chéreau, qui ne voulait pas que ses spectacles soient repris sans lui, et qui tenait à travailler sur la longueur avec la même équipe. Chrysothémis est Regine Hangler, Elektra Ricarda Merbeth, Orest Michael Volle et Aegisth Roberto Saccà. Certes, des chanteurs respectables ou remarquables, mais si Chéreau devient un cadre extérieur comme dans n’importe quelle production de théâtre de répertoire, c’est regrettable, ou pire, idiot. Avec Waltraud Meier (et Michael Volle l’autre chanteur hors du lot, même s’il n’a pas participé à l’aventure Chéreau), c’est la présence – une vraie surprise – au pupitre d’un des très grands chefs de la fin du XXème siècle, de plus en plus rare dans les théâtres, Christoph von Dohnanyi, qui va diriger cette partition tour de force à 89 ans…
Dernière production de la saison, une création du 15 au 25 novembre pour six représentations :
- Fin de Partie, de György Kurtág, une commande de Lissner et de Pereira si je ne m’abuse, qui devait être créée à Salzbourg, puis à la Scala, et mise en scène par Luc Bondy, dirigée par Ingo Metzmacher. Kurtág ayant pris un retard notable, le spectacle se crée à Milan, dans une mise en scène de Pierre Audi, décors et costumes de Christof Hetzer, dirigé par Markus Stenz, le très bon chef allemand, notamment pour le XXème siècle. Dans la distribution, notons Frode Olsen, familier des scènes, basse solide vue récemment dans Le Grand Macabre (dir.Simon Rattle) à la Philharmonie de Berlin et Leigh Melrose, magnifique baryton (vue cette saison dans L’Ange de Feu à Zürich) à la présence et à l’engagement scéniques hallucinants, Hilary Summers qu’on verra à Aix cet été (The Rake’s Progress) et Leonardo Cortellazzi.
Une création, de Kurtág en plus, cela ne se manque pas et celle-ci est particulièrement attendue.
Au total, cet automne 2018 est peut-être le moment le plus intéressant de la saison.Faisons les comptes : 15 productions différentes dont : - 8 nouvelles productions (Andrea Chénier, Die Fledermaus, Don Pasquale, Francesca da Rimini, Il Pirata, Ali Babà e i 40 ladroni, Ernani, Fin de Partie) dont une création mondiale (Fin de Partie)
- 4 spectacles importés ou coproduits dont trois nouveaux pour Milan (Orphée et Eurydice, Fierrabras, La Finta Giardiniera, Elektra),
- 3 reprises de productions maison (Simon Boccanegra, Aida, Fidelio).
Pour le répertoire,
- 8 œuvres du répertoire italien
- 2 œuvres de répertoire français (Orphée et Eurydice, et Fin de partie avec l’original français de Beckett, du moins c’est prévu ainsi)
- 1 œuvre de Mozart (en italien)
- 4 œuvres de répertoire germanophone (Die Fledermaus, Fierrabras Fidelio, Elektra)
Pour les compositeurs
- Italiens :
- Verdi : 3
- Giordano : 1
- Bellini : 1
- Donizetti : 1
- Cherubini : 1
- Zandonai : 1
- Non italiens :
- Beethoven : 1
- Gluck: 1
- Kurtág : 1
- Mozart : 1
- Schubert : 1
- Strauss Jr : 1
- Strauss : 1
Sur le papier une saison diversifiée, équilibrée, qui donne une bonne place au répertoire italien et très variée en terme de compositeurs et de titres, avec quelques raretés pour Milan ou en absolu (Il Pirata, Ali Babà, Fierrabras, la Finta Giardiniera, Ernani, Francesca da Rimini); en y regardant de plus près, des distributions solides mais pas exceptionnelles et plutôt sans imagination, quelques chefs de grand prestige (Chailly, Mehta, von Dohnanyi) d’autres excellents (Chung, Harding, Stenz, Fischer, Mariotti, Luisi) puis de bons chefs pas encore starisés, ou plutôt des chefs de répertoire (Carignani, Frizza, Fasolis, Santi) et l’impression que certaines œuvres rares sont affichées mais un peu sous-distribuées, avec des reprises inutiles (Boccanegra, Aida, voire Fidelio). Ce qui me gêne le plus, c’est l’impression que Riccardo Chailly aurait pu diriger plus d’œuvres (Ernani ? Aida ? Boccanegra ? Fidelio ?) pour donner une ligne à sa saison. Je ne comprends pas bien la nature de son engagement comme directeur musical.
Enfin, Andrea Chénier comme ouverture de saison, d’un côté cela peut, à la limite, se justifier, de l’autre je ne lis rien d’excitant dans le cast (Netrebko à part), avec une mise en scène sans trop d’attente non plus. So what ?
So what ? L’impression est celle d’une situation d’attente, d’absence de spectacles phares, en dépit de productions quelquefois intéressantes. D’où cette impression de fadeur, de théâtre solide de répertoire mais pas de stagione en « Festival permanent ». Quand l’Impératrice des opéras se réveillera-t-elle ?