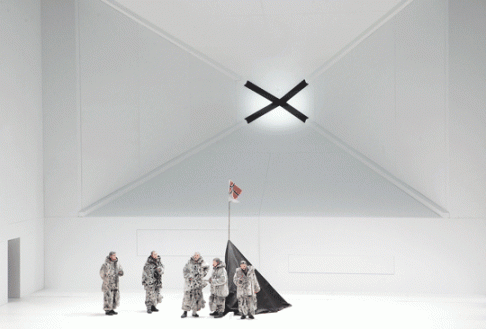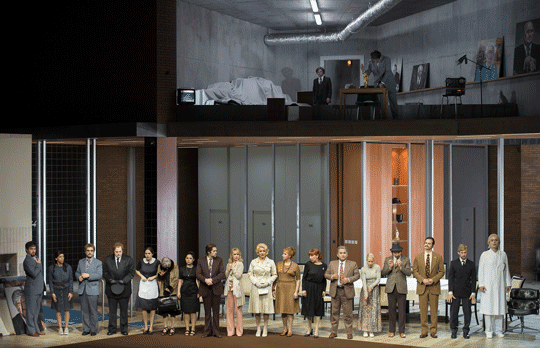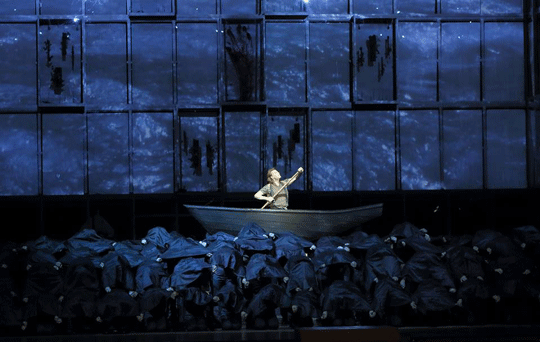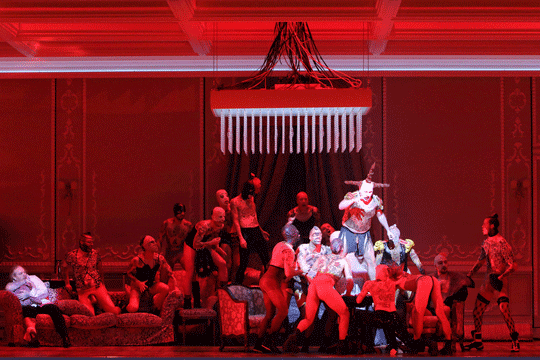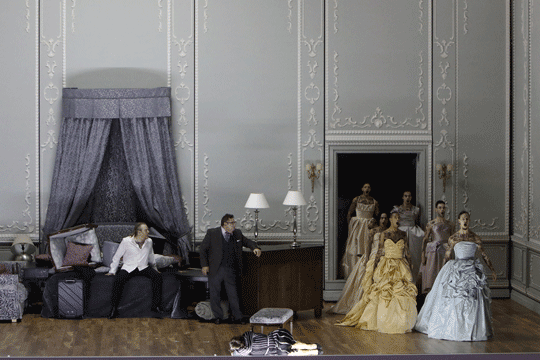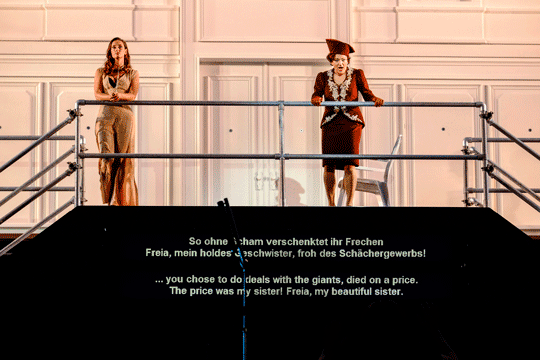On pourrait penser à d’autres théâtres plus prestigieux, plus conformes aux étapes habituelles du mélomane voyageur: Royal Opera House, MET, La Monnaie, Amsterdam, mais c’est décidément la Komische Oper de Berlin qui a ma préférence. D’abord parce que c’est un lieu qui a une histoire culturelle forte, et qui a traversé la fin de l’Empire allemand, la république de Weimar, le nazisme, la DDR, et les bouleversements de la réunification sans abdiquer sa nature profonde, au point que le mensuel Opernwelt lui a décerné le titre envié d’Opéra de l’année en 2007 et en 2013.
La Komische Oper, c’est l’histoire d’un théâtre mythique, qui s’appelle Theater in der Behrensstrasse au XVIIIème où ont été créés Goetz de Berlichingen de Goethe ou Nathan der Weise de Lessing, puis à la fin du XIXème Theater Unter den Linden et bientôt Metropol Theater : il y a toujours eu un théâtre là où existe aujourd’hui la Komische Oper. Le Metropol Theater a été le théâtre mythique de l’Opérette et des revues satiriques dans la Berlin des débuts du XXème jusqu’aux années 30, mais l’abondance de compositeurs juifs qui ont dû fuir le nazisme a interrompu cette fête permanente. Après la 2ème guerre mondiale, il rouvre en 1947 (miraculeusement, alors que le bâtiment a été bombardé et détruit, la salle est intacte, dans son style néo baroque de la fin du XIXème) et devient, sous la direction de Walter Felsenstein, un des lieux fondateurs de l’école de mise en scène moderne, universellement admiré dans le monde du théâtre. La Komische Oper de Berlin s’inscrit dans la tradition d’un théâtre ouvert et populaire (les prix pratiqués sont très raisonnables) et l’appellation « Komische Oper » s’inscrit là aussi dans une tradition née au XVIIIème en France qui a fait de l’Opéra Comique la réponse « populaire » à l’Opéra. C’est donc une scène « alternative » au sens où elle montre d’autres voies possibles, notamment en matière de mise en scène, c’est sa tradition, mais aussi de répertoire car l’opérette y tient une place non négligeable. Ainsi parmi les trois opéras berlinois, la Komische Oper est « différente » ; aussi invité-je ceux qui passent par Berlin de ne jamais oublier que c’est la Komische Oper qui est dépositaire de la tradition berlinoise moderne, plus que les deux autres institutions, aussi importantes soient-elles, et donc d’y aller faire un tour.
Le metteur en scène australien Barrie Kosky en est actuellement l’intendant, c’est un homme à tout faire ( et notamment un nombre respectable de productions) qui a réorienté la politique de la maison dans plusieurs directions :
- Le répertoire baroque : ses spectacles d’ouverture lorsqu’il a pris les rênes de la maison ont été la trilogie monteverdienne, un triomphe auprès du public, d’autant que la salle de 1200 places aux dimensions moyennes le permet.
- L’opérette berlinoise, et notamment celle qui avait été ostracisée par les nazis, celles des années 20 et qui triompha sur la scène du Metropol
- L’accueil d’un nouveau public, et notamment de l’importante communauté turque qui habite Berlin : ainsi, les surtitrages sont systématiquement en turc, entre autres langues, et la politique des publics est soucieuse de cette population.
- Auparavant, tous les opéras étaient donnés en langue allemande (comme à la Volksoper de Vienne). Désormais, les opéras sont donnés en langue originale.
- Et bien sûr, la continuation d’une tradition d’innovation scénique, d’appel à de nouveaux metteurs en scène (notamment anglo saxons comme “1927”, Benedict Andrews ou Keith Warner) et à des expériences scéniques différentes. N’oublions pas que les Hans Neuenfels, Harry Kupfer, Andreas Homoki (qui fut intendant avant Kosky) et bien d’autres ont beaucoup fréquenté cette maison, dans le sillage de la tradition instituée par Walter Felsenstein
Pour 2016-2017, voici les nouvelles productions :
Octobre 2016: Il barbiere di Siviglia de G.Rossini pour 12 représentations dans l’année (jusqu’en juillet), une nouvelle production signée Kirill Serebrennikov, metteur en scène russe à succès en Russie (Le Coq d’Or au Bolshoï) qui a présenté « Les idiots » en 2015 au Festival d’Avignon, et au pupitre Antonello Manacorda, ex-premier violon du Lucerne Festival Orchestra qui a embrassé la carrière de chef d’orchestre. C’est le très talentueux ténor Tansel Akzeybek qui sera Almaviva aux côtés de la Rosine de Nicole Chevalier, membre de la troupe d’origine américaine qui chantera la version pour soprano.
Novembre 2016 : Peter Pan de Richard Ayres, un opéra pour enfants (11 représentations jusqu’à février 2017), dans une mise en scène de Keith Warner et dirigé par Anthony Bramall. Sur commission conjointe de l’Opéra de Stuttgart et de la Komische Oper. L’Opéra pour enfants « comme des grands ».
Décembre 2016 : Période de Noël, période d’opérette.
Die Perlen der Cleopatra, d’Oscar Straus. Une opérette folle, une Egypte berlinisée, avec l’équipe de Ball im Savoy (fantastique spectacle) emmenée par la star Dagmar Manzel qui a aussi à son actif la recréation cette saison de Eine Frau, die weiß, was sie will!, un étourdissant show créé lui aussi au Metropol Theater en 1932 adapté en français en Madame, je veux en 1935. Oscar Straus (sans le s final, pourtant dans son vrai nom , pour le pas être confondu avec les autres Strauss) d’origine juive, a dû fuir le nazisme à l’Anschluss, se réfugier en France, puis à Hollywood, on lui doit des opérettes très célèbres dont Rêve de Valse et Trois Valses.
Dagmar Manzel et le chef Adam Benzwi feront revivre ce délire (créée au Theater an der Wien en 1923 entre autres par Richard Tauber), satire de la culture bourgeoise dans une mise en scène de Barrie Kosky, comme le fol et joyeux Ball im Savoy. À ne manquer sous aucun prétexte pour se réconcilier avec l’opérette.
Marinka d’Emmerich Kálmán. Encore un compositeur d’opérettes à succès, contraint de s’exiler parce que juif (même si, dit-on, Hitler adorait tellement ses opérettes qu’il lui offrit le tire d’Aryen d’honneur) on lui doit notamment Princesse Czardas et Comtesse Maritza. Marinka est une opérette créée à New York en 1945, qui revient à Berlin sous forme concertante (avec costumes) pour deux soirs seulement. (Direction musicale Koen Schoots)
Janvier 2017 : Petrouchka (Stravinsky)/L’Enfant et les sortilèges (Ravel), par la troupe « 1927 ». Après l’immense succès (exporté jusqu’à Los Angeles) de Zauberflöte (un spectacle à voir séance tenante, on le joue chaque année et aussi l’an prochain) , « 1927 », ce très célèbre groupe britannique, c’est à dire Suzanne Andrade, Esme Appleton et Paul Barritt pour les animations reviennent pour un binôme musical qui devrait encore ravir par l’originalité du travail. La direction musicale est assurée par Markus Poschner, qui fut 1.Kappelmeister à la Komische Oper, actuellement GMD à Brème jusqu’à l’an prochain. Il va prendre la direction du Linz Bruckner Orchester comme successeur de Dennis Russell Davies, à partir de la saison 2017-2018
En Coproduction avec la Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/ Duisburg.
Avril 2017 : La foire de Sorotchinzy de Modest Moussorgski (en langue russe). Un Moussorgski rare, dirigé par le GMD Henrik Nánási, un chef remarquable, et mis en scène par Barrie Kosky pour 7 petites représentations qu’il ne faudra sûrement pas manquer entre avril et juillet 2017. La version proposée est celle de Pavel Lamm (1932) orchestrée par Wissarion Jakowlewitsch Schebalin. L’œuvre inspirée d’une nouvelle de Gogol a attendu longtemps après la mort de Moussorgski pour être créée (1911 à Saint Petersburg) La version reconstituée la plus commune est celle de Nicolaï Tcherepine, mais la Komische Oper a choisi le travail de Pavel Lamm, considéré comme plus proche de Moussorgski.Deux remarques :
- Une nuit sur le Mont chauve (1867) a été introduit par Moussorgski dans l’oeuvre comme une sorte de cauchemar d’un des personnages, Grizko.
- L’œuvre manque à Berlin depuis 1948, où elle a été créée à la Komische Oper sans jamais être reprise ni depuis, ni ailleurs.
Beaucoup de raisons réunies pour ne pas manquer de faire le voyage de Berlin, d’autant qu’avril est toujours riche en musique (Festtage de la Staastoper).
Mai 2017 : Medea, d’Aribert Reimann d’après Franz Grillparzer (7 représentations de mai à Juillet). Créé en 2010 à l’Opéra de Vienne avec un énorme succès puis repris à Francfort, c’est la création à Berlin, dans une mise en scène de l’australien Benedict Andrews, à qui l’on doit la production locale de L’Ange de Feu de Prokofiev qu’on verra à Lyon la saison prochaine et dirigée par Steven Sloane, un chef passionné par le répertoire contemporain. Avec Nicole Chevalier, Nadine Weissmann, Günter Papendell.
Juin 2017 : Zoroastre, de Jean-Philippe Rameau (6 représentations en juin et juillet). Barrie Kosky continue de proposer à Berlin des opéras du répertoire baroque. Une production qui attire les mouches à mises en scène dont je suis puisque c’est Tobias Kratzer ( Les Huguenots, Le Prophète, Die Meistersinger pour ne citer que les productions que j’ai vues) qui mettra en scène l’œuvre de Rameau, tandis que le chef Christian Curnyn, spécialiste de ce répertoire et bel interprète de Rameau, dirigera la formation de la Komische Oper.
On peut rajouter que celui qui passe une semaine à Berlin début juillet peut voir toutes les nouvelles productions de l’année en un Festival annuel (du 8 au 16 juillet 2017).
Du côté des reprises et du répertoire, ce n’est pas si mal et j’ai essayé de sélectionner :

Septembre 2016 : Eine Frau die weiss was sie will , d’Oscar Straus, l’ébouriffant succès de cette saison repris pour 8 représentations de septembre à décembre 2016, production de Barrie Kosky dirigée par Adam Benzwi avec Dagmar Manzel et Max Hopp. À ne manquer sous aucun prétexte si vous êtes à Berlin à cette période.

Octobre 2016 : Die Meistersinger von Nürnberg, de R.Wagner, reprise de la production d’Andreas Homoki d’il y a quelques années pour 4 représentations en septembre et octobre . N’oublions pas que Meistersinger est qualifié par Wagner de « grosse komische Oper » et a droit à ce titre à la scène de la Komische Oper de Berlin. C’est Patrick Lange, excellent chef trop peu connu qui dirigera et Hans Sachs sera Tomas Tomasson, Walther, Will Hartmann et Ev,a Johanni van Oostrum.
Rusalka de A. Dvořák pour 6 représentations d’octobre à décembre 2016, dans la mise en scène de Barrie Kosky, dirigé par Henrik Nánási, le GMD. Cela promet du très bon niveau et Nadine Weissmann, la Erda et la Waltraute de Bayreuth, sera ici Ježibaba.
Die Zauberflöte de W.A. Mozart. On aurait bien été étonné qu’une production fétiche de cette maison qui est un must, qu’il faut avoir vue, n’apparaisse pas dans les reprises de l’année. 11 représentations entre octobre 2016 et janvier 2017, sous la direction de Henrik Nánási, la production de Susanne Andrade et du groupe 1927 aura pour couple Pamina/Tamino Nicole Chevalier et Tansel Akzeybek. Manqueriez-vous cela ? Ce serait une erreur, pire, une faute.
Novembre 2016 :
Eugène Onéguine, de P.I.Tchaïkovski, dans une mise en scène de Barrie Kosky (en coproduction avec Zürich) et dirigé par Henrik Nánási, pour 8 représentations entre novembre 2016 et janvier 2017. C’est Günter Papendell un bon chanteur de la troupe, qui sera Eugène Onéguine.
Février 2017 :

Les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach, 7 représentations entre février et avril 2017 de la production de Barrie Kosky avec ses trois Hoffmann (les trois ténors : Uwe Schönbeck, Tom Erik Lie, Alexander Lewis)et son unique poupée (Nicole Chevalier), dirigé par le très bon Stefan Soltesz.
Ball im Savoy de Paul Abraham, l’opérette qu’il faut avoir vue (une de plus): dans une Nice qui ressemble à Berlin, la rouerie des femmes et la balourdise des hommes, avec un gentil diplomate turc Mustafa Bey qui aujourd’hui ferait scandale. Adam Benzwi dirige bien sûr, Barrie Kosky met en scène bien sûr, et bien sûr Dagmar Manzel emporte la joyeuse troupe. J’ai vu, j’ai rendu compte, j’ai envie de revoir. (8 représentations entre février et avril 2017)

L’incoronazione di Poppea, de Cl.Monteverdi (nouvelle instrumentation d’Elena Kats-Chernin) reprise de la production inaugurale de 2012 alors en trilogie (Orfeo, Poppea, Ulisse) de Barrie Kosky pour 5 représentations d’avril à juin, dirigé par Matthew Toogood (avril)/André de Ridder avec une distribution qui change selon les dates.
Orfeo, de Cl.Monteverdi (nouvelle instrumentation d’Elena Kats-Chernin), reprise de la production inaugurale de 2012 alors en trilogie de Barrie Kosky pour 5 représentations de juin à juillet dirigée par Matthew Toogood (juin)/André de Ridder.
Dans les reprises, on peut aussi voir Don Giovanni, My fair Lady et Carmen, mais déjà le choix est large.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Komische Oper ou qui auraient envie de faire l’expérience, je conseille inévitablement de voir une opérette, ou bien Ball im Savoy, ou bien la nouvelle production Die Perlen der Cleopatra ; comme je le répète à mes amis qui naviguent entre Wagner, Verdi et Strauss (Richard), il peut être intéressant de découvrir une autre musique, complètement différente, mais de très grande qualité. Dans le cas d’Oscar Straus, il a traversé les deux guerres mondiales (né en 1870, il meurt en 1954) et a vécu aussi bien à Berlin (où il a étudié auprès de Max Bruch) qu’à Vienne, de plus contrairement à d’autres musiciens qui ont fui le nazisme, il est revenu en Autriche où il est mort. Le genre léger de l’opérette n’est pas dédaigné outre Rhin, y compris par les grands chefs ou les grands chanteurs.
Il y a de nombreux motifs de fréquenter la Komische Oper la saison prochaine, même si on peut s’étonner que Barrie Kosky signe tant de productions. En soi, ce n’est pas une mauvaise chose dans la mesure où Kosky est vraiment l’un des metteurs en scènes intéressants de la scène lyrique européenne. Dans un théâtre où la plupart des intendants sont historiquement tous les metteurs en scène, Walter Felsenstein, Joachim Herz, Harry Kupfer (même si il a été flanqué de Werner Rackwitz, ce qui fut plutôt une chance sous la DDR, puis d’Abert Kost les dernières années) Andreas Homoki et maintenant Barry Kosky, il n’est pas absurde que l’intendant signe de nombreuses productions donnant une couleur au théâtre : humour, bonne humeur, imagination, mais aussi causticité, culture et largeur de vues sont sa signature. Sa personnalité très fédératrice soude profondément la troupe et les travailleurs de la maison, ce qui est un autre avantage. Et ce qui ne gâte rien, rares sont les productions médiocres ou sans intérêt, avec une troupe solide sans être exceptionnelle, un orchestre sans doute moins prestigieux que les orchestre des deux autres opéras, mais un GMD (Generalmuskidirektor) de très grande qualité (Henrik Nánási), la Komische Oper est un théâtre d’où l’on sort rarement déçu. [wpsr_facebook]