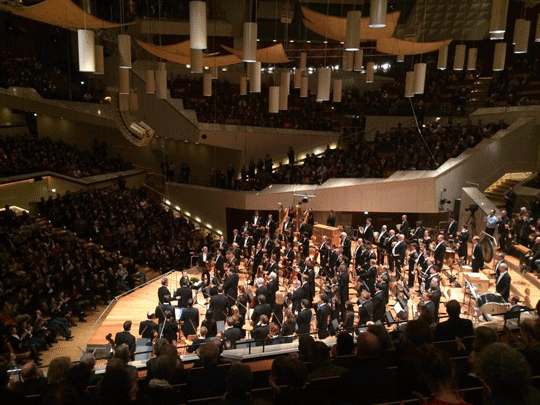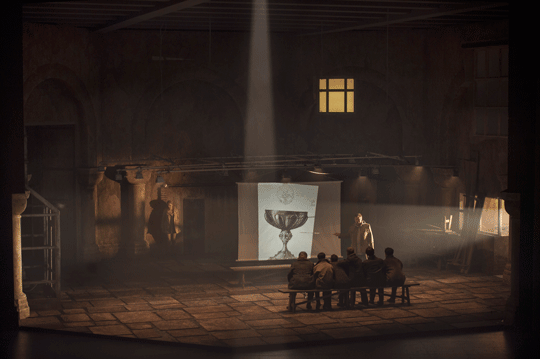
Parsifal est une des œuvres les plus discutées de l’histoire de l’opéra, et celle qui 133 ans après la création au Festival de Bayreuth, provoque des discussions passionnées : est-ce un spectacle ? est-ce une œuvre religieuse et sacrée ? est-ce du théâtre ? est-ce une messe ? doit-on applaudir après le premier acte ? doit-on ne pas applaudir du tout ? qu’est-ce qu’un Bühnenweihfestspiel ?
La multiplicité des sources, le creuset très syncrétique dans lequel Wagner a composé son œuvre, les apports chrétiens et orientaux, tout concourt à faire de Parsifal un lieu passionnant, et passionné de réflexion et de propositions.
Encore aujourd’hui, en terre germanique, il est traditionnel de représenter Parsifal à Pâques, à cause de l’Enchantement du Vendredi Saint, comme si en quelque sorte le message des Pâques chrétiennes se reflétait dans le message d’espoir, de pacification et de rédemption laissé par l’œuvre.
Je ne suis pas sûr, au vu des rapports agités que théâtre et chrétienté ont entretenus au long de notre histoire, que ce soit au théâtre qu’il faille célébrer cette religion-là.. Et faire de Bayreuth même le seul lieu où Parsifal puisse être représenté, comme ce fut le cas jusqu’à l’orée du XXème siècle au nom de règles édictées post mortem me semble pour le moins excessif. Ou bien Parsifal est une œuvre sacrée, et il faut bien vite mobiliser la cathédrale de Sienne pour en faire un mystère permanent, ou bien c’est un opéra comme un autre et l’on n’a pas à faire des simagrées comme si l’œuvre imposait une attitude religieuse qui serait alors bien proche du blasphème. En tant qu’œuvre d’art, Parsifal est bien entendu, comme d ‘autres œuvres, porteuse d’une très grande spiritualité, mais cela n’a rien à voir avec la religion, et il faudrait d’ailleurs savoir laquelle, tant les sources de Wagner et ses intérêts sont divers.
La religion a ses lieux, le théâtre les siens. Il y a certes une cérémonie théâtrale, mais elle est par définition laïque et ouverte à tout le corps social : le théâtre et la mairie sont les deux monuments essentiels des villes moyennes et grandes du XIXème, et ils font face à l’église. A chacun sa fonction.
Aussi, les efforts des metteurs en scène pour mettre en scène l’histoire, ses possibles et ses contradictions sont pleinement justifiables. On sourit à la manière dont la polémique est née à Bayreuth même, lorsqu’il fut décidé (en 1933) de changer la production originelle de Parsifal, qui tombait en lambeaux après 51 ans et 205 représentations de bons et loyaux services…
Depuis, une polémique après l’autre , Heinz Tietjen avec Alfred Roller et Emil Preetorius pour les décors (1933-1936), puis des décors de Wieland Wagner (1936-1939), puis Wieland Wagner qui déchaîna les passions avec son Parsifal sans colombe finale (1951-1973).
À Bayreuth, après Wieland Wagner, Wolfgang reprit la tradition (1974-1981), puis Götz Friedrich dans une belle production du centenaire dont on parle peu aujourd’hui, qui vit la fin de la Kundry de Leonie Rysanek et les débuts de celle Waltraud Meier (1982-1988), puis de nouveau Wolfgang Wagner de 1989 à 2001.
Depuis 2001, deux fortes productions, Christoph Schlingensief (2004-2007) d’une complexité telle qu’il est encore aujourd’hui impossible d’en démêler les fils géniaux, et Stefan Herheim (2008-2012) qui en fait une métaphore de l’histoire allemande dans une des productions les plus réussies de l’histoire récente de Bayreuth.
En 2016, un nouveau Parsifal devait être confié à l’artiste-performer Jonathan Meese. Mais son projet fut considéré comme trop onéreux (ou trop scandaleux ?), et Katharina Wagner décida de renoncer (amicales pressions?) et de le confier finalement au bien plus tranquille Uwe Erik Laufenberg, qui jusqu’ici n’a pas vraiment brillé par les idées…mais qui calmera les esprits.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, Daniel Barenboim qui a dirigé régulièrement à Bayreuth de 1981 à 1999 n’y a dirigé Parsifal (dans la mise en scène de Friedrich) qu’en 1987 alors qu’il l’a dirigé régulièrement à la Staatsoper de Berlin dont il est le directeur musical (GMD) depuis 1992.
Pour cette nouvelle production des Festtage 2015, c’est à Dmitri Tcherniakov à qui la Staatsoper de Berlin a fait appel. Il y a déjà mis en scène une Fiancée du Tsar (Rimsky Korsakov) remarquée et on lui doit à la Staatsoper unter den Linden Boris Godunov (Moussorgski) et Le joueur (Prokofiev).
Dans une salle de 900 places comme celle du Schiller Theater, jouer Wagner change singulièrement les rapports scène-salle, on l’avait déjà remarqué pour le Ring (Guy Cassiers) et Tannhäuser (Sasha Waltz) l’an dernier. Pour Parsifal, malgré la fosse très profonde, la présence de l’orchestre est accentuée, et la proximité des chanteurs et du décor monumental et fermé accentue l’impression d’étouffement, mais aussi la participation du spectateur : le jeu théâtral est sans aucun doute favorisé, voire exalté parce que le moindre geste est visible par tous, de beaucoup plus près, le spectateur est dans le drame, au plus près de la respiration du plateau. Voilà un espace (qui à l’origine est un théâtre et non un opéra) qui favorise les mises en scènes très dramaturgiques et portant l’accent sur les détails du jeu et des rapports des personnages entre eux.
En tant que spectateur assez régulier de la Staatsoper depuis qu’elle est provisoirement (et durablement) installée au Schiller Theater, je dois dire que je me sens particulièrement « bien » dans ce théâtre aux dimensions très humaines, au style un peu suranné mais chaleureux. Tout y a trouvé son style et ses habitudes.
Il y a donc de la cohérence à proposer un Parsifal « expérimental » comme l’a défini Tcherniakov dans une interview à un journal berlinois, qui mette le doigt de manière chirurgicale sur des possibles du livret et sur les contradictions de cette histoire, sans jamais néanmoins s’en écarter. Chaque épisode est clairement reconnaissable par tout spectateur connaissant l’œuvre, mais à chaque fois décalé, détourné ou interprété, voire jugé.
Tcherniakov, qui a fait les décors et les costumes, travaille à cette histoire avec sa propre culture et ses propres origines, orthodoxes, où le formalisme et le rituel sont si essentiels, et revendique son statut de totale étrangeté à ce qui se déroule. Il faut donc lire avec attention l’argument qu’il signe lui même dans le programme de salle.
La structure de l’œuvre est symétrique : premier et dernier acte sont construits de la même manière, tandis que le deuxième acte est un pivot, celui pendant lequel tout bascule. Dans le premier acte, Parsifal est ignorant, il est le « fol » évoqué dans les paroles : Durch Mitleid wissend der reine Tor , dans le dernier acte, il est « wissend » il « sait » parce qu’il a éprouvé la souffrance et la blessure lors du baiser de Kundry, il est donc de l’autre côté du savoir et peut donc sauver le monde du Graal. Le deuxième acte est presque un rite de passage, de « Tor » à « wissend », par l’intermédiaire de la Mitleid, que l’on traduit par pitié, et qu’il faut ici entendre en son sens propre « souffrir avec » une « com-passion » authentique. Le troisième acte est l’acte de résolution où la prophétie évoquée au premier acte se réalise
Parsifal n’est pas un héros venu de nulle part : comme Siegfried, comme Siegmund, comme Lohengrin, il a une généalogie très précise. Sa mère est identifiée, Herzeleide, épouse de Gamuret, chevalier mort au combat. Elle élève en conséquence son fils de manière très protectrice, dans l’isolement, pour éviter qu’il ne connaisse le destin de son père: il est donc complètement ignorant et innocent. Mais il a fui cette mère trop possessive pour vivre l’aventure des héros, et elle en est morte.
Den Vaterlosen gebar die Muter,
als im Kampf erschlagen Gamuret;
vor gleichem frühen Heldentod
den Sohn zu wahren, waffenfremd
in Öden erzog sie zum Toren – die Törin!
Voilà ce que dit Kundry au premier acte, anticipant tout ce qu’elle va apprendre à Parsifal au deuxième. Parsifal est donc violemment marqué par cette mort qu’il a par son départ provoqué.
De son côté Kundry est la femme comme Saint Augustin la voit, qui serait à l’origine du pêché et de la chute. Le jour, une sorte d’animal à la recherche obstinée de l’expiation, la nuit, une séductrice diabolique, servant donc à la fois les deux faces du monde (Ruth Berghaus qui mit en scène un Parsifal très remarqué à Francfort note fort justement que Parsifal ne présente pas deux mondes, mais deux faces d’un même monde) . Kundry n’a pas d’identité propre, c’est Klingsor qui le dit (« Namenlose »), mais dit-elle pendant le duo avec Parsifal, elle a ri au passage du Christ et depuis, frappée par le regard qu’il lui jeta, elle le cherche partout : elle est la juive à la recherche de l’expiation (raison pour laquelle Chéreau refusa de mettre en scène Parsifal à Bayreuth précisa un jour Gérard Mortier). Femme et juive, elle est donc à priori tout ce qui doit être rejeté, situation tragique où tout pardon lui est interdit, symbole d’une déchirure initiale et d’une rédemption désespérément cherchée.
Voici donc les deux personnages centraux de cette histoire, deux déchirures initiales, deux êtres perdus qui finiront par retrouver un chemin.
C’est cette histoire que raconte Tcherniakov, préférant fouiller les replis de l’âme humaine plutôt que raconter le mythe du Graal avec son cérémonial et son rituel. Du même coup pas de chevaliers, mais une communauté de pauvres hères, visible dès ce lever de soleil initial où l’on a l’impression d’être chez Emmaüs ou au « SAMU social », une communauté de rejetés de la terre, isolés, que l’on a entrepris d’éduquer dans la foi par le mythe et par une histoire qui sans doute se répète de génération en génération, l’histoire passée de la splendeur du Graal, une communauté et une ambiance où l’on imagine parfaitement un roman de Dostoïevski à qui Tcherniakov a sans doute pensé . Ce qui frappe en effet dans cette vision initiale, c’est que ce premier acte pourrait être le troisième, le temps a peu de prise et semble ne plus avancer. Tcherniakov a conçu un décor de salle octogonale romane qui rappelle le décor du premier Parsifal (la cathédrale de Sienne), mais qui est ici un espace déconsacré : plus d’élévation ni de coupole, symbole du ciel, indiquée par Wagner dès la Verwandlungsmusik du premier acte: Endlich sind sie in einem mächtigen Saale angekommen, welcher nach oben in eine hochgewölbte Kuppel d’où doit arriver la lumière. Plus de coupole, plus de lumière car le lourd plafond de béton l’empêche. Il a donc naguère fallu ouvrir un des arceaux pour construire une fenêtre, large baie par laquelle va pénétrer la lumière : c’est donc un espace reconstruit, (mal) restauré et d’une rare tristesse qui abrite les activités de la confrérie, où bancs rangés un peu n’importe comment et grill où sont suspendus de rares spots et quelques ampoules disséminées entre les arceaux donnent une luminosité vacillante à mille lieux d’un royaume triomphant.
Nous sommes de nos jours, dans une communauté vaguement sectaire qui essaie de reproduire et de se rappeler une grandeur passée mythique dont elle n’a plus qu’une vague idée, un monde fermé sur lui-même, profondément sombre et froid, un monde sans avenir.
Gurnemanz est une sorte de gardien du temple, non plus un récitant, mais celui qui entretient la mémoire et le rituel, celui qui est garant de l’ordre : lorsque les « chevaliers » s’attaquent à Kundry, il calme leur colère (Kundry, la femme, donc l’intruse de ce monde d’hommes), et puis leur raconte sans doute pour une nième fois l’histoire du Graal en leur projetant sur un écran brinqueballant mais toujours prêt à servir (d’ailleurs il est là à l’ouverture du rideau au troisième acte) les images de la splendeur passée, qui pourraient être aussi les images mythiques des splendides Parsifal du passé (décors de la création, images des personnages), avec la coupe, le Graal (on a l’impression de voir défiler les Graal remisés dans les magasins du festival de Bayreuth) mais dès que le rituel se prépare, on remet les bancs en cercle, le Graal est dans sa boite : en bref, tous les éléments traditionnels sont là, pour une cérémonie qui semble avoir perdu et sa grandeur et son sens.

La cérémonie du Graal en effet n’a rien d’une cérémonie, c’est un moment où les chevaliers cherchent à se régénérer pour vivre l’éternité, plus de religiosité, mais une chasse à la survie, dont le symbole est Titurel, habillé en redingote de cuir noir (toute allusion…) qui pour une fois n’est pas la voix désincarnée qu’on entend d’outre tombe, mais un vrai personnage dont la présence est pesante et l’exigence visible.
Pour souligner le rituel de régénérescence, il arrive, monte dans son cercueil recouvert d’un linceul, puis du fond du cercueil conformément au texte (Im Grabe leb’ich durch des Heilands Huld ) il émet ses exigences Mein Sohn Amfortas bist du am Amt ?
Alors qu’au-delà de sa souffrance, Amfortas n’est pas toujours un personnage intéressant (on se souvient ce qu’en avait fait en 2013, avec le même chanteur – Wolfgang Koch –la pauvre production de Michael Schulz au Festival de Pâques de Salzbourg), ici au contraire il devient central car il est celui dont se repaissent tous les autres. Il est réincarnation du Christ en croix, presque nu, à la source duquel les chevaliers avides de survie viennent se désaltérer : un servant prend du sang directement de la blessure pour le mélanger dans le Graal à de l’eau qu’on suppose bénite, comme la même coupe recueillit selon la légende le sang du Christ. Amfortas est littéralement saigné pour le bien de la collectivité, et Tcherniakov insiste sur une situation qui nous donne à voir le sacrifice permanent et surtout l’esclavage de ce roi soumis aux exigences du père, qui reste la clef de voûte de l’ensemble du groupe, comme en témoigne au premier acte la soumission finale des chevaliers à Titurel, tout frais régénéré sortant de son cercueil et leur prosternation la face contre terre, comme dans certains rites chrétiens orientaux, attendant la descente de la Parole.

La cérémonie du Graal est donc métaphoriquement le sacrifice du Christ (le fils) pour la gloire de Dieu le père. C’est important à noter pour comprendre ce que Tcherniakov fera du troisième acte.
Ce monde qui se ressource par la souffrance expiatoire de l’autre, c’est l’idée même du christianisme, où Christ est mort pour nous. Mais Tcherniakov y ajoute une extraordinaire violence,et en fait un monde sans chevaliers mais composé d’humains vivant dans le froid (bonnets, lourdes jaquettes) et dans cette obscurité à peine éclairée et d’où se dégage un sentiment de pesanteur glaciale, et surtout ni sérénité ni grandeur.

Dans ce monde complètement enfermé sur lui même, nos deux personnages clés apparaissent complètement en marge : Parsifal est un ado retardé, bermuda, baskets, capuche et sac à dos : une sorte de jeune randonneur à la mode d’aujourd’hui dont le sac à dos, renferme tout le nécessaire pour se changer, ce qu’il fait ostensiblement, après avoir secoué ses chaussures des éventuels cailloux, et étendu le tee shirt sans doute imbibé de sueur, il se retrouve torse nu au milieu de tous ces gens emmitouflés. Il fait littéralement “tache”, mais apparaît complètement organisé, autonome et en rien perd, errant, ou peureux.
Quant à Kundry, elle est en pantalon, jaquette, sac de cuir, voyageuse elle aussi, comme Parsifal, mais violemment prise à partie par les autres, LA femme dans ce monde d’hommes est donc a priori soupçonnée ou coupable comme il a été précisé plus haut. La relation à Kundry, toujours méfiante dans la plupart des mises en scène de ce premier acte, est ici franchement violente. D’ailleurs, la manière dont Parsifal est plaqué à terre à peine a-t-il atteint le cygne (symbole de la sensualité dans la mythologie nordique) est elle aussi empreinte de violence : le monde du Graal vu par Tcherniakov n’a rien de ce monde éthéré ou pacifié, mais c’est au contraire un monde de violence rentrée qui n’attend que la moindre occasion pour s’exprimer.

Le lever de rideau du deuxième acte est au contraire une image stupéfiante et inattendue : même décor qu’au premier acte, mais blanc immaculé, inondé de clarté et de lumière : Klingsor a bien construit son royaume à l’image de celui dont il a été chassé, honorant un autre Graal… C’est un Klingsor grand-papa distribuant des friandises ou des jouets à un groupe de filles (fillettes, petites filles, vraies jeunes filles) en robes à fleurs et chaussettes qui jouent qui à la balle qui au cerceau. Bref, un monde apparemment innocent qui renforce l’impression de tension du 1er acte, un monde du bonheur et de la joie et non un monde écrasé sous le poids du péché comme au premier acte.
Mais très vite, Tcherniakov nous fait déchanter : le vieux Klingsor est un pépé-gâteau, sans doute, mais bourré de tics, qui se déplace comme souvent les metteurs en scène font déplacer Mime, auquel il renvoie inévitablement. Mime n’a rien d’un personnage positif, et c’est un papa de substitution plutôt dangereux, et l’on constate très vite que ce Klingsor est un malade, méchant (voir comme il essaie de réveiller Kundry), fantasque (voir aussi comment il s’amuse à tourner sur sa chaise), et l’on comprend quelle violence perverse il exerce : Tomas Tomasson qui l’interprète est stupéfiant de vérité. Dans ce monde de petites filles (ses filles, dit Tcherniakov dans l’argument), Kundry, la seule qui puisse visiblement sortir de ce monde, arrive comme la grande sœur ou la fille préférée à qui l’on confie les missions délicates (on pense à Wotan et Brünnhilde dans la Walkyrie) et s’assoie au milieu des autres disposées en cercle comme les chevaliers au premier acte. Nous sommes au milieu d’une étrange famille ou d’une autre étrange communauté. Beaucoup ont vu en ce Klingsor un pépé pédophile : c’est dans la société d’aujourd’hui une image de mal absolu. Il faut en tous cas y voir d’abord les mécanismes de soumission au « Maître » (le mot Meister est prononcé par Klingsor plusieurs fois) et d’impossibilité pour toutes ces filles sans doute violées (ce qui probablement arriva à Kundry la première) de se libérer de leur bourreau. La pédophilie de Klingsor devenant une manière de recherche éperdue de pureté à travers la possession des enfants, comme en témoigne aussi la blancheur qui aveugle en ce lever de rideau.
Mais Klingsor arrive avec difficulté à convaincre Kundry de servir ses projets : Kundry la nocturne garde quelque chose du jour qu’elle a servi, et vice versa. Elle n’est jamais tout l’un ou tout l’autre, d’où l’intérêt de la scène avec Parsifal, où il est difficile de démêler le dessein de Klingsor ou le dessein personnel, sauver le royaume de Klingsor, se sauver elle-même ? D’où l’enjeu très ambigu de la scène de séduction.
Après avoir demandé aux (petites) filles-fleurs de lui laisser la place, Kundry entreprend de convaincre Parsifal, selon le déroulement traditionnel du livret. Kundry évoque d’abord la blessure profonde de Parsifal, née dans les replis des souvenirs d’enfance : Tcherniakov fait apparaître à la fois le jeune Parsifal qui joue avec un cadeau de sa maman, un petit chevalier qui tourne sur lui-même, image du rêve de rejoindre les exploits du père, rêve de chevalerie, rêve guerrier (Parsifal est un guerrier, comme son père) et qui découvre la sensualité avec une jeune fille, mais, surpris par sa mère, il est chassé pendant que la jeune fille est giflée.
La mère est à la fois celle qui procure le rêve de combats et la castratrice qui marque l’interdit du désir. Tous les éléments déclencheurs sont donc en place : Parsifal et Kundry de chaque côté du spectre, sont liés par des problèmes similaires, enfouis dans les profondeurs de l’enfance et chacun dans cette scène va essayer de résoudre ses propres nœuds. Le baiser de Kundry,
als Muttersegens letzten Gruss –
der Liebe – ersten Kuss! a l’ambiguïté du baisers interdit de l’inceste. Tout bascule quand ce baiser réveille à la fois les souvenirs enfouis et ceux plus récents qui font du désir et de la femme l’interdit suprême : Parsifal et Kundry se sont alors isolés hors du plateau, et Parsifal rentre violemment en scène (Amfortas, Die Wunde !) torse nu, bientôt suivi par Kundry en tricot et culotte. Il s’en suit une scène d’une rare tension, et en même temps d’une rare crudité où Tcherniakov essaie de montrer une vraie scène de violence entre un homme qui se refuse et une femme blessée: Parsifal est très tendu, bien plus Siegfried que Lohengrin, bien moins éthéré que dans d’autres mises en scène et surtout avec d’autres interprètes : il y a dans sa manière de chanter une extraordinaire violence et une grande virilité. Le jeu de la séduction, puis le jeu de la supplication, puis le désespoir et l’appel à l’aide, chaque étape de la scène avec Kundry, qui est à elle seule l’essentiel de l’acte II est respectée, mais Tcherniakov la règle comme une vraie scène de rupture, une scène de couple avec son intimité presque gênante, et en même temps une scène où l’enjeu est des deux côtés, alors qu’on n’a pas trop l’habitude de considérer la question de Kundry. Or Kundry est vécue comme ces femmes incapables de se libérer de leur « maître » et qui voit en Parsifal la « possibilité d’une île ».
Dans le rapport très marqué que Kundry entretient avec Klingsor, il y a cette dépendance dont elle ne réussit pas à se libérer, d’où ce tout pour le tout face à Parsifal. De son côté, Parsifal passe d’ado retardé à jeune adulte décidé, près à rejoindre le Graal : il abandonne d’ailleurs le bermuda, enfile un pantalon, et se couvre d’une veste de cuir noir qui fait penser au long manteau de cuir de Titurel : il est prêt. Kundry quant à elle se recouvre du vêtement taché de sang d’Amfortas qu’elle a ramassé précieusement à la fin du 1er acte comme une relique, comme le souvenir de quelque chose de profond (qu’on découvrira au 3ème acte).

Par ce jeu de costumes, Tcherniakov montre que quelque chose a basculé. De même Parsifal passe-t-il lui aussi une épreuve du sang : lorsque Klingsor arrive pour « aider » Kundry avec la lance, c’est Parsifal qui transperce Klingsor sous les yeux horrifiés des (petites) filles-fleurs au lieu de faire le traditionnel signe de croix (il n’y a d’ailleurs dans toute la mise en scène aucun véritable indice religieux ou de religiosité) et le sang gicle sur son visage. C’est le combattant qui transparaît ici et non celui qui par un signe de croix (Mit diesem Zeichen bann’ ich deinen Zauber) efface la magie. Car le royaume de Klingsor ne disparaît pas, ne s’écroule pas : Parsifal vient d’assassiner un quelconque Dutroux, laissant dans le désarroi les jeunes filles et la grande sœur prisonnières de leur liberté nouvelle. L’acte II s’était ouvert sur une « image » de bonheur, il se clôt sur un meurtre de profonde interrogation suspendue : c’est la dévastation qui domine.
L’acte III apparaît comme une réplique de l’acte I, même espace, un peu plus désordonné, mais avec l’écran suspendu un peu abandonné (on suppose que l’éternelle histoire du Graal a dû être répétée puis radotée à l’infini), un cercueil fermé et délaissé apparaît côté jardin.
Seul signe du temps qui a passé, non pas un temple ruiné, non pas une nature dévastée, mais un Gurnemanz à la longue barbe désordonnée, signe de négligence plus que de vieillissement, et des bancs disposés sens dessus dessous. Mais l’impression est la même qu’au premier acte, obscurité, tension, pauvreté.
Kundry apparaît émergeant d’une sorte de long sommeil, reconnue par Gurnemanz, puis Parsifal arrive : il a troqué son sac à dos de randonneur contre un sac à dos militaire, ses Nike contre des knickers. Il est armé de la lance, bientôt reconnue par Gurnemanz. Il se débarrasse de ses affaires, ouvre son sac, en sort le petit chevalier tandis que Kundry sort une poupée, chacun face à face avec ses doudous d’enfance, chacun unis comme au premier acte, comme au deuxième acte, par les blessures lointaines. Et d’ailleurs cette union, cette communauté de destin fraternels, se lit dans les attitudes : Parsifal ne cesse de regarder Kundry, il la regarde avec une infinie tendresse, pendant que Gurnemanz raconte ce qui s’est passé dans la communauté. Gurnemanz demeure complètement exclu de ce moment d’une rare intensité : l’Enchantement du vendredi saint, ce sont ces retrouvailles entre Kundry et Parsifal. Un seul exemple de cette manière très particulière qu’a Tcherniakov de voir les choses suffit à le montrer : alors que Heil mir, dass ich dich wieder finde! devrait être adressé à Gurnemanz selon la didascalie écrite par Wagner dans le livret, Parsifal l’adresse à Kundry, rappelant ainsi la dernière réplique du deuxième acte Du weisst,
wo du mich wiederfinden kannst!
C’est donc cette attitude tendue l’un vers l’autre qui frappe en cette première partie de troisième acte, où Parsifal écoute d’une oreille distraite un Gurnemanz subitement renvoyé au niveau d’un vieux radoteur, et où il est fasciné par Kundry, au point qu’on imagine un amour naissant. En réalité, il y a dans ces retrouvailles celles de deux destins croisés, chacun poursuivant sa propre libération au travers de l’autre.
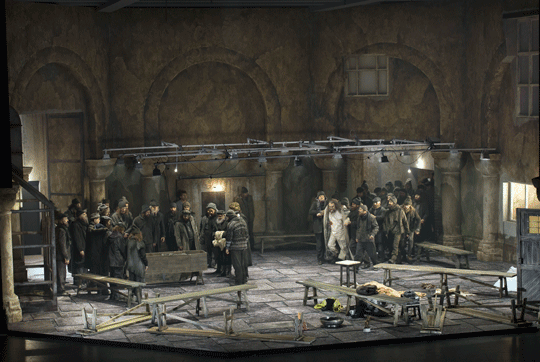
La cérémonie du Graal, si l’on peut encore appeler cela cérémonie, est marquée par le personnage d’Amfortas, courant seul dans l’espace vide, allant s’allonger sur le cercueil qu’on comprend être le cercueil paternel, volonté de mort, obsession du père. Mais en même temps image d’énergie (Amfortas court) complètement en contradiction avec son arrivée immédiatement après soutenu par deux hommes et incapable de marcher, comme s’il y avait deux Amfortas et si tout cela n’était qu’apparence…
La scène est d’ailleurs d’une violence encore supérieure à celle du premier acte : Amfortas évite tous les symboles pour lesquels il doit officier, ouvre brutalement le cercueil en fait tomber violemment le cadavre de Titurel, jette au loin la châsse enfermant le Graal, et se fait littéralement agresser par tous les autres.
L’intervention de Parsifal se fait étrangement par la même position qu’à l’acte II quand Parsifal tue Klingsor. Dans l’un la lance tue et dans l’autre la lance régénère, elle est jetée aux pieds du corps d’Amfortas épuisé, comme si Parsifal voulait s’en débarrasser. Tcherniakov écrit d’ailleurs dans l’argument que « Parsifal rend à Amfortas la lance perdue ».
Il n’y a pas, comme dans la plupart des mises en scène, de mise à l’écart d’Amfortas pour célébrer la cérémonie du Graal : pendant que la foule des chevaliers se régénère, Amfortas se lève et Kundry vient à lui : il est faux de dire qu’il n’y pas de rédemption. Kundry est la juive qui a ri du Christ et qui l’a recherché partout ensuite, comme nous l’avons dit plus haut. Amfortas est la réincarnation des souffrances du Christ, et il est sauvé par Parsifal (Erlösung dem Erlöser est la dernière parole de l’opéra), Kundry reconnaît en lui le sauveur qu’elle a jadis moqué, et Amfortas retrouve le regard qui avait tant frappé Kundry: voilà la rédemption de Kundry, qui en échange donne un baiser gratuit. Tcherniakov en fait la naissance du désir libéré de l’interdit et dans ce final complètement éthéré, introduit un long baiser d’amour enfin libre et débarrassé de toute culpabilité, pendant que Parsifal les regarde, ravi. De l’amour sans scandale et du plaisir sans peur pourrait-ils dire, comme Tartuffe…
Mais le livret prévoit la mort de la femme, puisque, même (ou parce que) rachetée, comme Marguerite de Faust, Kundry doit mourir.
Cette mort n’est pas une mort extatique comme pourrait l’être celle l’Elisabeth de Tannhäuser (autre histoire où la sensualité et l’amour sont profondément séparés), Tcherniakov ne veut pas d’une Kundry subitement sanctifiée, mais plutôt une Kundry mourant parce qu’elle est devenue une femme libre débarrassée du poids du péché originel. Ce sera donc une mort donnée par la violence du fanatisme : elle est poignardée dans le dos par un Gurnemanz qui ne supporte pas la vue du baiser entre Amfortas et Kundry, parce que dans la communauté, il n’y pas de place pour la femme et ses dangers, pour le désir et ses dangers, pour l’amour entre l’homme et la femme et peut-être pour l’amour simplement.
Kundry s’écroule, Parsifal prend le cadavre dans ses bras et fuit.
Il laisse la communauté seule, Amfortas seul et les « chevaliers » dans une sorte de transe, les yeux révulsés tournés vers le ciel, dans une absence totale de sens, sinon le constat que toute communauté fermée est condamnée au vide parce que le simplement humain n’y a pas de place.
En respectant presque à la lettre le livret, Dmitri Tcherniakov propose un message complexe, sur l’individu face aux dérives de notre monde: face aux manifestations extrêmes de la religiosité, quand elle confine au fanatisme, comme face aux comportements les plus pervers, il voit les dangers de la dépendance et de l’isolement . Il délivre un message d’une totale simplicité, d’humanité, de tolérance et d‘amour et de revendication profonde de l’individu face aux dangers du groupe.
C’est là son Parsifal, à la fois simple et dérangeant parce que là où l’on glorifie habituellement la célébration mystique, il la détricote en en montrant le mécanisme pervers. Là où l’on a, bien installée en nous, la certitude qu’il y a le bien d’un côté et le mal de l’autre, il nous dit que les frontières n’en sont pas si nettes et que le monde est totalement et l’un et l’autre, et que nous sommes donc et l’un et l’autre.
Il fallait à ce spectacle très discutable, mais d’une très grande intensité, d’une profonde sensibilité et d’une évidente intelligence une réalisation musicale à la hauteur. Elle le fut grâce à une distribution de très haut vol et surtout grâce à une direction musicale qui fait écho à la mise en scène en l’accompagnant avec attention et précision. Elle le fut aussi parce que Barenboim a voulu qu’entrer dans Parsifal c’était entrer en Parsifal, c’est à dire entrer dans une musique qui exige une concentration particulière : quand le noir se fait, un long silence s’installe volontairement avant le début de la musique et quand le rideau tombe à chaque acte, le même noir continue avant l’arrivée de la lumière en salle, imposant des applaudissements très timides aux entractes et une sorte de continuité. Entrer dans un tunnel en somme et n’en sortir qu’au bout des 4h30 de musique et donner à l’ensemble des artistes, chœur, orchestre, solistes chef et même metteur en scène le 18 avril la standing ovation qu’ils méritaient.
Certains ont trouvé que le premier acte était long (1h48) et donc ont décrété que la direction manquait de tension ou de dynamique . S’ils allaient voir, simplement voir les longueurs comparées des actes, ils constateraient qu’Hermann Levi le créateur faisait un premier acte de 1h47 et que la plupart des chefs (Richard Strauss compris, et même Knappertsbusch) tournent autour de cette durée. Seuls à Bayreuth, Arturo Toscanini et James Levine dépassent les deux heures dans le premier acte, Daniele Gatti était assez lent, mais plus encore au troisième acte, et les plus rapides sont Pierre Boulez (1h35 à 1h38 entre 1966 et 1970) et Hans Zender (1h33). Alors je veux bien que Barenboim soit trop lent, mais trop lent par rapport à qui ?? et à quel Parsifal rêvé?? D’ailleurs, Barenboim lui-même varie les tempi d’une représentation à l’autre, il n’est jamais métronomique.
En réalité, la durée n’est pas pour moi un critère dans Parsifal, car c’est une œuvre qui supporte des tempi différents sans être affectée. À vrai dire, je ne me pose pas la question car quelle que soit l’approche musicale, Parsifal reste une œuvre fascinante et toutes les options musicales sont défendables, comme l’a bien montré Boulez.
Ce qui frappe dans la direction de Barenboim, c’est d’abord sa clarté, son relief, c’est surtout la capacité à varier les accents et à accompagner dramatiquement ce qui se passe en scène. C’est aussi, dans une fosse un peu difficile, de ne jamais vraiment couvrir les chanteurs. L’épaisseur de la partition est sans cesse mise en valeur, la qualité des cordes et des bois permet des effets d’écho très élaborés et le sens dramatique de Barenboim fait de l’acte II un moment d’une intensité rarement atteinte, avec une dynamique pour le coup exemplaire.
Le prélude de l’acte III est aussi un des grands moments de l’exécution, où même les moments qui habituellement sont spectaculaires à l’orchestre (on pense à la Verwandlungsmusik de l’acte I ou de l’acte III par exemple) restent tendus et retenus à cause d’un spectacle justement aussi peu spectaculaire que possible. Il y a chez Barenboim une volonté tragique, une certaine noirceur qui domine l’ensemble de son travail, mais aussi des moments d’une indicible émotion, où il joue sur les cordes d’une manière incroyablement sensible et sentie. Certes, notamment le 18 avril, il y a eu quelques scories sur les cuivres, mais pas le 12 avril. Il reste que l’ensemble de sa direction démontre une immense sensibilité et une incroyable intelligence du texte : Daniel Barenboim est l’un des grands maîtres de l’univers wagnérien et il le démontre une fois de plus.
Il est vrai qu’il dirige une de ces distributions qui laissent l’auditeur émerveillé par la prestation ou l’incarnation collective, avec un engagement de chacun dans le respect des exigences de la mise en scène, très crue par moments notamment pour Amfortas (Wolfgang Koch) ou pour Kundry (Anja Kampe).
Les filles fleurs sont très homogènes, et plus le 18 que le 12, les aigus sont bien négociés et moins métalliques et les parties plus lyriques très réussies. La situation scénique fait que le chant enjôleur des filles-fleurs apparaît ici bien plus un jeu d’enfant artificiel, auquel finalement on prête peu attention : les choses sérieuses vont arriver après, mais il est intéressant de voir comment par l’art de la mise en scène la perception de la musique se transforme et se gauchit.
On est heureux aussi de retrouver Matthias Hölle, une des grandes basses de référence de Bayreuth entre 1981 et 2001, où il a à peu près chanté tous les grands rôles de basse, de Titurel à Gurnemanz en passant par Hunding et Marke. Il est un Titurel présent et non pas seulement une voix, avec grande allure. Et la voix reste puissante et marquée. Même pour quelques répliques, Titurel est un rôle important, il l’est d’autant plus dans cette mise en scène qu’il est le véritable maître des lieux.

Wolfgang Koch en Amfortas est bien plus intense qu’à Salzbourg. Son timbre reste très velouté, jamais agressif, mais vibrant avec une voix toujours bien projetée et une diction parfaite : il n’est jamais question de puissance ou de sons dardés (ses erbarmen ! sont intenses sans être un modèle de puissance) c’est inutile dans une salle aux dimensions aussi raisonnables, mais la voix est si bien projetée que tout passe sans problème. L’interprète et le jeu frappent tout autant, car la mise en scène exige beaucoup, et se retrouver en boxer en scène jouant le Christ sans être vaguement ridicule montre en même temps son extraordinaire présence et la puissance de l’incarnation. Car Amfortas est sans doute avec Parsifal et Kundry le personnage le plus fouillé de ce travail, c’est l’homme au sens de Ecce homo, il est homme et il est Christ, mais il est plus homme que Christ, c’est sa grandeur, et c’est sa faiblesse.
L’autre révélation, si l’on peut dire d’un chanteur déjà si connu, est le Klingsor de Tomas Tomasson, prématurément vieilli, extraordinaire de vérité dans son rôle de pépé pas si gâteau que cela. Il est difficile de trouver un bon Klingsor (Thomas Jesatko avec Herheim et Gatti à Bayreuth en était un), et souvent le rôle assez court est donné à des barytons basses en fin de carrière, d’où souvent des éructations, ou des aigus mal négociés.
La voix est ici impeccable, aussi bien dans la projection, dans l’expressivité, dans les accents, dans la couleur et d’autant plus impressionnante qu’elle cadre mal avec le personnage de gentil pépé. C’est incontestablement une voix de méchant, une voix qui joue magnifiquement sur les couleurs. C’est vraiment une magnifique référence dans ce rôle souvent sacrifié.
René Pape est un Gurnemanz de référence, il se partage le marché des grands théâtres avec Kwanchul Youn, dans un style très différent. Le 12, il était un peu fatigué et a fait faire une annonce, le 18 il était tel qu’en lui même, puissant, avec des aigus d’une incroyable tenue, des graves sonores et surtout un travail particulièrement approfondi sur la différence entre la couleur du I et la couleur du III, plus ouvert et plus jeune au I, plus voilé et plus sombre au trois. Ce timbre reste stupéfiant : à New York avec Gatti il m’avait littéralement bluffé, à Berlin avec Barenboim, il fait de la ciselure, jouant avec les accents, avec chaque mot entendu distinctement grâce à une incroyable diction et un véritable effort sur le ton. De plus, le travail scénique, les gestes, les mouvements sont confondants de naturel. Anthologique, comme toujours.
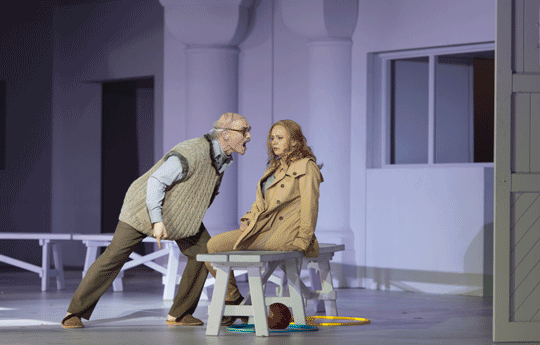
Mon opinion sur Anja Kampe est en train d’évoluer sensiblement. Je n’ai jamais douté de ses qualités scéniques et de son engagement toujours éminents, mais sa Leonore à la Scala m’avait déçu (elle ne m’avait jamais vraiment convaincu dans ce rôle) ainsi que sa Senta, et j’ai toujours eu l’impression qu’elle n’avait pas les moyens vocaux des rôles auxquels elle prétendait, qui sont les purs rôles de soprano dramatique. Elle a, c’est encore clair ce soir, très peu de réserves sur les notes très hautes, où le timbre devient métallique et proche du cri, et où elle n’arrive pas à négocier les passages de manière homogène. Mais quel engagement par ailleurs, quelle vérité, quel personnage, quels accents, quelle intelligence du texte, quelle interprète ! Son duo du deuxième acte est hallucinant : elle joue dans des conditions physiques (en tee shirt et culotte) plutôt difficiles (un peu comme Koch au premier acte) et elle transcende le personnage. Loin d’en faire un suppôt du démon, une femme fatale étendue sur son divan au milieu des fleurs du jardin de Ravello, Tcherniakov lui demande de travailler la vérité du personnage et sa quête, il en résulte qu’elle apparaît toujours sincère et engagée et jamais ambiguë lorsque le moment du fatal baiser est passé. Elle séduit avec ses moyens, n’étant jamais autre chose que ce qu’elle a été au premier et ce qu’elle sera au dernier acte, dans une sorte de continuité de l’image féminine, et elle est d’une classe incroyable. À vrai dire je suis émerveillé de la performance. Elle m’avait impressionné dans Walküre, elle me secoue dans Kundry. Depuis Waltraud Meier, je n’ai jamais vu une telle présence, et dans un style tout différent. Waltraud Meier est la duplicité, et la femme vampire, elle a cette extraordinaire capacité à personnifier quelque chose de négatif et diabolique, avec une puissance inouïe. Anja Kampe est à l’opposé une femme non dénuée de fragilité, plus humaine et moins distanciée, mais aussi impressionnante, mais aussi convaincante et vocalement splendide.
Andreas Schager s’installe peu à peu sur le marché des ténors dramatiques. Il sera Parsifal en 2017 à Bayreuth, il a été déjà Siegfried avec Barenboim et même Tristan dans des théâtres moins exposés (comme Meiningen). Il compose un Parsifal parfaitement en phase avec la mise en scène, il en a le physique juvénile, le style et il est stupéfiant de vérité dans l’adolescent retardé qu’il incarne au premier acte. Le timbre est chaleureux, la voix est assez large, les aigus assurés. Parsifal n’est pas le plus difficile des rôles wagnériens, il est assez bref, mais doit justement convaincre d’autant plus. Il y a des Parsifal éthérés (Vogt) d’autres très intériorisés (Kaufmann) certains vocalement magnifiques sans avoir le physique (Botha) et une série de bons chanteurs qui ne marquent pas vraiment le rôle comme Christopher Ventris ou Burkhard Fritz. Plus loin dans le passé il y eut des légendes comme Domingo ou Vickers. À l’Opéra de Paris dans les années 70 on a eu tout ce que l’opéra comptait comme grands Parsifal, Helge Brilioth, René Kollo, James King, Jon Vickers, seul Peter Hoffmann a manqué à l’appel, mais il fut pour Paris Siegmund.
Andreas Schager a un physique assez frêle qui convient bien au personnage, et une voix au contraire assez large et puissante, qui lui permet d’aborder le rôle de manière plus héroïque que ses collègues actuels, dans ce Parsifal là pointe Siegfried. Il a les aigus, le medium large et triomphant, il lui manque quelquefois un peu de grave, mais c’était plus net le 12 que le 18 avril et il est doué d’une diction exemplaire de clarté et d’accents.
Il affiche l’agressivité du jeune héros, il en a aussi l’effronterie et l’engagement, il a même une certaine nervosité, mais il a aussi le lyrisme et la douceur, et donc la versatilité et la ductilité nécessaires. C’est un Parsifal à la fois émouvant et dur. Il réussit aussi au troisième acte, et déjà au deuxième acte, à incarner un personnage mûri, décidé, affirmé. Une vraie composition, qui le fait rentrer totalement dans la mise en scène, avec une aisance rare. Un magnifique Parsifal d’emblée installé au sommet.
Après ce long compte rendu, il me paraît inutile de revenir sur une interprétation musicale totalement convaincante, de la fosse au plateau et un Barenboim superlatif.
Je sais en revanche que la mise en scène a laissé des doutes : il est difficile de renoncer aux habitudes et à une vision confortables du drame wagnérien. Mais l’inconfort vient surtout qu’au lieu de nous projeter dans un Eden espéré, Tcherniakov nous renvoie à nous mêmes, nos espoirs et nos contradictions, nos perversions et nos faiblesses. Cette crudité là est insupportable.
Il reste sur scène un Amfortas sauvé et humain…après tout c’est déjà beaucoup.[wpsr_facebook]