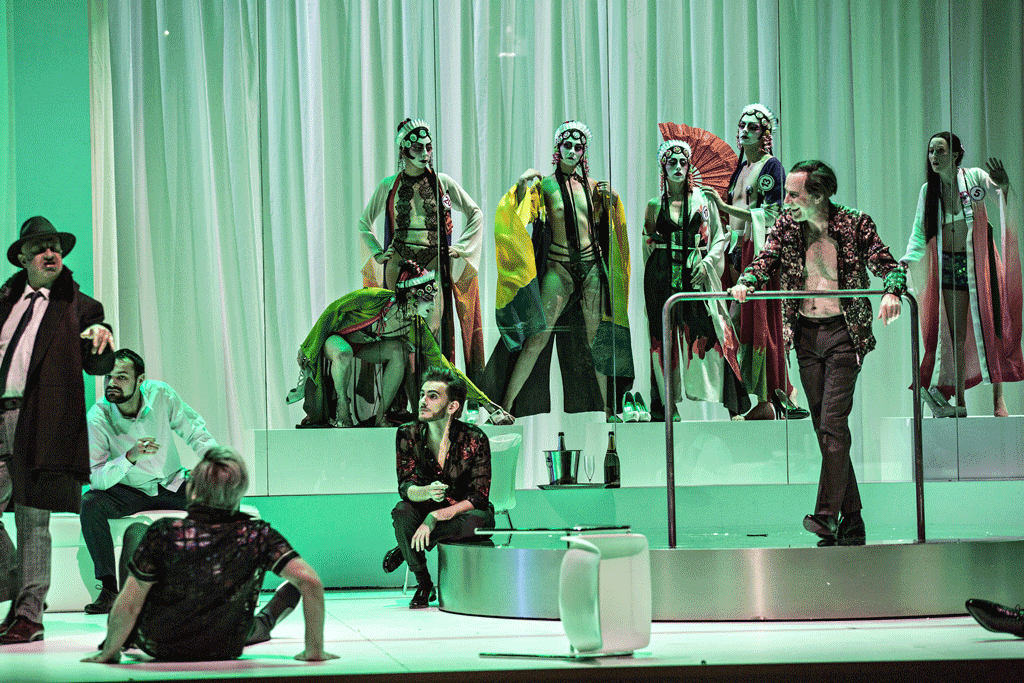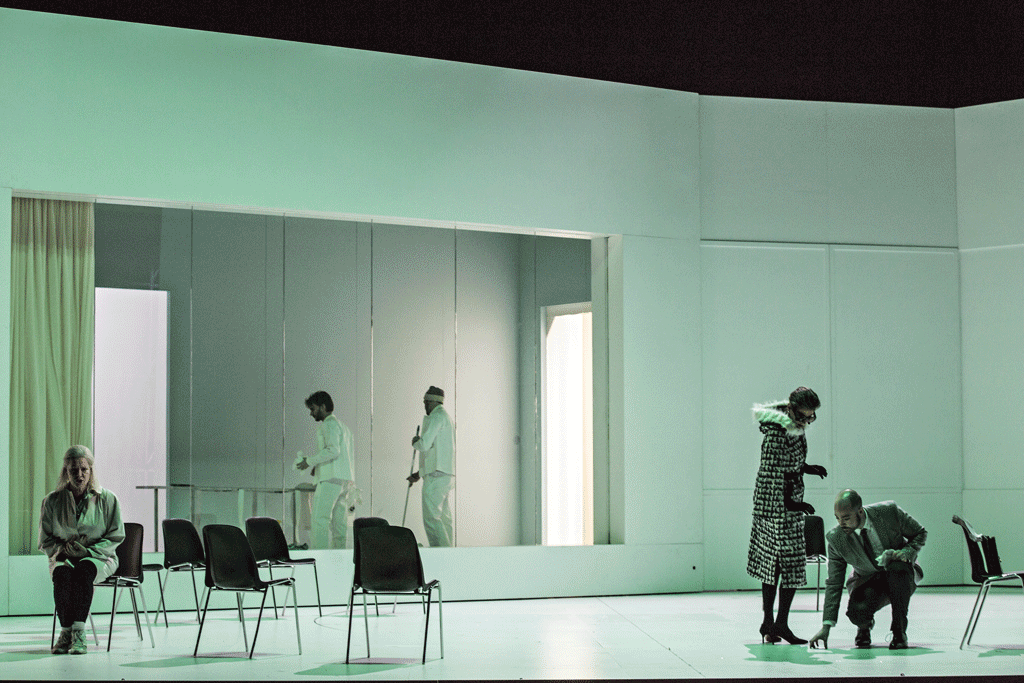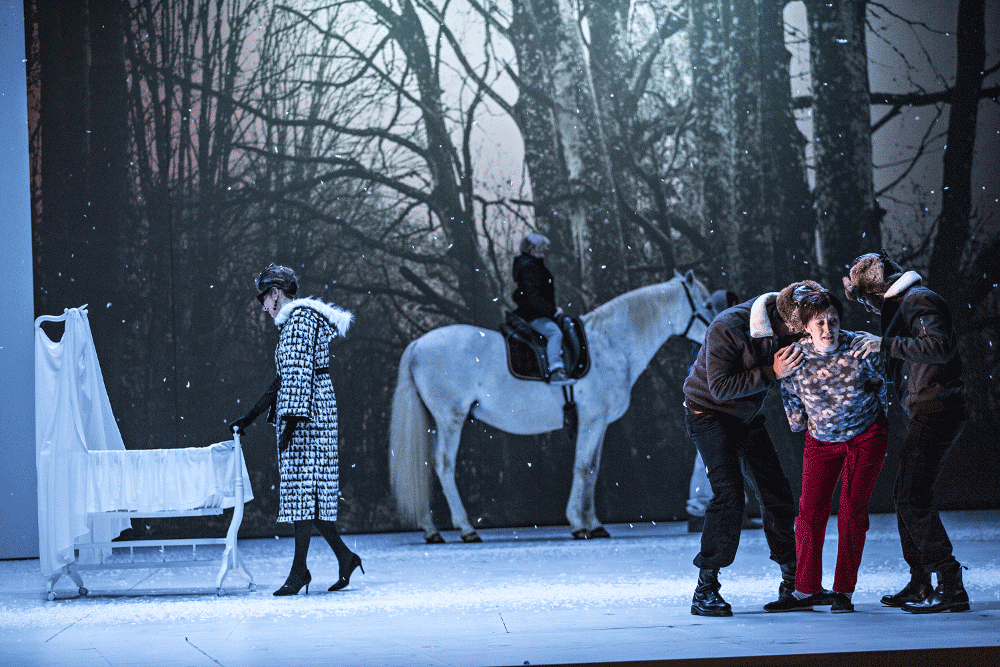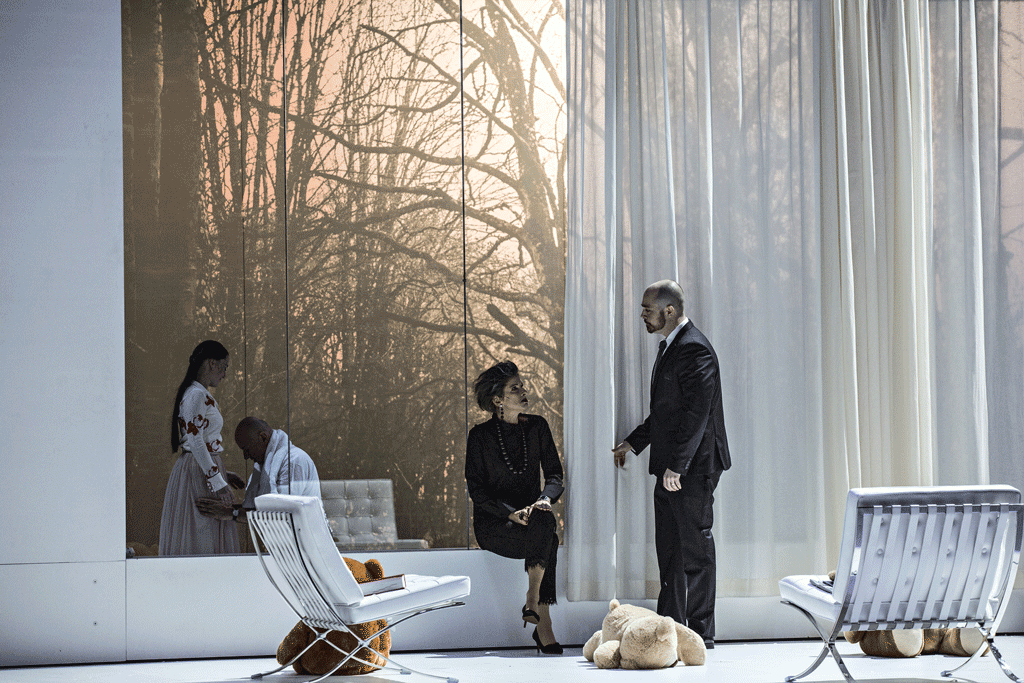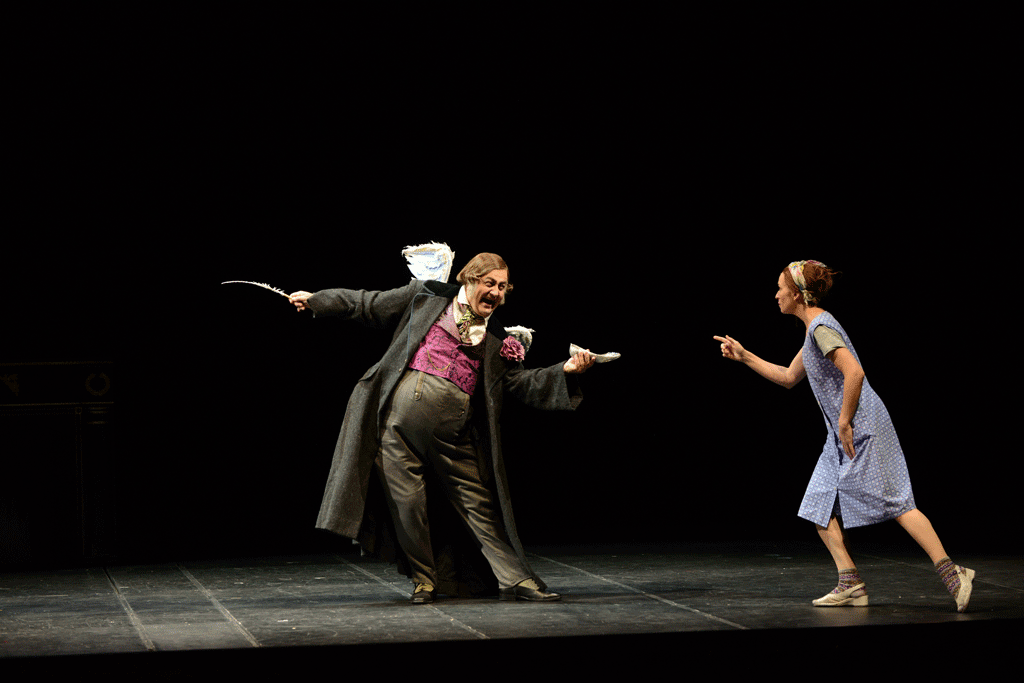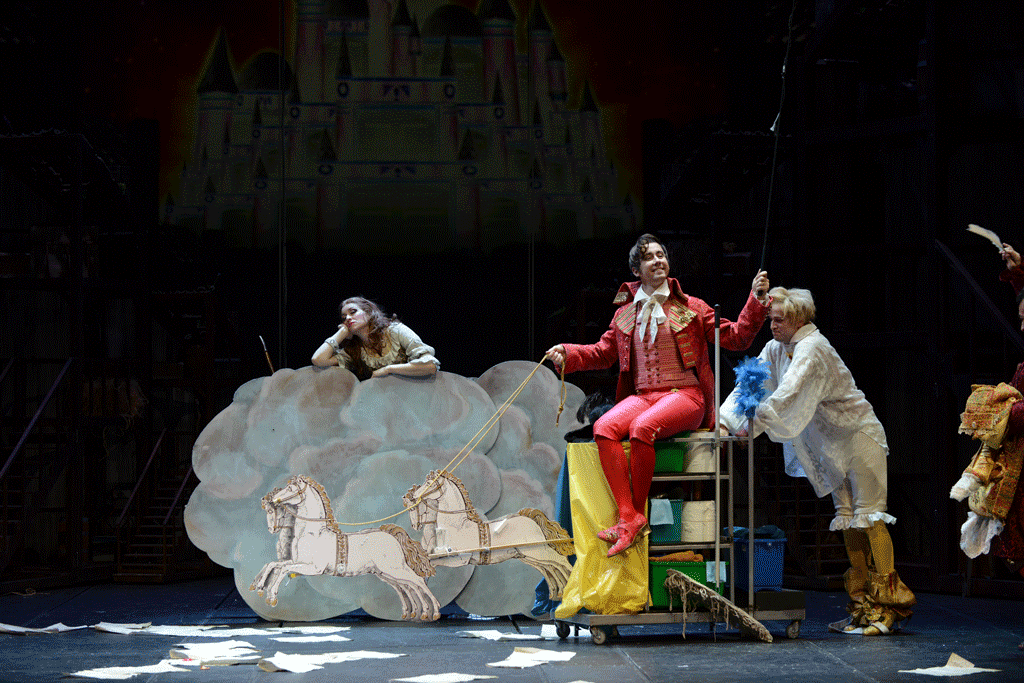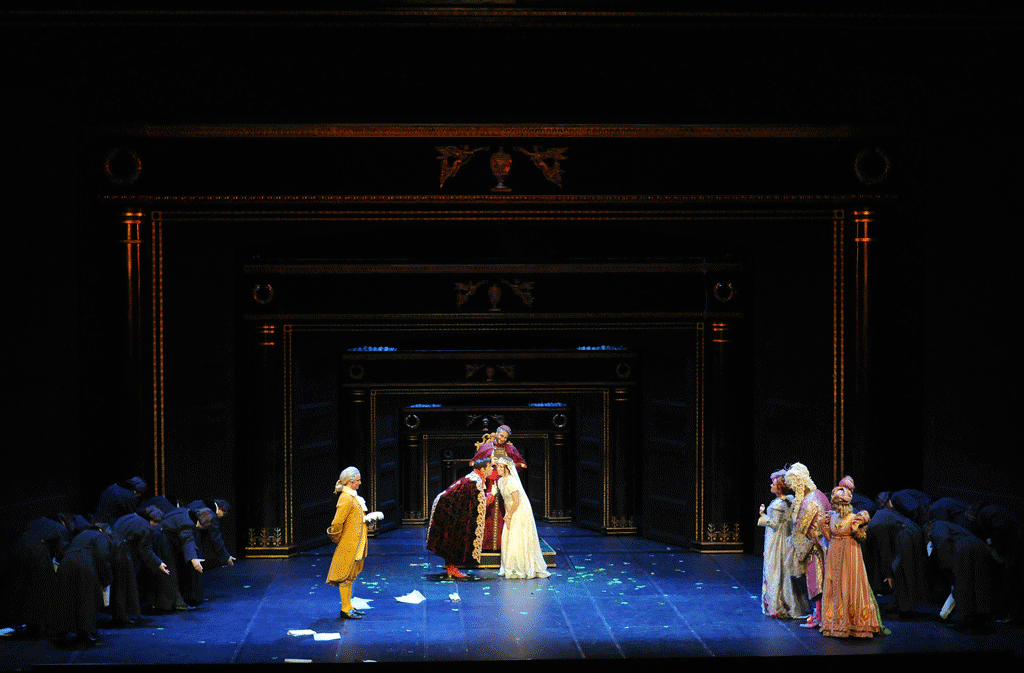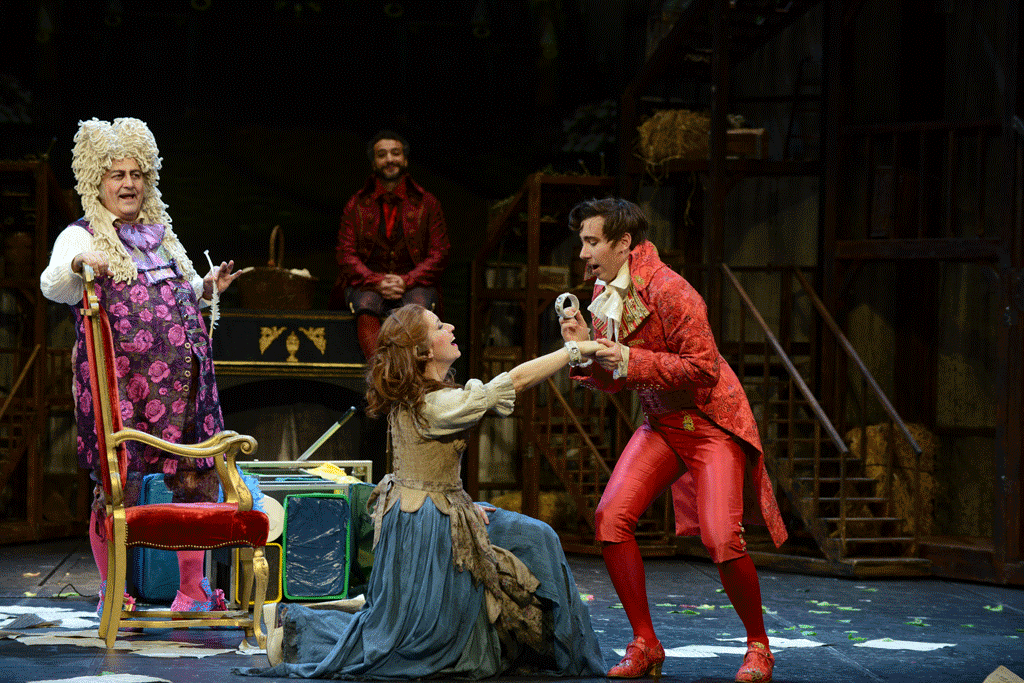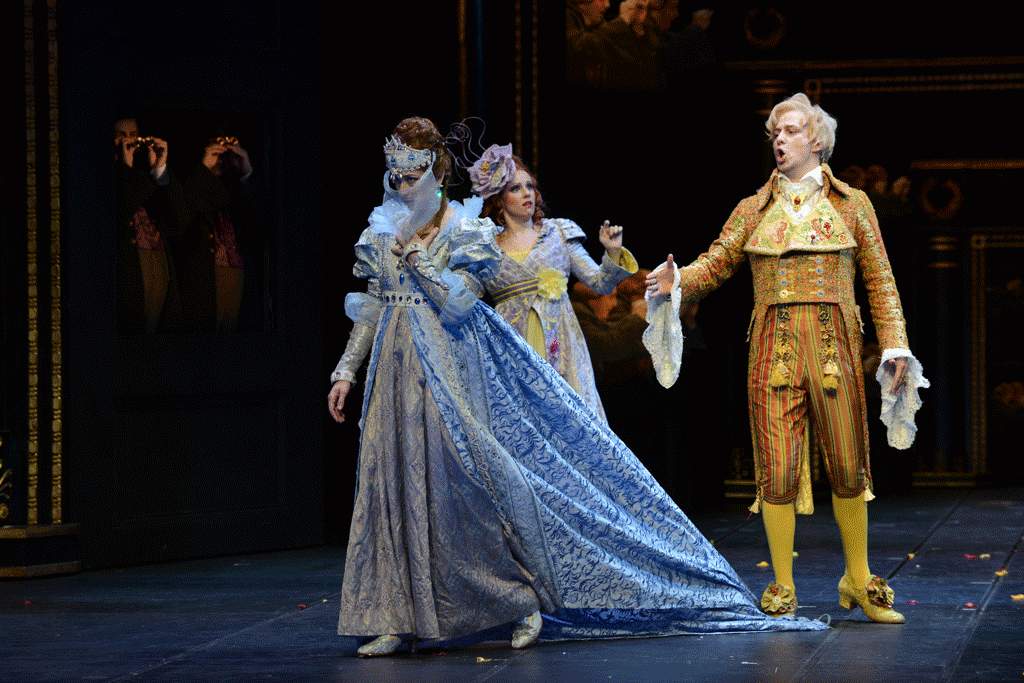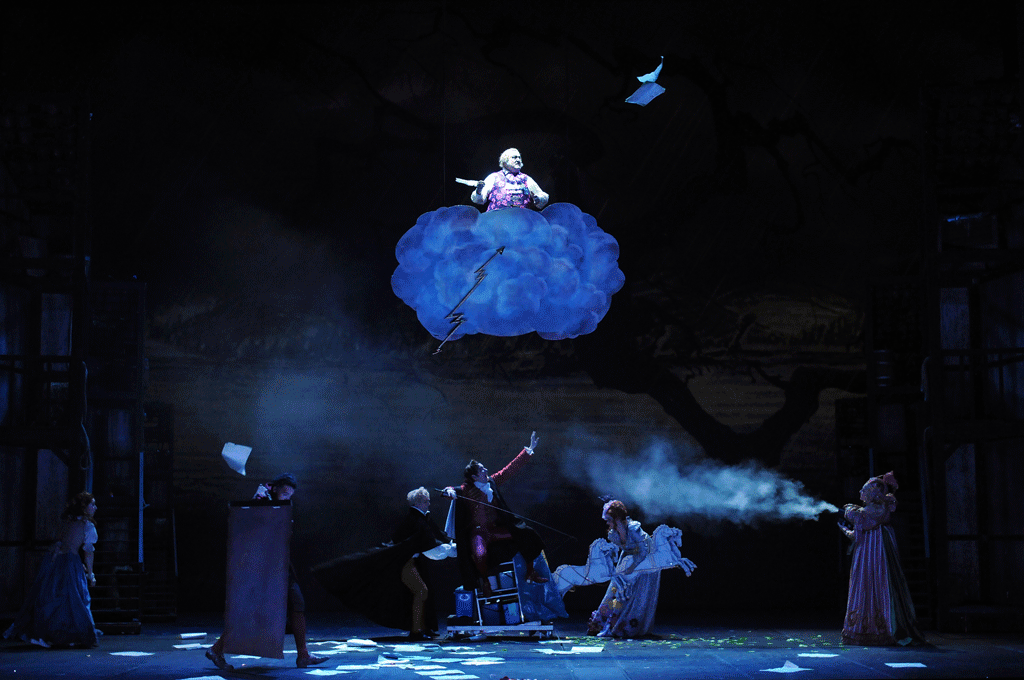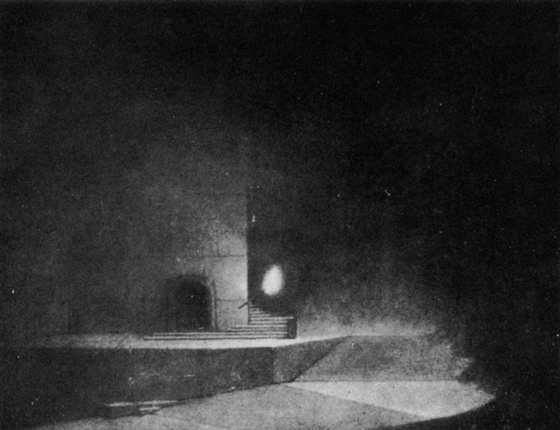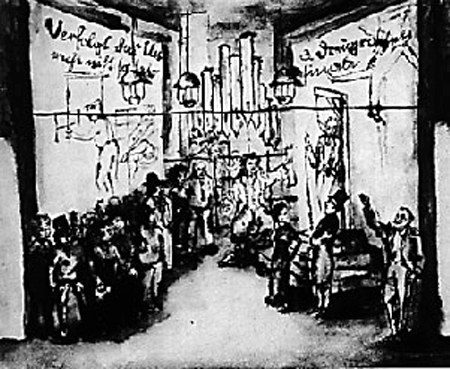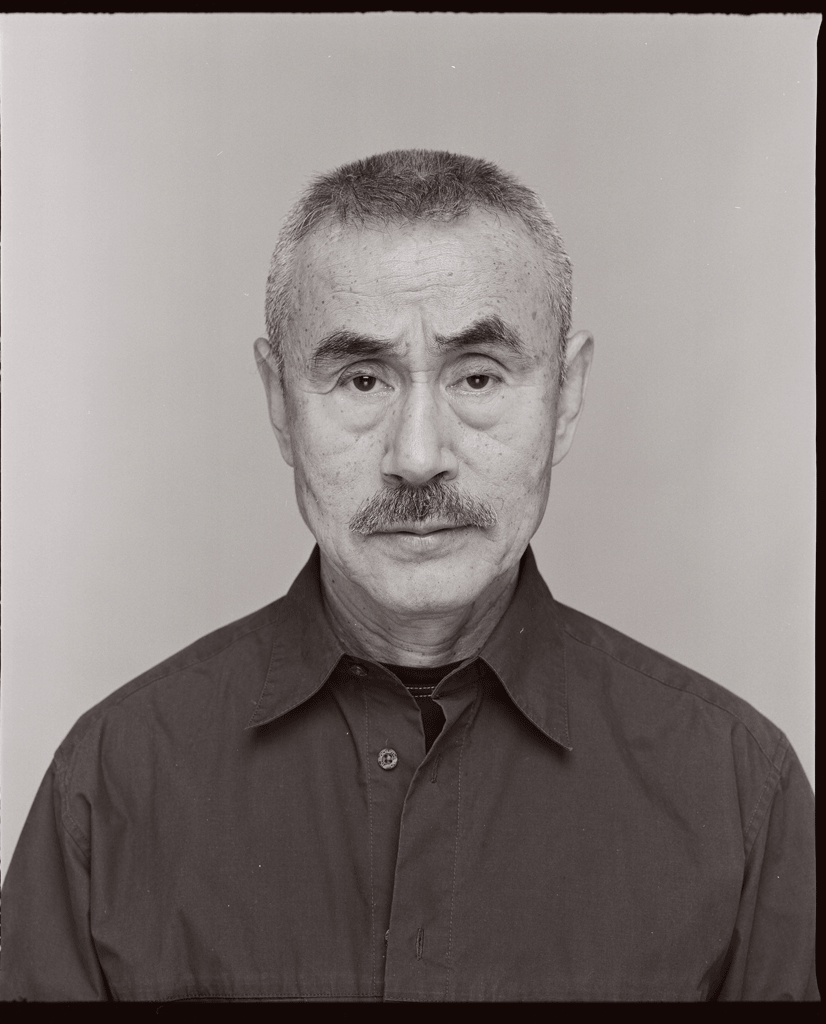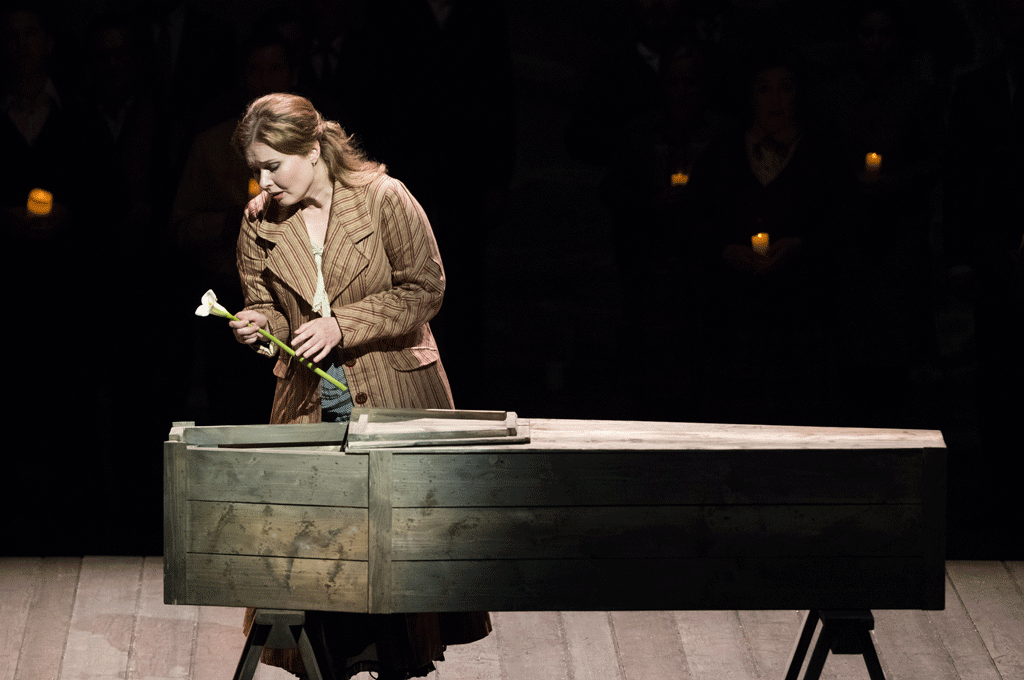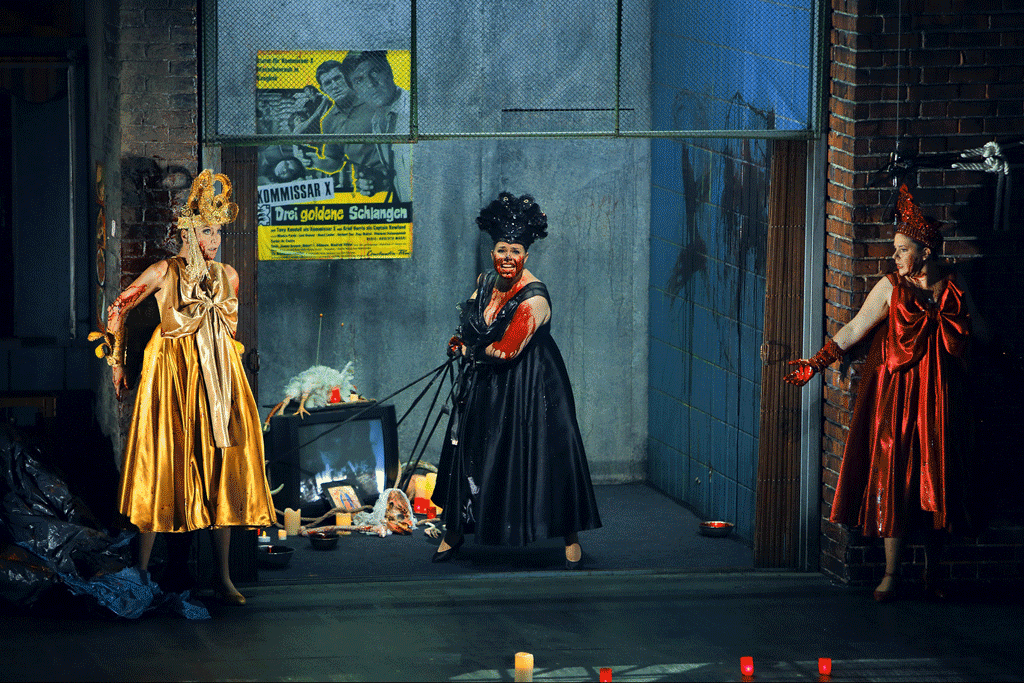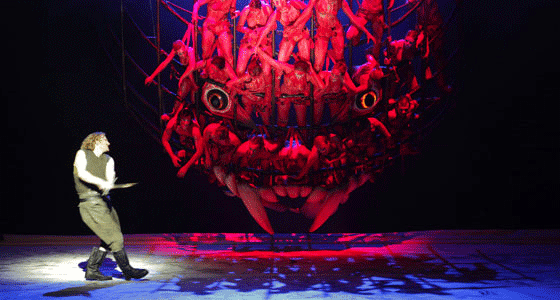Traditionnellement, la Scala est pratiquement le dernier des grands théâtres à annoncer sa saison, et cette année ne fait pas exception. Avant d’en découvrir le caractère, il est bon de rappeler le tissu de contradictions dans lequel ce théâtre est prisonnier, comme une proie dans une toile d’araignée, et les difficultés qui s’annoncent à la fin en 2020 du mandat d’Alexander Pereira, où le brouillard est encore plus épais. La seule forte probabilité est que le Sovrintendente sera italien, mais l’aventure turinoise où le lobby « Cinque Stelle » a nommé à peu près deux guignols est une alerte.
Traditionnellement, la Scala est pratiquement le dernier des grands théâtres à annoncer sa saison, et cette année ne fait pas exception. Avant d’en découvrir le caractère, il est bon de rappeler le tissu de contradictions dans lequel ce théâtre est prisonnier, comme une proie dans une toile d’araignée, et les difficultés qui s’annoncent à la fin en 2020 du mandat d’Alexander Pereira, où le brouillard est encore plus épais. La seule forte probabilité est que le Sovrintendente sera italien, mais l’aventure turinoise où le lobby « Cinque Stelle » a nommé à peu près deux guignols est une alerte.
Contrairement à Paris, la Scala construit son image depuis des décennies sur la tradition, sur une histoire, sur un répertoire. La tradition, c’est celle de grands spectacles formellement parfaits, où toute la maison montre l’excellence de ses personnels à tous niveaux, une histoire, c’est celle d’un théâtre qui est devenu peu à peu le phare des théâtres italiens, laissant derrière ses rivaux du XIXe, La Fenice de Venise et le San Carlo de Naples. Le rival aujourd’hui, c’est l’Opéra de Rome, bien plus récent, qui traverse une période plutôt fructueuse, mais dont l’histoire est faite de flux et reflux.
Les grands opéras italiens qui ont fait la gloire du lyrique de la fin du XXe, au-delà de la Scala, sont essentiellement Florence, avec un Mai musical qui fut un phare européen, et qui n’est plus grand chose aujourd’hui à cause d’une gestion désastreuse et d’une nouvelle salle mal conçue, ou Bologne qui fut toujours un théâtre important dans les années 1970 à 1990 et qui malgré la présence de Michele Mariotti, cherche à retrouver un rôle.
On a beaucoup reproché à Stéphane Lissner à Milan d’avoir fait une programmation plus européenne qu’italienne, et donc banalisé un théâtre à la forte identité, une institution devenue un des symboles de la nation, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Le concert du 11 mai 1946 dans la Scala reconstruite, dirigé par Arturo Toscanini, est l’emblème d’une reconstruction du pays, marqué par le retour de celui qui fut une des têtes de pont contre le fascisme. Toscanini, symbole de la Scala, est d’ailleurs souvent confondu et c’est une des premières contradictions de ce théâtre, avec un symbole de tradition. Or, Toscanini est celui qui a porté Wagner, Debussy, Moussorgski à la Scala, et même demandé à Adolphe Appia une mise en scène de Tristan und Isolde est un symbole de modernité et d’ouverture pendant la période où il a dirigé ce théâtre. Toscanini c’était l’ouverture et la modernité : à l’opposé de ce qu’est la Scala depuis 1986, année de départ de Claudio Abbado.
La contradiction de ce théâtre et le conflit dont il ne sort pas, c’est bien le conflit entre une certaine idée de la tradition et une certaine idée de la modernité. Le public italien est plutôt traditionnel en matière de mises en scène mais aussi souvent en matière musicale, bien que le théâtre ait une tradition de créations telle qu’il est le théâtre qui a vu le plus de créations depuis sa construction, et que cette tradition se poursuit, même si on crée et on ne reprend jamais, à de rares exceptions (cette saison…). Qui se souvient de Blimunda d’Azio Corghi ou Doktor Faustus de Giacomo Manzoni, voire plus récemment de CO2 de Giorgio Battistelli ?
La première de Wozzeck (dirigée par Dimitri Mitropoulos, avec Tito Gobbi) en 1952 fut huée par un public en furie pour son entrée à la Scala, 27 ans après la création berlinoise…Et encore aujourd’hui, Wozzeck ne fait jamais le plein alors que l’opéra a été plutôt bien servi au niveau des distributions et des chefs (Mitropoulos, Abbado, Sinopoli, Conlon, Gatti, Metzmacher), ce n’est qu’un exemple.
Il a donc été reproché à Lissner de ne pas avoir soigné le répertoire italien comme il a soigné le répertoire non-italien, et d’avoir fait appel à des metteurs en scène très contestés. Un symbole : La Traviata confiée à Dmitri Tcherniakov, un spectacle complexe, et intelligent, très contesté par le public et une critique pas très ouverte, est jeté aux oubliettes et à la place cette saison on va retrouver la production fade et sans idées de Liliana Cavani qui fit les beaux soirs du théâtre depuis 1990…car dans sa position, Alexander Pereira ne veut pas de vagues, et veut plutôt épouser l’air un peu poussiéreux qui règne à Milan. Quand Pereira est arrivé à Milan, il a affirmé un retour vers le répertoire italien, et c’est aussi le désir du directeur musical Riccardo Chailly que de proposer en inauguration des œuvres italiennes (Giovanna d’Arco, Madame Butterfly, Andrea Chénier, Turandot, et cette année Attila). Quand Strehler et Ronconi étaient vivants, aux temps d’Abbado, ce pouvait être aussi le cas, mais avec d’autres spectacles qui ont marqué les temps (Simon Boccanegra, Don Carlo) et l’on osait faire appel à des metteurs en scène qui montraient une certaine modernité : Lioubimov, Lavelli, Chéreau.
Que la Scala marque son identité culturelle en affichant encore aujourd’hui La Bohème de Zeffirelli ou l’Aida du même qui remontent à 1963 ne me choque pas en soi, mais que ce soit le bout du bout de la réflexion culturelle de ce théâtre me chagrine. Le seul directeur artistique marquant des trente dernières années a été Cesare Mazzonis, qui savait parfaitement allier tradition et ouverture, avec intelligence, finesse et curiosité. Tous les autres ont été bien médiocres et surtout n’ont rien su inventer.
Le résultat de cette absence de politique, c’est que la Scala est un nom, mais qu’aucun spectacle des vingt dernières années n’a fait référence dans le monde lyrique. Il fut un temps où les fans du lyrique se déplaçaient en masse à la Scala pour voir des spectacles, pour écouter les voix, pour des chefs. Aujourd’hui ce n’est plus vrai.
Pire encore, le public n’est plus au rendez-vous, d’excellentes productions comme Der Rosenkavalier dans la production Kupfer de Salzbourg (avec Zubin Mehta au pupitre), ou Die Meistersinger von Nürnberg du même (avec Gatti), venue de Zürich montrent des salles aux travées vides. Cette année, la belle Francesca da Rimini, pur répertoire italien, dirigée par l’excellent Fabio Luisi, n’était pas non plus très remplie (il restait 600 places à vendre la veille du jour où j’y suis allé, avec des places à 50% de réduction pourtant). Seul fait discuter le spectacle d’ouverture de saison, qui fait l’objet d’une campagne de presse exagérée et qui attire le public si la star est au rendez-vous. La politique tarifaire absurde, qui laisse l’accès aux clientèles riches de passage mais l’interdit aux autres qui se refusent avec raison à payer 300 Euros une place d’orchestre, l’absence de ligne artistique (le répertoire italien ne peut faire seul office de ligne), le trop grand nombre de productions pour un théâtre au public faussement international, voilà entre autres les questions à résoudre : le public de la Scala pour l’essentiel habite dans un rayon de 4 km autour du théâtre et a ses habitudes ancrées depuis des lustres fondées sur une douzaine de productions annuelles. Quand je suis arrivé à Milan, – j’étais chaque soir ou presque au théâtre – la saison lyrique allait de décembre à juillet, et la saison symphonique prenait le relais de septembre à novembre. Aujourd’hui la saison symphonique est diluée et réduite, grave erreur pour un théâtre comme la Scala, et la saison lyrique court de décembre à novembre de l’année suivante, mettant évidemment sous pression les forces du théâtre. Claudio Abbado – encore lui – ne dirigeait pas plus de deux ou trois productions, mais restait au contraire très présent pendant la saison symphonique, convaincu avec juste raison que c’est par le travail symphonique sur des répertoires peu explorés alors (Mahler !) que l’orchestre progressait.
Crise de public, crise artistique, directeur musical peu présent (Riccardo Chailly dirige peu, et seulement deux productions annuelles), perte d’aura artistique au profit d’une aura touristique où le selfie sur fond de dorures piermariniennes fait fureur au point que les malheureuses maschere (ouvreurs et ouvreuses) traversent la platea (l’orchestre) pour faire éteindre les mobiles toujours allumés comme des lucioles (ce qu’on voit bien lorsqu’on est assis en Galleria, en haut) voilà la Scala du jour…
Au milieu de ce tissu complexe et contradictoire, parce que le niveau technique des spectacles reste très haut, parce que les crises ne servent qu’à trouver des solutions (c’est dans les crises qu’on devient intelligent, c’est bien connu), parce que ce théâtre reste mon théâtre de cœur, celui qui m’a fait vibrer, pleurer et hurler, parce qu’on ne peut que tomber amoureux de la Scala, alors cela vaut le coup de passer en revue une saison qui ne fait pas partie des pires qu’on ait vues dans les dernières années.
Figure imposée de toute programmation scaligère – ce que Lissner avait refusé de voir peut-être- le répertoire italien doit occuper environ 50% des productions, le reste devant se partager entre répertoire français, allemand et russe pour l’essentiel, et une création qui est l’épine du pied puisqu’on sait à l’avance que les salles seront vides. On a pu aux temps d’Abbado investir dans des créations (voir les Stockhausen mis en scène par Ronconi, voir les Nono aussi qui en leur temps marquèrent la maison), aujourd’hui, vu la situation générale, il est difficile de tenir un discours de création.
Ouverture :
L’ouverture de la saison est le rendez-vous obligé : celui où toute la classe politique et économique de l’Italie se retrouve en une soirée où les prix décuplés rapportent au théâtre de quoi vivre. Et les médias s’en donnent à cœur joie pour faire croire au bon peuple que la Scala est le centre du monde. C’est la tradition et donc on n’a pas intérêt à rater cette entrée-là. Le titre choisi est souvent italien, même si sous Lissner (mais pas que…) on a pu voir Lohengrin, Fidelio, Idomeneo, Don Giovanni et que Boris Godunov, Parsifal, Lohengrin, Carmen ont aussi ouvert des saisons par le passé…
Sous Pereira, l’inauguration est symbole du bel paese (et avec le gouvernement qui se profile ce sera sans doute renforcé), et après Andrea Chénier l’an dernier, c’est au tour d’Attila de Verdi d’ouvrir la saison sous la direction de Riccardo Chailly.
Attila (Verdi) NP
Le titre est absent des programmes depuis 7 ans (2011), la dernière production (Lavia, Luisotti) est à oublier, la plus référentielle remonte à 1991, due à Riccardo Muti et Jérôme Savary, avec Ramey en majesté et l’œuvre n’en est qu’à sa quatrième présentation (affichée en 1974/75, en 1990/91, en 2010/2011) depuis la seconde guerre mondiale. Le jeune Verdi revient à la mode (on a quelques chanteurs pour ce répertoire) sans doute parce que le public a besoin de nouveautés qui sortent du répertoire standard.
Riccardo Chailly qui aime programmer des œuvres moins connues avait proposé Giovanna d’Arco une œuvre qui n’avait pas été jouée à la Scala depuis plus d’un siècle. C’est cette fois Attila qu’on a vu notamment au MET en 2010 et qui mérite sans conteste la présence au répertoire.
C’est Riccardo Chailly qui dirige et c’est une garantie car c’est un grand verdien, dans une mise en scène de Davide Livermore, un metteur en scène qui fait, disons, du classique intelligent, et qui s’entend avec Chailly avec qui il a fait Don Pasquale, et dont on a vu à Monte Carlo et en France (à Saint-Etienne) Adriana Lecouvreur.
La distribution comprend Ildar Abdrazakov, spécialiste du rôle, d’Attila, Simone Piazzola, un très bon baryton pour Ezio, le pâle Fabio Sartori pour Foresto, et une surprise pour le terrible rôle d’Odabella (où Cheryl Studer en 1991 avait chaviré), Saioa Hernandez, spécialiste des coloratures dramatique (Abigaille) qui émerge et que la France a entendue notamment dans la Francesca da Rimini strasbourgeoise dont David Verdier disait dans sa critique (Site Wanderer) «Saioa Hernández surmonte avec brio les difficultés d’une ligne de chant constamment sollicitée »
Inutile de tergiverser, cela vaudra sans doute le passage des Alpes. (9 représentations du 4 décembre 2018 (avant-première jeunes) au 8 janvier 2019.
La Traviata (Verdi)
Reprise de la production de Liliana Cavani, qui remonte à 1990 et qui a promené sa fadeur luxueuse pendant des décennies jusqu’à ce que Tcherniakov provoque le tollé dont on a parlé, essentiellement dû à un deuxième acte où Alfredo épluche des légumes. L’oignon ne sied pas à Alfredo, sinon pour pleurer. Indignation imbécile, parce qu’au contraire Tcherniakov montrait à travers cette scène le désir « d’ordinaire » du couple, et le refus total de la mondanité…
On reverra donc cette production hors d’âge, ennuyeuse et bien faite. Une production qui ne dit rien de l’œuvre, mais satisfait le bourgeois qui n’a pas à penser, mais seulement à regarder et pleurer. Médiocrité d’un calcul putassier de Pereira, qui veut remplir sa salle à tout prix.
La production sera dirigée par le directeur musical bis de la Scala, Myung-Whun Chung qui dirige à peu près tous les Verdi que le directeur musical en titre ne dirige pas avec une distribution faite pour attirer les foules :
Marina Rebeka (janv.fev) peu connue en Italie et Sonya Yoncheva (mars) qui en a fait un de ses rôles fétiches, Francesco Meli (en janv et mars) qui est LE ténor italien actuel et Benjamin Bernheim en février, qu’on a seulement vu dans le rôle du chanteur italien de Rosenkavalier à la Scala et qui, on le sait, est pour ce répertoire un remarquable artiste.
Quant à Germont, ce sera Leo Nucci en janv-fev et Placido Domingo en mars.
Yoncheva, Meli, Domingo en mars : cela fera courir et remplira les caisses, déjà bien gonflées par l’opération en janvier-février.
12 représentations en janv., fév., mars
Aucun intérêt pour ma part.
La Cenerentola (Rossini)
Autre opération tiroir-caisse, une reprise de la très fameuse production de Jean-Pierre Ponnelle qui remonte à 1973 (Ponnelle-Abbado) et qui fait parallèlement les beaux soirs de Munich.
Distribution dominée par l’Angelina de Marianne Crebassa, qu’on verra aussi à Paris et qui sans nul doute brillera, entourée de Maxim Mironov (très belle voix mais un peu pâle pour mon goût) Carlos Chausson un vétéran en Don Magnifico (il était déjà du Viaggio a Reims d’Abbado en 1984), l’excellent Nicola Alaimo en Dandini (alternant avec Mattia Olivieri) et Erwin Schrott (alternant avec Alessandro Spina en Alidoro (ce qui n’est pas forcément une bonne idée). À part Crebassa, Mironov et Alaimo cette distribution me laisse un peu perplexe. En revanche le choix d’Ottavio Dantone pour la direction musicale est pleinement convaincant. 11 représentations de février à avril.
La Khovantchina (Moussorgsky) (NP)
Valery Gergiev avait en 1998 dirigé une Khovantchina à la Scala, dans la production importée historique de Leonid Baratov (mort en 1964) qu’il mit en scène aussi bien au Bolchoï qu’au Mariinsky et qui était apparue au spectateur assez poussiéreuse. Il revient diriger l’œuvre à la Scala dans une production de Mario Martone. Mario Martone n’est un metteur en scène très inventif, mais au moins efficace. Le public ne sera pas secoué.
La distribution est solide, dominée par l’Ivan Khovansky de Mikhail Petrenko et la Marfa d’Ekaterina Sementchuk qui seront entourés de Sergei Skorokhodov (Andrei Khovansky), Evgeny Akimov (Golizin), Alexey Markov (Chaklovityi), tandis que Dosifei sera Stanislav Trofimov. Un cast de spécialistes, pour l’une des œuvres les plus émouvantes et saisissantes du répertoire d’opéra.
A voir évidemment, d’autant que l’œuvre est relativement rare sur les scènes.
7 représentations du 27 février au 29 mars.
Manon Lescaut (Puccini) NP
Retour au répertoire italien et à la présentation des œuvres complètes de Puccini voulue par Riccardo Chailly avec Manon Lescaut (1893), le premier très grand succès de Puccini, d’après l’Abbé Prévost. Il faudrait faire le compte des Manon Lescaut lyriques, chorégraphiques et cinématographiques et l’on serait étonné de la permanence de ce mythe littéraire qui a fleuri en Europe, citons pour faire vite à l’opéra Auber, Massenet (qui a même écrit une suite…), Puccini ou Henze.
La dernière production remonte à une vingtaine d’années, en 1998 dans une mise en scène de Liliana Cavani (moui…) dirigée par Riccardo Muti avec Maria Guleghina et José Cura, alors au faîte de leur gloire.
La production sera confiée à David Pountney (modernisme sans faire frémir) à qui l’on doit Francesca da Rimini cette saison et la distribution comprend Maria José Siri en Manon Lescaut, qui semble être une des voix favorites de cette maison depuis Butterfly et Francesca da Rimini, une voix effectivement solide, à laquelle je ne trouve pas grand caractère cependant…Son Des Grieux sera Marcelo Alvarez, qui fera sans doute son travail de ténor et Lescaut sera Massimo Cavalletti. Pour ma part, ni Siri, ni Alvarez ne sont des stimulants à passer les Alpes. Le seul véritable atout est Riccardo Chailly…
9 représentations du 31 mars au 27 avril.
Ariadne auf Naxos (R.Strauss) NP
Opéra relativement rare à la Scala (dernières productions celle de 1984 venue de Munich dirigée par Wolfgang Sawallisch au temps où l’échange entre les deux théâtres était riche et celle dirigée par Giuseppe Sinopoli en 2000 dans une mise en scène de Luca Ronconi, reprise en 2006 par Jeffrey Tate) Ariadne auf Naxos revient dans une production de Frederic Wake-Walker, à qui l’on doit la production des Nozze di Figaro très discutée de 2016, qui succédait à 35 ans de règne incontesté de Strehler – dur dur -. Peut-être la fantaisie de l’œuvre de Strauss et son côté théâtre dans le théâtre lui conviendront-ils mieux. Alexander Pereira se fait doublement plaisir : il appelle pour ce Strauss l’un de ses chefs favoris, Franz Welser-Möst, un très bon technicien, très précis, très rassurant pour les musiciens, mais qui manque souvent de poésie et quelquefois de sensibilité. La distribution est dominée pour l’essentiel des représentations par Krassimira Stoyanova, qui illuminait le Rosenkavalier Salzbourgeois avec le même Welser-Möst et la Zerbinetta de Sabine Devieilhe (avril-mai), le compositeur qui sera sans nul doute magnifique de Daniela Sindram et le Bacchus de Michael König. Comme beaucoup de productions cette année, les dates s’étirent entre plusieurs mois (cette fois-ci d’avril à juin), et les deux représentations de juin seront interprétées par Tamara Wilson (Primadonna) et Brenda Rae (Zerbinetta) tandis qu’on trouve dans la distribution d’autres noms dignes d’intérêt, Markus Werba, Kresmir Spicer, Tobias Kehrer .
À propos, j’ai écrit plus haut que Pereira se faisait doublement plaisir parce qu’il s’est aussi réservé le rôle du Haushofmeister (!).
8 représentations du 23 avril au 22 juin.
Idomeneo (Mozart) NP
La dernière production d’Idomeneo à la Scala est celle de Luc Bondy, réalisée en un temps record pour l’inauguration 2005, la première de Stéphane Lissner. Elle a été reprise une fois en 2008-2009 dirigée par Muyng-Whun Chung.
Alexander Pereira appelle cette fois Christoph von Dohnanyi, le vétéran et c’est la principale attraction de cette production confiée à Matthias Hartmann, l’ancien directeur du Burgtheater de Vienne jusqu’en 2014. Une distribution solide, sans vraie star, avec dans le rôle-titre l’excellent Bernard Richter, l’Elektra de Federica Lombardi, l’Idamante de Michèle Losier et l’Ilia de Julia Kleiter ainsi que le grand prêtre de Kresimir Spicer.
8 représentations du 16 mai au 5 juin 2019
Die Tote Stadt (Korngold) NP
C’est la première production à la Scala de Die Tote Stadt, de Erich Wolfgang Korngold qui entre ainsi au répertoire de la Scala et c’est une très bonne nouvelle. La distribution en est excellente, dominé par Klaus Florian Vogt et Asmik Grigorian (la Marie du Wozzeck salzbourgeois la saison dernière qui avait tant frappé), complétée par Markus Werba et Kismara Pessatti.
La production est confiée à Graham Vick, un metteur en scène classiquement moderne qui plaît beaucoup dans la péninsule, et la direction musicale à un chef encore peu connu en Europe qui après une carrière américaine notamment au New York Philharmonic s’installe solidement sur le vieux continent (à Hambourg notamment), Alan Gilbert qui a fait ses débuts à la Scala en 2016 dans Porgy and Bess à la place de Nikolaus Harnoncourt, revient cette fois invité “ès qualités”. Une œuvre inconnue du public, c’est excellent pour débuter et ça évite les comparaisons. Connaissant le manque de curiosité du public de Milan, le remplissage de la salle n’est pas garanti.
7 représentations du 28 mai au 17 juin 2019.
I Masnadieri (NP)
La «jeune Verdi » Renaissance continue, après l’Attila d’ouverture voici l’encore plus rare I Masnadieri d’après Die Räuber de Schiller, qu’on vient de voir à Monte Carlo (voir l’article de Wanderer) et dans la même saison à Rome (voir l’article de Wanderer). Le rendez-vous scaligère est confié à David Mc Vicar, autre classiquement moderne aimé en Italie, mais surtout à la baguette du spécialiste de ce répertoire, Michele Mariotti, c’est là tout l’intérêt de l’opération parce que du côté distribution, à part le Massimiliano de Michele Pertusi, c’est un peu maigre, Carlo est confié à Fabio Sartori, et Francesco sera Massimiliano Cavaletti et pas d’Amalia annoncée…on pourrait espérer l’arrivée à la Scala d’Angela Meade…mais c’est peut-être trop demander.
Pour moi, c’est une opération « à moitié »…
7 représentations du 18 juin au 7 juillet 2019
Prima la musica poi le parole/ Gianni Schicchi (NP)
Étrange couple, inattendu que de mettre ensemble Salieri et Puccini, mais au fond pourquoi pas? Tout est possible dans le monde de l’opéra.
La pochade de Salieri entre à la Scala dans une mise en scène de Nicola Raab à qui l’on doit la récente Francesca da Rimini de Strasbourg et dont le nom commence à tourner d’Helsinki à Valence en passant par Saint-Etienne, avec Ambrogio Maestri et sous la direction de l’excellent Adam Fischer.
Complète la soirée Gianni Schicchi représenté dans le cadre du Trittico (Chailly Ronconi) il y a exactement dix ans. Alexander Pereira pour avoir un nom à donner au public fait venir la production de Los Angeles signée…Woody Allen. C’est toujours Adam Fischer qui dirige (on connaît peu son Puccini), et c’est toujours Maestri qui est Schicchi (comme à Munich et un peu partout). Il sera entouré des jeunes de l’Académie de la Scala et ce sera pour eux un excellent exercice, avec un très bon chef.
6 représentations du 6 au 19 juillet.
Rigoletto (Verdi)
Pour la nième fois revient à la Scala Rigoletto dans la mise en scène de Gilbert Deflo, dont le seul intérêt est que ne dérangeant personne, elle dure aussi longtemps qu’elle peut. Créée en 1994 avec Muti, Alagna, Bruson et Andrea Rost , elle a été régulièrement reprise, avec Nucci depuis 2001. C’est encore Leo Nucci qui officiera au milieu des jeunes solistes de l’académie et sous la direction d’un autre vétéran, Nello Santi, très apprécié par Alexander Pereira.
Une série tiroir-caisse, pour 9 représentations du 2 au 22 septembre 2019
L’elisir d’amore (Donizetti)
Même fonction de tiroir-caisse pour cette production de Grischa Asagaroff importée dans les bagages de Alexander Pereira en 2015. L’œuvre de Donizetti bénéficie d’une distribution très honnête, Rosa Feola dans Adina, René Barbera dans Nemorino alternant en octobre avec Vittorio Grigolo, avec Massimo Cavalletti dans Belcore (on le voit si souvent cette saison qu’il a dû signer un contrat de troupe !) et Ambrogio Maestri dans Dulcamara, qu’on voit aussi sur toutes les scènes dans le rôle.
10 repr. Entre le 10 septembre et le 10 octobre 2019
Quartett (Francesconi)
Miracle à Milan : la reprise (!!!) d’une création mondiale de 2011 (alors dirigée par Susanna Mälkki), Quartett, d’après Heiner Müller (et Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos) avec les mêmes chanteurs, Allison Cook et Robin Adams. C’est le jeune et talentueux Maxime Pascal qui sera au pupitre dans la mise en scène de la Fura dels Baus (Alex Ollé). Ça vaut sans doute le déplacement…
6 représentations du 5 au 22 octobre
Giulio Cesare (Haendel) NP
L’événement est d’importance, Cecilia Bartoli qui désormais n’a plus rien à perdre, affronte le public de la Scala à nouveau après bien des années d’absence. Les imbéciles de service, bien connus des habitués l’ont huée violemment la dernière fois qu’elle apparut pour un gala. Ces imbéciles, jamais satisfaits et toujours grognons, combattent soi-disant au nom de l’art du chant et se prennent pour Zorro, à la différence qu’ils ne sauvent rien et gâchent la vie des spectateurs par leurs huées injustifiées (ils ont osé huer Mariotti dans Orphée cette année).
Il y a fort à parier qu’ils seront là, parce qu’ils vouent à la Bartoli une solide inimitié.
Ainsi donc c’est Giulio Cesare qui a été choisi, dans une nouvelle production de Robert Carsen et dirigée par Giovanni Antonini à la tête des forces de la Scala. La grande Cecilia a soigné son retour en Cleopatra et sera entourée d’une distribution étincelante : Bejun Mehta en Giulio Cesare, Sara Mingardo en Cornelia, Philippe Jaroussky en Sesto Pompeo pendant que Christophe Dumaux sera Tolomeo et Christian Senn Achilla.
À ne pas manquer, pour 7 représentations du 18 octobre au 5 novembre.
Die Ägyptische Helena (R.Strauss) NP
Faut-il une production en novembre alors que toute la maison a les yeux rivés sur la Prima du 7 décembre, et que répétitions et préparation nuisent peut-être à la sérénité des artistes. C’est pourtant le choix qui a été fait de jouer jusqu’à fin novembre la dernière série de représentations.
Cette année, c’est une nouveauté, une entrée au répertoire encore une fois, d’un opéra de Richard Strauss peu connu, die Ägyptische Helena, dans une production à l’odeur salzbourgeoise en diable, signée Sven-Eric Bechtolf dans des décors de Julian Crouch et dirigée par Franz Welser-Möst, deux fois invité cette saison..
Au-delà du metteur en scène médiocre, un classiquement moderne version autrichienne, qui était le directeur du Festival de Salzbourg-Théâtre au temps de Pereira, l’œuvre mérite évidemment le détour et il est heureux de la voir à la Scala, dans un pur effet Pereira…
La distribution est plutôt séduisante et réunit Ricarda Merbeth, Andreas Schager, Eva Mei, Thomas Hampson et Attilio Glaser.
Vaudra sans doute le détour, pour 7 représentations entre le 9 et le 29 novembre.
—
Faisons nos comptes : Donizetti (1), Francesconi (1), Haendel (1), Korngold (1), Moussorgski (1), Mozart (1), Puccini (2), Rossini (1), Salieri (1) Strauss (2), Verdi (4)
Sur 16 titres, 10 sont de compositeurs italiens dont une reprise d’opéra contemporain, 11 sont des nouvelles productions dont 3 entrent cette année au répertoire. C’est un ensemble bien équilibré.
Du point de vue des chefs, on note outre Chailly, Welser-Möst, Mariotti, Von Dohnanyi, Gergiev, Gilbert, c’est la force de la Scala d’avoir toujours su attirer des chefs d’envergure, à la différence de Paris dont la politique en matière de chefs est « hors Jordan, point de salut ».
Les distributions gagneraient à être plus inventives et plus stimulantes, mais certaines œuvres sont très bien servies.
Au total, la saison, qui affiche quelques œuvres rares semble plus intéressante que les années précédentes. On pourra aller plusieurs fois à la Scala la saison prochaine.